
À l’heure où Bayer rachète Monsanto, à l’heure où 3 millions de décès par an sont dus à la pollution atmosphérique, à l’heure où les articles, reportages et enquêtes se multiplient sur la mauvaise qualité d’une grande quantité d’aliments que l’on ingère quasi quotidiennement, à l’heure où les scandales autour des cosmétiques, bourrés de perturbateurs endocriniens, pleuvent, que faire ?
Tirer la sonnette d’alarme pour annoncer une catastrophe écologique ? Pour prévenir des problèmes de santé publique ? C’est fait. C’est en train de se faire. La prise de conscience est lente, les mentalités difficiles à changer, les modes de consommation complexes à modifier.
Sans se revendiquer militantes ou activistes du bio, les femmes rencontrées ce mois-ci ne baissent pas les bras et s’engagent dans une filière correspondant à leur mode de pensées et d’actions. Vers un environnement respectueux de la nature, du territoire et de soi.
La filière du bio s’apprête à battre son record de croissance d’ici la fin de l’année 2016. Selon les estimations de l’Agence BIO, le marché devrait rapporter 6,9 milliards d’euros en France. Une augmentation significative (1 milliard supplémentaire par rapport à 2015) qui confirme l’envol du secteur qui ne cesse d’attirer et de fidéliser un grand nombre de consommatrices et de consommateurs. Dans l’Hexagone, seul 11% de la population ne consommerait pas encore - d’aucune façon – des produits issus de l’agriculture biologique.
 Le dernier Baromètre Agence BIO / CSA, réalisé en 2015, montre que 9 français-es sur 10 consomment bio. Occasionnellement, en tout cas. Contre environ 5 français-es sur 10 en 2003. L’étude révèle également que 65% en consomment régulièrement – au moins une fois par mois – soit 28% de plus qu’il y a 13 ans.
Le dernier Baromètre Agence BIO / CSA, réalisé en 2015, montre que 9 français-es sur 10 consomment bio. Occasionnellement, en tout cas. Contre environ 5 français-es sur 10 en 2003. L’étude révèle également que 65% en consomment régulièrement – au moins une fois par mois – soit 28% de plus qu’il y a 13 ans.
Les magasins spécialisés se multiplient, la grande distribution s’embarque dans l’aventure en y dédiant plusieurs rayons plus par peur de perdre ses client-e-s que par éthique et les producteurs-trices s’engagent de plus en plus vers la filière bio. Ainsi, en juin 2016, la France comptait 31 880 producteurs-trices (plus de 2 000 sont en Bretagne, plaçant la région en 6e position sur 14) avec l’installation de 21 nouvelles fermes bio par jour au cours des six premiers mois de l’année. Et recensait au total 46 218 entreprises bio sur le territoire.
Le phénomène n’est pas récent, les premières boutiques bio datant du milieu du XXe siècle. Mais les comportements sont lents et difficiles à changer. Qu’est-ce qui précipite soudainement ces bouleversements ? Les raisons pour douter des produits vendus dans le commerce ne manquent pas.
Les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie, la règlementation en terme d’abattage des animaux ne sont quasiment respectées, les conditions d’élevage des volailles font froid dans le dos, manger 5 fruits et légumes gorgés de pesticides et d’engrais n’atteint pas vraiment l’objectif d’une alimentation saine, les composants des cosmétiques plein de perturbateurs endocriniens sont pour certains nocifs pour la santé, les produits d’entretien remplis d’éléments chimiques…
LA PRISE DE CONSCIENCE
À la télé, à la radio, dans les journaux, articles, enquêtes, reportages et documentaires sont accablants et unanimes : il y a urgence. Urgence en matière de santé publique mais aussi en matière d’environnement. Ce sont là les deux motivations principales des consommatrices-teurs bio, qui sont pour la plupart des femmes. Pourquoi ?Certainement parce que ce sont encore les femmes majoritairement qui sont chargées des courses, de l’alimentation du foyer et des tâches ménagères. Certainement parce que ce sont les femmes qui consomment le plus de cosmétiques.
Ou encore parce que ce sont les femmes qui font l’objet d’un marketing ardu et disposent – puisqu’elles sont identifiées comme responsables des achats, mais les hommes commencent aussi à être de plus en plus visés et assiégés par la consommation à outrance - d’un large choix de produits, plus toxiques les uns que les autres (dissolvant, couleurs de cheveux, vernis, déodorant, gels douche, shampooings…).
Si les étiquettes pleuvent aujourd’hui pour signaler l’absence de paraben, d’aluminium, de parfum de synthèse, d’OGM ou garantir l’élevage en plein air, etc., la confiance est brisée. Ras-le-bol de ne pas savoir précisément d’où vient le produit que l’on achète et ingère. Le respect des client-e-s doit primer, tout comme le respect de la planète et les valeurs portées par les producteurs-trices de l’agriculture biologique.
Tout en maintenant une forme de vigilance vis-à-vis de la mention bio, que les grandes marques souhaitent coller partout sans véritable gage ni caution d’une véritable origine naturelle. Les modes de consommation évoluent et glissent doucement vers un « mieux consommé ». Les questions ont besoin d’être posées quant à la composition d’un produit et le rapport de proximité devient vite une nécessité. On s’intéresse alors aux circuits courts, on prête attention à l’origine du produit, à la saison d’un fruit ou d’un légume, du territoire et de ses richesses végétales, animales, etc. Comme avant.
Si ce n’est qu’avant, il en allait d’une évidence. Le capitalisme et le consumérisme n’étant pas encore passés par là. Aujourd’hui, « y a plus de saison ! » Une phrase qui résume bien les attentes et les réflexes. On doit pouvoir trouver de tout, tout le temps, partout. Sur les étals des marchés et des hypermarchés, les mêmes fruits et légumes viennent de partout, à l’année. Les saisons évoluent - à qui la faute ?! - mais notre capacité d’adaptation, elle, semble figée.
Les chiffres croissants de la filière bio démontrent que la dernière partie de cette affirmation est erronée. L’adaptation est lente, mais pas figée. C’est le discours que tou-te-s les acteurs-trices du secteur assènent au cours des interviews ou des événements, de plus en plus nombreux, autour du bio.
En septembre, le réseau Scarabée Biocoop organisait la 2e édition du Scarabio Festival à Rennes, en octobre (les 8 et 9), c’est au tour du salon Ille & Bio de s’installer à Guichen pour fêter ses 25 ans et en novembre, démarrent à Paris les 9e Assises nationales de la Bio pour réunir les membres du secteur, les nouveaux-velles porteurs-teuses de projets ainsi que les financeurs, et on en passe.
 Des marchés bio fleurissent, comme tel est le cas le mercredi après-midi dans la capitale bretonne, au début du mail François Mitterand, les restaurateurs-trices optent désormais pour la démocratisation du bio dans les assiettes et les parents d’élèves réclament que cela en soi ainsi dans les cantines scolaires.
Des marchés bio fleurissent, comme tel est le cas le mercredi après-midi dans la capitale bretonne, au début du mail François Mitterand, les restaurateurs-trices optent désormais pour la démocratisation du bio dans les assiettes et les parents d’élèves réclament que cela en soi ainsi dans les cantines scolaires.
Là encore, la machine est difficile à huiler mais elle est en marche. Les enfants devenant un public important à sensibiliser.
UN ENGAGEMENT PERSO ET PRO
C’est en partie parce qu’elles sont devenues mamans qu’elles se sont intéressées aux plantes, aux huiles essentielles et à leurs vertus. Depuis octobre 2010, Delphine Ferrari commercialise ses savons, qu’elle fabrique de manière artisanale dans son atelier à Laillé. Cinq ans plus tard, le même mois, Emilie Briot lance son entreprise, Cosmétiques en cuisine, devenant animatrice en cosmétiques et produits d’entretien bio et proposant des ateliers à domicile ou à son local, à Gévezé.
Toutes les deux partagent un point commun. Avant de lancer la savonnerie La Dryade, cela faisait plus de 4 ans que Delphine avait commencé à créer ses propres produits. « J’avais une peau particulière et c’était dur de trouver un savon efficace dans le commerce. J’ai fait alors mes cosmétiques avec des produits naturels, pas forcément en bio. C’était d’abord un loisir créatif. », explique-t-elle.
À ce moment-là, elle est juriste, responsable formation en ressources humaines. Elle tombe dans « la savonite aigue », comme elle le dit en plaisantant. Elle aime assembler les composants, découvrir leurs effets et apprécier leurs qualités hygiéniques, réparatrices et protectrices. La jeune femme, alors âgée d’une trentaine d’années à peine, met en place une procédure rigoureuse pour limiter les dangers liés à la manipulation de la soude caustique (le produit liant qui permet aux huiles de se transformer en savon).
« On a déménagé en Bretagne, mon fils était déjà né et en arrivant ici, je ne voulais pas poursuivre mon métier. Je me posais des questions quant à la nourriture et aux soins pour un enfant et je voulais vivre responsable. Puis je me suis intéressée à la question du « consommer local » et sain. »
poursuit-elle.
Emilie Briot est venue elle aussi au bio par l’entrée personnelle, tout d’abord. Pour ses enfants, puis pour sa famille plus largement. Après avoir utilisé des huiles essentielles pendant plusieurs années, elle se forme aromathérapie familiale, commence à tester et fabriquer ses propres produits cosmétiques et ménagers. Assistante commerciale à l’époque, elle entame une reconversion professionnelle et repart en formation pour cette fois pouvoir animer des ateliers.
« Aujourd’hui, les gens s’alarment davantage et s’inquiètent de ce qu’ils mangent et de ce qu’ils se mettent sur la peau, de ce qu’ils mettent sur la peau de leurs enfants. Ils viennent dans les ateliers pour le côté « C’est sympa de fabriquer son produit ». Et c’est vrai, mais le but est aussi de parler des produits naturels. J’en parle beaucoup avec les enfants car j’interviens 3 jours par semaine dans les écoles, sur le temps périscolaire. », précise Emilie, 36 ans.
D’un métier prenant à un autre, les deux professionnelles affichent pourtant un soulagement et une autre manière d’envisager le travail. Une manière de penser qui relève de l’ordre de la passion et de l’engagement et moins du labeur contraignant. Comme si elles avaient été replacées au centre de leur vie professionnelle.
LE BIO, UNE ÉVIDENCE
C’est ce qu’évoque Sophie Persehais, agricultrice en plantes aromatiques et médicinales, implantée à Baulon. Cheffe de l’exploitation Le champ de l’air depuis 2009, elle a adhéré à l’agriculture biodynamique il y a 3 ans.
 « C’est un courant agricole que l’on ne peut pas résumer en 3 phrases dans un article mais en gros il place l’agriculteur au cœur d’un système agricole vu comme un organisme vivant. On travaille avec tous les éléments, comme la lune par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails mais ce qui est important, c’est que c’est une agriculture qui repose beaucoup sur l’observation. On prend le temps de faire, on prend le temps de se poser et de regarder nos plantes. Et ça définit le boulot qu’on a car on voit des choses que l’on n’aurait pas vu dans l’urgence. », analyse Sophie.
« C’est un courant agricole que l’on ne peut pas résumer en 3 phrases dans un article mais en gros il place l’agriculteur au cœur d’un système agricole vu comme un organisme vivant. On travaille avec tous les éléments, comme la lune par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails mais ce qui est important, c’est que c’est une agriculture qui repose beaucoup sur l’observation. On prend le temps de faire, on prend le temps de se poser et de regarder nos plantes. Et ça définit le boulot qu’on a car on voit des choses que l’on n’aurait pas vu dans l’urgence. », analyse Sophie.
Pour elle, le bio était une évidence lors de son lancement. Ses parents travaillent en agriculture conventionnelle et possèdent les valeurs agricoles, les valeurs de la terre et du respect de l’environnement. Elles sont trois sœurs mais elle est la seule à vouloir reprendre des parcelles agricoles. « Une volonté politique de conserver les petites exploitations. », surenchérit-elle.
Pourtant, elle exercera dans un premier temps la profession de professeure en communication avant de se former dans le domaine de l’agriculture et d’enseigner la biologie végétale er l’agronomie :
« J’adore la biologie ! J’ai vite pu constater les effets de synthèse, des éléments chimiques et autres. Je voulais revenir sur les terres familiales, travailler en micro-ferme, être tout le temps dehors dans mon champ. C’était logique pour moi d’aller vers le bio, je ne me suis pas posée la question. »
Même discours du côté de la créatrice de jardins biologiques et écologiques Pauline Beunaiche. Elle étudie les Arts appliqués au lycée, en Mayenne, et le design aux Beaux-Arts de Rennes. Son intérêt pour la conception de l’espace l’oriente vers les jardins et vers son premier coup de cœur pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire, qui organise chaque année le Festival international des jardins auquel elle participe avec d’autres étudiant-e-s des Beaux-Arts.
« Nous n’avons pas gagné mais j’ai découvert quelque chose de très riche. Le jardin est un espace de liberté et de création, je ne l’avais jamais pensé comme ça. Pourtant, je suis issue de la campagne, mes parents et mes grands-parents jardinent… », se souvient-elle.
Pauline se lance alors dans un BTS en aménagement paysager, effectue plusieurs stages auprès de différents paysagistes et part 6 mois vivre à Berlin et travailler dans un bureau d’études dont la démarche artistique influencera particulièrement la jeune créatrice, de retour en France il y a 6 ans, qui s’établit à son compte en fondant La Racinais.
« Je ne me suis jamais dit que j’allais faire du bio, j’ai juste fait comme ça, naturellement. La plupart des paysagistes agissent de cette façon. »
souligne-t-elle.
UNE SENSIBILITÉ AU SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
Toutes les quatre agissent à leur échelle, selon leurs savoir-faire. Des savoir-faire qui s’acquièrent au fil du temps, sur le terrain. La fabrication des cosmétiques répond évidemment à une réglementation quant au procédé, à la recette et aux ingrédients pour l’obtention d’une certification bio.
La saponification à froid demande un respect minutieux des consignes, du dosage et des températures. Le séchage des plantes aromatiques requiert l’absence de lumière. Et la création des jardins exige des compétences en terme de conception de plans, par exemple. Mais chacune se forme essentiellement dans la pratique. Une pratique artisanale et manuelle. Sans oublier, par conséquent, très physique.
Par les tests qu’elles effectuent, les ratés qu’elles ont déjà essuyé de nombreuses fois, le soin qu’elles mettent dans le quotidien et par la curiosité qu’elles accordent à leurs domaines. C’est en échangeant avec les collègues, en se documentant, en posant des questions aux herboristes, aux pharmacien-ne-s, en lisant et en prêtant attention aux retours des client-e-s qu’elles apprennent, se renouvellent, se perfectionnent. Et qu’elles se différencient, avec une signature propre.
 Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se lancent dans la filière. Il n’y a qu’à voir les chiffres. La conversion des éleveurs de vaches laitières est fluctuante et un développement de l’ordre de 30% est attendu d’ici 2018 dans le secteur du lait bio.
Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se lancent dans la filière. Il n’y a qu’à voir les chiffres. La conversion des éleveurs de vaches laitières est fluctuante et un développement de l’ordre de 30% est attendu d’ici 2018 dans le secteur du lait bio.
Plusieurs centaines de domaines viticoles s’engagent également depuis le début de l’année et les ventes de vin bio enregistrent une hausse de 10% sur le premier semestre, du côté des grandes surfaces.
Delphine Ferrari et Sophie Persehais le confirment, toutes deux installées dans des domaines peu développés jusqu’il y a peu. « Quand j’ai fait mon premier marché en 2010 à Cesson-Sévigné, les gens découvraient la saponification à froid. Je devais expliquer à chaque fois le procédé. J’étais quasiment la seule savonnière sur le territoire. Peut-être que La Cancalaise existait déjà… Mais on a dû faire beaucoup de pédagogie, et ça fait aussi partie de notre objectif d’expliquer l’intérêt de ce procédé (qui conserve la glycérine, permettant de protéger la peau, partie souvent retirée des savons industriels, ndlr). Maintenant c’est le boom ! Tout le monde s’installe. Sept savonneries se sont créées à Rennes et aux environs. Il faut beaucoup de temps et de pratique pour établir une formule qui fonctionne. Moi je me suis laissée le temps. », signale Delphine.
Pour Sophie, même son de cloches : « Quand je me suis installée, j’étais une des premières fermes en plantes médicinales. Il y avait peu de producteurs en Bretagne. Maintenant on est une cinquantaine en France, dont 5 en Ille-et-Vilaine. Depuis 10 ans, ça intéresse plein de gens ! »
LES CIRCUITS COURTS ET LOCAUX
Une obligation, désormais ? Presque. C’est en tout cas une nouvelle attente, un nouveau besoin réclamé par les consommateurs-trices. Pour le bien-être personnel, pour l’environnement. Mais aussi pour la production territoriale. Savoir ce que l’on mange, savoir ce que l’on consomme dans l’assiette, dans les crèmes, dans les verres ou dans les produits ménagers, c’est aussi savoir à qui on les achète.
Comme les AMAP permettent d’assurer un revenu plus juste à la personne qui produit ce qu’elle met dans les paniers, on tend aujourd’hui à se tourner vers les regroupements de producteurs-trices, pour plus de visibilité et de proximité. Delphine Ferrari tient particulièrement à ce que ces matières premières soient issues de l’agriculture biologique et tant que possible proviennent du coin pour fabriquer ces savons sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant, ni parfum de synthèse, sans huile minérale ou animale.
« Je tiens vraiment à travailler cette solidarité en impliquant les acteurs locaux dans ma démarche. En arrivant ici, j’ai vu tout le tissu bio qui existait et il est vraiment très riche. Ce qui est intéressant, c’est que je me servais par exemple de l’huile de colza, de l’huile de chanvre, du miel, que j’achète dans un périmètre proche de chez moi, pour l’alimentaire. Et je m’en sers pour les savons. C’est aussi une manière de faire découvrir des produits du quotidien utilisés différemment et qui sont faits ici, chez nous. Pour les matières premières qui viennent de loin, j’essaye de limiter et de faire en sorte qu’au moins, elles soient issues du commerce équitable. Je sous-traite également l’emballage des savons, une fois qu’ils ont séché (une pièce est dédiée au séchage après la coupe, ndlr). Toutes les semaines, je les amène à l’ESAT de Bruz qui rassemblent des travailleurs handicapés. », s’enthousiasme-t-elle.
Et fan de légendes celtiques, elle marque son attachement au territoire dans les 13 formules qu’elle a développées (ainsi que dans les 2 inédites de Noël) mais aussi dans les noms qu’elle donne à ses savons : Avalon, Lancelot, Beltane, Fée Morgane ou encore Brocéliande…
Cette manière de travailler se retrouve chez Pauline Beunaiche, qui entreprend des jardins pour des particuliers, des coopératives – comme tel est le cas actuellement avec le potager installé devant le magasin Biocoop de Bruz dont elle entretien le suivi – ou par exemple d’une maison de retraite. Des missions stimulantes puisqu’il lui faut répondre à une commande, des exigences mais aussi des adaptations selon les profils.
 « Parfois, j’ai des demandes pour simplement dessiner et élaborer un plan de jardin. Mais quand je réalise, je travaille en local. Avec un créateur de rosiers ou une productrice de graines et plantes sauvages. Ce que j’aime bien faire aussi, c’est de travailler avec les semis. Les gens ont envie de mettre la main à la patte, on garde donc des coins pour les récupérer les graines et les replanter. Les gens demandent des jardins vivants avec un éco-système qui va intégrer les insectes, etc. », déclare-t-elle. Le geste écologique est donc important et se développe petit à petit, à des échelles différentes.
« Parfois, j’ai des demandes pour simplement dessiner et élaborer un plan de jardin. Mais quand je réalise, je travaille en local. Avec un créateur de rosiers ou une productrice de graines et plantes sauvages. Ce que j’aime bien faire aussi, c’est de travailler avec les semis. Les gens ont envie de mettre la main à la patte, on garde donc des coins pour les récupérer les graines et les replanter. Les gens demandent des jardins vivants avec un éco-système qui va intégrer les insectes, etc. », déclare-t-elle. Le geste écologique est donc important et se développe petit à petit, à des échelles différentes.
« Ça peut être des échanges de pieds de plante par exemple, je leur propose quand ils sont dans un rayon de 30 kms autour de Rennes. Ou alors ils sont en quête de solution pour limiter l’arrosage, le désherbage. Ça demande moins d’entretien et ça répond à une démarche écologique en même temps. », poursuit Pauline qui a à cœur également de développer des animations autour du potager de la Biocoop de Bruz.
Voilà peut-être les raisons d’un engouement lent mais solide et créateur de liens sociaux et solidaires. L’essor du bio prend un tournant, délaissant quelque peu les réticences d’un prix trop élevé des produits. D’où l’importance d’un changement des modes de comportement, vers une consommation plus raisonnable, certes plus chère mais peut-être aussi plus juste dans la rémunération du producteur ou de la productrice.
« Pour en vivre, ça prend du temps. Moi, je travaille en manuel, avec une seule cuve et je suis toute seule. Faut pas compter ses heures ! J’ai choisi de ne pas pratiquer des prix trop élevés, 5 euros pour un savon, ça va. Il faut trouver le juste prix en fonction du juste travail. », livre Delphine Ferrari, rejointe par Emilie Briot : « Il faut relativiser, moi mes ateliers ne sont pas très chers (19 euros pour un atelier dans lequel on réalisera un produit cosmétique type crème de jour, huile sèche pailletée, stick à lèvres, lait pour le corps, ndlr) mais ce qu’il faut voir, c’est surtout que l’on paye très cher les cosmétiques bio et non bio dans le commerce. Il faut donc trouver un équilibre pour être rentable mais pas hors de prix par rapport à ce que coûtent les matières premières. »
ET LES FEMMES DANS LE SECTEUR DU BIO ?
Sans se laisser porter par l’utopie d’un système alternatif qui romprait totalement avec le capitalisme et le patriarcat, la filière bio serait-elle plus égalitaire ? Pas de chiffres probants sur le nombre de femmes et d’hommes dans le secteur. Soit la marque d’un avenir qui cesse de réfléchir en terme de sexe et de genre. Soit un désintérêt total pour la répartition au sein de la production.
Quoi qu’il en soit, Sophie Persehais conclut sur une note positive et optimiste : « Je ne sais pas ce qu’il en est en règle générale mais je vois qu’on est pas mal de femmes dans le secteur. En tout cas, je pense que les petites exploitations et micro-fermes en bio facilitent l’intégration des femmes. Alors certes, en réunion, je vois bien qu’on est parfois 2 femmes pour 10 hommes mais je n’ai jamais ressenti que je n’avais pas ma place ici. Je dirais plutôt que l’on ressent qui fait du bio, qui fait du conventionnel. Qui fait du lait, qui n’en fait pas. Car dans le coin, y a pas de mal de productions laitières. C’est donc plus en terme de techniques que ça se joue qu’en terme femmes/hommes. Et autour de moi, je vois que nombreuses sont les femmes qui sont cheffes d’exploitation. À côté, j’ai une copine boulangère en bio, c’est elle qui fait le pain, c’est son mari qui vend. Ici, je suis cheffe d’exploitation, je suis tout le temps dans le champ ou à bosser la production, mon compagnon est salarié, c’est lui qui fait les livraisons et j’ai deux autres salariés. On est tous d’origines différentes et tout se passe bien. Parce qu’on communique. J’ai fait une formation sur la communication non violente. », dit-elle en rigolant. Voilà qui donne à réfléchir.
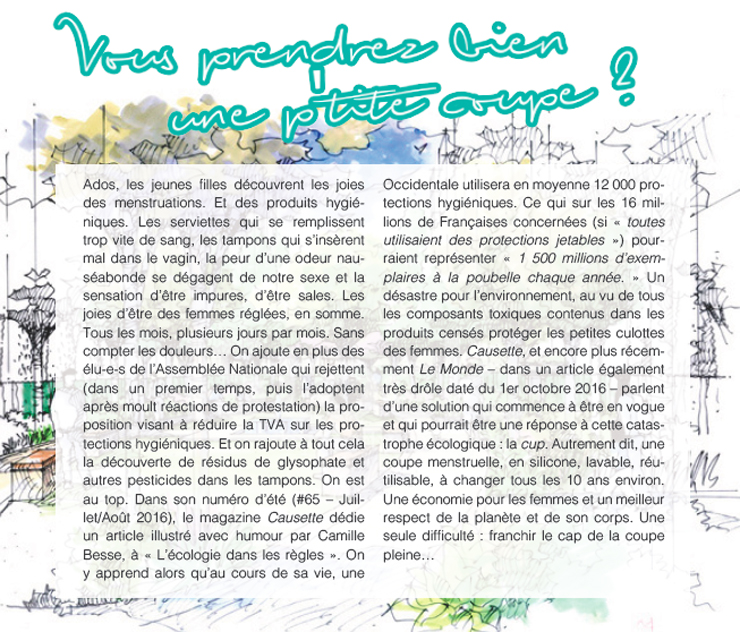
Depuis décembre 2015, Priscilla Zamord et Julie Orhant ont créé La Belle Déchette, projet de ressourcerie intégré au réseau national des ressourceries. La structure répond aux 4 fonctions du label : la collecte et le tri, la valorisation des objets de seconde main, la vente à moindre coût et la sensibilisation à l’environnement. Du 2 septembre au 29 octobre, ateliers, causeries et étude-action ont été menés à l’occasion d’une résidence à l’Hôtel Pasteur, à Rennes. En parallèle, pour alimenter la matériothèque et se procurer un camion, La Belle Déchette cherche à lever des fonds sur la plateforme de crowdfunding, helloasso.com.
YEGG : Comment est venue l’idée de ce projet ?
Julie : J’ai une formation Gestion de l’environnement et je travaille dans la gestion des déchets. Après un an passé à Madagascar pour une ONG, à travailler sur la sensibilisation à l’environnement et la gestion des déchets, ce projet a muri dans ma tête et j’ai écrit un projet très synthétique. J’en ai parlé à mon entourage. Une personne que nous avons en commun avec Priscilla nous a mis en relation.
Priscilla : Je viens plutôt du milieu culturel et j’ai glissé vers le secteur de l’insertion sociale par la culture puis l’insertion professionnelle. J’ai été responsable de l’ancienne friperie solidaire à Rennes Chez Rita Love. Après un Master en politique sociale et insertion, j’ai été embauchée à Bruxelles, dans une ressourcerie, sous forme de boutique.
Je suis revenue ici et j’ai travaillé à Rennes Métropole au service insertion et emploi et j’ai rencontré une personne qui m’a mise en lien avec Julie. Moi, j’avais l’idée de créer une structure mais je ne savais pas trop sous quelle forme, sachant que j’étais très très inspirée par le modèle belge et qu’on est à Rennes…
Qu’est-ce qui change ?
Priscilla : Ce n’est pas le même territoire, ce n’est pas la même culture du réemploi. Les pays nordiques sont très en avance, ça fait partie des pratiques quotidiennes. Avec Julie, on a un intérêt fort pour ce genre d’activité et en même temps une envie de faire quelque chose de local. Sans oublier la volonté de décloisonner les pratiques, c’est-à-dire qu’on est aussi dans un système très franco-français.
Tout le monde est mis dans une case. Ici on est dans un projet d’économie sociale et solidaire qui a des ambitions à la fois économiques, culturelles, environnementales et sociales. Il nous faut donc mettre tous ces acteurs là autour de la table et leur dire « on peut créer des éco-systèmes ensemble ».
Julie : Se faire rencontrer des élu-e-s de différents domaines et leur dire que ce serait bien de concilier les atouts des uns et des autres pour créer un projet, ce n’est pas si évident que ça ici. Ça bouscule.
Qu’est-ce qui n’est pas si évident ?
Julie : Je pense qu’il n’y a pas d’interrogations. Dans les mentalités, les déchets, l’environnement et la culture, ce n’est pas évident de les lier.
Priscilla : C’est culturel. Je pense que c’est aux porteurs de projet de secouer un peu les choses. C’est une mentalité liée à un système bureaucratique, pas simple, qui a des injonctions fortes. Mais globalement, on arrive tout de même à avoir des soutiens des collectivités territoriales sur chacun des volets et ça c’est une entrée positive.
 Maintenant notre enjeu c’est de mettre les gens autour de la table pour créer des passerelles. C’est ce qu’on essaye de faire avec La Belle Déchette et notamment l’étude-action que l’on a lancé début septembre. Au premier comité de pilotage, il y avait autour de la table les partenaires et les financeurs de tous les domaines. C’était très innovant. C’est de la co-construction.
Maintenant notre enjeu c’est de mettre les gens autour de la table pour créer des passerelles. C’est ce qu’on essaye de faire avec La Belle Déchette et notamment l’étude-action que l’on a lancé début septembre. Au premier comité de pilotage, il y avait autour de la table les partenaires et les financeurs de tous les domaines. C’était très innovant. C’est de la co-construction.
Qu’est-ce qui ressort des ateliers de la résidence ?
Priscilla : C’est intéressant de voir comment les ateliers de réemploi sont une entrée possible pour travailler la sensibilisation à l’environnement, l’artisanat, le bricolage. De manière valorisante. Pas dans la contrainte de la réparation mais la joie de la création. Et ça, sans distinction de genre. C’est une entrée hyper chouette d’un point de vue social pour travailler sur les modes de consommation.
On a commencé à réfléchir à un partenariat avec le CCAS. Pour proposer des ateliers aux bénéficiaires du RSA, montrer comment sans avoir beaucoup de sous on peut vivre en toute dignité, en ayant accès à des objets moins chers mais aussi en redonnant une seconde vie à leurs objets et en étant sur des modes de consommation plus économiques. Et puis les gens se rencontrent, c’est du lien social. Toujours dans la bienveillance et la générosité.
Vous avez étudié, Priscilla, la place des femmes dans l’ESS, qu’en est-il ?
Julie : Les entrepreneurs sont majoritairement des hommes. Dans le monde du déchet, ce sont des hommes. Ça détonne un peu que l’on soit 2 femmes à l’origine de ce projet.
Priscilla : Les gros postes, c’est toujours les mecs. Y a plein de nanas mais elles ne sont pas à des postes à responsabilité. Dans l’ESS, c’est pareil, les décisionnaires sont des hommes. L’ESS, il y a beaucoup de branche. Le care, services à la personne, oui c’est très genré. L’insertion par le recyclage, c’est plus masculin.
L’insertion sur de la vente textile, ça va être plus féminin. On est toujours dans les mêmes lectures. De temps en temps on peut nous prendre un peu de haut, il y a parfois une certaine forme de paternalisme.
Julie : Après, à nous de faire nos preuves.
Priscilla : Je pense qu’on doit faire encore plus nos preuves parce qu’on est des nanas.
Julie : Je suis d’accord avec toi.
Priscilla : Je trouve ça assez scandaleux dans le secteur de l’ESS. C’est mon point de vue. L’économie sociale et solidaire est fondée sur des principes d’égalité et c’est un modèle opposable à l’économie capitaliste classique où il y a une forme d’accès aux droits à l’entreprenariat, l’égalité des salaires, etc.
Il faut toujours avoir une forme de vigilance pour qu’on ne reproduise pas les mêmes schémas que dans l’économie classique. Après c’est quand même un mouvement qui aujourd’hui prend beaucoup d’ampleur…
Il y a de quoi être optimistes alors !?
Priscilla : Oui, Rennes, ça bouge ! Plein de choses émergent, dans l’économie sociale ou classique. Ça met du temps pour faire bouger les mentalités décisionnaires. Mais c’est une posture politique aussi que la Ville de Rennes doit prendre. On est très soutenues par l’ADEME et Rennes Métropole. La Ville est un peu plus timide. Ce n’est pas financier mais dans les échanges…
La plus value d’un projet comme ça, ça a un impact économique en terme de création d’emplois, ça a un impact en terme de marketing territorial, Nantes l’a compris il y a 10 ans, et ça a un impact social parce que Rennes est une ville forte qui a développé la carte Sortir, qui a permis à des gens qui n’ont pas de sous d’avoir un accès équitable à pas mal de choses. On peut être utiles socialement dans la ville. Ça a aussi un impact environnemental et politique.
Aujourd’hui, certes la Ville nous aide indirectement parce qu’on est à Pasteur. Mais on demande une prise de position, une écoute. C’est ce qu’on attend de la Ville.
Julie : Après, on va vite aussi. Et on sait que pour les politiques ça prend du temps. À nous de leur insuffler ce potentiel. Pas uniquement pour La Belle Déchette.