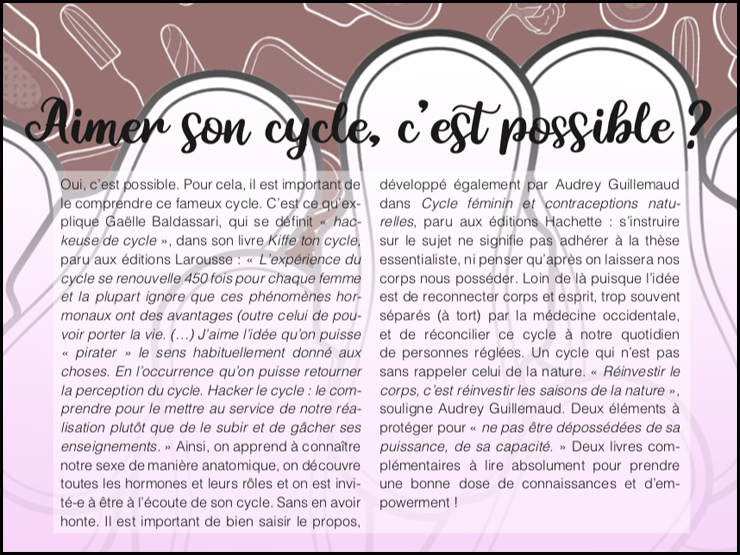Au cours du transport des kits Virilité, l’accessoire « poche de sang » a certainement dû être bien secoué… Parce que les bonhommes, ils ont le cœur bien accroché pour faire la guerre, dépecer les animaux tués à la chasse, opérer des êtres vivants, jouer à des jeux vidéos bien belliqueux ou encore pour ne pas détourner le regard pendant un épisode de Game of Thrones. Mais paradoxalement, on leur attribue la grande capacité à tourner de l’œil à la vue du sang, que ce soit pour une prise de sang ou un accouchement. Pas étonnant donc qu’ils aient un petit haut-le-cœur dès qu’on mentionne que tous les mois, nous les femmes, on saigne, phénomène créé par la non fécondation de l’ovule qui s’évacue avec une partie de notre endomètre via notre vagin, pour finir absorbé par un tampon ou une éponge, récupéré par une coupe menstruelle ou une serviette hygiénique ou encore évacué aux toilettes ou dans le bain ?! Peu importe, ça sort. C’est cyclique. Point barre.
Mais qu’est-ce qui horrifie tant – les hommes et les femmes - quand on parle des règles ? Il semblerait que le fait de savoir qu’une femme saigne au moment même où elle se tient debout juste en face de nous à la machine à café et discute de manière tout à fait normale soit perturbant. Voire dégoûtant si elle ose le dire ouvertement. « J’ai mes règles », ça glace le sang. Cette image implicite d’un ovule non fécondé qui vient s’écraser par filets et caillots de sang dans la culotte, ça répugne…
ZUT À LA FIN !
Ras-la-culotte de tous ces mythes oppressants autour des menstruations ! Ras-la-serviette de voir les visages se crisper quand le mot « règles » vient à être prononcé ! Ras-le-tampon de la vieille réflexion disant de se mettre aux abris pour ne pas essuyer le courroux de la harpie menstruée ! La coupe est pleine, évidemment.

Peut-être que cette soi-disant bande d’hystériques mal lunées l’est à cause des fortes douleurs ressenties avant, pendant et après ce fameux moment du cycle ou à cause des milliers d’euros dépensés pour s’acheter des produits hygiéniques imbibés pour la plupart de pesticides et de composés chimiques…
Ou tout simplement parce qu’elle a été éduquée dans la peur de la tâche et de l’odeur du sang et qu’elle a intégré depuis l’adolescence que « règles » équivaut à « impure ». Le cycle des femmes inquiète et dégoute. Nous, forcément on voit rouge et on milite pour que tout le monde se sente concerné, pas directement par nos vagins ensanglantés mais par tous les à côté.
Actuellement, nombreuses sont les publicités qui nous sollicitent au fil de la journée, sur les réseaux sociaux principalement, pour nous filer LA solution pour vivre paisiblement nos règles et sauter de joie à la première coulée… Chouette des nouvelles culottes de règles méga absorbantes ! Aussi écolos soient-elles, ça interpelle. Vivre sereinement nos règles n’est pas qu’une histoire de culotte tâchée ou pas tâchée, de vulve au sec ou à la fraiche ! Non, c’est bien plus complexe et complet que ça.
#ERROR
On touche ici à un système global de connaissance du corps des femmes et son fonctionnement cyclique. Souvent, on le connaît peu, on le connaît mal. En France, en 2016, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) a révélé qu’une fille de 15 ans sur quatre ignore qu’elle possède un clitoris et 83% ne connaissent pas son unique fonction érogène.
On l’appelle « minou », « chatte », « zezette », « abricot », « moule », etc. On les nomme « ragnagnas », « trucs » ou carrément « les anglais débarquent ». On pense qu’au moment des règles, les femmes ratent la mayonnaise (en Argentine, c’est la crème fouettée, au japon, les sushis et en Italie, l’ensemble des plats) et sont énervées sans raison aucune pendant leur durée entière.
Si la majorité de la population a tendance à minimiser, il serait une erreur de penser que l’utilisation des termes exacts est à négliger. Pire, à penser que cela constitue un danger ! Car apprendre aux enfants que les petites filles ont entre les jambes à l’extérieur un pubis, un clitoris et une vulve et à l’intérieur, un vagin et un utérus, c’est déjà briser le tabou visant à laisser croire que là où les garçons ont un pénis bien apparent, elles n’ont « rien ».
Les premières menstruations déboulent dans la culotte, c’est la panique et l’incompréhension. Ce passage que tout le monde imagine comme un symbole de l’évolution de fille à femme peut être un véritable séisme pour qui n’y est pas préparé-e et un moment de solitude si aucun espace de parole libre et d’écoute bienveillante n’a été créé que ce soit au sein de la famille, de l’entourage et/ou de l’école.
On passe de l’innocence enfantine à la femme potentiellement active sexuellement. Sans information anatomique. On passe du « rien » à la possibilité d’avoir un enfant, et cela même sans comprendre comment notre cycle fonctionne. Et quand à cela on ajoute des complications type fortes douleurs au moment des règles pour lesquelles on nous explique qu’avoir mal, c’est normal, on apprend à souffrir en silence, à serrer la mâchoire et à redoubler d’effort pour faire taire la douleur.
Peut-être sera-t-on diagnostiquées plus tard d’une endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques, du Syndrome PréMenstruel et même de trouble dysphorique prémenstruel. Heureusement, les combats féministes permettent de faire avancer la cause et des personnalités issues des milieux artistiques – actrices, chanteuses, etc. – témoignent de leurs vécus et des parcours chaotiques qu’elles ont enduré de nombreuses années durant afin de faire reconnaître les maladies et les conséquences physiques et psychologiques que cela inclut.

Aussi, de supers ouvrages existent pour en apprendre plus au sujet des règles comme Sang tabou de Camille Emmanuelle, Le grand mystère des règles de Jack Parker, Cycle féminin et contraceptions naturelles de Audrey Guillemaud et Kiffe ton cycle de Gaëlle Baldassari (les deux derniers étant écrit par des Rennaises – lire l’encadré).
Sans oublier le livre Les règles… Quelle aventure ! d’Elise Thiebaut et Mirion Malle à destination des préados et ados, filles et garçons. Cela participe à la découverte de soi et de l’autre, car comme le disent Elise Thiebaut et Mirion Malle à juste titre « rendre les règles invisibles, c’est rendre les femmes invisibles. »
SUR LE FIL DE L’EXPÉRIENCE
Lis Peronti est une artiste-chercheuse installée à Rennes depuis plusieurs années. Elle y a notamment fait un mémoire autour des menstruations et des performances durant lesquelles elle a laissé le sang de ses règles couler sur une robe blanche ou un pantalon (lire le focus « Menstruations : ne plus avoir honte de ses règles » - yeggmag.fr – août 2017).
Aujourd’hui, elle continue son travail de recherches et de restitution sous forme artistique, mêlant savoirs théoriques et vécus personnels, autour du sexe féminin. Quand on lui demande ce qu’est pour elle la précarité menstruelle, elle répond :
« Comme ça, je pense au prix des protections hygiéniques. J’en ai beaucoup acheté avant la cup. Mais en fait, c’est plus que ça. C’est le fait que les règles soient considérées comme dégueu, tabou, comme quelque chose à cacher. La précarité menstruelle n’est pas juste liée au prix des tampons et des serviettes mais aussi au manque d’informations qu’on a sur les règles si on ne fait pas la démarche d’aller chercher plus loin. »
Sa démarche au départ, elle le dit, n’était pas consciemment féministe. En commençant à travailler sur le sujet « de façon intuitive », elle a fait des choix pas forcément réfléchis mais qui l’ont mené à mieux comprendre le fonctionnement de son corps, de son cycle et aussi à mieux protéger sa santé. Plus tard, elle a fait des liens avec sa recherche académique :
« C’était une porte d’entrée vers toutes les études féministes et vers la connaissance de mon corps aussi. Par exemple, c’est au moment où j’ai commencé à faire une performance à chaque menstruation, performance qui était censée fonctionner selon mon cycle naturel, que j’ai arrêté la pilule pour retrouver le temps décidé par mon corps pour l’arrivée des règles, et aussi parce que j’avais entendu que la pilule provoquait des maladies. À ce moment-là, j’ai commencé à me rendre compte de quand est-ce que les règles arrivaient. Le fait de les laisser couler sur un tissu ou sur la terre m’a permis de me rendre compte de la quantité de sang versée, qui était d’ailleurs beaucoup moins importante que ce que je croyais. »
Aujourd’hui, elle connaît mieux son cycle et s’étonne d’autant plus de tous les tabous liés aux règles : « On a d’autres pertes au cours du cycle et ça ne choque personne. » Pour elle, en tout cas, le mémoire et les performances l’ont amenée à de nombreuses lectures et réflexions sur le sujet mais aussi à apprécier la beauté de la couleur du sang menstruel et de son mouvement lorsqu’il se dissout dans l’eau. Voilà pourquoi elle a choisi la coupe menstruelle, bien avant le scandale autour de la composition des tampons et des serviettes.
À ce propos, elle nous livre son opinion : « Les fabricants ont toujours su que c’était de la merde à l’intérieur mais on en parle aujourd’hui parce qu’il y a un nouveau marché à prendre. On en voit partout maintenant des culottes menstruelles, des tampons bios, des serviettes lavables, etc. C’est bien mais ce n’est pas nouveau. »
Ce que Lis Peronti retient particulièrement de tout cet apprentissage menstruel, c’est que « travailler sur les règles m’a aussi fait prendre l’habitude d’échanger sur ses sujets avec différentes personnes, que ça soit des bio ou techno femmes ou desbio ou techno hommes(termes utilisés par Beatriz Preciado dans Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique). Et connaître le vécu ou l’opinion des autres est la chose la plus enrichissante dans cette recherche artistique. »
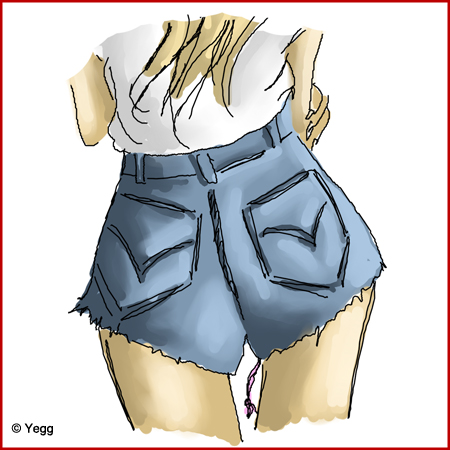 Et même sans démarche artistique, on la rejoint : échanger et partager les vécus et opinions, en prenant soin d’écouter en premier lieu les personnes concernées, est enrichissant et nécessaire à la déconstruction du tabou et des stéréotypes autant autour des règles que du genre.
Et même sans démarche artistique, on la rejoint : échanger et partager les vécus et opinions, en prenant soin d’écouter en premier lieu les personnes concernées, est enrichissant et nécessaire à la déconstruction du tabou et des stéréotypes autant autour des règles que du genre.
SOURCE DE SOUFFRANCES
Car ce tabou autour des règles peut être une source de violence à l’encontre de celles à qui on ne permet pas l’expression de leurs souffrances et à qui on dit que la douleur est uniquement dans leur tête. Mais aussi à l’encontre de celles qui n’osent pas l’exprimer et qui demandent, en chuchotant à l’oreille de leurs copines, si elles n’ont pas un tampon et qui le cachent ensuite dans le revers de leur manche ou encore de celles qui intègrent malgré elles un sentiment de honte et de peur.
Le silence et la méconnaissance qui règnent autour de cette thématique sont également à la base de la lenteur du diagnostic de l’endométriose, qui touche entre 1 femme sur 7 et 1 femme sur 10. Il faut en moyenne 7 ans pour diagnostiquer l’endométriose. Pourquoi ? Parce que le corps médical est mal informé, mal formé. Parce qu’une femme expliquant que tous les mois elle est handicapée par son cycle (transit perturbé, gênes urinaires, gênes ou douleurs lors des rapports sexuels, fortes douleurs utérines, incapacité à marcher au moment des règles, etc.) ne sera pas réellement écoutée et prise en charge, encore aujourd’hui, en 2019.
L’alliance des charges symboliques, émotionnelles et physiques qui s’ajoutent et s’imbriquent provoque une première forme de précarité, dans le sens de fragilité, contre laquelle les femmes luttent, bien conscientes qu’au premier signe de « faiblesse », elles seront renvoyées à la thèse essentialiste, c’est-à-dire à leur prétendue nature et fonction première : celle d’enfanter et de s’occuper du foyer.
Aujourd’hui, et cela est d’autant plus vrai avec le développement de l’image (fausse) de la Wonder Woman, une femme doit pouvoir affronter sans ciller et sans transpirer une double, voire une triple journée. La charge mentale s’accumule et pourtant, elle reste toujours suspectée de ne pas pouvoir y parvenir. De ne pas être assez forte, de ne pas pouvoir garder son sang froid et de ne pas avoir les épaules assez solides.
Alors, en plus des taches domestiques et de son travail, elle doit aussi penser à la contraception et aux protections hygiéniques, sans oublier les multiples remèdes de grand-mère ou les médicaments à prendre en cas de douleurs.
LES INÉGALITÉS SE CREUSENT
« Le tabou des règles est l’un des stéréotypes sexistes qui affecte la quasi-totalité des filles et des femmes dans le monde. », signale l’ONG internationale CARE. Si la majorité des femmes éprouvent de la honte concernant leurs règles, il existe aussi une partie de la population féminine touchée par l’isolement social, voire l’exil menstruel.
Au Népal, notamment, avec la pratique du chhapaudi, un rituel pourtant interdit visant à exiler les femmes du domicile familial pendant leurs règles, une brutalité à laquelle elles sont confrontées en raison de leurs menstruations encore pensées comme signe d’impureté et source de malheurs.
Selon les pays, les croyances diffèrent : dans certains coins d’Amérique du Sud, on pensera que côtoyer des femmes réglées peut provoquer des maladies, tandis qu’ailleurs, on pensera que le sang qui souille la terre la rend stérile. Elles seront alors tenues à l’écart de leur maison mais aussi de leur travail si celui-ci par exemple consiste à la culture et aux récoltes dans les champs. Dans la religion juive également, l’exil menstruel peut être appliqué, un rituel sera alors à suivre pour réintégrer le foyer. Afin de se laver et de redevenir pure.
Au-delà de la précarité sociale imposée par cette exclusion et de l’humiliation engendrée par celle-ci – et des morts fréquentes des exilées asphyxiées par les fumées du feu qu’elles ont allumé pour se réchauffer, mordues par des serpents, agressées, etc. – leur quotidien est affecté depuis très longtemps.
Ce n’est que depuis le 2 janvier que des femmes ont pu se rendre dans le temple d’Ayyappa à Sabarimala (dans la région du Kerala en Inde), après que la Cour suprême indienne ait levé l’interdiction, pour les femmes menstruées, d’accéder aux lieux sacrés hindous. Malgré tout, elles n’ont pas pu franchir les marches du temple, obligées d’emprunter l’entrée du personnel pour se protéger des réactions hostiles de certains croyants.
ISOLEMENT ET DÉSCOLARISATION
Malheureusement, en Inde, la population féminine est habituée dès le plus jeune âge à être rejetée à cause des règles, comme le montre le documentaire Les règles de notre liberté (en anglais Period. End of sentence) diffusé en France, en février 2019, sur Netflix.

Dans le village de Kathikhera, située en zone rurale, avoir ses menstruations est véritablement synonyme de précarité. Ce qui apparaît dans les silences filmés par la réalisatrice Rayka Zehtabchi lorsque le mot « règles » est prononcé. Les femmes du village n’ont pas accès aux protections hygiéniques, trop chères, qu’elles ne connaissent que de « réputation », comme une légende urbaine.
Elles, elles se tapissent le fond des sous-vêtements avec du papier journal ou des tissus usagés. Comme le font en France les femmes SDF, les détenues n’ayant pas l’argent nécessaire pour cantiner ou encore les personnes les plus précaires, étudiantes comprises dans le lot.
Selon l’ONG Care, elles sont environ 500 millions de filles et de femmes dans le monde à ne pas avoir accès aux protections hygiéniques. Autre problématique mondiale qui en découle : la déscolarisation des jeunes filles. En Afrique, 1 fille sur 10 manque l’école lors de ses menstruations.
En Inde, 23 millions de filles arrêtent l’école à cause de leurs règles. Soit par manque d’accès aux produits d’hygiène, soit parce que les toilettes ne sont pas séparées dans les établissements. Dans tous les cas, la honte l’emporte.
Les femmes de tous les pays ne vivent pas à la même échelle le même degré d’exclusion face aux stéréotypes et au tabou des règles. Si on revient à notre propre plan national, on ne peut pas parler de déscolarisation des jeunes filles mais certaines ont des absences répétées au fil de leur cursus justifiées par le début de leur cycle, que ce soit à cause des complications physiques – nausées, douleurs, diarrhées, fatigue… - ou en raison de l’hygiène.
Mais aussi de cette fameuse peur qui rend les adolescentes « indisposées » pendant les cours de natation. On voit aussi dans l’Hexagone une certaine réticence à réfléchir à la mise en place du congé menstruel, comme cela s’applique dans d’autres pays, comme l’Italie ou le Japon. Parce qu’on craint des abus, nous répond-on régulièrement.
En clair, des abus de la part des femmes qui profiteraient de l’occasion pour prendre des jours de congé alors qu’elles n’ont pas leurs règles ou qu’elles n’ont aucune difficulté avec celles-ci. Certainement un abus justifié par une soudaine envie de faire les boutiques... C’est croire en la frivolité des femmes et en un manque de cadre législatif qui viendrait entourer la loi.
C’est surtout ne pas considérer que les règles puissent entrainer de vraies difficultés et constituer un handicap dans le quotidien d’une partie des femmes dont on profit e qu’elles ont intégré le risque de précarité dans laquelle cela les mettrait si elles se permettaient des absences répétées au travail, aussi justifiées soient-elles.
LA SITUATION DES FEMMES EN GRANDE PRÉCARITÉ
Parler des règles, montrer un vêtement tâché par les menstruations, ça choque. Là où une porte s’ouvre en direction de la prise de conscience, c’est sur l’accès aux protections hygiéniques pour les plus démuni-e-s. Et elle ne s’opère pas en un claquement de doigts.
Il a fallu le concours de plusieurs actions, notamment associatives et médiatiques, et un film grand public Les invisibles de Louis-Julien Petit (lire notre critique dans YEGG#77 – Février 2019) pour que l’on commence à ouvrir les yeux sur une réalité jusqu’ici très peu prise en compte.
Une réalité que relate le sondage IFOP publié le 19 mars dernier et réalisé pour Dons solidaires : 8% des Françaises, soit 1,7 million de femmes, ne disposent pas suffisamment de protections hygiéniques et 39% des femmes bénéficiaires d’associations sont concernées.
Conséquence : 1 femme sur 3 (sur ce pourcentage) « ne change pas suffisamment de protection ou à recours à l’utilisation de protections de fortune. », souligne le communiqué. Là encore, on recroise la précarité sociale puisque, selon le sondage toujours, 17% des femmes en grande précarité renoncent à sortir à l’extérieur durant la période des règles et se retrouvent parfois en incapacité de se rendre à un entretien d’embauche ou un rendez-vous professionnel, par manque de protections hygiéniques. Un fait que l’on sait dangereux pour la santé et propice au Syndrome du Choc Toxique.
Trop souvent, on oublie les exclues du débat dont font parties les détenues et les femmes SDF. Elles ont rarement voix au chapitre parce que par confort, on oublie celles qui n’en disposent pas et parce qu’elles pâtissent d’une image stéréotypée due à leur condition. Et pourtant, elles aussi ont leurs règles, et elles aussi ont le droit à la dignité.
 Le 19 mars, L’Obs et Rue89 révèlent la précarité sanitaire que subissent les femmes incarcérées qui selon les établissements disposent de protections périodiques de mauvaise qualité souvent à des prix trop élevés, particulièrement pour celles qui ne cantinent pas.
Le 19 mars, L’Obs et Rue89 révèlent la précarité sanitaire que subissent les femmes incarcérées qui selon les établissements disposent de protections périodiques de mauvaise qualité souvent à des prix trop élevés, particulièrement pour celles qui ne cantinent pas.
« De nombreuses détenues utilisaient des tissus, des draps ou encore des serviettes de bain qu’elles mettaient dans leurs culottes », témoigne une ancienne détenue tandis que d’autres fabriquent des coupes menstruelles artisanales : « Elles utilisent une bouteille en plastique qu’elles découpent afin de n’en garder que la partie supérieure. Pour éviter de s’arracher les parois internes, la cup de fortune doit être lissée contre un mur. »
Le système débrouille côtoie alors le facteur risque sanitaire. Et s’applique également aux femmes SDF. Corinne Masiero, comédienne dans Les invisibles notamment, a vécu elle aussi dans la rue et dit au média Brut :
« Tout est dix fois plus problématique quand t’es une gonzesse, dix fois plus. Un truc tout con : quand t’as tes règles et que t’as pas de quoi t’acheter des trucs, alors tu vas chouraver des serviettes, des machins et tout. Mais des fois t’as pas eu le temps ou t’as pas pu, comment tu fais ? Tu te mets des journaux, des machins… on en parle jamais de ça. Pourquoi ces trucs là, c’est pas remboursé par la Sécu par exemple ? »
AGIR POUR LES AIDER
Lors de notre reportage au Salon bien-être solidaire fin novembre à Vitré, organisé par l’association brétillienne Bulles Solidaires, Anaëlle Giraurdeau, alors stagiaire au sein de la structure, expliquait que l’impact de la sensibilisation des passantes à ce propos était important lors des collectes effectuées à l’entrée des supermarchés.
La majorité de la société ne réalise pas qu’être une femme dormant à la rue signifie également ne pas avoir de quoi s’acheter des protections hygiéniques. D’où la mobilisation de Bulles Solidaires, créée en septembre 2017 par Laure-Anna Galeandro-Diamant afin de récolter des échantillons et produits d’hygiène corporelle (non entamés et non périmés) pour tou-te-s lors de collectes, via le bouche à oreille, le démarcharge des pharmacies, instituts de beauté et hôtels ou encore grâce aux points de collecte disposés dans certains magasins du centre ville, à l’Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique de Rennes, ou encore dans des commerces vitréens.
Ces produits sont ensuite redistribués aux occupant-e-s des établissements avec lesquels l’association travaille comme le Secours populaire, le foyer Saint Benoit de Labbre à Rennes, Le Puzzle, etc. Mais aussi à l’occasion des maraudes organisées dans la ville. Collecter serviettes, tampons et coupes menstruelles est alors essentiel pour les femmes en grande précarité car à l’heure actuelle, les associations venant en aide aux personnes sans abris sont principalement spécifiques à la question du logement et à celle de l’alimentation.
Bulles Solidaires réalise donc une mission particulière sur un terrain presque vierge à ce niveau-là, à l’échelle locale, et n’en oublie pas les besoins des femmes. Sur le plan national, Règles élémentaires est la première association depuis 2015 à collecter des produits d’hygiène intime à destination des femmes sans abris et mal logées. Initiée par Tara Heuzé-Sarmini, la structure a réussi à organiser plus de 150 collectes en France et à redistribuer plus de 200 000 tampons et serviettes à plus de 20 000 femmes bénéficiaires.
La dynamique crée des émules. Le 16 mai prochain, une soirée autour de la précarité menstruelle est organisée à Askoria, à Rennes, par Aux règles citoyen-ne-s, un collectif de travailleurs-euses sociaux en formation dans l’école.
« Les femmes en situation de précarité sont les premières victimes. Elles sont déjà vulnérables et en plus, elles doivent se cacher à cause des tâches et c’est très difficile d’aller demander une protection hygiénique à quelqu’un dans la rue, c’est tellement tabou dans notre société actuelle… »
signale les membres du collectif.
En creusant le sujet, ielles ont l’idée d’une collecte mais rapidement se pose la question de la forme : « Une collecte c’est bien mais si en plus on peut sensibiliser autour de ça, c’est mieux ! On a donc fixé le prix de la soirée à une boite de tampons ou de serviettes qui seront ensuite données à Bulles Solidaires. »
Si le collectif souhaite provoquer des rencontres, des échanges et des débats entre professionnel-le-s du secteur social, futur-e-s professionnel-le-s, associations féministes (ou pas), il tient à ce que le grand public, hommes comme femmes donc, soit convié, intéressé et concerné. Ainsi, le débat sera précédé de la diffusion du film Les invisiblespour faire le pont avec la précarité menstruelle, un sujet large qui touche un grand nombre de femmes.
RENDRE LES PROTECTIONS HYGIÉNIQUES ACCESSIBLES
Et parmi les plus impactées, on trouve également la population étudiante dont les revenus sont souvent faibles voire inexistants. Pour une boite de tampons ou de serviettes, il faut compter entre 3 et 8 euros. Pendant une période de règles, les femmes peuvent utiliser les deux sortes de protection, pour ne pas dormir avec un tampon ou une coupe menstruelle, et ainsi réduire le risque d’infection.
Aussi, il faudra certainement prévoir l’achat de boites d’anti-inflammatoires ou autres médicaments, l’investissement dans une bouillote, etc. Et rien dans la liste ne peut être répertorié comme produit de confort. C’est pourquoi en janvier, l’université de Lille, sur les conseils de Sandrine Rousseau, fondatrice de l’association Parler, ancienne élue EELV et actuellement professeure d’économie à la fac, a décidé au début de l’année 2019 de distribuer gratuitement 30 000 kits de protections hygiéniques, contenant tampons, serviettes et coupes menstruelles réutilisables.
 Une idée qui a été inspirée par le modèle écossais. En effet, le pays qui avait déjà investi pour lutter contre la « period poverty » auprès des femmes en grande précarité réitère son action auprès des étudiantes à présent, en levant 5,7 millions d’euros afin de fournir aux 395 000 élèves d’Ecosse des protections hygiéniques gratuites. Dans les écoles, collèges et universités sont, depuis la rentrée scolaire, accessibles tampons, serviettes, serviettes lavables et coupes menstruelles.
Une idée qui a été inspirée par le modèle écossais. En effet, le pays qui avait déjà investi pour lutter contre la « period poverty » auprès des femmes en grande précarité réitère son action auprès des étudiantes à présent, en levant 5,7 millions d’euros afin de fournir aux 395 000 élèves d’Ecosse des protections hygiéniques gratuites. Dans les écoles, collèges et universités sont, depuis la rentrée scolaire, accessibles tampons, serviettes, serviettes lavables et coupes menstruelles.
La réforme crée des émules là encore puisque début mars, la newsletter pour adolescentes « Les petites Glo » - la petite sœur des « Glorieuses » – lançait le mouvement #StopPrécaritéMenstruelle afin de demander la gratuité des protections hygiéniques dans tous les établissements scolaires français.
Johanna Courtel est étudiante à l’université Rennes 2. Début avril, son projet de protections périodiques en accès libre – co-piloté avec une autre étudiante – figurait parmi les 10 lauréats qui seront financés par le budget participatif de la faculté.
« Il existait déjà un projet de l’Armée de Dumbledore, une organisation politique de Rennes 2, pour installer 3 distributeurs de protections hygiéniques. C’est bien mais c’était limité. Là, l’idée est d’installer des meubles avec des tampons, des serviettes, des cups, en libre accès. Et que les produits soient le moins toxiques possible. On veut privilégier le bio et la qualité, des produits respectueux pour nous et pour la nature. », explique-t-elle, précisant qu’elle ne connaît pas encore la date de mise en fonction des installations et du premier ravitaillement.
« Peut-être que beaucoup vont hésiter à en prendre au début mais l’objectif est vraiment que les personnes s’habituent à ce que ce soit gratuit. À ce que ce soit normal que ce soit gratuit,poursuit-elle. En tant que femmes, depuis qu’on a nos règles, on sait que c’est la galère. Dès la naissance, on sait qu’on va être précaires. En plus de ça, on doit payer plus de choses avec un moindre salaire… Etudiante, je me suis déjà retrouvée à la fin du mois avec du sopalin dans la culotte car j’ai préféré m’acheter à manger qu’acheter des protections. »
UNE BATAILLE À POURSUIVRE
Mais avant même d’être contrainte à tester le « dépannage menstruel » que de nombreuses femmes connaissent au cours de leur vie, Johanna Courtel avait déjà conscience de la problématique, notamment grâce à la campagne médiatisée du collectif Georgette Sand qui a ardemment lutté contre la taxe tampon et obtenu gain de cause en décembre 2015 lorsque l’Assemblée nationale a voté l’abaissement de la taxe de 20% à 5,5%, reclassant ainsi les protections hygiéniques injustement qualifiées de « produits de luxe » à la catégorie « produits de première nécessité ».
Bonne nouvelle donc ! Pas tant que ça en fait, indique le collectif Georgette Sand dans un article paru dans Ouest France : « Malheureusement, l’abaissement de la TVA n’a pas été répercuté sur les produits des grandes marques. Maintenant que nous avons pu constater que la baisse de la TVA n’est qu’un cadeau pour les marques qui leur permet d’augmenter leurs marges sans faire monter leurs prix, nous avons conscience que cette taxe n’est plus la question. Il faut prendre conscience que le sujet est une question de santé publique. Des décisions comme celle prise par la LMDE d’allouer une somme de son forfait étudiant au remboursement des protections hygiéniques est un progrès que nous saluons. »
Dans le fait que la parole se libère petit à petit et que les exemples d’actions concrètes se développent, l’étudiante rennaise y sent le vent tourner et saisit l’occasion du budget participatif pour apporter sa pierre à l’édifice. Pour elle, le vote des étudiant-e-s en faveur de son projet marque l’importance de répondre désormais à un besoin bien réel de lutte contre la précarité.
Tout comme sur le campus, on trouve une épicerie solidaire, on trouvera prochainement des protections périodiques en libre service : « C’était important aussi de ne pas mettre un moment spécifique durant lequel les gens viennent se servir. Parce qu’en faisant ça, je pense que plus de gens vont s’autoriser à en prendre alors que si ça se faisait devant tout le monde pendant une permanence, beaucoup de personnes n’oseraient pas. Et quand on a pas une bonne protection hygiénique ou qu’on a oublié d’en prendre d’autres, on n’est pas à l’aise, on est moins aptes à écouter, à se concentrer. On pourrait parfaitement ne pas être dans cet état si justement on savait que, même si on oublie d’en mettre dans son sac ou qu’on n’a pas les moyens d’en acheter, on va pouvoir en trouver sur place. Dans les toilettes par exemple, pour que ce soit un lieu plus intime. »
L’ESPACE PUBLIC, ENCORE ET TOUJOURS GENRÉ…
Les toilettes, c’est encore un autre sujet dans le sujet. Mais là, on ne parle plus de l’université mais de l’espace public. À Rennes, tandis que la municipalité installe des urinoirs en forme de kiwi, de pastèque et autres fruits pour que ces messieurs arrêtent de pisser où bon leur semble lors des soirées arrosées du jeudi au samedi, personne ne s’inquiète du devenir de nos abricots qui marinent dans la sauce airelles chaque jour de nos règles.
Et ça ne me passe pas inaperçu dans les médias, avec en tête de fil le site Alter1fo qui par deux fois interpelle sur la question. En janvier, d’abord, on peut lire l’article « Précarité menstruelle : Rennes manque une occasion de « régler » la question » dans lequel le rédacteur Politistution dévoile qu’un projet concernant l’augmentation du nombre de toilettes pour femmes n’a pas pu être mis au vote du budget participatif de la ville car entre autre « la ville de Rennes dispose déjà de sanitaires publiques et aucun emplacement n’a pu être trouvé pour en construire de nouvelles. »
Il revient dessus en mai se saisissant de l’actualité chaude des urinoirs mobiles pour souligner, à juste titre, qu’il s’agit là encore d’un privilège de mâles. Il conclut son article :
« Les toilettes publiques restent finalement révélateurs des inégalités entre les sexes et ne doivent pas accentuer l’hégémonie masculine dans la ville. »
De par cette phrase, il pointe une nouvelle problématique qui enfonce encore davantage les femmes dans la précarité menstruelle. Les villes pensées par et pour les hommes permettant uniquement aux femmes de se déplacer dans l’espace public mais pas de l’occuper comme les hommes le font.
Encore moins quand elles ont leurs règles et qu’elles n’ont pas d’autres choix pour changer leurs protections que d’aller dans un bar ou rentrer chez elle, si leur domicile n’est pas trop éloigné. Alors des urinoirs en forme de fruits, c’est bien joli mais c’est quand même discriminatoire, même si on est équipé-e-s d’un pisse-debout, c’est ce que développe Virginie Enée, journaliste pour Ouest France, dans son billet d’humeur daté du 6 mai :
« Alors oui, une cabine de toilette mixte ne coûte certainement pas le même prix. Probablement que cela prend plus de place dans l’espace public et que c’est moins ludique qu’un urinoir déguisé en pastèque ou en kiwi. Mais justifier une inégalité par l’incivilité de certains, c’est ni plus ni moins qu’une discrimination. Réclamons des cabines de toilettes publiques dans une citrouille, type carrosse de Cendrillon. (Sinon nous aussi, on se soulagera sur ses roues.) »
LES TOILES D’ARAIGNÉE, C’EST SALE…
De nombreux facteurs convergent, créant ainsi une précarité menstruelle qui pourrait s’apparenter à une toile d’araignée, tissée autour du tabou des règles pour coincer les femmes dans leur émancipation. Comme le souligne Lis Peronti, les règles ne sont qu’une partie du cycle, et non l’entièreté et surtout pas la fin comme on vise souvent à le penser. Bien au contraire même puisqu’en réalité l’arrivée des règles marque le début du cycle.
Elles ne sont pas donc pas synonymes de la fin, dans le sens de l’échec de la femme dans son soi-disant rôle premier et majeur de procréatrice, mais le début, le renouveau, l’instant de tous les possibles. La possibilité de choisir son mode de vie, son mode de contraception, son corps.
De plus en plus de comptes, comme Dans Ma culotte, SPM ta mère ou encore Mes règles et moi, se créent sur les réseaux sociaux, utilisant la toile non pour nous coller à une matière et se faire dévorer ensuite mais pour dénoncer la précarité menstruelle, briser le tabou et dévoiler la couleur de la réalité, parce que non ce qui coule dans nos culottes n’est pas bleu comme le montre la publicité, mais bel et bien rouge.
Montrer le sang - comme l’a fait la youtubeuse Shera Kirienski en posant en pantalon blanc tâché et comme l’a fait auparavant Lis Peronti - participe à ne plus cautionner les mythes et les mensonges qui entretiennent la précarité menstruelle dans sa globalité. Les initiatives fleurissent. Au Canada, par exemple, au musée de Kitchener, en Ontario, a dévoilé l’exposition Flow pour démystifier les règles et aider les femmes qui se sentent stigmatisées à cause de ça à s’émanciper.
Sinon, sans prendre l’avion plusieurs heures durant, on peut de chez nous, en toute intimité si on a honte (en espérant ensuite qu’on aura le courage d’en parler avec d’autres, au café, puis dans le bus, puis au milieu d’une foule ou mieux, à table) regarder le super documentaire d’Angèle Marrey, Justine Courtot et Myriam Attia, 28 jours, disponible sur YouTube.
Ou encore on peut participer à la campagne Ulule de financement participatif afin d’aider Leslye Granaud pour la réalisation et diffusion de son documentaire SPM ta mèrequi interroge hommes et femmes sur leur rapport aux menstruations.
Mise en garde (qui arrive bien trop tard, tant pis) : après tout ça, vous ne penserez plus que les règles, c’est dégueu et vous prônerez le choix pour toutes les femmes d’en parler librement ou de garder ça pour elles. Car si cela ne doit pas virer à l’injonction au témoignage, il est urgent de se libérer des sentiments de honte et d’humiliation qui entourent toutes les personnes ayant leurs règles.
De garantir l’accès aux protections hygiéniques à toutes les personnes ayant leurs règles, sans conditions. D’apprendre à toutes les filles et à tous les garçons l’anatomie des un-e-s des autres et d’ouvrir la voix aux personnes désireuses de connaître davantage leur cycle que l’écoféminisme met en parallèle du cycle de la Nature. Mais ça, c’est un autre sujet. Et c’est pour bientôt.


 « En janvier 2023, Net Plus a mis en place une nouvelle organisation de travail. Les nouvelles fiches de poste augmentent drastiquement les charges de travail mais pas le temps de travail. Elles – je dis « elles » car ce sont majoritairement des femmes – nous ont expliqué qu’elles rentraient le soir en pleurant. Certaines sont en arrêt malade, d’autres ont démissionné et une a été licenciée », précise Mélisande, avant de rejoindre le groupe composé de salarié-e-s de Net Plus, de syndicats (CGT, Sud Solidaires) et de collectifs (Si on s’alliait ?, La cause du peuple, Les Jeunes révolutionnaires, Nous Toutes 35), au métro Pontchaillou.
« En janvier 2023, Net Plus a mis en place une nouvelle organisation de travail. Les nouvelles fiches de poste augmentent drastiquement les charges de travail mais pas le temps de travail. Elles – je dis « elles » car ce sont majoritairement des femmes – nous ont expliqué qu’elles rentraient le soir en pleurant. Certaines sont en arrêt malade, d’autres ont démissionné et une a été licenciée », précise Mélisande, avant de rejoindre le groupe composé de salarié-e-s de Net Plus, de syndicats (CGT, Sud Solidaires) et de collectifs (Si on s’alliait ?, La cause du peuple, Les Jeunes révolutionnaires, Nous Toutes 35), au métro Pontchaillou.
 Sans oublier la dimension genrée d’un travail précaire, souvent attribué à des personnes sexisées racisées ou exilées. 77% des agents de service sont des femmes, indique le site de Net Plus. « On est là pour soutenir la mobilisation et on est réuni-e-s pour montrer qu’on peut agir ! Le collectif augmente de plus en plus… », prévient Si on s’alliait ?.
Sans oublier la dimension genrée d’un travail précaire, souvent attribué à des personnes sexisées racisées ou exilées. 77% des agents de service sont des femmes, indique le site de Net Plus. « On est là pour soutenir la mobilisation et on est réuni-e-s pour montrer qu’on peut agir ! Le collectif augmente de plus en plus… », prévient Si on s’alliait ?.





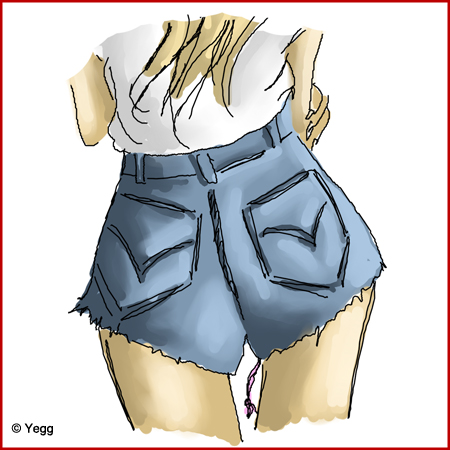 Et même sans démarche artistique, on la rejoint : échanger et partager les vécus et opinions, en prenant soin d’écouter en premier lieu les personnes concernées, est enrichissant et nécessaire à la déconstruction du tabou et des stéréotypes autant autour des règles que du genre.
Et même sans démarche artistique, on la rejoint : échanger et partager les vécus et opinions, en prenant soin d’écouter en premier lieu les personnes concernées, est enrichissant et nécessaire à la déconstruction du tabou et des stéréotypes autant autour des règles que du genre. 
 Le 19 mars, L’Obs et Rue89 révèlent la précarité sanitaire que subissent les femmes incarcérées qui selon les établissements disposent de protections périodiques de mauvaise qualité souvent à des prix trop élevés, particulièrement pour celles qui ne cantinent pas.
Le 19 mars, L’Obs et Rue89 révèlent la précarité sanitaire que subissent les femmes incarcérées qui selon les établissements disposent de protections périodiques de mauvaise qualité souvent à des prix trop élevés, particulièrement pour celles qui ne cantinent pas. Une idée qui a été inspirée par le modèle écossais. En effet, le pays qui avait déjà investi pour lutter contre la « period poverty » auprès des femmes en grande précarité réitère son action auprès des étudiantes à présent, en levant 5,7 millions d’euros afin de fournir aux 395 000 élèves d’Ecosse des protections hygiéniques gratuites. Dans les écoles, collèges et universités sont, depuis la rentrée scolaire, accessibles tampons, serviettes, serviettes lavables et coupes menstruelles.
Une idée qui a été inspirée par le modèle écossais. En effet, le pays qui avait déjà investi pour lutter contre la « period poverty » auprès des femmes en grande précarité réitère son action auprès des étudiantes à présent, en levant 5,7 millions d’euros afin de fournir aux 395 000 élèves d’Ecosse des protections hygiéniques gratuites. Dans les écoles, collèges et universités sont, depuis la rentrée scolaire, accessibles tampons, serviettes, serviettes lavables et coupes menstruelles.