Célian Ramis
Discrimination raciale : un enjeu de santé majeur pour les femmes noires

 À l’intersection de la journée internationale pour les droits des femmes et de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, l’occasion de réfléchir aux impacts du racisme sur la santé et l’accès aux soins, le 21 mars à la Maison des associations de Rennes. Une table ronde qui a réuni Yaotcha d’Almeida, psychologue spécialisée dans l’impact du racisme sur la santé mentale, Lucie Obermeyer, coordinatrce du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace et Priscille Sauvegrain, sage-femme, sociologue et maitresse de conférences en maïeutique.
À l’intersection de la journée internationale pour les droits des femmes et de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, l’occasion de réfléchir aux impacts du racisme sur la santé et l’accès aux soins, le 21 mars à la Maison des associations de Rennes. Une table ronde qui a réuni Yaotcha d’Almeida, psychologue spécialisée dans l’impact du racisme sur la santé mentale, Lucie Obermeyer, coordinatrce du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace et Priscille Sauvegrain, sage-femme, sociologue et maitresse de conférences en maïeutique.
Il y a des phrases bien connues des personnes concernées qui soulignent des représentations et imaginaires basés sur des stéréotypes à caractère raciste. « Tu as le rythme dans la peau » ou encore « D’où viens-tu ? Non mais vraiment… » en sont quelques exemples, à l’instar du comportement visant à toucher les cheveux, sans l’autorisation de la personne. Les définir « ordinaires » revient à minimiser leur portée quand il s’agit en réalité de microagressions. Ce soir-là, Yaotcha d’Almeida présente le travail qu’elle a réalisé dans le cadre de son mémoire de master en psychologie clinique.
Un mémoire pour lequel elle a effectué, en 2020, une recherche qualitative et exploratoire visant à mieux comprendre la souffrance psychique due à l’expérience vécue de discriminations raciales des femmes noires à qui elle donne la parole. Plus précisément, elle s’intéresse à « L’impact des microagressions et de la discrimination raciale sur la santé mentale des personnes racisées », à travers « l’exemple des femmes noires en France ». Un intitulé qui donne également son nom au livre publié aux éditions L’Harmattan et qui reprend son ouvrage universitaire, dans lequel on trouve les définitions précises des termes et notions qu’elle aborde au cours de la conférence.
DES IMPACTS NOMBREUX ET DRAMATIQUES
On lit alors que les microagressions sont « des actions subtiles ou interactions verbales dédaigneuses, désobligeantes ou discriminatoires » selon la définition de Pierce en 1970. Quarante ans plus tard, Sue précise : « Les microagressions sont des outrages quotidiens brefs, banals, verbaux, non verbaux ou comportementaux, ou des outrages environnementaux, intentions ou non, qui communiquent des affronts hostiles, désobligeants, négatifs ou des insultes envers les membres de groupes opprimés. » Ainsi, Yaotcha d’Almeida explique que c’est leur récurrence qui entraine « un impact et des répercussions sur la santé mentale et physique des personnes racisées » (dans le sens de la construction sociale). Confrontées à des projections exotisantes et sexualisantes (les femmes noires seraient des tigresses au lit, par exemple), stigmatisantes, caricaturales et essentialistes, les concernées peuvent présenter du « stress racial, dit aussi stress lié à la race » qui peut être « aigue, intense, circonscrit à un moment ou chronique. »
 Dans tous les secteurs de leur vie professionnelle et personnelle. « Plus on va subir du stress racial, plus on peut développer des troubles », souligne la psychologue. Des troubles cliniques comme la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique, allant du sentiment de honte et d’impuissance à l’hypervigilance, la perte d’appétit, la fatigue, au désespoir et aux doutes de soi, et se manifestant par des réponses comportementales tels que l’évitement, le désengagement, l’isolement ou encore la consommation de substances. La liste s’allonge et s’alourdit avec l’ajout des troubles physiques.
Dans tous les secteurs de leur vie professionnelle et personnelle. « Plus on va subir du stress racial, plus on peut développer des troubles », souligne la psychologue. Des troubles cliniques comme la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique, allant du sentiment de honte et d’impuissance à l’hypervigilance, la perte d’appétit, la fatigue, au désespoir et aux doutes de soi, et se manifestant par des réponses comportementales tels que l’évitement, le désengagement, l’isolement ou encore la consommation de substances. La liste s’allonge et s’alourdit avec l’ajout des troubles physiques.
Ulcères, maladies cardiovasculaires, hypertension, maux de tête, douleurs thoraciques, maux de dos, vomissements, nausées ou encore maladies inflammatoires : « Le racisme impacte profondément les personnes et agit aussi à l’échelle de l’infiniment petit. L’activité de l’ADN est modifiée par le racisme, entrainant à travers les cellules le développement des maladies inflammatoires. Il les impacte dans ce qu’elles ont de plus minimes et de plus intimes. » Elle le dit, c’est l’accumulation des microagressions et des discriminations, « leur omniprésence dans les différents domaines de la vie de la personne », qui crée le traumatisme racial.
DES REPRÉSENTATIONS RACISTES TRÈS ANCRÉES
Concrètement, Yaotcha d’Almeida livre des exemples récoltés au fur et à mesure des témoignages réalisés dans le cadre de son mémoire. Elle cite cette femme qui est allée consulter une psychologue en généalogie, une discipline basée sur la transmission et l’héritage psychiques des générations précédentes : « La femme est antillaise et aborde le méga trauma de l’esclavage. La psy lui répond qu’il faut oublier le passé… » Une réponse aberrante mais malheureusement significative. Elle le dit : les femmes noires viennent la voir parce qu’elle est noire. « Parce que beaucoup de femmes racisées sont malmenées et agressées dans leur suivi psy, en étant invalidées, minimisées. Venir me voir, pour elles, c’est s’enlever de la charge raciale. Dans mon cabinet, elles n’ont pas à se justifier, elles n’ont pas besoin de m’éduquer sur le sujet, elles n’ont pas à s’adapter à moi… Même si ça devrait être à le/la professionnel-le de s’adapter à la personne », commente la psychologue.
Parmi les représentations sociales, il y a l’image de l’animalité chez les femmes noires. Dans la sexualité, l’allaitement, la résistance à la douleur. Un lien que Yaotcha d’Almeida établit avec la nature et le processus de naturalisation que l’on opère dans la société envers les femmes noires, que l’on englobe dans une seule et même catégorie, sans distinction du pays, de la culture, de l’histoire et des trajectoires. S’appuyant sur les propos de Ndiaye en 2008, elle écrit « qu’il n’existe pas de « nature noire » cependant une « condition noire » est observable. » En clair : « une expérience communément partagée par des hommes et des femmes ‘d’être considérés comme noirs à un moment donné dans une société donnée. C’est faire référence à des personnes qui ont été historiquement construites comme noires, par un lent processus de validation religieuse, scientifique et intellectuelle de la « race » noire, processus si enchâssé dans les sociétés modernes qu’il est resté à peu près en place, alors même que la racialisation a été délégitimée.’ »
Et puis, il y a cet archétype, hérité de l’esclavage, de la strong black woman : « C’est le pilier de la maison, la femme qui assume tout et gère tout. Cette image a pour conséquence pour la concernée de ne pas se plaindre, de résister, encaisser, devoir s’occuper de tout le monde et de ne pas aller chercher d’aide si besoin, puisqu’elle est censée tout gérer… »
DES PROPOS RACISTES EN RDV AU REFUS DE SOINS…
 Sans oublier de manière plus globale en termes de genres, le syndrome méditerranéen, « une construction sociale qui prête une expression plus forte pour les douleurs pour les populations méditerranéennes », définit Priscille Sauvegrain, sage-femme et sociologue, expliquant que les stéréotypes varient en fonction de l’origine des personnes : « On estime les femmes d’Afrique du nord très douillettes et les femmes d’Afrique subsahariennes très fortes. » Les conséquences sont lourdes lorsque les professionnel-les minimisent de leurs biais racistes les symptômes décris et perçus, c’est là qu’interviennent les soins différenciés : soins non adaptés à la situation et à la personne, report de la prise en charge pouvant entrainer le décès tel que cela fut le cas en 2018 lorsque Naomi Musenga, âgée de 22 ans, avait alerté le Samu de sa détresse respiratoire, signalant qu’elle allait mourir, ce à quoi l’opératrice du Samu lui avait répondu « Oui vous allez mourir un jour comme tout le monde ».
Sans oublier de manière plus globale en termes de genres, le syndrome méditerranéen, « une construction sociale qui prête une expression plus forte pour les douleurs pour les populations méditerranéennes », définit Priscille Sauvegrain, sage-femme et sociologue, expliquant que les stéréotypes varient en fonction de l’origine des personnes : « On estime les femmes d’Afrique du nord très douillettes et les femmes d’Afrique subsahariennes très fortes. » Les conséquences sont lourdes lorsque les professionnel-les minimisent de leurs biais racistes les symptômes décris et perçus, c’est là qu’interviennent les soins différenciés : soins non adaptés à la situation et à la personne, report de la prise en charge pouvant entrainer le décès tel que cela fut le cas en 2018 lorsque Naomi Musenga, âgée de 22 ans, avait alerté le Samu de sa détresse respiratoire, signalant qu’elle allait mourir, ce à quoi l’opératrice du Samu lui avait répondu « Oui vous allez mourir un jour comme tout le monde ».
Un exemple parmi d’autres, moins médiatisés... La maitresse de conférences en maieutique évoque la typologie de Fassin, allant du refus de soin, « très courant pour les personnes étrangères », à la prise en charge alimentée de propos racistes et xénophobes, en passant par le retard de prise en charge – « il faudra attendre 8 mois pour obtenir un rdv là où une personne blanche en aura un plus rapidement » -, l’abaissement de la qualité de la prise en charge et les modalités de soins culturellement spécifiques « sans même avoir mené un examen complet ».
DES BARRIÈRES (MORTELLES) DANS L’ACCÈS AUX SOINS
Priscille Sauvegrain constate également les répercussions des représentations racistes sur la prise en charge, dans les parcours de maternité, des femmes noires dont les grossesses sont davantage pathologisées, le recours aux soins plus tardifs, le taux de césarienne plus important et le risque de mortalité maternelle plus élevé : « Il est de 1 sur 3 pour les femmes d’Afrique subsahariennes, d’Amérique du sud et d’Asie du sud-est. Elles ont des risques plus importants de développer des pathologies d’hypertension artérielles (dues au stress racial) et de faire des hémorragies obstétricales sévères (dues à la prise en charge). » Les barrières dans l’accès aux soins sont réelles et persistantes. Elle parle « de soins différenciés », dans le sens où les stéréotypes et comportements racistes influent sur « un accès différencié aux soins et un abaissement ou une hausse des normes de prise en charge. »
Ainsi, la professionnelle note de la part de ses collègues des tendances à catégoriser et à naturaliser les femmes noires, désignées comme « les africaines ». Il y a par exemple ce discours présumant l’absence de volonté de suivre les cours de préparation à la naissance : « Elles ne viennent jamais… » En creusant la question, Priscille Sauvegrain s’aperçoit que cette présupposition anticipant la réaction des personnes concernées dessert ces dernières qui ne sont même pas informées, et par conséquent pas invitées à participer aux séances. À l’instar du raisonnement généralisant sur le fait « que ces femmes-là, elles allaitent toutes très bien », s’épargnant ainsi leur rôle de conseils et encore une fois d’informations. En somme, les femmes noires sont globalement délaissées en étant naturalisées dans leurs fonctions maternantes.
« Jamais on ne parle de leurs apports dans l’évolution de nos pratiques de puériculture… Par contre, pour s’occuper des enfants et des personnes âgées, là on pense à elles ! »
déplore la sage-femme.
Elle insiste sur certaines recommandations : rester vigilant-es quant aux pratiques routinières dans les hôpitaux, dépister les violences dans les soins afin de les prévenir et recourir plus fréquemment aux traducteur-ices et médiateur-ices lorsque les personnes concernées ne parlent pas la langue.
SENSIBILISER LES PROFESSIONNEL-LES DE LA SANTÉ ET AGIR COLLECTIVEMENT
 Au vu de leur déontologie, engagement et de leur éthique professionnelle, les personnes exerçant dans le secteur de la santé ont « des réticences à penser qu’elles peuvent être discriminantes. » C’est ce que souligne Lucie Obermeyer, coordinatrice du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace. Pour sensibiliser les professionnel-les de la santé et du social, et leur permettre d’identifier les pratiques discriminatoires à l’œuvre afin de les prévenir, la structure a élaboré en 2019 un guide intitulé « Vers plus d’égalité en santé ». « Au sein de l’association, nous avons un grand nombre d’interprètes pour accompagner les personnes migrantes à leur rendez-vous. Ce sont elles et eux qui ont constaté les discriminations racistes et les refus de soins. C’est ce qui a donné la rédaction de ce guide », signale-t-elle, précisant : « Il s’agit de comprendre les discriminations, d’analyser les situations vécues par les concerné-es et surtout d’agir, en abordant les recours juridiques et les actions inspirantes. »
Au vu de leur déontologie, engagement et de leur éthique professionnelle, les personnes exerçant dans le secteur de la santé ont « des réticences à penser qu’elles peuvent être discriminantes. » C’est ce que souligne Lucie Obermeyer, coordinatrice du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace. Pour sensibiliser les professionnel-les de la santé et du social, et leur permettre d’identifier les pratiques discriminatoires à l’œuvre afin de les prévenir, la structure a élaboré en 2019 un guide intitulé « Vers plus d’égalité en santé ». « Au sein de l’association, nous avons un grand nombre d’interprètes pour accompagner les personnes migrantes à leur rendez-vous. Ce sont elles et eux qui ont constaté les discriminations racistes et les refus de soins. C’est ce qui a donné la rédaction de ce guide », signale-t-elle, précisant : « Il s’agit de comprendre les discriminations, d’analyser les situations vécues par les concerné-es et surtout d’agir, en abordant les recours juridiques et les actions inspirantes. »
Ainsi, elle intervient à ce titre-là à la faculté de médecine, en école de sage-femmes ainsi qu’en école d’infimièr-es, au sein de formations qu’elle estime « trop courtes » - 2 jours – mais qui ont « le mérite d’exister ». Un moyen selon elle, parmi d’autres, de lutter contre les discriminations. Une manière de rappeler que celles-ci sont prohibées et encadrées par le droit français : des lois existent, insiste-t-elle. La difficulté majeure : « Il y a peu de contentieux sur les discriminations en santé. Souvent, parce que les personnes ne sont pas informées sur le sujet, mais aussi parce qu’elles sont laissées à elles-mêmes, pas ou peu accompagnées. » Lucie Obermeyer se saisit alors de l’assemblée pour délivrer quelques conseils à appliquer aussi bien pour les victimes que pour les témoins de situations à caractère raciste et discriminatoire. Saisir le défenseur des droits, saisir les ordres professionnels ou encore saisir les commissions des usagers des établissements de santé publics et privés. « Pour introduire une action en Justice, il faut être bien accompagné-é, recommande-t-elle. Parce que le propos raciste ou le refus de soin se fait souvent à l’oral. Vous n’avez pas à prouver précisément mais vous avez à apporter des éléments de ce que vous avez vécu : par les gens à qui vous en avez parlé par exemple en sortant du rendez-vous. » Elle ajoute : « Sachez aussi que les preuves enregistrées et les vidéos sont désormais recevables, dans le cadre de la discrimination. » Sans oublier un des enjeux majeurs et principaux : écouter et croire les personnes concernées. « Et favoriser les actions collectives ! », conclut-elle.
UNE PROBLÉMATIQUE PROFONDE
Lucie Obermeyer observe également un manque de soignant-es dans les quartiers populaires : « Plus l’offre est rare, plus les inégalités augmentent. » Les populations ciblées, dans lesquelles sont sur-représentées les personnes racisées, les personnes étrangères et les personnes en situation de grande précarité, sont majoritairement en moins bonne santé. « Les prises en charge sont plus tardives puisqu’il n’y a pas de professionnel-les et que certain-es refusent de s’y déplacer s’il s’agit d’un quartier mal perçu… Tous les stéréotypes entrent en jeu et des problèmes de santé qui auraient pu ne pas être trop graves vont le devenir, voir s’avérer mortels, s’ils ne sont pas pris à temps », déplore-t-elle. Si chacune s’accorde à établir que la parole se libère, de la part des usager-es, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour déconstruire les stéréotypes racistes intégrés et persistants dans la société, y compris au sein des personnes concernées. Yaotcha d’Almeida parle de racisme internalisé, soit l’intégration des discours dévalorisants par les personnes racisées, dont l’estime de soi subira de plein fouet l’impact.
« Sans oublier la menace du stéréotype. Les concerné-es ont peur de confirmer le stéréotype, ce qui créé chez elleux de l’anxiété et ce qui impacte la performance à réaliser. On retrouve chez certain-es un schéma d’exigence très élevé en réponse à la menace du stéréotype, les personnes redoublent d’effort et de travail »
analyse-t-elle.
Un levier qu’elle encourage : le réseau. « J’ai beaucoup de témoignages de personnes ayant vécu des violences dans un cadre de santé alors que c’est censé être safe. Alors, avoir des listes de personnes reconnues safe, je suis pour ! », clame-t-elle avec enthousiasme. Autre solution qui lui parait indispensable : la formation des professionnel-les. « On n’en a pas parlé ce soir mais des soignant-es affrontent également les microagressions et les discriminations raciales. Il faut une prise de conscience politique qui mène à l’action », précise-t-elle. C’est ce qu’entreprend Priscille Sauvegrain depuis 2 ans avec la création d’un module obligatoire pour les étudiant-es sur le sujet : « L’amphi est plein, ils et elles en ont besoin et il y a une très grosse attente sur ce cours ! » C’est à Yaotcha d’Almeida que revient le mot de la fin. Elle s’adresse aux professionnel-les de la santé qui pourraient être présent-es dans l’assemblée (mais le discours s’applique à chacun-e) : « Vous pouvez aller vous informer et vous questionner sur les biais de pensées et de représentations. Oui, ça demande un effort. Il faut être pro-actif-ve ! »
Table ronde animée par Marie Zafimehy, journaliste, porte-parole de l’Association des Journalistes Antiracistes et Racisé-es.

 On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun.
On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun. D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. »
D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. » Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle.
Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle. Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.
Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.
 Elles encourent un risque plus élevé de subir des violences sexistes et sexuelles au cours de leurs vies mais dans la société patriarcale et validiste, on ne parle que trop peu d’elles : les femmes en situation de handicap sont silenciées et invisibilisées. À travers l’exposition « Féminisme et handicap psychique : la double discrimination », les personnes concernées mettent leurs existences et difficultés en lumière pour une prise en considération globale de leurs individualités.
Elles encourent un risque plus élevé de subir des violences sexistes et sexuelles au cours de leurs vies mais dans la société patriarcale et validiste, on ne parle que trop peu d’elles : les femmes en situation de handicap sont silenciées et invisibilisées. À travers l’exposition « Féminisme et handicap psychique : la double discrimination », les personnes concernées mettent leurs existences et difficultés en lumière pour une prise en considération globale de leurs individualités. Onze personnes participent à cet atelier ludique qui opère à travers des exercices basés sur l’écoute et l’observation de soi et des autres. Déambuler, accélérer, se croiser, se regarder, marquer un temps d’arrêt et repartir. Agir en miroir de l’autre, être à l’écoute et en réaction de l’autre. « On commence à faire connaissance, on connait nos prénoms, on se regarde, on se rencontre », souligne Yann, animateur de l’atelier théâtre. C’est la première fois que Danielle, 66 ans, prend part à l’activité. Avec Sylviane, elles sont toutes les deux bénéficiaires de l’accueil de jour et ont participé à ce projet indispensable pour briser les tabous : « J’ai été prise en photo, ça fait drôle… Mais je me suis trouvée bien ! »
Onze personnes participent à cet atelier ludique qui opère à travers des exercices basés sur l’écoute et l’observation de soi et des autres. Déambuler, accélérer, se croiser, se regarder, marquer un temps d’arrêt et repartir. Agir en miroir de l’autre, être à l’écoute et en réaction de l’autre. « On commence à faire connaissance, on connait nos prénoms, on se regarde, on se rencontre », souligne Yann, animateur de l’atelier théâtre. C’est la première fois que Danielle, 66 ans, prend part à l’activité. Avec Sylviane, elles sont toutes les deux bénéficiaires de l’accueil de jour et ont participé à ce projet indispensable pour briser les tabous : « J’ai été prise en photo, ça fait drôle… Mais je me suis trouvée bien ! » À la marge, mises au ban de la société, les femmes en situation de handicap sont majoritairement silenciées et invisibilisées. Reniées dans leurs identités et existences. Au sein du mouvement féministe, elles sont souvent reléguées au second plan. « Le mouvement #MeToo a mis en lumière les injustices auxquelles sont confrontées les femmes et les minorités de genre au quotidien. Mais beaucoup d’entre elles ne sont pas représentées malgré les tentatives de ne pas les oublier. Les personnes que nous accompagnons sont en situation de fragilité psychique et elles font partie de cette catégorie de femmes invisibilisées dans les mouvements de lutte. », relatent Fantine Cariou et Manon Rozelier en introduction de l’exposition, attirant l’attention sur un fléau de grande ampleur : « Pourtant, paradoxalement, elles courent un risque plus élevé d’être victimes de violences sexistes et sexuelles, tant physiques que psychologiques. Dans notre société validiste, ces femmes sont victimes d’une double discrimination : celle liée au genre et celle liée au handicap. »
À la marge, mises au ban de la société, les femmes en situation de handicap sont majoritairement silenciées et invisibilisées. Reniées dans leurs identités et existences. Au sein du mouvement féministe, elles sont souvent reléguées au second plan. « Le mouvement #MeToo a mis en lumière les injustices auxquelles sont confrontées les femmes et les minorités de genre au quotidien. Mais beaucoup d’entre elles ne sont pas représentées malgré les tentatives de ne pas les oublier. Les personnes que nous accompagnons sont en situation de fragilité psychique et elles font partie de cette catégorie de femmes invisibilisées dans les mouvements de lutte. », relatent Fantine Cariou et Manon Rozelier en introduction de l’exposition, attirant l’attention sur un fléau de grande ampleur : « Pourtant, paradoxalement, elles courent un risque plus élevé d’être victimes de violences sexistes et sexuelles, tant physiques que psychologiques. Dans notre société validiste, ces femmes sont victimes d’une double discrimination : celle liée au genre et celle liée au handicap. »  Stéréotypes de genre, idées reçues sur la vulnérabilité, la non désirabilité et l’objetisation des femmes en situation de handicap, remarques grossophobes et quotidiens de violences… L’exposition, sans prétention d’exhaustivité ou d’exemplarité concernant la représentativité, aborde de nombreux sujets pointant les discriminations et (micro et macro) agressions vécues par les participantes. Et c’est aussi l’occasion pour elles de faire entendre leurs voix et de rendre l’invisible visible : « Ce projet, c’est une bonne idée pour montrer aux autres qu’il y a des femmes en situation de handicap, qu’on existe. » / « On n’imagine pas que j’ai un handicap physique, psychique et intellectuel. » ou encore « Même si on a le handicap psychique, ça ne nous empêche pas de vivre. Le plus dur, c’est le regard des autres. »
Stéréotypes de genre, idées reçues sur la vulnérabilité, la non désirabilité et l’objetisation des femmes en situation de handicap, remarques grossophobes et quotidiens de violences… L’exposition, sans prétention d’exhaustivité ou d’exemplarité concernant la représentativité, aborde de nombreux sujets pointant les discriminations et (micro et macro) agressions vécues par les participantes. Et c’est aussi l’occasion pour elles de faire entendre leurs voix et de rendre l’invisible visible : « Ce projet, c’est une bonne idée pour montrer aux autres qu’il y a des femmes en situation de handicap, qu’on existe. » / « On n’imagine pas que j’ai un handicap physique, psychique et intellectuel. » ou encore « Même si on a le handicap psychique, ça ne nous empêche pas de vivre. Le plus dur, c’est le regard des autres. »
 S’attaquer aux origines de la maladie figure comme un objectif de ce plan. Car aujourd’hui, « on ne sait pas comment elle arrive ». Ce que l’on sait : chez les personnes menstruées, atteintes d’endométriose, des lésions se développent dans et en dehors de l’utérus, pouvant se propager, comme des métastases, et atteindre d’autres organes. « Mais des jeunes filles ressentent des douleurs dès les premières règles. Cela signifie que l’endométriose était déjà présente », souligne la gynécologue-obstétricienne, pointant ici les potentiels facteurs génétiques et la possibilité que les lésions se soient créés lors de la vie intra-utérine du bébé.
S’attaquer aux origines de la maladie figure comme un objectif de ce plan. Car aujourd’hui, « on ne sait pas comment elle arrive ». Ce que l’on sait : chez les personnes menstruées, atteintes d’endométriose, des lésions se développent dans et en dehors de l’utérus, pouvant se propager, comme des métastases, et atteindre d’autres organes. « Mais des jeunes filles ressentent des douleurs dès les premières règles. Cela signifie que l’endométriose était déjà présente », souligne la gynécologue-obstétricienne, pointant ici les potentiels facteurs génétiques et la possibilité que les lésions se soient créés lors de la vie intra-utérine du bébé. 

 Pour parler d’elles, pour parler d’autres femmes. Pour créer la rencontre, provoquer les discussions et les échanges, favoriser la prise de conscience. « Avoir un plateau composé exclusivement de femmes, c’est possible. La non mixité, ça interroge les gens alors que quand il s’agit de plateaux composés uniquement d’hommes, on ne se pose pas la question… À un moment, il faut faire des efforts pour tendre vers une parité systématique dans les événements et ça passe par des événements comme Visibles. », analyse Fanny Dufour, faisant référence, entre autres, aux conférences TedX, qu’elle a présidé à Rennes pendant plusieurs années. Prendre la licence TedX Women, elle y a pensé.
Pour parler d’elles, pour parler d’autres femmes. Pour créer la rencontre, provoquer les discussions et les échanges, favoriser la prise de conscience. « Avoir un plateau composé exclusivement de femmes, c’est possible. La non mixité, ça interroge les gens alors que quand il s’agit de plateaux composés uniquement d’hommes, on ne se pose pas la question… À un moment, il faut faire des efforts pour tendre vers une parité systématique dans les événements et ça passe par des événements comme Visibles. », analyse Fanny Dufour, faisant référence, entre autres, aux conférences TedX, qu’elle a présidé à Rennes pendant plusieurs années. Prendre la licence TedX Women, elle y a pensé. 
 L’occasion de valoriser toutes celles qui l’ouvrent, toutes celles qui disent et toutes celles qui permettent de parler. Et c’est ainsi que dans l’espace Lauren Bastide a lieu la conférence réunissant Marine Beccarelli, historienne et co-créatrice de la série radiophonique Laisse parler les femmes, diffusée sur France Culture, et Aurélie Fontaine, journaliste et fondatrice du podcast Breton-nes et féministes. Toutes les deux expriment « l’aspect parisiano-centré » des médias. Et évoquent « le manque de parole de l’ordinaire. » Alors, Marine Beccarelli et 3 consœurs sont parties à travers la France, en milieu urbain comme en milieu rural, à la rencontre des femmes du quotidien :
L’occasion de valoriser toutes celles qui l’ouvrent, toutes celles qui disent et toutes celles qui permettent de parler. Et c’est ainsi que dans l’espace Lauren Bastide a lieu la conférence réunissant Marine Beccarelli, historienne et co-créatrice de la série radiophonique Laisse parler les femmes, diffusée sur France Culture, et Aurélie Fontaine, journaliste et fondatrice du podcast Breton-nes et féministes. Toutes les deux expriment « l’aspect parisiano-centré » des médias. Et évoquent « le manque de parole de l’ordinaire. » Alors, Marine Beccarelli et 3 consœurs sont parties à travers la France, en milieu urbain comme en milieu rural, à la rencontre des femmes du quotidien : 
 Les chiffres sont effarants. Et cerise sur le gâteau, l’essayiste précise que son estimation est en deçà de la réalité. Elle parle « d’un gouffre statistique ». Les hommes représentent 83% des 2 millions d’auteurs d’infractions pénales traitées annuellement par les parquets, 90% des personnes condamnées par la Justice, 86% des mis en cause pour meurtre, 99% des auteurs de viols, 84% des auteurs présumés d’accidents routiers mortels, 95% des auteurs de vols avec violences, 97% des auteurs d’agressions sexuelles… « Tous les hommes ne sont pas des délinquants et des criminels mais majoritairement les délinquants et les criminels sont des hommes ! Et il y a là un point d’aveuglement car quand on étudie la violence, on ne prend pas ça en compte », souligne Lucile Peytavin qui prend l’exemple d’un soir de match de foot : jamais dans les médias, par exemple, on ne mettra en exergue le fait que dans 98% des affaires de violence sont commises par des hommes.
Les chiffres sont effarants. Et cerise sur le gâteau, l’essayiste précise que son estimation est en deçà de la réalité. Elle parle « d’un gouffre statistique ». Les hommes représentent 83% des 2 millions d’auteurs d’infractions pénales traitées annuellement par les parquets, 90% des personnes condamnées par la Justice, 86% des mis en cause pour meurtre, 99% des auteurs de viols, 84% des auteurs présumés d’accidents routiers mortels, 95% des auteurs de vols avec violences, 97% des auteurs d’agressions sexuelles… « Tous les hommes ne sont pas des délinquants et des criminels mais majoritairement les délinquants et les criminels sont des hommes ! Et il y a là un point d’aveuglement car quand on étudie la violence, on ne prend pas ça en compte », souligne Lucile Peytavin qui prend l’exemple d’un soir de match de foot : jamais dans les médias, par exemple, on ne mettra en exergue le fait que dans 98% des affaires de violence sont commises par des hommes.

 Elle veut parler de l’invisibilité de la toxicité des algues vertes, du manque d’informations de certain-e-s passant-e-s, de l’omerta flagrante, du travail des scientifiques. « Comme je n’avais pas le droit de montrer les images de leur travail officiellement, j’ai recréé des scènes par le prisme de la fiction, en demandant à des modèles de refaire les gestes. Je ne voulais pas perpétuer l’omerta à mon tour », explique Alice Pallot qui souhaite également présenter la vision d’une algue verte : « Elles sont diabolisées mais ce n’est pas leur matière qui est toxique. C’est la réaction au soleil et aux déchets de l’agriculture intensive. » Au fil de la narration, l’artiste photographe offre un regard qu’elle définit « désanthropocentré ». Elle dézoome le propos de l’intervention humaine et de ses conséquences sur l’environnement pour réduire la focale sur les micro-organismes vivants passés au microscope : « Ils sont en mode pause, par manque d’oxygène par exemple, mais ils vont revivre lorsqu’ils auront les bonnes conditions. On voit là la résilience de la part de certains organismes ! »
Elle veut parler de l’invisibilité de la toxicité des algues vertes, du manque d’informations de certain-e-s passant-e-s, de l’omerta flagrante, du travail des scientifiques. « Comme je n’avais pas le droit de montrer les images de leur travail officiellement, j’ai recréé des scènes par le prisme de la fiction, en demandant à des modèles de refaire les gestes. Je ne voulais pas perpétuer l’omerta à mon tour », explique Alice Pallot qui souhaite également présenter la vision d’une algue verte : « Elles sont diabolisées mais ce n’est pas leur matière qui est toxique. C’est la réaction au soleil et aux déchets de l’agriculture intensive. » Au fil de la narration, l’artiste photographe offre un regard qu’elle définit « désanthropocentré ». Elle dézoome le propos de l’intervention humaine et de ses conséquences sur l’environnement pour réduire la focale sur les micro-organismes vivants passés au microscope : « Ils sont en mode pause, par manque d’oxygène par exemple, mais ils vont revivre lorsqu’ils auront les bonnes conditions. On voit là la résilience de la part de certains organismes ! » 
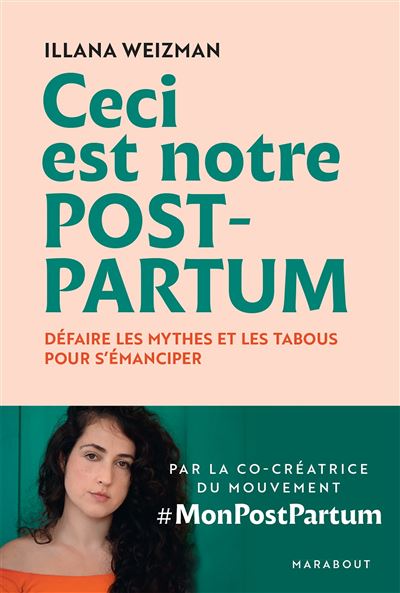 De son côté, la sociologue Illana Weizman publie en 2021 l’essai Ceci est notre post-partum et du leur, Ayla Saura, Morgane Koresh et Masha Sexplique rédigent depuis Rennes, Tel Aviv et Nîmes le guide Nos post-partum, paru en 2022 aux éditions Mango. Parce que clairement, l’information manque. Dans les commentaires et les témoignages, nombreuses sont celles qui expriment leur désespoir après coup de n’avoir reçu aucun cours sur le post-partum lors des séances de préparation à l’accouchement, que certaines sages femmes intitulent désormais « Préparation à l’accouchement et à la parentalité » afin d’englober quelques notions sur la période qui suivra la naissance. Mais là encore, ce n’est pas suffisant.
De son côté, la sociologue Illana Weizman publie en 2021 l’essai Ceci est notre post-partum et du leur, Ayla Saura, Morgane Koresh et Masha Sexplique rédigent depuis Rennes, Tel Aviv et Nîmes le guide Nos post-partum, paru en 2022 aux éditions Mango. Parce que clairement, l’information manque. Dans les commentaires et les témoignages, nombreuses sont celles qui expriment leur désespoir après coup de n’avoir reçu aucun cours sur le post-partum lors des séances de préparation à l’accouchement, que certaines sages femmes intitulent désormais « Préparation à l’accouchement et à la parentalité » afin d’englober quelques notions sur la période qui suivra la naissance. Mais là encore, ce n’est pas suffisant. En résumé, la femme, nouvelle mère, remplit son rôle reproductif et doit également satisfaire les besoins de rentabilité économique du pays et donc retourner bosser avec la même hargne. « Le patriarcat et le capitalisme voudraient qu’on ferme nos gueules et qu’on soit toujours aussi productives qu’avant la grossesse. Mais entre les douleurs ligamentaires, le mal de dos, les reflux gastriques, le fait d’être essoufflées au moindre mouvement, potentiellement les nausées et les vomissements, puis tout ce qui survient lors du post-partum, ce n’est pas possible. J’ai mis du temps à accepter que ça déborde sur mon travail, à accepter que ma fille était là, que j’allais mal dormir, qu’elle allait être malade, que j’avais envie de passer du temps avec elle et être contente qu’elle prenne du temps et de la place dans ma vie. », souligne Ayla. Elle pointe du doigt le manque d’écoute, de compassion et de compréhension. Face aux professionnel-le-s de la santé mais pas que. La société étant imprégnée des stéréotypes entourant la grossesse et la maternité, les femmes qui cassent l’image d’épanouissement et d’accomplissement sont marginalisées et clouées au pilori des mauvaises mères.
En résumé, la femme, nouvelle mère, remplit son rôle reproductif et doit également satisfaire les besoins de rentabilité économique du pays et donc retourner bosser avec la même hargne. « Le patriarcat et le capitalisme voudraient qu’on ferme nos gueules et qu’on soit toujours aussi productives qu’avant la grossesse. Mais entre les douleurs ligamentaires, le mal de dos, les reflux gastriques, le fait d’être essoufflées au moindre mouvement, potentiellement les nausées et les vomissements, puis tout ce qui survient lors du post-partum, ce n’est pas possible. J’ai mis du temps à accepter que ça déborde sur mon travail, à accepter que ma fille était là, que j’allais mal dormir, qu’elle allait être malade, que j’avais envie de passer du temps avec elle et être contente qu’elle prenne du temps et de la place dans ma vie. », souligne Ayla. Elle pointe du doigt le manque d’écoute, de compassion et de compréhension. Face aux professionnel-le-s de la santé mais pas que. La société étant imprégnée des stéréotypes entourant la grossesse et la maternité, les femmes qui cassent l’image d’épanouissement et d’accomplissement sont marginalisées et clouées au pilori des mauvaises mères. Les vécus sont variés, les voix également, les visages et les identités de genre aussi. D’où l’importance d’une campagne comme celle du Planning Familial qui a fait couler tant d’encre et de souffrance dans une vague transphobe décomplexée. Pour rappel, l’affiche, réalisée par Laurier The Fox, montrant un homme enceint a été la cible d’attaques virulentes en août 2022. En finir avec le discours binaire, sortir du silence, donner la parole et écouter les personnes concernées, valoriser les vécus et expériences, prendre en compte et en considération les récits de post-partum dans leurs réalités toutes entières.
Les vécus sont variés, les voix également, les visages et les identités de genre aussi. D’où l’importance d’une campagne comme celle du Planning Familial qui a fait couler tant d’encre et de souffrance dans une vague transphobe décomplexée. Pour rappel, l’affiche, réalisée par Laurier The Fox, montrant un homme enceint a été la cible d’attaques virulentes en août 2022. En finir avec le discours binaire, sortir du silence, donner la parole et écouter les personnes concernées, valoriser les vécus et expériences, prendre en compte et en considération les récits de post-partum dans leurs réalités toutes entières. Briser le silence, briser le tabou, briser l’isolement. Mettre en avant les changements, la liberté d’agir, le droit de faire autrement, signifier la perte de repères, la stupéfaction face à un corps que l’on ne reconnaît plus mais aussi face à une personnalité qui se dévoile, celle du parent. Accepter les difficultés, pouvoir les dire, échanger autour des vécus et ressentis. Et puis aussi s’autoriser l’épanouissement et/ou la frustration, parfois les deux mélangés, sentir sa puissance et la faire jaillir. Ou pas.
Briser le silence, briser le tabou, briser l’isolement. Mettre en avant les changements, la liberté d’agir, le droit de faire autrement, signifier la perte de repères, la stupéfaction face à un corps que l’on ne reconnaît plus mais aussi face à une personnalité qui se dévoile, celle du parent. Accepter les difficultés, pouvoir les dire, échanger autour des vécus et ressentis. Et puis aussi s’autoriser l’épanouissement et/ou la frustration, parfois les deux mélangés, sentir sa puissance et la faire jaillir. Ou pas. 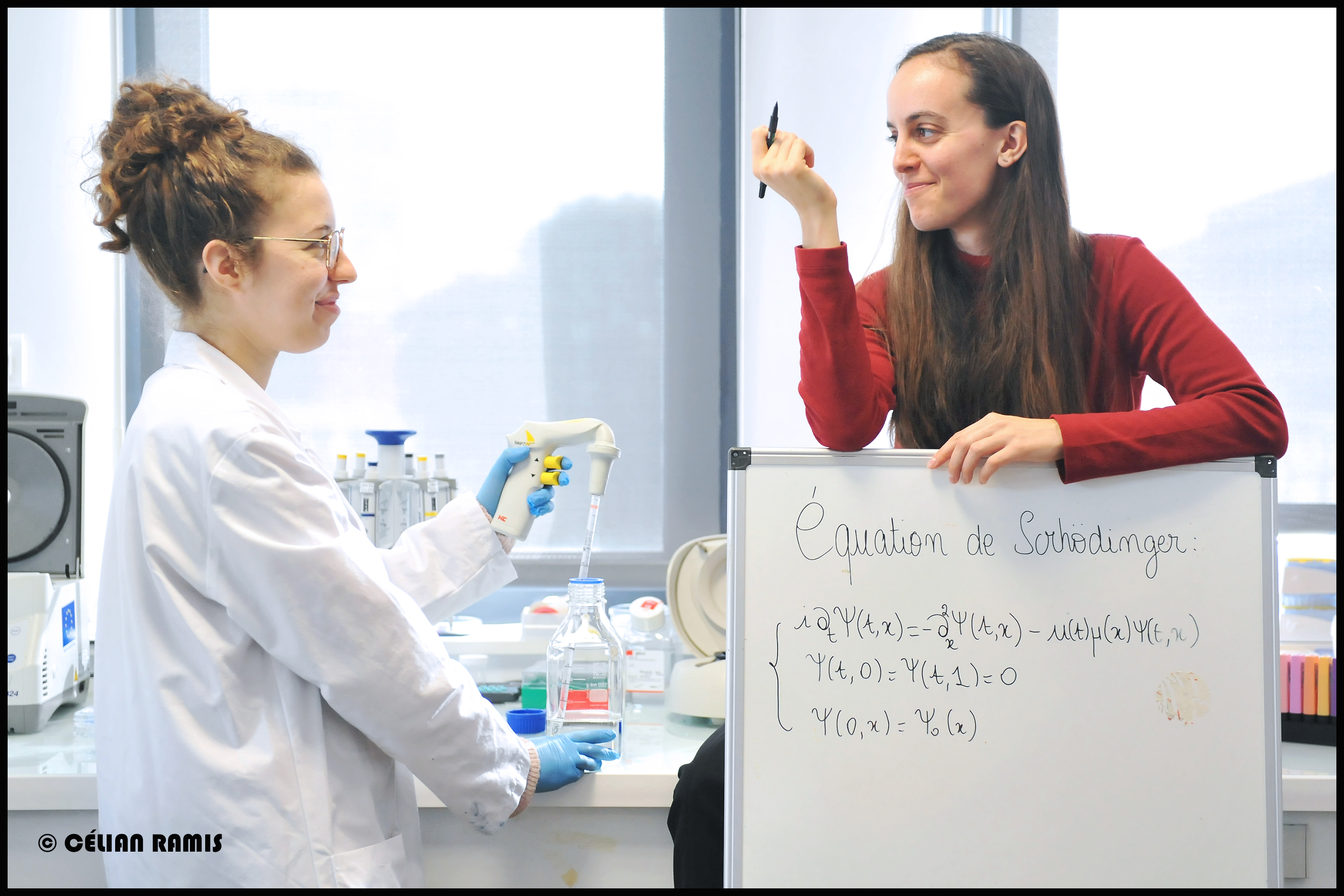
 YEGG : Vous travaillez en théorie du contrôle…
YEGG : Vous travaillez en théorie du contrôle…
 Tribunal d’Evry, mai 2021. Tran To Nga a 79 ans et cela fait 6 ans qu’elle attend l’ouverture de ce procès intenté à l’encontre de 14 multinationales, semeuses de souffrances et de morts et représentantes de l’impérialisme occidental. Des millions de corps exposés et contaminés à l’agent orange, destiné à détruire le maquis et stopper la guérilla communiste lors de la guerre du Vietnam.
Tribunal d’Evry, mai 2021. Tran To Nga a 79 ans et cela fait 6 ans qu’elle attend l’ouverture de ce procès intenté à l’encontre de 14 multinationales, semeuses de souffrances et de morts et représentantes de l’impérialisme occidental. Des millions de corps exposés et contaminés à l’agent orange, destiné à détruire le maquis et stopper la guérilla communiste lors de la guerre du Vietnam. C’est la période des guerres qu’Angelica Kiyomi Tisseyre Sékiné nous raconte minutieusement. Accompagnée d’images d’archives et de vidéo, elle décrit le paysage, l’engouement, la force et le courage, l’enthousiasme, la peur, le désarroi. Le climat de guerre, la tension mais aussi les joies, les liens qui se nouent, les vécus qui s’embrasent et s’entrelacent. Elle nous embarque avec elle dans les galeries souterraines, dans la forêt vietnamienne, on traverse le pays avec elle et ses compagnons d’unité, on vibre avec elle lorsqu’elle retrouve sa sœur, puis sa mère, on pleure la mort de son bébé, on craint les bombardements et puis on sent cette pluie gluante qu’elle reçoit sur les épaules et on sait que ce n’est pas un herbicide quelconque.
C’est la période des guerres qu’Angelica Kiyomi Tisseyre Sékiné nous raconte minutieusement. Accompagnée d’images d’archives et de vidéo, elle décrit le paysage, l’engouement, la force et le courage, l’enthousiasme, la peur, le désarroi. Le climat de guerre, la tension mais aussi les joies, les liens qui se nouent, les vécus qui s’embrasent et s’entrelacent. Elle nous embarque avec elle dans les galeries souterraines, dans la forêt vietnamienne, on traverse le pays avec elle et ses compagnons d’unité, on vibre avec elle lorsqu’elle retrouve sa sœur, puis sa mère, on pleure la mort de son bébé, on craint les bombardements et puis on sent cette pluie gluante qu’elle reçoit sur les épaules et on sait que ce n’est pas un herbicide quelconque.