Célian Ramis (ouverture avec Maryse Berthelot)
Poils et tétons : rien à cacher !


Couvrez ces tétons et lissez vos guiboles ! Soyez décentes, Mesdemoiselles et Mesdames. Un peu de « bon sens », bordel de cul ! Nos gouvernants l’exigent de vous. Conformez-vous. Et éduquez vos filles pour que dès à présent, elles adoptent une tenue républicaine.
Sortez du droit chemin, de ces prétendu-e-s « codes » et « réglementations » - invoqué-e-s pour clore une polémique, lancée accessoirement par nos dirigeants qui surenchérissent à leur propre connerie – et vous serez punies. WTF les gars ? Nos corps, nos choix !
Nous sommes en 1830. Eugène Delacroix vient de peindre La liberté guidant le peuple. Au centre de son tableau, entourée d’hommes, trône Marianne, dans le feu de l’action, une arme dans une main, un drapeau français dans l’autre. Elle est conquérante. Elle est puissante cette femme du peuple à l’allure de déesse grecque.
Nous sommes en 2020. Elle tourne la tête, interloquée par cet homme qui charge son fusil et le pointe dans sa direction : « C’est tenue correcte exigée ici. Range-moi ce nibard ! Et puis baisse le bras, sérieux, la touffe de poils accrochée à ton aisselle, ça fait dégueu. T’es pas une meuf ou quoi ? » Alors, Marianne rentre chez elle, la mine blafarde.
Elle enfile un vieux futal troué, un tee-shirt « Sans Hermione, Harry serait mort dans le tome 1 », monte sur les barricades en courant, brandi son bras, tend son poing en l’air, lève le majeur et crie « Liberté, égalité, sororité ! »
Les femmes ont des tétons et des poils. Les hommes ont des tétons et des poils. Jusque là, tout va bien. Nous sommes bel et bien de la même espèce. Oui, mais quand on parle des hommes et des femmes, on aime bien jouer au jeu des 7 différences, histoire de légitimer la hiérarchisation existante.
Sinon les arguments misogynes et sexistes ne tiennent plus et ça, c’est franchement (pas) dommage. Ainsi, il a été décidé que le poil serait viril et, par conséquent, masculin. Le couperet tombe et rase les poils naissant sur le corps des femmes. Pour les tétons, c’est une autre histoire.
Car quand ils sont sur le corps d’une femme, ils cristallisent à eux seuls les deux figures féminines que l’on voudrait opposer : la mère et l’amante. Ce qui nourrit l’enfant dans les premiers mois de vie – ou années, ou jamais - alimente également le fantasme masculin et dans les deux cas, on exige que cela se passe dans l’intimité de l’espace privé. Les seins, il faut les deviner.
Entrevoir cette chair ferme et galbée, c’est - dans l’imaginaire collectif intégré par la majorité des individus - une mise en bouche pour ces Messieurs. Comment résister quand les tétons se mettent à pointer ou qu’on peut à travers le vêtement les voir se dessiner ? Il est plus facile de blâmer la femme considérée comme une tentatrice : qu’on la foute au bucher ! Non mais sérieusement ?
ÇA DÉRANGE, POILS AUX PHALANGES ?
Ils dérangent ces poils et ces tétons, voire ces poils aux tétons. On ne veut pas les voir sur le corps des femmes, sous peine de s’octroyer le droit de juger, d’insulter, d’harceler, voire de menacer et de punir, les personnes concernées. Début septembre, Mélanie poste sur Twitter une photo d’elle.
Elle reçoit pendant plusieurs jours des milliers de messages haineux et insultants. Sur la photo, on voit ses poils. C’est ça qui choque. C’est ça qui donne la gerbe. C’est ça qui, pensent ses assaillant-e-s, leur donne le droit de la menacer de mort. Nombreuses sont les réactions inverses, créant ainsi le mouvement #JeGardeMesPoils. Heureusement.
Mais dans la réalité, les femmes qui affichent et assument leurs poils sont encore minoritaires, par rapport au nombre de bouches qui condamnent et de doigts qui pointent ces dangereuses sorcières, ces traitresses de leur sexe et de leur genre ! Elles transgressent la norme, elles sont coupables.
Elles laissent sur leur corps ces poils qui poussent là, naturellement, sans qu’elles n’aient rien demandé mais sans qu’elles n’aient rien fait non plus pour les y empêcher. C’est barjot ? Oui, complètement. On vit dans un monde où ne pas s’épiler quand on est définie en tant que femme provoque un scandale.
On vit dans un monde où la plupart des femmes enlèvent leurs poils en pensant qu’il s’agit là d’une corvée ainsi que de temps (et d’argent) perdu. Elles le font parce qu’on leur a appris qu’il fallait en passer par là pour être une femme. Elles le font par conformisme d’abord, par habitude ensuite.
Elles le font parce que sinon, elles seront rappelées à l’ordre. Elles le font par peur d’être rappelées à l’ordre. Par peur de ne plus plaire. Parce qu’on leur apprend à plaire aux autres avant elles-mêmes. Et le poil, il ne plait pas.
Mais à qui est-ce qu’il ne plait pas ? À partir de quel moment demande-t-on aux personnes définies et perçues comme appartenant à la gent féminine de retirer cette pilosité ? Et pourquoi se permet-on de rejeter, jusqu’à la haine, celles qui s’écartent de l’idéal du corps glabre (dépourvu de poils) ? Un idéal imposé, rappelons-le…
TERRIBLE ADOLESCENCE…
Les tétons, et les seins plus largement, viennent également interroger notre perception du féminin, de la féminité. De ce que doit être une femme et quels comportements, physiques et sociaux, elle doit adopter en société, à savoir dans l’espace public. Elle doit être sexy, donc sans poils.
 Parce que les poils sont considérés comme répugnants sur le corps d’une femme. Mais elle ne doit pas être trop sexy, donc sans tétons apparents parce que les tétons sont considérés comme excitants sur le corps d’une femme. D’un autre côté, ils sont aussi la source par laquelle peuvent se nourrir les bébés.
Parce que les poils sont considérés comme répugnants sur le corps d’une femme. Mais elle ne doit pas être trop sexy, donc sans tétons apparents parce que les tétons sont considérés comme excitants sur le corps d’une femme. D’un autre côté, ils sont aussi la source par laquelle peuvent se nourrir les bébés.
Quelle ambivalence alors face à ce sein si fantasmé et hypersexualisé, que l’on brandit et que l’on offre à la bouche du nourrisson ! C’est à en choper le tournis de constater la brutalité de l’effet provoqué par un allaitement en terrasse de café ou par un téton pointé sous un tee-shirt.
On pense que durant l’enfance, les différences entre les filles et les garçons ne sont pas perçues à travers le sexe (on se fourvoie, clairement, iels apprennent à les distinguer). La puberté accroit cet l’écart, créé par le regard de la société et des adultes. La voix qui mue, les poils qui poussent, les seins qui se développent, les menstruations, l’acnée… L’adolescence, c’est terrible. D’autant plus si notre corps ne se moule pas dans la norme de ce que doit être un homme et dans la norme de ce que doit être une femme.
Pour la première catégorie, la masculinité hégémonique exige une voix qui mue vers une tonalité grave et une peau qui se recouvre de poils. Pour la seconde catégorie, la féminité unique impose une peau lisse et douce et des seins fermes et galbés, assez gros de préférence, mais tout dépend de la décennie dans laquelle on grandit…
Que se passe-t-il dans la tête des filles quand elles découvrent que leurs seins poussent de manière aléatoire et anarchique ? Que leur poitrine ne se développe pas comme celles des copines ou comme celles des égéries des publicités et des magazines féminins ? Que ressentent celles qui ont principalement joué et trainé avec les garçons durant toute la primaire et qui, au moment même où apparaissent deux piqures de moustique sous le tee-shirt, sont envoyées sur la touche ?
Il n’y a qu’à voir Tomboy de Céline Sciamma ou lire Lily a des nénés de Goeff pour constater que les seins qui poussent sur le corps des filles sont motifs d’exclusion et de rejet. Elles ne peuvent plus faire partie de la bande de mecs qui jusque là les traitaient comme des copains.
Pourquoi les seins des filles et des femmes constituent-ils un prétexte de mise à l’écart, une source de débat et de discrimination et pourquoi complexent-ils celles qui les portent ? Les questions se bousculent et s’entremêlent au fur et à mesure que s’accumulent dans l’actualité des informations plus aberrantes les unes que les autres.
UNE HISTOIRE SANS FIN…
Il y a les publications sur les réseaux sociaux censurées parce que l’algorithme décèle que les photos dévoilent soi-disant trop de peau nue et/ou des tétons. En août 2019, Le Télégramme relatait le combat de la photographe Stéphanie Rouprich dont les pages ont été supprimées par Facebook parce qu’elle y publiait ses photos de nu artistique.
Pour les contourner, il faut placer des caches sur les tétons et/ou faire pression en dénonçant massivement le procédé (et encore…). Et puis, il y a, en juillet 2020, ce sondage Ifop, réalisé pour Xcams auprès d’un échantillon de 3 000 français-es, sur le « no bra », le fait de ne plus porter de soutien-gorge.
Il révèle que pour 20% des interrogé-e-s « le fait qu’une femme laisse apparaître ses tétons sous un haut devrait être, pour son agresseur, une circonstance atténuante en cas d’agression sexuelle ».Traduction : elle l’a bien cherché ! Au même titre que si elle porte une jupe et/ou un décolleté et/ou qu’elle sort le soir dans les bars et/ou qu’elle s’alcoolise et/ou qu’elle rentre chez elle toute seule durant la nuit…
Il y a ce que les médias ont qualifié de « tétongate » : Anaëlle Guimbi est évincée de l’élection de Miss Guadeloupe (en vue de l’élection de Miss France 2021) pour avoir posé seins nus dans le cadre d’une campagne de dépistage du cancer du sein. Il y a aussi cette polémique qui nait le 20 août 2020 sur la plage de Sainte-Marie-la-Mer, là où deux gendarmes vont contraindre plusieurs femmes pratiquant le topless à mettre un haut de maillot de bain car cela choquerait soi-disant des enfants.
La gendarmerie parle de « maladresse » et explique que dans un souci d’apaisement, il a été demandé « aux personnes concernées si elles acceptaient de couvrir leur poitrine après leur avoir expliqué le sens et l’origine de leur démarche. » Face aux forces de l’ordre, difficile de s’opposer.
Mais pourquoi dans un souci d’apaisement, ne va-t-on pas discuter avec cette famille ou ne leur propose-t-on pas d’aller s’installer sur une autre plage en leur expliquant que le topless n’est pas interdit sur cette plage, puisqu’aucun arrêté municipal ne le précise, et donc que les femmes peuvent libérer leurs seins si elles le souhaitent ? Pourquoi se permet-on de « demander » aux personnes concernées de mettre un haut de maillot de bain ?
Demande-t-on aux hommes d’enfiler un tee-shirt sur la plage parce que des enfants sont choqués de voir leurs tétons ? La ville de Paris pourrait-elle juger indécent le fait qu’un homme à Paris-Plages porte un slip de bain qui lui moule le paquet (le règlement interdit les strings et les monokinis, jugés comme des tenues indécentes) ?
Non. Ce sont toujours les femmes qui pâtissent des regards et des jugements hétéronormés sur leurs corps et tenues. Le fameux male gaze, dont parlent notamment Céline Sciamma et Iris Brey dans le cinéma.
TROP OU PAS ASSEZ… À QUI DE JUGER ?
On emmerde les femmes portant le burkini. On emmerde les femmes portant le monokini. Soit elles sont trop. Soit elles ne sont pas assez. Et même quand elles ne dévoilent pas entièrement leurs seins mais que ceux-ci sont confortablement installés dans un décolleté, on peut les juger trop présents, donc indécents et par conséquent, on interdira à la personne l’accès… au musée par exemple !
Sauf si elle accepte de mettre sa veste par dessus sa robe. C’est ce qui est arrivé à Tô’ – son nom d’utilisatrice Twitter – pas plus tard que le 8 septembre dernier à l’entrée du musée d’Orsay. Elle écrit dans une lettre ouverte :
« Je me demande si les agents qui voulaient m’interdire d’entrer savent à quel point ils m’ont sexualisée, obéissent à des dynamiques sexistes, et si le soir en rentrant ils estiment avoir été dans leur bon droit de ne pas respecter les miens. Je questionne la cohérence avec laquelle les représentants d’un musée national peuvent interdire l’accès à la connaissance et la culture sur la base d’un jugement arbitraire qui détermine si l’apparence d’autrui est décente. Je ne suis pas que mes seins, je ne suis pas qu’un corps, vos doubles standards ne devraient pas être un obstacle à mon droit d’accès à la culture et la connaissance. »
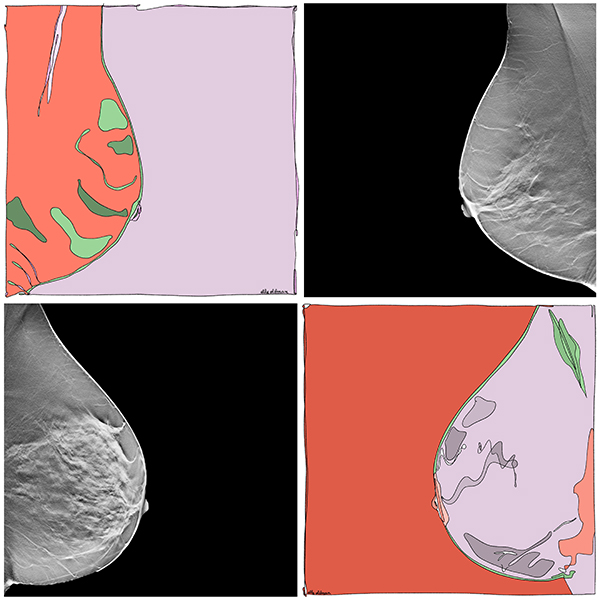 Voilà un discours qui s’applique également aux dirigeant-e-s d’établissements scolaires interdisant l’accès à l’enseignement aux collégiennes et lycéennes qui portent des croc tops, des jupes courtes et des shorts en raison de la potentielle excitation que cela pourrait provoquer du côté des élèves masculins…
Voilà un discours qui s’applique également aux dirigeant-e-s d’établissements scolaires interdisant l’accès à l’enseignement aux collégiennes et lycéennes qui portent des croc tops, des jupes courtes et des shorts en raison de la potentielle excitation que cela pourrait provoquer du côté des élèves masculins…
Ainsi donc les filles et les femmes entraveraient les valeurs et le fonctionnement de la République de par les tenues qu’elles portent ou du soutien-gorge qu’elles ne portent pas. Le sujet est placé actuellement au cœur du débat. Mais c’est aux hommes que l’on demande de s’exprimer. Jean-Michel Blanquer, Emmanuel Macron, Alain Finkielkraut… Ce sont leurs paroles, leurs opinions, leurs conseils avisés qui en appellent au « bon sens » et à « la tenue républicaine », que l’on sollicite et que l’on répand dans la presse.
Les femmes, encore une fois, n’ont pas voix au chapitre. Leur corps sont comme toujours étalés et jugés sur la place publique. Ils sont coupables ! Ils excitent les hommes avec leurs petits, moyens ou gros tétons ronds qui transpercent leurs hauts. Ils répugnent les hommes avec leurs poils drus, bouclés ou colorés qui s’affichent sous leurs aisselles, sur leurs jambes, leurs bras ou encore leurs pubis.
Elles n’ont pas choisi mais elles sont condamnées. Leur châtiment : intégrer l’idée que leur corps ne leur appartient pas et se soumettre en permanence aux injonctions paradoxales qu’on leur assaille depuis la petite enfance. Tout ça, en silence. Evidemment. Pourtant, ce sont bel et bien leurs voix qui devraient être entendues, qui devraient compter.
LE SOUTIF : DEPUIS QUAND ET POURQUOI ?
« J’ai dû commencer à en porter vers 12-13 ans je pense… Je n’en suis même pas sûre. C’est ma mère qui a pris l’initiative de m’en faire porter. C’était juste des soutiens-gorge sans armature. Après réflexion, ça devait sûrement être pour éviter qu’on me fasse des remarques ou qu’on voit les tétons qui pointent. » Camille, 25 ans.
« J’ai commencé à en porter à partir de la 6e/ 5eje dirais… Je crois que lorsque j’ai commencé à vouloir porter des soutiens-gorge, c’est parce que je souhaitais avoir de la poitrine. Clairement vu la petitesse de ma poitrine de l’époque, je n’en avais pas d’utilité physique. », Lise, 22 ans.
« Au début, à mes 11 ans, parfois j’oubliais d’en mettre mais plus ma poitrine se formait, plus j’avais des remarques de mes copines de mon âge qui me disaient que je devais en porter. Par la suite, c’est devenu une habitude, une norme, je ne me voyais pas sans. Il faut savoir que toutes mes représentations féminines autour de moi en portaient un et critiquaient celles qui n’en portaient pas. » Audrey, 22 ans.
« Je ne sais plus bien exactement (quand j’ai commencé à en porter), au collège, je dirais, vers 13 ans peut-être. Je crois hélas que ça a été systématique, comme la majorité des jeunes filles aujourd’hui, on fait comme tout le monde, on ne se pose la question, c’est la normalité, on se sent devenir femme en portant cette camisole ! On parle plus aux jeunes filles de mettre un soutif que de leurs premières règles ! » Laura, 32 ans.
« J’ai commencé à la fin du collège, quand un garçon m’a dit qu’on voyait mes tétons à travers mon tee-shirt. »
Nina, 35 ans.
« J’ai porté des soutiens-gorge pendant environ 14/15 ans. Je me souviens qu’à l’époque du collège, c’était vraiment important pour l’image, d’avoir des bretelles de soutien-gorge visibles, qui dépassaient des débardeurs. C’est à ce moment que j’étais très heureuse d’avoir des brassières, puis de véritables soutiens-gorge. Sans nécessité autre que l’image que ça pouvait me renvoyer. D’ailleurs je ne me suis dit jamais posé la question de l’utilité, c’était simplement une étape vers « la vie de femme ». » Enthea, 30 ans.
« J’ai mis très longtemps à en porter : pré ado, adolescente, je n’avais que des très petits seins (bonnet A trop grand) et ne voyais donc pas l’utilité du « soutien ». J’ai dû commencer vers 17 ans. Ensuite adulte, j’en ai porté (mais avec de grandes difficultés pour trouver une taille adéquate et confortable – bonnets trop grands / molletonnés tout en ayant un tour de torse trop serré – brassières disponibles seulement pour enfants…) pour des occasions particulières : port de robes moulantes, de vêtements transparents, allaitement. Ce n’est que la pression sociale (camarades filles de l’école, du collège, du lycée) qui m’a poussée à demander à en porter, pour faire « comme les autres », pour m’intégrer.
Par exemple, à l’âge de 11 ans, j’ai été la seule fille à me présenter à la piscine uniquement en slip de bain lors du 1erjour des séances scolaires. Le haut du maillot bikini n’est pas un soutien-gorge en soi mais en l’occurrence il a cette fonction de cache seins. Ensuite, adulte, la pression de « conformité » a continué. Femme mariée, puis vivant en union libre, je mettais donc un soutien-gorge pour « remplir » les vêtements que je portais à l’endroit adéquat, pour ressembler à l’image que je pensais devoir montrer pour être une femme, mais seulement de façon ponctuelle quand le « flottement » était trop flagrant, tout en étant complexée, en attendant que le fait d’avoir des enfants « me les fasse pousser » (je sais c’est bizarre… Scoop : ça n’a pas fonctionné) » Béa, 56 ans.
« Au début de ma transition, ça me faisait plaisir de porter un soutif.»
Gwenn Loona, 43 ans.
« J’ai commencé à avoir de la poitrine tôt, environ en CM2. Ça ne me dérangeait pas mais je jouais beaucoup avec les garçons, je n’étais pas pudique sauf qu’un jour, on se déguisait et je me suis changée devant eux, sans trop penser au fait que je commençais à avoir des seins. Ils ont vu, ils étaient gênés donc ça m’a gênée aussi. Je me suis ensuite dit que si je portais un soutien-gorge, ce serait mieux. » Léna, 21 ans.
« Avec le traitement hormonal, j’ai eu une poitrine naissante à 18 ans. J’étais excitée de voir mon corps se transformer comme je le souhaitais. J’ai mis un soutien-gorge bien push up ! C’était un moyen de mettre en avant ma poitrine, c’est un symbole de la féminité. J’en rêvais depuis le début de mon adolescence, surtout que ma jumelle, elle, en portait. Du coup, j’en portais tout le temps sauf pour dormir. Le reste du temps, c’était inconcevable de ne pas en porter. Ça me légitimait en tant que femme. » Vanessa, 28 ans.
« Pour moi, c’était normal d’en porter. J’ai grandi, j’ai eu des seins, j’ai eu honte. Ma mère était seins nus sur la plage pourtant mais une fille m’a dit « Tu mets pas de soutien-gorge ? ». Finalement, on ne se pose pas de question la première fois qu’on enfile un soutien-gorge. Alors qu’il n’y avait pas d’injonction à ça dans ma famille. Je l’ai fait pour être comme tout le monde, pour être comme les filles de mon âge. » Eva, 25 ans.
PASSAGE OBLIGÉ…
Pour notre enquête journalistique, nous avons interrogé 32 personnes concernées par les injonctions à l’épilation et au port du soutien-gorge (lire notre encadré sur le sujet). Sur l’ensemble des réponses, 100% des personnes ont indiqué avoir déjà porté un soutien-gorge, une brassière ou une bralette.
Lors de la puberté, majoritairement, pour les femmes cisgenres, lors de la transition, pour les femmes transgenres. Avec ou sans armatures, les répondant-e-s expliquent que ce geste, parfois attendu avec impatience lors de l’enfance, est souvent motivé par l’envie de « faire comme les grandes », par « mimétisme ».
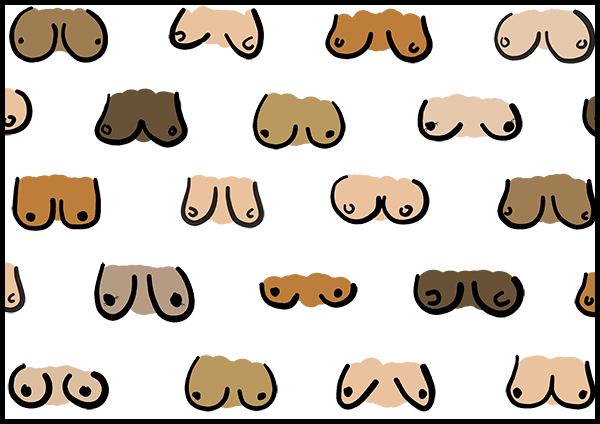 Il peut aussi être « un mal nécessaire », selon les situations, comme en témoigne Loreleï, 42 ans : « J’ai une taille qui varie du 40 au 44. Mon soutien-gorge affiche 90D/E le plus souvent, même lorsque je descends à mon poids minimal, je reste à 90D. J’aurais aimé pouvoir ne pas porter cet accessoire qui trop souvent est inconfortable, même dans les grandes marques. J’ai essayé les corsets, les brassières, tous les modèles plus ou moins vantés pour leur confort. C’est malheureusement très onéreux pour un résultat aléatoire. Le poids de ma poitrine trop sensible se répercute sur les bretelles, générant du petit inconfort à la blessure (taches violettes, abrasions) car j’ai aussi la peau très sensible. Malheureusement, si je me passe de tout soutien, ma poitrine attirée par la gravité tire sur les tissus et mes seins deviennent douloureux au moindre mouvement. Je passe invariablement la fin de la journée les bras croisés, quasi sans bouger. »
Il peut aussi être « un mal nécessaire », selon les situations, comme en témoigne Loreleï, 42 ans : « J’ai une taille qui varie du 40 au 44. Mon soutien-gorge affiche 90D/E le plus souvent, même lorsque je descends à mon poids minimal, je reste à 90D. J’aurais aimé pouvoir ne pas porter cet accessoire qui trop souvent est inconfortable, même dans les grandes marques. J’ai essayé les corsets, les brassières, tous les modèles plus ou moins vantés pour leur confort. C’est malheureusement très onéreux pour un résultat aléatoire. Le poids de ma poitrine trop sensible se répercute sur les bretelles, générant du petit inconfort à la blessure (taches violettes, abrasions) car j’ai aussi la peau très sensible. Malheureusement, si je me passe de tout soutien, ma poitrine attirée par la gravité tire sur les tissus et mes seins deviennent douloureux au moindre mouvement. Je passe invariablement la fin de la journée les bras croisés, quasi sans bouger. »
Dans la plupart des cas, les jeunes filles semblent intégrer l’idée qu’enfiler un soutien-gorge est un passage obligé, non pas pour le confort et la santé, mais pour la symbolique qu’il représente : il est un des leviers qui nous propulse vers le statut de femme.
ET LES POILS, MÊME COMBAT ?
Et qui dit femme, dit imberbe. Surprenant puisque la journaliste et autrice Morgane Soularue nous apprend dans son livre Cheveux et autres poils que « filles et garçons ont le même nombre de follicules pileux (petit trou sur la peau dans lequel le cheveu et le poil naissent. Toute notre peau ou presque en contient.) : 4 millions environ, placés aux mêmes endroits du corps. »
Ainsi, les cheveux apparaissent à la naissance et le reste de la pilosité survient à la puberté. Là, les hormones s’en mêlent : « Le corps des garçons produit plus d’hormones androgènes, comme la testostérone. Et plus on a de testostérone, plus on est poilu… »
Globalement, le corps des femmes compte moins de poils (toutefois, on sait qu’en raison du syndrome des ovaires polykystiques par exemple, une pilosité importante est susceptible de se développer) mais il en compte quand même. Problème : « Un peu tabous, les poils véhiculent un tas d’idées reçues. On a tendance à les associer à un manque d’hygiène, en particulier sous les bras, car on les croit responsables de la transpiration. »
Un argument que l’autrice dément immédiatement après. Toutefois, même si le poil n’a rien à voir là-dedans, la pilosité est genrée et le rasoir devient dès la puberté un autre levier nous propulsant vers le statut de femme (et qui nous fait payer plus cher, merci la taxe rose…).
Parmi les 32 répondant-e-s, 25 ont témoigné de leur rapport à leurs poils. Tout comme pour le port du soutien-gorge, 100% des personnes ont indiqué avoir déjà eu recours à l’épilation.
« Par peur du regard des autres. » Manon, 24 ans.
« Par souci esthétique et d’intégration. » Elodie, 25 ans.
« Je détestais les poils et j’avais l’impression d’être sale. Je l’ai ressenti (la pression, l’obligation à l’épilation) à mon adolescence et quand j’ai commencé à avoir des rapports sexuels. » Gaëlle, 39 ans.
« En y réfléchissant, c’était sûrement par mimétisme et parce que je me sentais obligé.e à cause de la pression de la société. » Ange, 24 ans.
« Pour faire comme tout le monde car je ressentais le regard des autres notamment au lycée et au collège. Ayant une maman qui ne s’épile pas, j’ai eu un modèle qui me disait « fais ce que tu veux » mais je n’ai pas compris tout de suite son message, j’avais honte quand elle levait les bras. Dès mes 13 ans, j’ai commencé à me raser les aisselles, les jambes, l’entrejambe. » Audrey, 22 ans.
 « À l’adolescence, je me suis épilée les aisselles à cause des odeurs de transpiration. Entre 18 et 25 ans, je me suis épilée les jambes ou le sexe pour la piscine (pression sociétale) ou pour les relations intimes. » Sophie, 31 ans. « Au collège, j’avais des poils sous les bras. J’étais hyper fière et ma meilleure pote m’a prise à part pour me dire de les enlever. Je suis passée de la fierté à la honte. Je me suis sentie tellement bête. » Eva, 25 ans.
« À l’adolescence, je me suis épilée les aisselles à cause des odeurs de transpiration. Entre 18 et 25 ans, je me suis épilée les jambes ou le sexe pour la piscine (pression sociétale) ou pour les relations intimes. » Sophie, 31 ans. « Au collège, j’avais des poils sous les bras. J’étais hyper fière et ma meilleure pote m’a prise à part pour me dire de les enlever. Je suis passée de la fierté à la honte. Je me suis sentie tellement bête. » Eva, 25 ans.
« Pour ne pas être stigmatisée, rentrer dans le moule. J’ai eu une puberté précoce. J’étais complexée et dans ma famille, il y a un tabou autour de la puberté. Je voyais ma grande sœur qui était tout le temps épilée alors j’ai commencé à le faire, en piquant ses outils. » Chloé, 29 ans.
« Une meuf au lycée m’a dit que ça la gênait. Je me suis épilée. Ma mère aussi me met la pression sur mes poils. Mais moi je les aime mes poils ! » Loona, 20 ans.
« J’ai eu un mec gros connard. Au lieu de me dire ce qu’il aimait ou ce qu’il n’aimait pas, il me l’a dit par texto, avec des émoticônes : Mouton – Ciseaux – Cochon – Aubergine – Abricot. Traduction : avec mes poils, je suis dégueulasse, une fois épilée, il pourra me baiser. » Elly, 30 ans.
Grande classe…
INJONCTIONS, INJONCTIONS, INJONCTIONS
Les réactions sont variées mais sans appel. Le kit de la féminité se compose de maquillage, d’un lisseur, d’un rasoir, de crème dépilatoire, de tampons, serviettes ou coupes menstruelles, d’un soutien-gorge avec ou sans armature ou encore une brassière… Et on le vend aux jeunes filles de plus en plus tôt comme en témoigne notamment Florence Braud, fin août, sur Twitter :
« Tu as 8 ans, tu mesures environ 128 cm, tu joues encore aux petites voitures et à la dinette, mais surtout, surtout, n’oublie pas de mettre ta brassière rose REMBOURRÉE pour ta rentrée en CE2 !!! #SexismePasNotreGenre. » Elle accompagne la publication d’une photo de la dite brassière rose rembourrée « Girls by Athena » et poursuit : « Sérieusement, c’est quoi l’idée ? Quel est le message envoyé aux gamines de 8 ans ? À quel moment une marque se dit que oh, et si on faisait complexer les fillettes qui n’ont pas de seins ? (Parce que oui, c’est bien connu, à 8 ans c’est important d’avoir des seins…). »
Quatre ans plus tôt, elle avait déjà rédigé un billet de blog sur le sujet et songe que dans quatre ans, il sera toujours d’actualité. La discussion s’anime sur le réseau social. De nombreuses femmes commentent, scandalisées elles aussi par le produit fustigé mais majoritairement, elles témoignent de la difficulté, voire de la « galère » à trouver un haut de maillot de bain non rembourré pour les pré-adolescentes et les adolescentes.
Rares sont celles qui s’indignent au même titre que Florence Braud qui recadre parfois le débat : « Plusieurs personnes me répondent dans les commentaires (de manière parfois agressive) que les coques servent « à cacher les tétons qui pointent ». Ok. En quoi est-ce un problème des tétons qui pointent à 8 ans ? Et même, à 20, 40 ou 80 ans ? »
Injonction à porter un soutien-gorge, injonction à cacher ses tétons, injonctions à épiler ses poils… « Les injonctions sont de plus en plus nombreuses et surtout de plus en plus précoces. », nous signale Camille Froidevaux-Metterie, philosophe féministe et autrice. Celle qui a écrit La révolution du féminin dédie un chapitre aux seins quelques années plus tard dans Le corps des femmes – la bataille de l’intime, puis récemment tout un livre intitulé Seins – En quête d’une libération.
Parce qu’elle a découvert et pris conscience que les seins sont singulièrement absents des initiatives de réappropriation du corps, « grands oubliés de la dynamique d’émancipation » comme elle le formule en titre de son introduction.
« Il est important de replacer le féminisme dans le temps long de l’histoire. Les années 1970 ont été celles du second grand moment féministe (après la bataille pour le droit de vote), celui qui visait à libérer les femmes du carcan de leur corps procréateur. Mais, dans les décennies qui ont suivi, ces sujets corporels ont disparu du champ féministe. Depuis le début des années 2010, une nouvelle génération de féministes se ressaisit de chaque centimètre cube du corps des femmes. La dynamique à l’œuvre est puissante.
Elle témoigne de ce que les femmes ont décidé de se réappropier leurs corps sexués et intimes, sur le versant négatif de la lutte contre les injonctions objectivantes comme sur le versant positif de l’exploration de toutes les dimensions de nos vies incarnées. On ne se défait évidemment pas rapidementde décennies de formatage mais le foisonnement des initiatives me fait penser que les plus jeunes ont de la chance.», explique-t-elle.
Dans son livre Seins – En quête d’une libération, Camille Froidevaux-Metterie donne une place prépondérante aux vécus et ressentis des femmes qui témoignent et à leurs seins, photographiés toujours nus, toujours de deux manières : en portrait, le corps orienté de ¾, et en portrait encore mais avec les mains dans le champ. Jamais le visage n’apparaît :
« Les seins peuvent être comme des visages. Après avoir fait le portrait des seins, je demandais aux femmes de faire entrer leurs mains dans le cadre, cela faisait entrer une partie de leur personnalité mais aussi leurâge. »
On lit l’ouvrage et on respire. Nos seins sont tous différents. D’une diversité infinie, comme le dit et le démontre l’autrice. C’est la représentation que l’on en fait qui est unique. Les seins, en forme de demi pomme, bien ronds, fermes et galbés, « ce sont des seins irréels, ils existent évidemment mais de manière minoritaire. »
GROSSE PRESSION, GROS COMPLEXES
Visant à faire croire qu’ils constituent la norme, il s’agit là d’un idéal, impossible, à atteindre. En pratique, ça donne source à de nombreux complexes. Comme en témoigne Julie, 30 ans :
« À l’adolescence, j’étais très complexée par ma petite poitrine asymétrique. J’enviais beaucoup ma sœur et son bonnet D, et je pensais qu’en portant de gros push-up (parfois même en dormant), j’allais « dresser » mes seins à remonter. Après des années de baleines douloureuses et de bretelles tombantes insupportables, je suis passée aux brassières rembourrées. Je voulais des seins ronds, bien dessinés. J’avais une idée très précise de ce que devait être le corps de la femme, aussi bien au sujet de la poitrine que de toutes les autres parties de son corps. Je n’étais d’ailleurs pas très heureuse dans ma peau puisque le reflet du miroir était loin de me renvoyer l’image de cette femme idéalisée. »
Elle nous précise ensuite :
« Au sujet de ce corps féminin idéalisé : le premier modèle a été ma mère : mince, fine de visage, sensuelle sans être apprêtée, plutôt menue, la poitrine bien présente sans être imposante. J’ai grandi en entendant que je ressemblais surtout à mon père. À l’adolescence, cet idéal s’est cristallisé autour de ces jeunes filles minces, le ventre hyper plat, la poitrine haute et le corps ferme. Bonjour clichés… Je ne fais pas dans l’originalité, mais c’est un modèle qui m’a été imposé par les pages « ados » du catalogue La Redoute quand je commandais des vêtements, les actrices de mon âge qui jouaient dans les films à succès, les copines de classe qui restaient minces et attirantes. Et ce, toujours au naturel. »
Jeunes, on se compare et on se soumet à la pression d’une société qui depuis longtemps objective le corps des femmes. Dans Seins – En quête d’une libération, Camille Froidevaux-Metterie écrit :
« L’apparition des seins est aussi immaîtrisable qu’inéluctable, elle inscrit la fille dans une histoire qui est à la fois la sienne propre et celle de toutes les femmes, une histoire dont le cours est par ailleurs inflexible. Elle peut se couper les cheveux, ne porter que des pantalons, refuser tout signe extérieur de féminité, elle ne pourra se défaire de ses seins, sauf à se faire opérer. Têtue, leur présence figure l’évidence d’une condition sexuée définie à l’aune de l’ordonnancement phallocentré du monde. On peut dire que les seins fonctionnent tout à la fois comme l’augure, la preuve et l’emblème de la féminité entendue comme un mixte de disponibilité sexuelle et de dévouement maternel.
Leur renflement indique que la fille est désormais soumise au regard des hommes, bientôt prête à « accueillir » leurs mains et leurs sexes, susceptible d’être fécondée. Personne ne l’annonce en ces termes mais les concernées le savent et développent des comportements qui en témoignent : honte, dissimulation, comparaison, détestation ou, à l’inverse, exposition, exaltation, séduction, jouissance. Les seins signifient, et imposent même, la présence inesquivable du féminin. »
RÉÉDUCATION DES MENTALITÉS
Le féminin, et c’est là que se niche la problématique, est une construction sociale. La société l’associe à la douceur, au calme, au côté maternel, à tout ce qui s’apparente au soin et à l’aide aux personnes mais aussi à la nature, etc. Les petites filles sont éduquées en direction de cette idéal de féminité : les cheveux longs, lisses, éventuellement noués d’un ruban rose, portant des robes et des chaussures vernies, elles ne font pas de bruit, sont studieuses et sérieuses, toujours prêtes à aider leur prochain, à consoler leurs camarades, elles jouent à la poupée et à la dinette quand elles ne sont pas occupées à lire des bouquins (de préférence sur les chevaux et les dauphins) et elles n’ont aucun sens de l’orientation (oui, nous aussi on s’est étouffé en l’écrivant).
 En grandissant, elles apprendront qu’elles sont faites pour créer la vie et éduquer les enfants… et entretenir la maison… et satisfaire leur mari. Depuis quelques années, elles doivent également réussir à tout prix leur carrière professionnelle (sans non plus dépasser Monsieur…).
En grandissant, elles apprendront qu’elles sont faites pour créer la vie et éduquer les enfants… et entretenir la maison… et satisfaire leur mari. Depuis quelques années, elles doivent également réussir à tout prix leur carrière professionnelle (sans non plus dépasser Monsieur…).
Notons donc qu’en 2020, la vision (rétrograde) hétéronormée domine toujours le monde et la féminité s’incarne désormais dans un méli mélo mêlant Blanche-Neige et Wonder Woman, une Barbie des temps modernes. Et cette dernière n’a ni tétons, ni poils. En plus de 50 ans, les femmes ont conquis des droits et des libertés pour elles et leurs corps. Mais elles n’y sont autorisées que dans une certaine mesure.
« Les femmes apprennent à bien gérer leur corps. Par exemple, on intègre l’idée qu’il faut être bien épilée avant un rendez-vous. C’est une injonction qui bride la sexualité féminine. Il y a un lien entre femme objectivée et femme épilée. Le poil, il dérange énormément sur le corps d’une femme. Cette barrière franchie qu’on ne veut pas voir dérange la virilité de ces messieurs ! Je trouve ça très intéressant de pouvoir repenser les genres. », explique Enthea, photographe et co-fondatrice, avec Amandine Petit-Martin, du projet de rééducation visuelle collective Soyeuses, à suivre sur Internet et sur Instagram.
Elle trouve que les poils au soleil, c’est beau : « Mais c’est souvent l’été qu’on complexe par rapport à ça. En même temps, on nous apprend depuis qu’on a 10 – 12 ans qu’il faut enlever nos poils… Alors quand vient la saison des shorts et des jupes… »
Partout autour de nous, dans les magazines, sur les panneaux publicitaires, en couverture de bouquins et de BD, dans les clips, les séries et les films, les femmes sont sans poil. L’objectif de Soyeuses : proposer de nouveaux modèles. Avec des femmes non épilées.
« Je ne fais pas des photos à la chaine. Je travaille avec un-e modèle, pas avec une statue. On discute beaucoup avant que je fasse les photos. On échange, on tourne autour du sujet. C’est hyper important de les photographier en tant que sujets. On a toutes une histoire, on a toutes des histoires différentes. Et le poil est là au milieu de tout ça. On a toutes une pilosité différente. Des cheveux longs, des poils courts, très marqués ou invisibles… », souligne Enthea.
La première photo visible sur le site montre une femme au crane rasé et aux jambes poilues qui allaite son enfant. On scrolle et on découvre une série de photographies sublimes et captivantes. Toutes les femmes y sont différentes. Leur pilosité aussi. Ce qu’on regarde, c’est l’ensemble de la photo. On ne focalise pas sur les poils qui souvent apparaissent dans un second temps. Ils sont de l’ordre du détail et n’ont rien de choquant.
« On veut montrer de nouvelles manières de vivre librement en tant que femmes. La question du poil est beaucoup tournée en dérision mais elle est très symptomatique de ce que l’on impose aux femmes. Faut qu’on puisse faire ce qu’on veut ! Mais ça prend du temps… Sur le poil, le regard n’est pas neutre encore ! »
précise la photographe.
UTILITÉ VS ESTHÉTIQUE & DOMINATION
La question de la représentation, de ce que l’on donne à voir des femmes, est cruciale. Elle traverse l’Histoire. Cheveux, barbes, types de coiffure… sont des marqueurs de rangs et de classes sociales. Ils désignent également notre appartenance à un groupe spécifique, une communauté, etc.
Mais ils véhiculent également des stéréotypes et des assignations, principalement genrés et sexués. Dans Cheveux et autres poils, Morgane Soularue rappelle la fonction des poils : « Nos cheveux et nos poils ne sont pas là pour rien, ni pour faire joli ni pour nous embêter. Très utiles, ils ont beaucoup à raconter et en disent longs sur nous. »
En effet, elle explique leur rôle d’isolants thermiques, permettant de réguler notre température corporelle selon les saisons et de protéger l’épiderme contre les rayons du soleil. Elle précise : « Si on a moins besoin de ce rôle isolant qu’à la préhistoire, le poil et le cheveu ont toujours un rôle social et esthétique. »
Les cils et les sourcils empêchent les impuretés et la sueur de rentrer dans nos yeux, les poils de nez et d’oreille barrent la route aux poussières extérieures et les poils sous les aisselles et sur les organes génitaux réduisent « les irritations et les inflammations liées aux frottements des vêtements, aux impuretés et plis de la peau. »
Toutefois, par souci esthétique, on exige de la moitié de l’humanité qu’elle éradique ces poils de la surface de sa peau, pubis compris ! « Dans les productions pornographiques des années 70, les mottes foisonnantes étaient pourtant légion. Le site web Waxing Nostalgic retrace en quelques photos les évolutions des pubis des playmates du magazine Playboyà travers les âges. Jusqu’aux années 80, elles dévoilent des sexes en totale liberté pileuse. À partir des années 90, le ticket de métro devient la norme. Au-delà de 2005, les poils ont totalement disparu. », écrit Stéphane Rose dans Défense du poil contre la dictature de l’épilation intime.
Quelques pages plus loin, il cite la psychanalyste Daniela Litoiu-Colliard : « depuis cinquante ans, les femmes se sont « masculinisées » en s’appropriant de plus en plus des rôles tenus jusqu’alors par les hommes. Elles sont désormais ministres, chefs d’entreprise, chefs de famille… Elles arrivent même à faire des enfants sans les hommes ! Leur imposer l’épilation permet aux hommes de conjurer la peur profonde qu’ils éprouvent face à la puissance de la femme et sa nature sauvage, incarnée par ses poils. Comme s’ils avaient peur d’être castrés par ces femmes… Le fantasme du sexe glabre qui renvoie à la pré-puberté rejoindrait-il celui de la puissance masculine qui ne peut se vivre devant une femme mûre et velue ? »
QUI DÉTIENT LE CORPS DES FEMMES ?
Les poils font débander les hommes, coupons-les (les poils…). Les tétons font bander les hommes, cachons-les (les tétons…). L’un comme l’autre, ils sont obscènes. Chez les femmes. Ils renvoient à la sexualité. Des hommes. Hétéros. Cisgenres. La norme absolue. La perfection. Le pouvoir. De détenir le corps des femmes. De déposséder les femmes de leurs propres corps.
« Pendant très longtemps, les femmes ont dû demeurer des corps « à disposition », dans les deux fonctions sexuelle et maternelle. En tant qu’organes de l’allaitement et organes de plaisir, les seins condensent ces deux fonctions. Ils ont un rôle instrumental dans la vie sexuelle, ils servent d’appâts. Pourexciteret attirer le regard, ils doivent être suffisamment visibles, suffisamment gros donc. Mais une fois la relation sexuelle engagée, les femmes regrettent que les seins ne soient pas suffisamment investis par leurs partenaires masculins. », analyse Camille Froidevaux-Metterie.
Montrer une partie des seins serait recommandé donc mais les aréoles et les tétons sont bannis de la vision autorisée. Pour toutes les raisons invoquées par la philosophe, le soutien-gorge est l’arme idéale : il permet de donner cette forme bien arrondie, cette impression de fermeté, cet effet de nichons remontés-collés-serrés et de dissimuler aréoles et tétons par la même occasion. Et va dès lors jusqu’à dissimuler les « vrais seins ».
On ne sait pas, on ne sait plus ce à quoi ressemble les poitrines des femmes qui tentent par divers procédés d’atteindre cette demi pomme, qui donnera tant envie aux hommes de croquer dedans. On complexe, on compare, on jalouse, on envie, on rejette, on fait des tours de passe passe, on négocie…
 On lâche l’affaire ? Pas dans une dimension d’échec, non, loin de là. Dans une dynamique de confort, d’émancipation personnelle, de militantisme collectif… Les raisons ne manquent pas à celles qui rejoignent Free The Nipple et No Bra. D’ailleurs, aucune obligation de revendiquer une appartenance à un mouvement, c’est là l’idée : avoir le choix. Avoir le choix de faire ce que l’on veut. S’épiler ou pas. Porter un soutif ou pas.
On lâche l’affaire ? Pas dans une dimension d’échec, non, loin de là. Dans une dynamique de confort, d’émancipation personnelle, de militantisme collectif… Les raisons ne manquent pas à celles qui rejoignent Free The Nipple et No Bra. D’ailleurs, aucune obligation de revendiquer une appartenance à un mouvement, c’est là l’idée : avoir le choix. Avoir le choix de faire ce que l’on veut. S’épiler ou pas. Porter un soutif ou pas.
Tout comme les seins ont des formes différentes, que les aréoles et les tétons varient d’une personne à l’autre dans leur couleur, texture, taille, que les poils poussent plus ou moins lentement, plus ou moins selon les endroits du corps, qu’ils sont fins ou drus, etc., les personnes qui ont témoigné auprès de la rédaction dans le cadre de ce dossier ont des raisons, des réactions, des ressentis et des vécus plus ou moins différent-e-s d’arrêter, progressivement, définitivement, par alternance ou pas du tout le port du soutien-gorge (de la brassière ou de la bralette) et/ou l’épilation.
Souvent, elles se rejoignent sur les injonctions subies en tant que personnes définies et/ou perçues en tant que femmes et leurs conséquences. Elles relatent des expériences communes dues à leur sexe et à leur genre mais font part de parcours personnels, résultant de leur émancipation individuelle mise en résonnance avec les réflexions collectives naissant autour du corps des femmes et de la réappropriation de celui-ci par les un-e-s et les autres.
PAS À PAS
Oui, le confinement a aidé certaines femmes à s’interroger sur leur rapport à leur corps. Plus précisément à questionner les diktats esthétiques qui pèsent sur la gent féminine, principalement. Elles ont pu expérimenter le naturel. Elles ont pu constater que le ciel ne leur tombait pas sur la tête lorsqu’elles laissaient leurs poils pousser et leurs seins en liberté.
Elles ont pu découvrir que leur poitrine avait réellement besoin de soutien ou au contraire que le soutien-gorge n’était qu’une contrainte supplémentaire vis-à-vis de leur corps. Il y en avait qui le savaient déjà et d’autres qui n’ont pas eu le temps / la chance / le loisirs / l’opportunité / l’envie / ou autre d’explorer le sujet. La démarche n’est pas neutre.
La déconstruction face aux assignations de genre et injonctions à la pudeur et à la dissimulation n’est pas appréhendée et vécue de la même manière par tou-te-s. De manière globale, les répondant-e-s ont démontré dans leurs récits un épanouissement incontestable à partir du moment où elles avançaient à leur rythme, selon leurs choix, décidés du jour pour le lendemain ou appliqués pas à pas. Il y a parfois un déclic. Parfois, non.
Pour Julie, 30 ans, c’est un séjour à la campagne. Pour Agathe, 24 ans, ce sont d’abord les périodes de vacances, puis le confinement. « Je fais du topless sur la plage, ça ne me dérange pas. Mais je suis surprise souvent d’être quasi la seule. Quand j’étais petite, on allait sur des plages nudistes et je me souviens qu’il y avait quasiment que des hommes. C’est surprenant quand même… Pendant les vacances, j’ai l’habitude d’abandonner le soutien-gorge. Pendant le confinement, je n’en mettais plus du tout. Par contre, je travaille avec des enfants et j’en mets dans ce cadre-là. Quand je sors, parfois, dans la rue, je le sens pas donc je préfère porter un bandeau. »
Pareil pour Vanessa, 28 ans : « Pendant le confinement, j’étais chez moi. Je n’avais pas besoin de sortir. À part pour faire quelques courses et je n’en mettais pas pour y aller. Je n’ai eu aucun regard particulier… Quand j’ai repris le boulot (en présentiel, ndlr), j’ai mis un soutien-gorge le premier jour mais je ne me suis pas sentie bien. Je sentais physiquement la différence. Dès le lendemain, je n’en ai plus mis. Si on voit mon téton, ce n’est pas grave, je ne montre pas mes seins ! Oui, une pointe peut apparaître mais je ne cherche pas à la faire apparaître.»
Pour Lucile, 33 ans, c’est la pratique du Qijong qui a été l’élément déclencheur, il y a quatre ans : « Quand il fallait écarter les bras, ouvrir le plexus solaire, remplir la cage thoracique d’air, j’étais tout simplement gênée par mon soutien-gorge. Au départ, je l’enlevais pour pratiquer puis le remettais après. Ensuite, plus j’ai pratiqué, ressenti le bien-être de mettre mon corps en mouvement, et plus je n’avais pas du tout envie de retourner dans un vêtement qui me serrait. »
Cela suscite des réactions : « Pour ma mère, c’était très étrange de faire ce choix et en même temps assez osé je crois. Quand je lui en ai parlé, elle m’a dit que ça allait se voir. Ah, on allait voir ma poitrine. Et puis, elle a rajouté, bon tu es encore jeune. Alors si c’est une jolie poitrine, on peut retirer le soutien-gorge ? Je lui ai alors demandé si elle avait remarqué que je n’en portais pas depuis le début de notre conversation. Ah bah non. Une croyance, une peur. J’ai continué de vivre sans soutien-gorge. Je ressens plus de liberté dans mes mouvements, j’ai aussi moins chaud l’été et mon portefeuille s’en porte bien ; pour avoir de la qualité, il faut y mettre le prix quand même. Aujourd’hui, je suis enceinte, mes seins ont un peu grossi mais j’ai encore moins l’envie de me sentir étriquée dans des vêtements.
Je témoigne parce que la sage-femme qui me suit a remarqué que je ne portais pas de soutien-gorge en m’auscultant et m’a dit : « Mais vous ne portez pas de soutien-gorge ? Non. Mais vous n’avez pas une petite poitrine ? Non. Ah parce que j’ai une ado qui ne veut pas en porter et je cherche des arguments pour qu’elle en porte. Donc cela me fait réfléchir. » Je ne veux pas convaincre les mamans de dire à leurs ados de ne pas porter de soutien-gorge, je souhaite juste que chacune nous puissions avoir le choix. Si on hésite à passer à l’action, que ce soit pour mettre un soutien-gorge ou pour le retirer, on peut le voir comme une expérience pendant quelques jours et relever comment cela se traduit dans notre corps, sur notre respiration, sur notre bien-être, sur notre confiance en soi. »
Elle conseille également à toutes les personnes craignant le regard des autres de démarrer le no bra en hiver puisqu’en général, les couches de vêtements s’accumulent sur notre corps à cette période. Sans se sentir contraintes non plus. Elle enfile un débardeur léger par exemple quand il fait froid et qu’elle n’a pas envie que ses tétons entrent en contact direct avec le tissu qui les couvre. Comme cela peut être le cas en période de règles ou quelques jours avant le début des menstruations.
Camille, 25 ans, réfléchit actuellement au no bra, elle a du mal à accepter sa poitrine au naturel : « Si je passe au no bra, je pense que je porterai un soutien-gorge (ou un bandeau ou une brassière) sous des vêtements où il y a risque de tout voir, ou pour une occasion particulière. Je porterai un soutien-gorge ou une brassière à cause du SPM (syndrome pré-menstruel, ndlr), j’ai la poitrine plus sensible avant mes règles et du coup, j’ai mal en descendant/montant les escaliers, quand ils bougent trop, donc je préfère en porter pendant cette période. »
Elle craint que l’on voit ses tétons. Elle craint les remarques. « Et le fait aussi qu’un sein puisse malencontreusement sortir de la tenue aussi. Mais globalement je suis à l’aise dans un soutien-gorge, ça ne me dérange pas d’en porter, je trouve ça beau, et selon le modèle ça peut faire une belle poitrine. J’essaie d’apprendre à aimer ma poitrine au naturel et pas seulement avec un soutien-gorge, c’est pour ça que je tente le no bra parfois chez moi. »
Nina, 35 ans, a commencé à mieux accepter son corps et ses « seins pas énormes ». Elle passe progressivement à des brassières et à des soutiens-gorge sans armatures. Si pendant l’été et les vacances, elle s’en passe aisément, en revanche, quand la rentrée de septembre arrive, elle rempile :
« Je suis prof au collège, je pense que ce ne serait pas du tout accepté. J’ai déjà eu des soucis avec ma cheffe parce que je portais des shorts, je n’ose même pas imaginer si je me pointais sans soutif. J’ai déjà vu une collègue le tenter sans souci, mais personnellement mes tétons pointent très souvent, et je n’assumerais pas. C’est connoté sexuellement et ça attire le regard. »
Ainsi, elle l’avoue, elle est gênée si dans la rue, un jour où elle ne porte pas de soutien-gorge, elle croise un voisin ou un élève. « Cette année, pour la première fois, je suis frustrée de ne pas pouvoir poursuivre le no bra à la rentrée. Je cherche des brassières légères du coup, et peut-être qu’avec des tee-shirts côtelés où on ne voit pas trop les détails, je tenterai le coup. », poursuit-elle.
Mais ça ne l’empêche pas de se sentir de plus en plus épanouie : « Après l’allaitement de mes jumelles et de mon fils, j’ai cru devoir dire au revoir à mon plaisir d’avoir des seins. J’ai commencé leur deuil. Et puis ça s’est remis peu à peu. Alors je profite ! Je les aime, mon homme aussi. Je ne me cache plus quand je me ballade torse nu à la maison. Il y a quinze ans, c’était l’inverse. Même dans l’intimité je les cachais. »
OUI, MAIS…
Certaines l’enlèvent car il crée une gêne, un inconfort ou même des douleurs. C’est le cas de Léna, 21 ans : « Je commençais par ne plus en mettre quand on ne pouvait pas forcément voir mes tétons, puis au fur et à mesure, je me suis écartée du regard que pouvaient avoir les gens donc je n’en ai plus porté du tout. Par confort, puis par militantisme. »
 Pour Manon, 24 ans, il est quasiment impossible d’imaginer de ne pas en porter, avec son 95E : « Même si j’entends beaucoup de témoignages de personnes qui ont une forte poitrine et qui arrive à ne plus en porter, ce n’est pas le cas pour moi. Quand je suis chez moi et que je n’en porte pas j’ai très vite mal au dos. Et un autre problème que j’ai découvert : la transpiration ! Je transpire de ouf de sous les seins avec l’effet peau contre peau, c’est désagréable et ça fait des traces sur le t-shirt donc super… Je pense que c’est un de mes plus gros freins, même si je me remusclais le dos, j’aurais trop peur de ne pas porter un soutif au boulot et d’avoir des traces de transpi sous les seins… »
Pour Manon, 24 ans, il est quasiment impossible d’imaginer de ne pas en porter, avec son 95E : « Même si j’entends beaucoup de témoignages de personnes qui ont une forte poitrine et qui arrive à ne plus en porter, ce n’est pas le cas pour moi. Quand je suis chez moi et que je n’en porte pas j’ai très vite mal au dos. Et un autre problème que j’ai découvert : la transpiration ! Je transpire de ouf de sous les seins avec l’effet peau contre peau, c’est désagréable et ça fait des traces sur le t-shirt donc super… Je pense que c’est un de mes plus gros freins, même si je me remusclais le dos, j’aurais trop peur de ne pas porter un soutif au boulot et d’avoir des traces de transpi sous les seins… »
Elly, 30 ans, de son côté explique que c’est en changeant de milieu professionnel qu’elle a pu se libérer peu à peu de cette injonction. « Quand je travaillais au bar, un client m’a dit un jour « Tu n’as pas le droit de parler sans nichons ». J’ai acheté un push up. Je ne me sentais pas en sécurité « sans nichons »… Si tu as le téton qui pointe par exemple au bar, tu te fais insulter… le matin, quand je partais bosser, je mettais une armure en quelque sorte. Mes cheveux roses m’ont protégée aussi de pas mal de connards. Aujourd’hui, je mets un soutif ou je n’en mets pas, selon mes fringues ou selon par exemple si je vais en rendez-vous pro, genre pour obtenir des subventions… Et je me sens apte à parler dans n’importe quelle situation ! », lance-t-elle.
Gwenn Loona, 43 ans, travaille également dans un bar : « Dans cet univers, t’as pas la même liberté. Il y a à la fois la haine des trans et à la fois l’érotisation des corps des femmes. Tout ce que je suis. Je suis obligée de mettre un soutien-gorge au bar. » En dehors, elle choisit, sa fille aussi.« J’ai élevé mes enfants seule, j’ai une fille et une garçon. Mes enfants ont eu une éducation féministe et ma fille se libère des carcans, c’est elle qui décide. On ne veut pas rentrer dans la dynamique de l’ancien monde. On s’en libère en tant que mère et fille en train de vivre notre puberté en même temps, ensemble. Bah, on se marre bien ! »
En revanche, pour Loona, 20 ans, impossible de se sentir en sécurité sans enfiler une brassière : « L’insécurité se traduit partout. Même chez moi. Je dors avec. J’ai vraiment vachement peur du regard des autres. »
L’INTIME EST POLITIQUE
Il y a des tonnes de motivation pour ne plus porter de soutien-gorge. Des tonnes de manière de le faire. Par alternance, en hiver, pendant les vacances, chez soi, dans les lieux identifiés (par la personne concernée) comme étant sécurisés et bienveillants, en portant un débardeur léger, en mettant une bralette, en portant des caches tétons, progressivement. Ou définitivement. Par confort, par militantisme, par choix. Il y a aussi des raisons d’en porter.
Parce qu’on a des problèmes de dos, une peau sensible, qu’on trouve nos seins beaux aussi dans de la lingerie, qu’on s’en sert comme un accessoire de séduction, qu’on n’assume pas d’avoir les tétons qui pointent, qu’on a une poitrine un brin ou très handicapante si elle n’est pas soutenue, pour faire du sport, etc.
Il y a aussi des stéréotypes et des peurs. Les tétons qui pointent sont signe d’excitation sexuelle chez les femmes. Cliché, ce n’est pas la seule explication. Une femme qui ne porte pas de soutien-gorge est une allumeuse. Cliché. Une femme qui ne porte pas de soutien-gorge et qui ne s’épile pas est une lesbienne qui veut ressembler à un homme. Cliché encore et encore.
Mais ceux-ci ont la vie dure et le problème perdure car majoritairement, on accable les femmes que l’on décrète fautives et responsables « d’aguicher », de « l’avoir cherché ». Quand on prend la problématique par l’autre bout, on prend conscience que le souci vient non pas des femmes mais du regard sexualisé que l’on porte sur elles, en tant qu’objets.
« La première fois que j’ai enlevé mon soutif pour dormir avec un gars, c’était pour être libre, pas pour qu’on couche ensemble. Il m’a violée. »
déclare Sadbh, 18 ans.
Quand va-t-on enfin écouter et prendre au sérieux les femmes ? On renvoie sans cesse le corps à l’intime. Il l’est. Et l’intime est politique. Si les Femen utilise leurs poitrines comme un outil d’action et un vecteur de messages, toutes les femmes ne sont pas obligées de revendiquer leurs libertés sur leurs seins.
Chaque démarche compte. De celle qui se pose des questions sur le pourquoi du comment à l’activiste torse nu, elles se battent pour arracher leurs droits comme les militantes des années 70 ont arraché leurs soutifs (la légende veut qu’elles les aient brûlés…). Chacune à son échelle et à son rythme, selon ses envies et possibilités.
« C’est une déconstruction sociale importante, ça change la vision que l’on a de soi et celle que l’on a des autres. Ce qui est dommage, c’est que quand on essaye de se déconstruire, genre du soutif, on va trouver des femmes qui vont nous mettre dans la tête qu’il faut en mettre. On ne devrait pas se juger, on devrait être solidaires ! Quand on fait les choses en sachant pourquoi on les fait, on est moins dans la souffrance. Quand on a le choix, on vit mieux les choses. Les poils sont beaux, les tétons aussi sont beaux. Et ils ne sont pas forcément sexuels. Moi, je trouve personnellement qu’avec des poils, on ressent plus de choses… », commente Eva, 18 ans.
UN SENTIMENT DE RÉAPPROPRIATION
Qu’elles apprécient ou non, ou pas trop, ou de temps en temps, leurs seins, les répondant-e-s qui composent autour du no bra parlent toutes de réappropriation de cette partie-là de leur corps. Décomplexées pour certaines, libres de leurs mouvements pour d’autres. Ou les deux. Lili, 38 ans, les trouve « plus beaux, plus libres ! »
Coraline, 19 ans, porte maintenant des hauts moulants sans complexes : « Au début, j’avais des caches-tétons mais que lorsque je portais des habits moulants, sachant que je portais habituellement des habits fluides voire oversize et que j’ai une forte poitrine donc mes tétons se voient moins. Mais un coup, j’en ai perdu un en ville et je m’en suis rendue compte qu’en rentrant chez moi. Après j’avais la flemme d’en racheter une paire alors que j’en avais encore un et puis je me suis dit que si c’était arrivé alors c’était un signe et que je ne devais pas en porter et qu’au fond, moi je m’en fiche, je n’ai aucun problème avec le fait que mes tétons se dessinent à travers mon haut ! »
Rebecca, 30 ans, fait même des randonnées sans soutif : « Avant, j’étais dans l’optique que je ne supportais pas le contact direct de mes seins avec les textiles… En fait non. Une question d’habitude, de changement de pensée et d’acceptation de son corps. Je fais des randonnées sans et je suis même allée courir dans les montagnes sans. Je trouve ma poitrine encore plus belle ainsi. Certes, je porte des soutifs si le t-shirt est transparent ou qu’un sein pourrait s’échapper du décolleté. Sinon il n’est plus question que je porte ces instruments. Je suis persuadée que j’en respire mieux. Fin du saucissonnage pulmonaire ! »
Gaëlle, 39 ans, se sent enfin libre : « Libre de mes choix, libre de mon corps ! »
Et pourtant, ça n’a pas toujours été simple : « Pendant très longtemps, j’ai été complexée à cause de mon petit 85A, tout le monde me disait que ce n’était pas féminin, que je ressemblais à une petite fille, que je ne pourrais jamais allaiter. Psychologiquement, ça a été très difficile pendant près de 25 ans. »
À 38 ans, Sophie, du blog Woods Witch, ressent elle aussi pour la première fois l’acceptation :
« Je crois que c’est la plus belle victoire à mes yeux. Je suis ce qu’on appelle une plus size et rares sont celles qui ont une si petite poitrine par rapport à leur poids. Accepter mon corps fut la bataille de ma vie sous bien des aspects et j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir. »
Si elle éprouve un sentiment de réappropriation de son corps à travers le no bra, c’est « parce que c’est un choix en pleine conscience et non pas un choix pour se conformer aux critères sociaux. Cela aide à s’assumer telle que l’on est. » Pour Elodie, 25 ans, ne pas porter de soutien-gorge, « c’est comme ne pas avoir d’écharde dans le doigt. »
COMPOSER À SA MANIÈRE
 On pourrait encore et encore et encore retranscrire et partager les récits de nos répondant-e-s. Nombreux, fournis ou synthétiques. Le sujet les inspire et les anime. On ressent le besoin de parler de leurs ressentis intimes, qui deviennent au fur et à mesure qu’on les croise pour les analyser, des vécus communs, même si encore une fois, toutes les personnes ayant témoigné n’adoptent pas toutes la même trajectoire et les mêmes réactions.
On pourrait encore et encore et encore retranscrire et partager les récits de nos répondant-e-s. Nombreux, fournis ou synthétiques. Le sujet les inspire et les anime. On ressent le besoin de parler de leurs ressentis intimes, qui deviennent au fur et à mesure qu’on les croise pour les analyser, des vécus communs, même si encore une fois, toutes les personnes ayant témoigné n’adoptent pas toutes la même trajectoire et les mêmes réactions.
Et c’est bien heureux. Puisqu’il est question de choix. Ce qu’elles expriment justement, c’est bien le fait qu’elles ne le sentent pas ce choix au départ, lors de leur puberté. Alors, elles l’ont pris et ont fait à leur manière, comme elles veulent, comme elles peuvent. La plupart ont entamé en parallèle ou en décalé des démarches similaires concernant d’autres aspects de leur quotidien, toujours en lien avec leur corps.
Comme Sophie, mentionnée ci-dessus, qui a au même moment arrêté la pilule : « Je pense qu’une fois que l’on entreprend certaines démarches, de remise en question sur ces choix de vie de femme, à un moment donné la question du port du soutien-gorge se pose, d’où cette corrélation finalement je suppose. »
Souvent – par conséquent, pas tout le temps – elles ont donc développé des réflexions autour de l’épilation et de leur rapport à leurs poils. Lise, 28 ans, continue « de trouver la lingerie belle, ou sexy, en certaines circonstances », tout comme Vanessa, 28 ans, aime s’en parer par moment dans l’intimité de son couple, mais, poursuit Lise :
« Quel plaisir de m’en être libérée au quotidien ! Je fais un parallèle entre la libération de mes seins et la pousse de mes poils. Je n’assume pas encore totalement de porter une robe courte lorsque mes jambes sont poilues de plusieurs mois, mais depuis quelques années, je suis beaucoup moins à l’affût du moindre poil qui repousse. L’aisselle est l’endroit qui me dérange le moins lorsqu’elle est poilue. Je trouve même que c’est un symbole de féminité assumé, et en certaines circonstances, cela me plait d’avoir les dessous de bras poilus (je me rends bien compte que je suis soumise aux injonctions, et que c’est bien parce qu’on voit de plus en plus de femmes l’assumer que cela me plait !). »
LE POIDS DU REGARD
Elle est loin d’être la seule à laisser ses poils d’aisselle tranquilles, à assumer ses poils de jambes en hiver, à chasser à la pince à épiler les poils de l’entrejambe qui dépassent du maillot de bain l’été ou encore à se sentir mal à l’aise lorsqu’elles exposent leur pilosité aux regards extérieurs. Il semble, au vu des témoignages, que l’épilation soit une injonction plus difficile à combattre que le port du soutien-gorge.
Ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les seins, qu’ils soient apparents dans leur ensemble ou en partie, restent synonymes de féminité, là où les poils sont eux considérés comme un symbole de virilité. Et la virilité appartient dans la construction sociale au masculin.
Ainsi, les femmes subissent dès la puberté la pression quant à leur pilosité. Loreleï, 42 ans, parle même de « dictature sociale », « avec des commentaires automatiques au moindre poil oublié. Bien que je ne porte jamais de jupe ni de robe courte, en sorties comme dans l’intimité, il me fallait être totalement impeccable. »
Il lui a fallu« attendre d’être maman pour assumer d’exhiber des jambes aussi poilues qu’une chenille de papillon de nuit, même dans les lieux publics comme un supermarché, en jupe jusqu’aux genoux. Je garde l’habitude de m’épiler les aisselles à la pince à épiler une fois par semaine, et celle d’entretenir un buisson court dans la culotte, à coups de ciseaux, pour des raisons d’hygiène : c’est plus vite lavé et ça ne retient pas d’odeurs. Au final, je fais de sacrées économies de temps depuis 4 ans ! »
Les commentaires dont elle parle, elle n’est pas la seule à en être assaillie. Quasiment toutes les personnes ayant témoigné de leur rapport à leurs poils en ont fait mention. Comme le soutien-gorge, l’épilation constitue une norme de féminité et celles qui la transgressent, consciemment ou non, sont rappelées à l’ordre.
« J’ai commencé par laisser pousser mes poils de jambes. Ma mère, qui est pourtant féministe, m’a déjà demandé un jour si je voulais vraiment mettre une robe pour aller au resto avec mes grands-parents… Après ça, j’ai laissé pousser mes poils sous les aisselles ! », rigole Sadbh, 18 ans.
Le regard des autres, elle passe outre. Au maximum. Béa, 56 ans, se souvient qu’une camarade de classe lui avait dit qu’elle était moche justement parce qu’elle était poilue des jambes.
« Ensuite, c’est moi qui me suis chargée moi-même de m’auto-critiquer sur les poils qui pointaient hors de mes collants par exemple. Un homme avec qui j’ai eu une relation sexuelle m’a demandé de raccourcir mes poils de pubis, considérés comme trop touffus et longs : j’ai découvert à cette occasion la mode du « ticket de métro », que je n’ai pas appliquée. Aucun autre homme ne m’a fait de commentaire à leur sujet. Je ne m’épile plus du tout depuis bientôt 15 ans, depuis que j’ai mis mon second compagnon dehors. », souligne Béa qui avoue qu’en couple, elle ressent le besoin « de paraître conforme à l’image féminine glabre ».
Ainsi, « en tant que femme hétéro ne m’épilant pas, je dois admettre que l’absence de besoin d’épilation pour être dans la norme (pour plaire) fait partie de mes raisons pour rester célibataire. Songer à retrouver une relation implique pour moi de retourner inévitablement dans ces préoccupations dont je ne veux plus. »
Pour Chloé, 29 ans, être acceptée telle qu’elle est est devenu un critère dans son couple. « Mes aisselles, je les vois comme la barbe pour les mecs. Je coupe quand j’ai envie. Pour les jambes en revanche… pourquoi m’abimer la peau pour une norme sociale ? Je vois pas trop l’intérêt… À une époque, je l’ai fait. Et en étant célibataire, mon premier réflexe a été d’aller chez l’esthéticienne alors que je ne m’étais pas épilée les cuisses depuis deux ans ! C’est triste ! Je veux quelqu’un qui m’accepte. Je veux bien expliquer, discuter. Je ne suis pas là pour faire de la pédagogie mais je suis ouverte à la discussion. Avec mon copain actuel, on a déconstruit au fur et à mesure.
Et aujourd’hui, ce n’est plus un sujet pour moi. Cette réflexion, elle date de mes 20 ans. J’ai lu beaucoup de littérature féministe (pas que sur ce sujet), j’ai suivi beaucoup de comptes sur Twitter et Instagram et j’ai vu beaucoup de photos de femmes pas épilées. Aujourd’hui, pour moi, les poils, ils sont présents. Ils sont ni beaux, ni moches, ils sont là c’est tout. Comme n’importe quoi d’autre. Comme mes sourcils par exemple ! Et maintenant, quand je vois des jambes lisses, je ne trouve pas ça beau. Pas naturel. », explique-t-elle.
L’ÉPILATION, UNE OBLIGATION… POUR LES FEMMES ?
Léna, 21 ans, a diminué progressivement son recours au rasoir. Elle ne fait que de temps en temps les aisselles. Des remarques et des regards insistants, elle en a essuyé « mais je les rembarre directement. » Quand ça provoque une discussion, elle le dit, elle se montre ferme sur la question :
« Une fille qui s’épile si c’est son choix, ainsi soit-il, elle dispose de son corps et je comprends l’envie de s’épiler (douceur, etc.). Par contre, un homme qui exige ou fait des remarques sur l’épilation, je ne tolère pas et mon discours est : je suis contre l’épilation, pour être frontale et leur afficher leur connerie. Donc mon discours change selon l’interlocuteur. J’explique aussi calmement que pour moi, s’épiler, c’est se faire mal uniquement pour des stéréotypes, des constructions de normes débiles que la société tente d’imposer, et je ne l’accepte pas. »
En couple ou célibataire, elle entretient le même rapport à l’épilation : « M’épiler le maillot, ça me gêne plus que de ne pas le faire, une chatte sans poils ressemble à celle d’une enfant de 10 ans, non merci, et ça me fait me sentir nue. Je suis bi, en couple avec une fille depuis plusieurs mois. J’en parle souvent, car j’aime la discussion. Elle, elle s’épile les aisselles et les jambes car elle en a pris l’habitude et elle se sent mal de ne pas le faire. Moi je ne le fais pas et elle l’accepte totalement, il n’y a aucun problème, exigence ni tabou sur l’épilation, chacune fait ses choix et on s’aime comme ça. »
De son côté, Camille, 25 ans, essaye de dépasser la peur que ses poils gênent ou embêtent ses partenaires. Elle avait déjà l’habitude de laisser pousser ses poils en hiver, elle a, depuis le confinement, arrêté de s’épiler « pour mieux les apprécier au naturel et apprendre à trouver ça normal sur moi. »
Plus jeune, elle a ressenti une sorte d’obligation à l’épilation : « On ne voit que ça à la télé / dans la rue par exemple et parce que je pensais que mes partenaires n’aimeraient pas les poils. Mais je n’ai jamais aimé m’épiler (en même temps, qui apprécie ?), ça m’a toujours énervé de devoir m’épiler alors que les hommes font ce qu’ils veulent (et encore, c’est pas toujours hyper bien vu les hommes qui s’épilent). Ça m’a toujours gonflé de perdre une heure de temps et de l’argent pour m’épiler… »
C’est en allant chez l’esthéticienne qu’une sorte de pression est apparue « sur deux zones qui ne me dérangeaient pas, je parle des poils sur les pieds et entre le nombril et le pubis. L’esthéticienne m’a demandé pendant une séance « Je fais cette partie-là aussi ? », j’étais gênée, du coup j’ai dit oui et depuis les poils sur ces zones se voient plus qu’avant, je suis obligée de continuer parce que je n’arrive pas encore à les accepter. J’ai aussi des poils sur les tétons que je n’arrive pas à accepter, alors que ceux des hommes c’est totalement ok… »
Pareil pour Ange, 24 ans, qui n’aime pas ses poils sur les tétons, ces trois poils au menton comme iel dit, les cheveux longs et les poils entre les sourcils. Iel a subi « des regards surpris et dégoûtés, et énormément de remarques blessantes de ma famille. » Iel nous livre en conclusion :
« Je rêve d’un monde où les personnes ayant été assignées femme à la naissance pourrait être vraiment libres de faire ce qu’elles souhaitent, parce que nous avons déjà beaucoup de pression dans nos vies, donc ce serait une véritable libération pour nous. »
POUVOIR FAIRE SES CHOIX
Chacun-e appréhende et vit ses poils différemment. Coraline, 19 ans, n’a jamais eu honte de ses poils. Dans sa famille, pas d’injonction à l’épilation. Elle a déjà utilisé des techniques pour se raser, que ce soit la crème dépilatoire ou le rasoir mais elle ne supporte pas ça :
« J’ai donc décidé d’arrêter de me faire du mal juste pour plaire (ne pas déranger) aux autres. Et puis… je les aime bien mes poils ! Au début, tu as peur. J’appréhendais plus pour les poils que pour les tétons. À la plage, cet été, j’avais un peu d’appréhension mais je n’ai pas touché à mes aisselles et j’ai juste fait les côtés du maillot (ce qui pourrait se voir) mais j’ai vite regretté parce que personne ne m’a regardée, personne ne m’a fait de remarque. J’ai eu peur pour rien. Je me suis sentie libre ! »
Pour Sophie, 31 ans, c’est le mariage et la maternité qui lui ont permis de déconstruire les normes sociales. Elle se détache petit à petit du regard des gens. Elle fait maintenant ses propres choix quant à l’épilation ou non et les zones.
« J’étais lasse de dépenser de l’argent et d’avoir des poils incarnés. Et aussi parce que j’ai appris que j’allais être maman. Je voulais être en paix avec moi pour mieux accompagner ce futur enfant dans l’acceptation de son corps. J’ai une fille et ce sera un challenge. J’ai la chance d’avoir un mari féministe et un noyau familial/amical avec qui nous pouvons aborder librement différents sujets. »
Elly, 30 ans, défend ardemment la possibilité de chacun-e à faire ses choix. À prendre conscience des injonctions qui pèsent sur nos corps. « C’est important de se déconstruire et que les gens autour de nous le fassent aussi. Quand on se prend des remarques, je me dis que c’est à ces personnes là de se déconstruire ! Mes poils, ça me concerne moi, pas les autres. Même en étant super féministe, je viens de payer 1300 euros pour me faire épiler les demis jambes et le maillot au laser. Même si j’aime mes poils, j’ai trop subi, j’ai pris trop cher ! », s’indigne-t-elle.
UNE QUESTION DE REPRÉSENTATION ?
La pression sociale, les injonctions à la féminité, le manque de choix apparaissent très clairement dans tous les témoignages. Tout comme le manque de représentations et d’alternatives face à cette féminité normative et unique imposée. Le besoin d’échanger autour de ce sujet, de se libérer des carcans, de voir d’autres modèles pour se sentir enfin un peu plus libres de leurs choix pour leur corps revient fréquemment dans les récits de ces femmes, cisgenres, transgenres, personnes non binaires, hétéros, bis, lesbiennes, pansexuelles, blanches, noires, racisées.
Zoé Royer a 24 ans, elle est étudiante à l’université Paris II en information et communication et a rédigé un mémoire sur les mouvements en ligne de libération de la pilosité féminine.
« Je me suis mise dans les mouvements Instagram sur la libération du corps des femmes et j’ai vu tout ça évoluer. Il y a un réel enjeu derrière tout ça. Ça peut paraître rigolo, les poils, mais les garder, c’est symbolique, ça participe à la réappropriation du corps des femmes qui se détournent du corps glabre. Ça montre leur émancipation ! Rendre le poil visible, ça le normalise. Les comptes qui montrent des photos de femmes assumant leurs poils permettent de se sentir moins seule, de libérer la parole et de se montrer sans avoir à faire face au regard direct des autres. Alors oui, on peut être victime de remarques et de commentaires, avec des emojis qui vomissent, on peut être victime de menaces de viols, c’est très grave. Mais sur les réseaux sociaux se créent des communautés autour de ce sujet pour être plus fortes et plus nombreuses et c’est important. », analyse Zoé Royer.
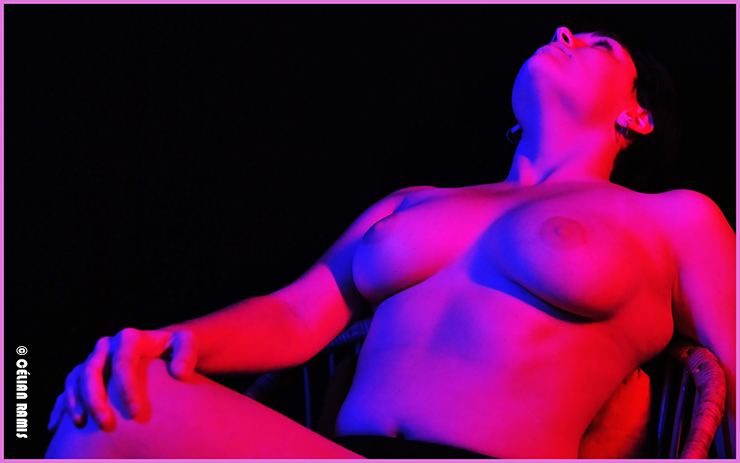
Travailler sur cette thématique l’a aidée elle aussi à se poser des questions, prendre conscience et à voir un peu plus ses poils comme la continuité de son corps :
« Comme mes cheveux ! Je me sens mieux avec mes poils que sans. Mais j’ai toujours encore un peu le problème de ce que les autres vont penser. Des fois, je suis dans l’état d’esprit où je m’en moque et parfois, non. Ça dépend de la tenue, du lieu où je vais, de qui je vais voir… »
CENSURE, PATRIARCAT ET CAPITALISME…
Les mentalités évoluent. Lentement, très lentement. Le corps des femmes est encore largement commenté dans nos sociétés. On peine à accorder aux personnes concernées le droit d’en disposer comme elles le souhaitent et on interroge régulièrement la population à propos des tenues des femmes, afin de juger si celles-ci sont décentes ou indécentes. Républicaines ou non.
Alors bien sûr, on progresse mais l’actualité vient nous rappeler que la marge de manœuvre est étroite. De nombreux comptes, Instagram notamment, sont dédiés à la valorisation des corps dans leur grande pluralité et complexité. L’impact est indéniable. On prend conscience que ce que l’on nous présente comme la norme est en fait un idéal à atteindre.
Il ne prend pas en compte la réalité des corps, surtout ceux des femmes, toujours en mouvement mais toujours contraints à se dissimuler et à se conformer. Elles sont aujourd’hui très nombreuses à refuser de poursuivre cette course à la perfection et à l’apparence.
Cela prend du temps et une injonction ne doit pas être remplacée par une autre. Alors, chacun-e a son rythme. D’autres modèles s’affichent désormais sur les réseaux sociaux mais la bataille de l’intime n’est pas sans conséquence. Car en face, l’enjeu est de taille. Tant financièrement que socialement. Les comptes militants se voient censurer, les photos dévoilant soi-disant trop de peau, trop de nudité, trop de tétons, sont supprimées, les femmes avec des poils et/ou des cheveux courts sont diabolisées.
Pour Audrey, 22 ans, « toutes œuvres et artistes ont un rôle à jouer pour faire changer les mentalités en rappelant que les femmes comme les hommes sont des humains qui ont juste des poils et que rien n’est sale, ni moins sexy ou moins viril. Le poil ne devrait jouer aucun rôle dans la société si ce n’est de nous protéger. Dans une société comme la notre, c’est possible de faire évoluer les mentalités. Elles ne sont pas le problème, c’est plus le capitalisme qui aura beaucoup à perdre sans le marché du poil. »
Les marques surfent sur la vague, comme Veet par exemple qui opte pour le slogan « Vos poils, vos choix, nos produits ». Ou Sloggi qui table sur une publicité post-confinement :
« Laissez-nous deviner, les articles les moins portés dans votre placard en ce moment sont les soutiens-gorge ? N’est-ce pas ? Eh bien, croyez-nous, vous n’êtes pas la seule. Mais ne plus jamais porter de soutien-gorge n’est pas non plus la solution. Nous ne voulons pas que vous renonciez à votre sentiment de liberté et de confort absolu, c’est pourquoi nous avons la solution pour que vous ne sentiez plus votre soutien-gorge, non seulement à la maison, mais aussi partout où la vie vous mène ! Parce que chez Sloggi, le confort est notre priorité numéro une, deux et trois ! Découvrez nos sous-vêtements au confort absolu avec 20% de réduction ! »
CHANGER NOS REGARDS, DÉCULPABILISER ET CHOISIR !
L’idée n’est pas de tout abandonner, de tout boycotter. Simplement de faire changer nos regards sur nos propres corps. Nous offrir davantage de bienveillance envers eux. Se détacher au fur et à mesure de ce que pense la société. Composer avec ce que l’on a, ce que l’on est.
Faire bouger les lignes de la féminité et de la masculinité vers quelque chose de moins réducteur et oppressant, vers quelque chose de plus libre et personnel. Comme le dit Klaire fait Grr en conclusion de son livre Au poil ! :
« il est possible que la perception du poil soit un jour totalement bousculée, mais en attendant, peut-être pourrions-nous prendre un peu de recul, et considérer l’épilation totale comme un choix esthétique optionnel et non comme une obligation absolue sous peine de honte intersidérale ? Tout comme peindre ses ongles en orange fluo, réaliser un brushing impeccable, s’offrir un piercing du genou ou porter des faux-cils sont aujourd’hui des options, s’épiler les aisselles ne pourrait-il pas un jour devenir une simple éventualité parmi d’autres ? Ça semble relever encore de la science-fiction, et pourtant… »
Et pourtant, le mouvement est en route. On voit poindre des avancées et ça fait du bien. On se réjouit de la sortie prochaine par exemple du livre jeunesse Tata de la barbe sous les bras, d’Anne-Cécile Morizur et Florence Dollé, publié en novembre aux éditions Goater.
Certaines ne se sentent pas en sécurité, n’osent pas, y vont petit à petit, commencent en hiver, en vacances, puis grignotent du terrain sur leur corps. D’autres ne se sentent pas prêtes du tout, envient celles qui y parviennent, suivent des comptes Instagram et autres lectures et visuels féministes qui les accompagnent dans leur prise de conscience et leur déconstruction.
D’autres encore franchissent le cap et ne souhaitent plus jamais toucher à un rasoir, des bandes de cire, un arracheur de poils ou entrer dans un salon esthétique. Et puis d’autres encore se lancent des défis, ne pas se raser pendant plusieurs mois, ne pas porter de soutien-gorge pour aller au supermarché, achètent des bouquins féministes sur le rapport au corps, témoignent en toute sincérité pour que d’autres à leur tour se posent des questions ou expriment leurs pensées…
On l’a dit, on le redit, les réactions, ressentis et vécus sont différents selon les personnes. Et c’est bien là que tout le monde a un rôle à jouer. Ne pas juger, se montrer solidaire, éviter les regards insistants et les remarques désobligeantes. Parce que le corps de la personne ne concerne que la personne.
C’est là dessus qu’il est primordial et essentiel d’avancer. Et de se questionner sur ce qui nous dérange réellement quand une femme affiche ses poils ou ses tétons.
Qu’est-ce qui nous fait violence dans le fait de les voir apparaître sur le corps des femmes ? De quoi a-t-on peur ? Que les genres soient troublés ? Qu’on ne puisse plus définir une femme simplement à partir de son corps et de son apparence ? Que les individus s’approprient leur propre corps et qu’iels décident en leur pleine conscience pour celui-ci ? Posons-nous la question : qu’est-ce qui nous dérange ?
Au fond, demandons-nous : en quoi ça nous concerne qu’une personne définie et perçue en tant que femme affiche ses poils, pointe sous son débardeur, se balade en croc top, en jupe, en short, avec un voile sur la tête, des baskets, des talons, un jogging ou un poncho ? En quoi ça nous concerne ?







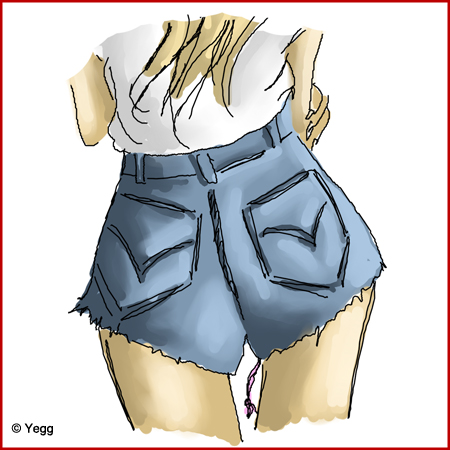 Et même sans démarche artistique, on la rejoint : échanger et partager les vécus et opinions, en prenant soin d’écouter en premier lieu les personnes concernées, est enrichissant et nécessaire à la déconstruction du tabou et des stéréotypes autant autour des règles que du genre.
Et même sans démarche artistique, on la rejoint : échanger et partager les vécus et opinions, en prenant soin d’écouter en premier lieu les personnes concernées, est enrichissant et nécessaire à la déconstruction du tabou et des stéréotypes autant autour des règles que du genre. 
 Le 19 mars, L’Obs et Rue89 révèlent la précarité sanitaire que subissent les femmes incarcérées qui selon les établissements disposent de protections périodiques de mauvaise qualité souvent à des prix trop élevés, particulièrement pour celles qui ne cantinent pas.
Le 19 mars, L’Obs et Rue89 révèlent la précarité sanitaire que subissent les femmes incarcérées qui selon les établissements disposent de protections périodiques de mauvaise qualité souvent à des prix trop élevés, particulièrement pour celles qui ne cantinent pas. Une idée qui a été inspirée par le modèle écossais. En effet, le pays qui avait déjà investi pour lutter contre la « period poverty » auprès des femmes en grande précarité réitère son action auprès des étudiantes à présent, en levant 5,7 millions d’euros afin de fournir aux 395 000 élèves d’Ecosse des protections hygiéniques gratuites. Dans les écoles, collèges et universités sont, depuis la rentrée scolaire, accessibles tampons, serviettes, serviettes lavables et coupes menstruelles.
Une idée qui a été inspirée par le modèle écossais. En effet, le pays qui avait déjà investi pour lutter contre la « period poverty » auprès des femmes en grande précarité réitère son action auprès des étudiantes à présent, en levant 5,7 millions d’euros afin de fournir aux 395 000 élèves d’Ecosse des protections hygiéniques gratuites. Dans les écoles, collèges et universités sont, depuis la rentrée scolaire, accessibles tampons, serviettes, serviettes lavables et coupes menstruelles.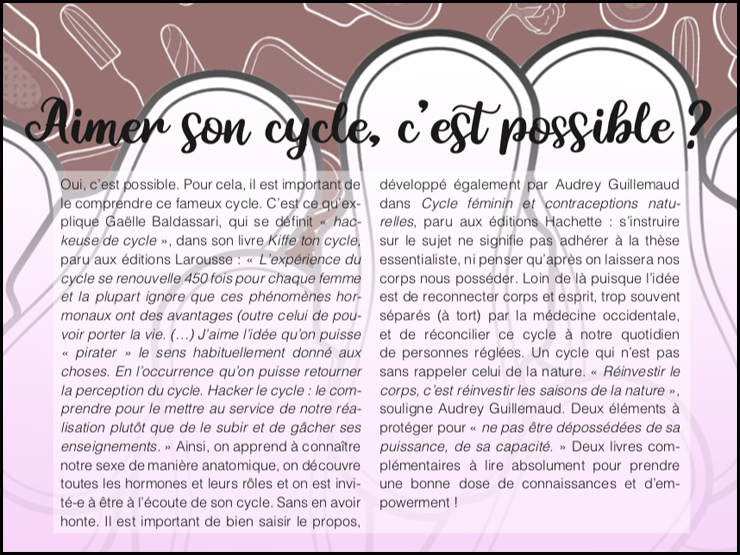




 Dans la salle, environ 12 danseuses/seurs sont allongé-e-s sur le dos, sur un tapis de sol, un plaid sur les jambes pour la plupart. La voix de Nathalie Schulmann, danseuse contemporaine, professeure de danse et analyste du corps dans les mouvements dansés, les guide pour les inviter à s’intéresser au poids de la tête se déposant sur le ballon placé à l’arrière de leur crâne. Mais aussi à s’aider de leur respiration et de la sonorisation du souffle.
Dans la salle, environ 12 danseuses/seurs sont allongé-e-s sur le dos, sur un tapis de sol, un plaid sur les jambes pour la plupart. La voix de Nathalie Schulmann, danseuse contemporaine, professeure de danse et analyste du corps dans les mouvements dansés, les guide pour les inviter à s’intéresser au poids de la tête se déposant sur le ballon placé à l’arrière de leur crâne. Mais aussi à s’aider de leur respiration et de la sonorisation du souffle. Pour elle, prendre soin est un acte fort aujourd’hui. Car cela n’est pas dans la culture des professionnel-le-s de la danse. « Le danseur prend soin de son corps quand il est cassé ou vieux. Le besoin d’équilibre, de se recentrer, de trouver des moteurs autrement, de se mettre en disponibilité émerge cependant chez les danseurs. Ce ne sera jamais tout le monde mais c’est de plus en plus présent. », souligne-t-elle.
Pour elle, prendre soin est un acte fort aujourd’hui. Car cela n’est pas dans la culture des professionnel-le-s de la danse. « Le danseur prend soin de son corps quand il est cassé ou vieux. Le besoin d’équilibre, de se recentrer, de trouver des moteurs autrement, de se mettre en disponibilité émerge cependant chez les danseurs. Ce ne sera jamais tout le monde mais c’est de plus en plus présent. », souligne-t-elle. Elle poursuit : « J’aime proposer un autre corps que le sien. Parce que ces séances sont collectives, la femme peut penser à son vagin mais va aussi se projeter dans le corps d’un homme présent dans la salle. On est entre des corps. Cette transposition des corps m’intéresse davantage que les codifications du corps féminin et masculin, qui n’est qu’une catégorisation comme une autre. J’ai aussi construit une séance chorégraphique où on passait des organes sexuels féminins aux organes sexuels masculins constamment, au point d’en perdre la notion du masculin et du féminin, on est alors obligé d’inventer un autre corps qui n’existe pas encore. » Et finalement, le corps n’a jamais été aussi réel que lorsque cette fiction nous a permis de le ressentir, de l’imaginer et de l’envisager.
Elle poursuit : « J’aime proposer un autre corps que le sien. Parce que ces séances sont collectives, la femme peut penser à son vagin mais va aussi se projeter dans le corps d’un homme présent dans la salle. On est entre des corps. Cette transposition des corps m’intéresse davantage que les codifications du corps féminin et masculin, qui n’est qu’une catégorisation comme une autre. J’ai aussi construit une séance chorégraphique où on passait des organes sexuels féminins aux organes sexuels masculins constamment, au point d’en perdre la notion du masculin et du féminin, on est alors obligé d’inventer un autre corps qui n’existe pas encore. » Et finalement, le corps n’a jamais été aussi réel que lorsque cette fiction nous a permis de le ressentir, de l’imaginer et de l’envisager.


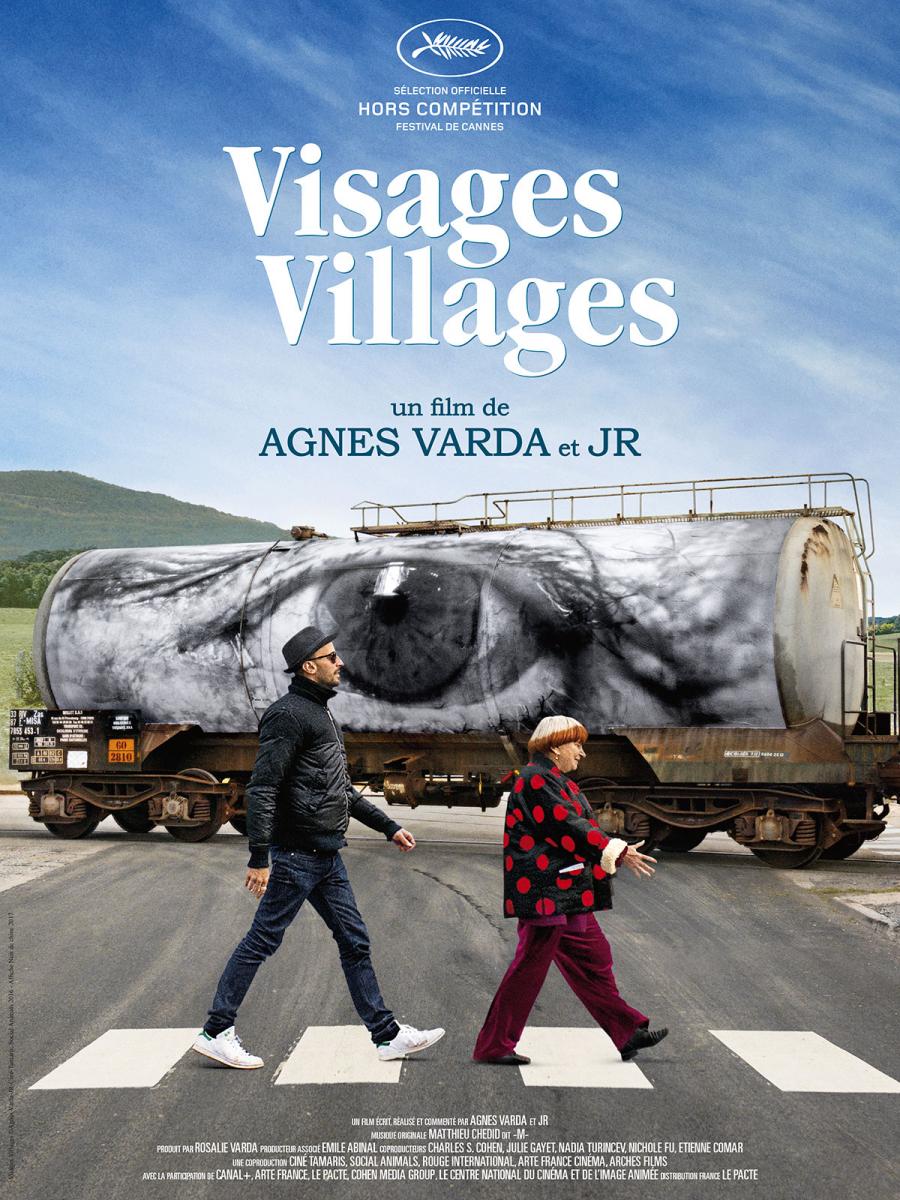 « On n’a jamais pris au sérieux l’aspect sociologique. On a juste voulu rencontrer des personnes qui parlent de ce qu’ils connaissent, aiment, veulent. Et c’est ce qu’on voit. Des gens très variés. On avait envie de vous mettre de bonne humeur. Que vous ayez une curiosité pour toutes ces personnes, que vous les rencontriez à votre tour. Ils sont en situation de vous intéresser et que vous ne les oubliez pas. Alors on l’a fait de manière un peu fantaisiste avec quelques broderies autour mais ce sont surtout des visages et des surprises. », s’émeut la réalisatrice des Glaneurs et la Glaneuse, plusieurs fois primée pour l’ensemble de son œuvre.
« On n’a jamais pris au sérieux l’aspect sociologique. On a juste voulu rencontrer des personnes qui parlent de ce qu’ils connaissent, aiment, veulent. Et c’est ce qu’on voit. Des gens très variés. On avait envie de vous mettre de bonne humeur. Que vous ayez une curiosité pour toutes ces personnes, que vous les rencontriez à votre tour. Ils sont en situation de vous intéresser et que vous ne les oubliez pas. Alors on l’a fait de manière un peu fantaisiste avec quelques broderies autour mais ce sont surtout des visages et des surprises. », s’émeut la réalisatrice des Glaneurs et la Glaneuse, plusieurs fois primée pour l’ensemble de son œuvre.
 Des femmes à contacter, elle n’en a pas manqué. Mais des refus, elle en a essuyé. « Il fallait que je sois crédible, convaincante et en même temps que je ne parte pas trop dans l’intellect. Sinon elles me filaient entre les doigts. », précise l’auteure. Certaines déclineront la proposition, d’autres lâcheront en cours de route. Et dans les huit restantes, il lui faudra parfois « renoncer à des choses et changer des noms, des dates ou des lieux. »
Des femmes à contacter, elle n’en a pas manqué. Mais des refus, elle en a essuyé. « Il fallait que je sois crédible, convaincante et en même temps que je ne parte pas trop dans l’intellect. Sinon elles me filaient entre les doigts. », précise l’auteure. Certaines déclineront la proposition, d’autres lâcheront en cours de route. Et dans les huit restantes, il lui faudra parfois « renoncer à des choses et changer des noms, des dates ou des lieux. »
 Et ce, en toute discrétion, sans que les médias n'en touchent un mot. Cette discrétion caractérise aussi la suppression du Pass Contraception (2) en avril 2016, au conseil régional d'Ile de France présidé par Valérie Pécresse, et montre bien que le combat pour la survie du PF est loin d'être terminé.
Et ce, en toute discrétion, sans que les médias n'en touchent un mot. Cette discrétion caractérise aussi la suppression du Pass Contraception (2) en avril 2016, au conseil régional d'Ile de France présidé par Valérie Pécresse, et montre bien que le combat pour la survie du PF est loin d'être terminé. Ce recours à l'IVG étant stable depuis plusieurs années (environ 200 000 IVG par an sont pratiqués en France selon l'INED – Institut National d'Études Démographiques), il n'est toutefois pas encore totalement intégré dans les mentalités comme une intervention chirurgicale classique et demande encore, du temps et de l'argent pour faire déculpabiliser les femmes ayant eu recours à ce type d'opération.
Ce recours à l'IVG étant stable depuis plusieurs années (environ 200 000 IVG par an sont pratiqués en France selon l'INED – Institut National d'Études Démographiques), il n'est toutefois pas encore totalement intégré dans les mentalités comme une intervention chirurgicale classique et demande encore, du temps et de l'argent pour faire déculpabiliser les femmes ayant eu recours à ce type d'opération.

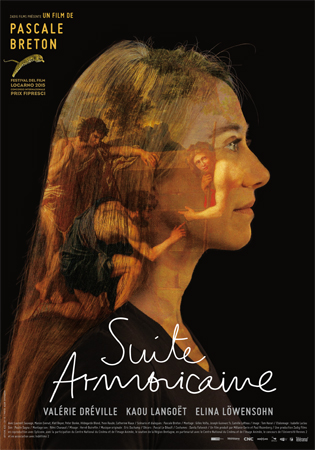 C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.
C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.