Tout le monde s’accorde à dire que les femmes ont toujours participé au travail de la terre. C’est un fait. C’est historique. Mais dans l’imaginaire collectif, elles ne sont pas agricultrices à part entière. Elles sont femmes d’agriculteurs et donnent un coup de main. À la traite, à l’alimentation, aux soins des animaux, aux récoltes, à la comptabilité… Un petit coup de pouce, en somme, sur leur temps de loisir, en plus de l’éducation des enfants, de la préparation des repas, des tâches ménagères, etc.
N’en déplaisent aux idées reçues, elles sont de plus en plus nombreuses à choisir la paysannerie, à s’installer avec leurs conjoints, bâtissant ainsi leurs projets de vie et professionnels ensemble, à se former et à obtenir le statut de cheffes d’exploitation. Pourtant, les préjugés persistent et perdurent. Quelles sont les difficultés rencontrées par les agricultrices aujourd’hui et comment s’organisent-elles pour prendre leur place au sein d’un secteur d’activités qui reste, dans les mentalités, un bastion masculin ?
 Les 27 et 28 février 2019, la compagnie On t’a vu sur la pointe mêlait témoignages d’agricultrices et récit familial fictionnel dans un théâtre documentaire saisissant et impactant. Les premières représentations, en milieu urbain, de Héroïnes ont eu lieu au théâtre de la Paillette à Rennes (la rédaction y était et avait réalisé un article à la suite du spectacle, publié dans le numéro 78 – mars 2019).
Les 27 et 28 février 2019, la compagnie On t’a vu sur la pointe mêlait témoignages d’agricultrices et récit familial fictionnel dans un théâtre documentaire saisissant et impactant. Les premières représentations, en milieu urbain, de Héroïnes ont eu lieu au théâtre de la Paillette à Rennes (la rédaction y était et avait réalisé un article à la suite du spectacle, publié dans le numéro 78 – mars 2019).
HÉROÏNES SILENCIEUSES
Elles sont des héroïnes qui s’ignorent. Longtemps invisibilisées, ces filles ou femmes d’agriculteurs ont pourtant toujours participé au quotidien des fermes. Le terme féminisé n’entre dans le Petit Larousse qu’en 1961 alors qu’en 1914 la France les a appelées à la terre pour soutenir l’effort de guerre.
« La France t’appelle et puis t’oublie. », murmure Cécile, poursuivant sa chronologie : en 1999, elles deviennent conjointes collaboratrices et en 2006, elles peuvent enfin s’émanciper de leurs maris pour devenir des agricultrices à part entière. Cécile, elle, veut comprendre l’histoire de ces femmes. Elle veut « faire entrer les voix de toutes celles qui peuplent l’arbre de (s)a généalogie ».
De la paysanne à la cheffe d’exploitation, de son arrière-grand-mère à sa sœur, les femmes de sa lignée ont toujours été agricultrices. Avec Héroïnes, la compagnie On t’a vu sur la pointe leur rend hommage et interroge leur place dans le milieu agricole au fil d’un siècle de labeur qui a non seulement vu les engins se moderniser – pour répondre à une demande plus importante de production - mais aussi les campagnes se vider.
Pour les femmes, « les difficultés ne sont plus exactement les mêmes mais elles se sont simplement déplacées. Mais on voit qu’il y a parfois une incompréhension des anciennes face aux difficultés des nouvelles. », souligne Anne-Cécile Richard, autrice, metteuse en scène et comédienne, qui a effectué une résidence au long cours, accompagnée d’Antoine Malfettes, auteur, metteur en scène et comédien, à la maison de retraite de Guémené-Penfao :
« En écoutant les histoires des résidentes, leurs conditions de vie, on a eu envie d’en parler. On a alors interviewé des agricultrices à la retraite et des agricultrices en activité. C’est intéressant de rencontrer des femmes qui ont fait ce choix de vie aujourd’hui, car il y a beaucoup de conversion professionnelle vers ce secteur. Et c’est très intéressant aussi d’avoir le témoignage des anciennes car les femmes des années 50 parlent difficilement. Elles n’ont pas l’habitude de parler d’elles, de leur vie. »
Dans ce seule-en-scène, le public suit la conférence de Cécile qui ne cesse de poser des questions sur ces héroïnes oubliées, ces héroïnes qui jamais ne se plaignent et qui pourtant souffrent en silence. Si elle nous donne à entendre concrètement les voix des interviewées, la protagoniste nous délivre également l’histoire intime des femmes de sa famille, liées par leur métier mais aussi par une nappe blanche qui se transmet de génération en génération, jusqu’à ce qu’elle en devienne la propriétaire, après le suicide de sa sœur.
Un spectacle intense et sensible dans lequel la fiction vient donner un coup de fouet à une actualité dramatique à laquelle chacun-e assiste dans le silence : « Ce sujet concerne tout le monde.»
L’EFFORT DE GUERRE…
En août 1914, le président du Conseil, René Viviani, en appelle ainsi aux femmes : « Debout, femmes française, jeunes enfants, fils et filles de la patrie ! Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés ! Il n’y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout ! À l’action ! À l’œuvre ! Il y aura demain de la gloire pour tout le monde ! »

Et pourtant, malgré le travail fourni par les centaines de milliers de femmes sur les exploitations, au lendemain de la guerre, on les a déjà oubliées les paysannes. Elles œuvrent toujours au travail de la terre, des cultures, des récoltes, à la traite, aux soins des animaux, etc. Aux côtés de leurs conjoints. L’agriculture est considérée comme une affaire d’hommes. Parce qu’elle est physique. Parce qu’elle est éprouvante. Les épouses ne travaillent pas, elles aident. Nuance…
Pendant très longtemps, le seul statut (informel) qu’elles auront sera celui de l’aide familiale. Pour un début de changement, il faut attendre les années 60 comme l’indique le site gouvernemental de l’agriculture :
« Ce sont les importantes transformations de l’activité agricole, ainsi que le développement des mouvements féministes des années 60, qui ont rendu légitime une revendication des femmes pour la reconnaissance de leur travail. L’obtention d’un statut professionnel distinct de leur situation matrimoniale semblait alors primordiale. Une première réponse juridique a vu le jour en 1962 avec la création des GAEC (groupements agricoles d’exploitation en commun), permettant à des agriculteurs de s’associer. Toutefois, cette loi, qui empêche deux époux d’être seuls associés, a principalement profité aux fils d’agriculteurs s’apprêtant à reprendre l’exploitation, maintenant ainsi l’épouse comme aide familiale. En 1973, le statut « associé d’exploitation » a eu des conséquences similaires. »
L’ÉVOLUTION DES STATUTS
L’histoire se poursuit dans les années 80 avec l’arrivée du statut de « co-exploitante » : les femmes peuvent désormais, officiellement, accomplir les actes administratifs nécessaires à la bonne gestion de la ferme. Et en 1985, apparaît l’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) qui permet aux conjoints de s’associer tout en individualisant leurs tâches et leurs responsabilités.
« Toutefois, il s’agit d’une identité professionnelle à partager avec le mari, et non d’un droit personnel attribué aux femmes. », précise le site. Ce sont là les prémices d’avancées nouvelles qui se profilent. En 1999, la loi d’orientation agricole instaure le statut de « conjoint collaborateur », en 2006 la couverture sociale est étendue aux conjointes d’exploitants, en 2011 est autorisé le GAEC entre époux et en 2019, le congé maternité des agricultrices s’aligne sur celui des salariées et indépendantes, soit 8 semaines (2 semaines avant l’accouchement et 6 semaines après l’accouchement), le décret prévoyant également une indemnité journalière pour celles qui ne pourraient pas être remplacées (sachant qu’en juin, un communiqué signé par les ministres de la Santé, de l’Agriculture et la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes signalait que 60% des agricultrices arrivaient à être remplacées… On ne sait rien en revanche de celles qui n’y parviennent pas…).
Lentement. On progresse. Sans que ce soit la panacée, on progresse. L’agriculture ne se féminise pas, les femmes ont toujours travaillé dans les exploitations. Les tâches accomplies par les paysannes et conjointes de paysans sont désormais rendues légèrement plus visibles et les statuts, quand elles en ont, leur apportent un peu plus de reconnaissance, sans oublier la protection sociale.
Depuis les mouvements féministes et la création de statuts permettant de déclarer la partie réalisée par les agricultrices, les chiffres ont triplé. En 1970, elles sont 8% à être cheffes d’exploitation ou coexploitantes. En 2010, elles sont 27%. Cependant, on constate également qu’elles restent majoritairement plus nombreuses à être conjointes actives non exploitantes (62% encore en 2010). Comme le souligne Anaïs Fourest, « Le secteur de l’agriculture, c’est un microcosme de ce qu’on peut voir dans la société. »
INTERROGER LES IDÉES REÇUES
Elle est animatrice au sein de l’Adage 35 et observe précisément ce microcosme à travers le groupe non mixte Les Elles, dont elle est la coordinatrice. L’Adage, c’est un Civam (centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) fondé par des éleveurs et des éleveuses pour l’Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement. Bâti dans les années 90 sur les principes de l’éducation populaire, il est composé aujourd’hui, à l’échelle départementale, d’une centaine d’adhérent-e-s, réuni-e-s par leur volonté de se former à la pratique des systèmes herbagers pâturants autonomes.
« L’idée, c’est vraiment que les groupes – constitués par thématique – soient force d’échanges et de formations avec ses pairs pour partager leurs questionnements et leurs expériences. »
explique Anaïs Fourest.
Dans l’association, on compte majoritairement des éleveuses et éleveurs de vaches laitières mais la réflexion d’intégrer d’autres ruminants comme les chèvres et les moutons suit son cours et on ouvre à l’agriculture biologique comme à l’agriculture conventionnelle : « L’objectif est toujours la recherche d’autonomie. »
 Pas étonnant dans cette dynamique que l’on trouve au sein de la structure un groupe non mixte, bien décidé à bouleverser les idées reçues et à interroger les stéréotypes.
Pas étonnant dans cette dynamique que l’on trouve au sein de la structure un groupe non mixte, bien décidé à bouleverser les idées reçues et à interroger les stéréotypes.
« Depuis plusieurs années, la réflexion autour de la place des femmes dans ce secteur se développe. Cette réflexion a plus ou moins d’écho selon les périodes. En Ille-et-Vilaine, en 2016/2017, le CA, qui est majoritairement masculin, a constaté une proportion inégale entre les femmes et les hommes lors des réunions et des formations. Le groupe vise alors à se questionner sur les freins à la participation des femmes mais aussi à chercher comment répondre au mieux à leurs besoins. », précise la coordinatrice, qui mentionne, au départ, la réticence de certaines adhérentes, notamment les plus engagées dans le Civam, à constituer un groupe non mixte, comme le déclare d’entrée de jeu Marie Edith Macé, agricultrice à Melesse et vice-présidente de l’Adage :
« Quand on m’a dit que c’était un groupe ouvert uniquement aux femmes, avec aussi les conjointes de paysans, je disais « au secours », et puis je suis allée voir… »
Elle en fait toujours partie. Avant la création, elles se sont renseignées sur les apports de la non mixité et ont pris conseil auprès du Civam 44, déjà expérimenté dans ce domaine. Aujourd’hui, elles s’accordent sur les bienfaits d’un espace dédié aux paysannes et aux conjointes de paysannes - quel que soit les statuts des unes et des autres - dans lequel se libèrent les paroles, s’échangent les parcours, les vécus et les ressentis et se crée au fur et à mesure un lien de confiance et devient une source d’émancipation.
ELLES MÈNENT L’ENQUÊTE
Au printemps 2019, Les Elles décident de réaliser une enquête pour mieux connaître les freins et les leviers quant à la progression de l’égalité femmes-hommes au sein de l’Adage : « L’enquête est partie de l’envie de mieux connaître les femmes qui sont là. De mieux connaître leurs profils, leurs envies et leurs besoins. »

Qui sont-elles et que font-elles ? Ce sont dans un premier temps les deux axes d’interrogation de cette première approche. Parmi les 130 fermes – environ – de l’Adage (qui estime à une soixantaine les exploitations comptant des femmes ayant un statut), 49 femmes ont répondu : 36 paysannes, avec ou sans statut, et 13 conjointes de paysans.
« Il y a encore des femmes qui toute leur vie durant travaillent sur la ferme, sans statut, sans rémunération. C’est extrêmement précaire. Il y a quelques générations, c’était le lot de quasiment toutes les femmes sur les fermes. La grande majorité a un statut désormais et souvent, elles sont associées. Certaines s’installent seules, d’autres en couple, ou sont salariées, ou sont conjointes collaboratrices. Les profils sont différents. », commente Anaïs Fourest.
Elles ont entre 25 et 70 ans et sont principalement issues du milieu agricole en ce qui concerne les agricultrices, et principalement non issues du milieu agricole pour les conjointes d’agriculteurs. Sur les 36 paysannes, 24 sont cheffes d’exploitation et 2 retraitées étaient anciennement cheffes d’exploitation. Sur ces 26 femmes, 15 indiquent que leur statut a évolué dans le temps avant de devenir cheffes d’exploitation.
L’enquête pose ainsi la question : « En est-il de même pour les hommes ou est-ce le statut des femmes qui est le plus souvent la variable ajustable ? » Page suivante, une autre interrogation est mise en évidence : « Y a-t-il un lien entre le type de formation initiale et le sentiment de légitimité sur la ferme ? » Sachant que la plupart d’entre elles n’ont pas de formation initiale agricole et ont exercé une autre profession avant de s’installer, souvent pour rejoindre le conjoint ou pour reprendre la ferme familiale.
Concernant les conjointes d’agriculteurs, qu’elles aient une activité à temps plein ou à temps partiel en dehors de la ferme, dans le milieu agricole ou non, elles consacrent tout de même entre 0 et 5h par semaine en moyenne au travail sur l’exploitation (principalement pour aider/faire (à) la traite, le soin aux veaux, l’alimentation et l’entretien des espaces). Trois des répondantes passent plus de 10h dans la semaine aux tâches de la ferme. Toutes aident à la comptabilité et à la gestion.
IL EST OÙ LE PATRON ?
« Partout, tout le temps, il y a toujours eu une grande implication des femmes dans la vie des fermes. Dans l’enquête, on s’est intéressées également à la répartition des tâches. Il n’y a aucune découverte, juste une confirmation d’une répartition « classique » et genrée : les femmes sont plus souvent chargées de la traite, des soins, de la compta, de la gestion, etc. Ce n’est pas toujours heureusement ! Certains couples répartissent les astreintes, partagent les infos et les décisions et la gestion se fait de manière équitable mais ça reste minoritaire. », précise la coordinatrice des Elles.
Finalement, leur point commun est là. Au-delà de leur métier d’agricultrice, elles sont femmes, et composent avec les assignations imposées à leur genre. Alors la fameuse apostrophe de « Il est où le patron ? », en règle générale, elles la connaissent malheureusement bien.
« Un jour, un technicien arrive et fixe un RDV avec Pascal (Renaudin, ndlr),c’est lui qui était là ce jour-là. C’est moi qui suis allée au RDV parce que c’était plus dans mon domaine. Donc pour nous, c’était naturel de faire comme ça et on ne s’est pas posés de questions. Ah bah le technicien il était surpris en me voyant, je dois pas avoir le look agricole. »
rigole Lynda Renaudin.
Elle poursuit : « Je peux vous dire que l’entretien ne s’est pas très bien passé… Faut toujours ramer, c’est assez incroyable ! » Quand on arrive sur l’exploitation de Vert-Lait-Près, installée à Bréal-sous-Monfort, Lynda gère la traite des vaches et Pascal s’en va amener leur plus jeune fille, âgée de 9 ans, à l’école.
« Au niveau de l’organisation et des décisions, on fonctionne à 2. On prend les décisions ensemble. Après, on essaye d’équilibrer selon nos envies et nos compétences. On a forcément des domaines dans lesquels on est plus à l’aise. », nous dit-elle.

Elle a de la gouaille, un grand sourire et du répondant. Et il en faut visiblement pour affronter les remarques, les regards et les éléments qui peuvent sembler anodins mais ne le sont pas du tout :
« En 2006, on a créé l’EARL, on est associé-e-s à 50-50. A ce moment-là, on a changé de banque. Bon alors, c’est moi qui suis rattachée à quelque chose d’existant du fait de mon installation mais la conseillère a quand même entièrement mis le compte au nom de Pascal. La femme n’est pas forcément reconnue dans son statut d’agricultrice. »
Face aux techniciens extérieurs, elle le dit, il ne faut surtout pas être en position de recul. Et ne pas accepter le moindre manque de respect quand ceux-ci ne veulent pas comprendre qu’ici, il y a une patronne, au même titre qu’un patron.
« Pourquoi c’est l’homme qui dirige l’exploitation ? Pourquoi c’est l’homme qui prend les décisions ? On a le devoir de dire « On est là ! », c’est important. Si dans la vie de tous les jours, on relève tous et toutes des inégalités du quotidien, on va avancer. »
dit-elle.
CHEMINS DIVERS
Elles ont des parcours différents et des motivations différentes. Lynda Renaudin, elle, a fait des études de médecine et de droit. En rencontrant son mari, dont l’exploitation appartient à sa famille depuis de nombreuses générations (peut-être depuis la Révolution, nous confie-t-il), elle décide, il y a 20 ans, de se convertir à l’agriculture d’abord en tant que conjointe collaboratrice puis en tant qu’associée, après avoir obtenu un BTS agricole en un an, dans une formation pour adultes.
« C’est une super expérience parce que ça donne vraiment une vision d’ensemble de l’exploitation, on aborde plein de points techniques, etc. », s’enthousiasme l’agricultrice de 43 ans, toujours désireuse d’apprendre et curieuse de tout ce qui attrait à son troupeau, constitué d’une quarantaine de vaches laitières élevées, en agriculture bio :
« Ce qui me plait, c’est le contact avec les animaux et avec la nature, c’est le côté très apaisant. C’est un peu la base ! Et puis j’aime mes vaches, c’est important pour moi, elles ont toutes un caractère différent, elles sont toutes différentes, j’aime ça. Et puis, ça me plait aussi de produire un lait bio pour les gens, de produire quelque chose de qualité qui est en phase avec nos convictions. »
Stéphanie Guilloteau est installée sur une ferme de Pancé, avec un troupeau d’une quarantaine de vaches laitières également en agriculture bio, depuis bientôt 10 ans. Travailler sur une exploitation, elle a « toujours fait ça ». Ses parents à elle avaient une ferme, les parents de son conjoint, Cyril Guilloteau, aussi.

Tous les deux ont un BTS agricole en poche et une année supplémentaire de spécialisation en animation nature pour elle, en production vaches laitières pour lui. Le projet a été conçu à deux. D’abord en EARL puis en GAEC. Toujours associé-e-s.
« M’installer, c’était pour le cadre de vie, la liberté d’organisation, d’espace et de temps, malgré les contraintes. Pour faire une famille aussi, c’est le cadre idéal. Après, au niveau de l’activité, qu’on ait un troupeau de chèvres, d’éléphants ou de vaches, pour moi, c’était pareil. », nous dévoile-t-elle, en descendant du tracteur pour récupérer les piquets qui balisent le chemin et encourager les vaches retardataires à rejoindre la salle de traite.
Elle est franche et réservée et le dit d’emblée, elle est en pleine réflexion professionnelle : « Dix ans après, mon choix m’est revenue à la tronche. Je sors d’un bilan professionnel parce que je me posais des questions. Un métier en salariat, ça ne me motive pas du tout. Moi, ce que je voudrais, c’est ouvrir la ferme en fait. Ne pas être coincée qu’avec des vaches. Je veux conserver le cadre de vie et la liberté d’organisation, et développer un projet d’accueil social et pédagogique sur la ferme à terme. Ensuite, je devrais enchainer avec une labellisation pour accueillir les structures qui accompagnent les publics comme les personnes handicapées par exemple. Ce n’est pas un loisir, je veux que mon projet soit rémunérateur. »
De son côté, Marie Edith Macé se souvient, les yeux pétillants, de la phrase qu’elle prononçait lors de son enfance : « Plus tard, c’est moi que je trairais les vaches ! » Et ça n’a pas manqué puisqu’en 2008, elle reprend la ferme familiale, située en bordure quasiment de Rennes, à Melesse. Entre temps, elle a effectué des études de comptabilité et a exercé le métier pendant 15 ans.
« Mon père disait qu’agriculteur, c’était le plus beau métier du monde mais que c’était un métier de con. Il ne nous a jamais inclus dans les travaux de la ferme quand on était petits avec mes frères. Finalement, j’ai repris et j’ai fait une formation pour adulte, un BPREA (Brevet professionnel responsable d’exploitation agricole, ndlr). », souligne-t-elle.
AFFRONTER LE SEXISME, QUASIMENT AU QUOTIDIEN
Des embuches, elle en a connu depuis son installation. Le sexisme, elle l’a affronté à plusieurs reprises. : « Mon père était associé sur la ferme avec son frère. Quand il est parti à la retraite, ma mère l’a remplacé. Elle a continué avec un salarié et moi j’ai repris avec ce même salarié. Je me suis mise en GAEC mais ça a tourné en eau de boudin. Je me suis alors installée avec un père et son fils en 2012. On a fait grossir le troupeau et on a multiplié les activités : viande bovine, cidre, jus de pomme, marché à la ferme, etc. Tout en vente directe. C’était très chronophage. »
Elle s’occupe alors de la vente, du troupeau et de l’administratif. Jusqu’au jour, où le père et son fils - associés à 25% chacun à Marie Edith qui elle, détient 50% à elle seule – viennent lui dire que comme elle ne fait pas de tracteur ni de béton, elle sera désormais payée 70%...
« Ils me disent ça en novembre, vous savez quand France Inter (parce que c’est France Inter dans la salle de traite) annonce qu’à partir de ce jour-là, les femmes ne sont plus payées par rapport aux inégalités salariales !!! En gros, ils m’ont dit que sans eux, la ferme ne tournait pas… J’ai pris mes clics et mes clacs (façon de parler parce que je suis restée là) et j’ai recommencé toute seule. Je suis née là moi, j’ai un attachement viscéral à ce lieu. », scande l’agricultrice qui a conservé son troupeau de vaches laitières en agriculture bio et son marché à la ferme, où elle vend divers produits du coin.

Depuis, elle a embauché un salarié et s’implique dans la vie locale en tant qu’élue adjointe mais aussi à l’Adage en tant que vide-présidente ou à la Cuma (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole), entre autre. La fameuse question, « Est-ce que je peux voir le patron ? », tout comme Lynda Renaudin, elle l’a déjà entendue : « C’est moi, dégage ! Non mais plus sérieusement, y a que mon nom sur l’exploitation… » La preuve que les inégalités et les stéréotypes sont bien ancrés. Elle poursuit :
« Quand je vais aux réunions à la Cuma, pour la gestion du matériel et des plannings, je prends toujours soin d’arriver 10 minutes en retard. Sinon, je dois taper la bise et les mecs en veulent toujours 4… Et puis, quand j’y vais, c’est jean et baskets. Je fais attention à m’habiller de la manière la plus neutre possible. C’est délirant qu’on puisse faire attention à ce genre de calculs ! »
PRISE DE CONSCIENCE, VIGILANCE ET PIQURE DE RAPPEL
Ses connaissances lui ont, en partie, étaient transmises par sa mère. Une vraie éleveuse, comme elle dit. Qui lui a tout appris sur les vaches, sur les gestes à avoir avec elles, sur la gestion de la ferme. Intervenants extérieurs et techniciens lui ont souvent dit que cette exploitation, c’était une affaire de femmes. Parce que depuis 5 générations, ce sont elles qui transmettent les informations concernant l’élevage et le rapport aux animaux.
« C’est la société qui fait que les femmes s’occupent des animaux. Ma mère a commencé à avoir un statut très tard. Elle a été cheffe parce qu’elle a repris la suite de mon père. Ma grand-mère, mon arrière grand-mère, etc. n’avaient pas de statut, elles. Elles n’étaient que des femmes de. Comme les boulangères. Ce sont les femmes des boulangers. Alors qu’elles passent leurs journées entières dans la boutique. Il y a plein de métiers comme ça. Quand je travaillais en compta, on conseillait justement à nos clients de déclarer les femmes. C’était une vraie révolution à l’époque ! Aujourd’hui, l’égalité femmes – hommes est d’actualité et tant mieux ! », s’anime l’agricultrice.
Les choses avancent. Les mentalités progressent. Doucement. Lentement. Entre les générations, un fossé se creuse. Sans parler d’incompréhension – parce qu’on n’a pas mené l’enquête sur ce terrain-là – Stéphanie Guilloteau décèle tout de même une sorte de rejet vis-à-vis du modèle de ses parents :
« Je ne voulais surtout pas être comme eux. Pas dans leur métier mais dans leur couple. Et puis, des fois, je me suis aperçue que ce que je ne voulais absolument pas reproduire de ma mère, je l’ai fait quand même. Ça ne me va pas. Il y a vachement de choses à changer dans la société et dans les mentalités. Moi, je commence par l’éducation de mes enfants. C’est super important. Je veux donner toutes les clés à nos enfants. On a 2 garçons et une fille et je veux qu’ils aient tous les trois les mêmes clés. »
 Lynda et Stéphanie parlent toutes les deux de « piqure de rappel », d’attention et de vigilance à avoir au quotidien. Si pour la ferme, les décisions se prennent et se répartissent à deux, il doit en être de même à la maison.
Lynda et Stéphanie parlent toutes les deux de « piqure de rappel », d’attention et de vigilance à avoir au quotidien. Si pour la ferme, les décisions se prennent et se répartissent à deux, il doit en être de même à la maison.
« En fait, faut toujours la ramener. Et c’est jamais évident parce qu’on passe vite pour des rabats joie. Faut réussir à être fines… Par exemple, moi j’entends « Si tu veux que je fasse plus de vaisselle, tu vas donner à bouffer aux vaches », je suis pas contente d’entendre ça. Ça ne me va pas. Les tâches de la maison ne sont pas que pour moi. C’est particulier dans une ferme, le fonctionnement de la maison, de l’organisation, entre les enfants, les repas, les tâches ménagères, etc. est très lié au travail sur l’exploitation. Tout est intrinsèquement lié pour moi. Quand je fais la bouffe le midi, je me dis que ça fait parti du boulot. C’est pas très valorisant. Alors oui, Cyril est plus motivé que moi par les vaches mais bon… C’est pour ça que j’espère qu’avoir mon activité en parallèle aidera à résoudre quelques problèmes. On verra. », pointe Stéphanie.
Elles ont conscience que la problématique est sociétale. « Ces inégalités sont historiques. Les tâches ménagères, les enfants, les repas… Avec Pascal, on essaye de se partager au max les tâches. Mais oui, il faut encore une petite piqure de rappel. Quand je vois que ça se déséquilibre, je lui dis et puis ça se rééquilibre. Mais c’est tout le temps comme ça. », précise Lynda Renaudin.
C’est aux femmes qu’incombent la responsabilité de la vigilance permanente et la responsabilité de pointer les inégalités, afin de rééquilibrer la balance.
L’ENRICHISSEMENT PAR L’AUTO-FORMATION, ENTRE AGRICULTRICES
Ce que note Anaïs Fourest à partir des premiers résultats de l’enquête et une analyse plus large des problématiques concernant l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est que les tâches principalement réalisées par les femmes sont souvent des « tâches entrecoupées, entrecoupables » :
« En gros, qui peuvent être interrompues, si par exemple, elles font la compta, elles peuvent fermer l’ordinateur pour aller faire à manger ou aller chercher les enfants à l’école. »
Ainsi, la charge mentale du foyer est plus souvent attribuée aux femmes « et ça se retrouve ensuite dans la gestion des fermes. » À travers le groupe non mixte, les participantes témoignent de leur volonté de travailler sur les causes de la dévalorisation des missions des femmes et sur comment il est possible de les revaloriser.
Dans leurs discours et anecdotes, on entend la difficulté de la répartition des tâches domestiques dont le bon fonctionnement et l’équilibre leur incombe encore à elles, les femmes. Et subsistent encore également les représentations genrées faisant persister et perdurer les préjugés, accompagnant ainsi le sentiment d’illégitimité que de nombreuses agricultrices ressentent. Et quand on aborde le sujet, un même exemple revient toujours sur le tapis : le tracteur.
« Pascal utilise plus le tracteur que moi, c’est vrai. Mais je sais le faire. J’ai appris sur le tas parce que ça m’a intéressée d’apprendre. Je suis une femme et je ne vois pas pourquoi je ne conduirais pas un tracteur. Une fois, Pascal a été arrêté 3 mois, j’ai tout fait toute seule, je suis capable de faire tous les postes. Si je dois labourer, je laboure. Je ne peux pas vous donner une journée type parce que ça dépend des saisons, des besoins, etc.
Mais déjà le minimum syndical, c’est la traite – qu’on fait souvent à 2 – l’alimentation des animaux et l’administratif. Après, il y a les coups de fil, la vente, on peut être amené à devoir refaire les clôtures, à raboter l’espace, on soigne les animaux, puis il faut aller chercher ma fille à l’école et repartir à la traite, etc. Quand j’ai repris mes études, mes enfants étaient petits (bon maintenant ils ont 20, 17 et 9 ans) mais je ne pouvais pas travailler sur la ferme en même temps. Pascal gérait.C’est un vrai travail d’équipe. », souligne Lynda Renaudin.
Au sein du groupe Les Elles, une formation informelle a été organisée pour celles qui souhaitaient apprendre à conduire un tracteur. Les volontaires se sont retrouvées à la ferme de Stéphanie et Cyril. Fille d’agriculteurs, elle a appris dès son adolescence à diriger l’engin, tout comme ses frères.
« C’était chouette cette formation tracteur. C’était très intéressant d’être toutes sur la même position et non pas dans la relation de dominants et de dominées. En général, c’est ton père qui t’apprend ça ou ton mari. À un certain âge, c’est bon t’as plus envie de ça. Entre pairs, c’était rassurant et enrichissant. »
commente Stéphanie Guilloteau, tout aussi convaincue que ses consœurs de l’évolution progressive des mentalités.
Qui vient notamment des femmes et des filles elles-mêmes. « Je vois ma nièce l’autre jour, je la mets sur le tracteur, elle a 11 ans, et elle me dit « Mais je peux pas en faire, je suis trop petite. » On a discuté et pour elle, en tant que fille, elle peut tout à fait conduire un tracteur, elle voit même pas pourquoi elle ne pourrait pas. Elle disait juste qu’elle était encore trop jeune. C’est bien, on gagne des batailles ! », se réjouit Marie Edith Macé.

LIBÉRER LA PAROLE DANS UN ESPACE BIENVEILLANT
Elles s’accordent toutes les trois sur de nombreux points, en particulier sur l’intérêt à participer au groupe Les Elles. Il a suffi d’une seule réunion à Marie Edith, la moins convaincue au départ :
« On ne se sent pas légitimes à parler quand des hommes sont à côté. On le deviendra mais faut qu’on s’entraine. Les femmes, on se met une pression pour prouver qu’on peut y arriver. Et souvent, on échoue parce qu’on y va en force ou avec la trouille au ventre. Je ne dis pas que c’est la faute des mecs, eux aussi ont des injonctions qui sont difficiles, mais je dis que c’est la faute de la société. Entre nous, on a une grande liberté de paroles. »
Même son de cloches du côté de Lynda qui apprécie le fait de pouvoir discuter de leurs vécus et d’avancer ensemble. « On s’encourage et on se soutient. Il n’y a pas de jugement et il y a une parole libre. Chacune raconte son vécu, ses craintes, ses doutes, etc. Collectivement, y a moyen de dépasser les difficultés. À cause du regard des autres, certaines agricultrices se mettent dans des situations où elles ne sont pas reconnues parce qu’elles n’osent pas. Et c’est incroyable de se dire qu’il y a des organismes para agricoles qui portent ce regard stéréotypé, même s’il est inconscient. Il faut qu’on arrive à dépasser ça, ce regard des autres, et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts mais ça avance. C’est pour ça que le groupe me plait. Si on sent le jugement, forcément on se rétracte et on ne veut plus avancer. Là, on est dans l’écoute et la bienveillance. C’est très enrichissant d’entendre et de découvrir les expériences de chacune car on a toutes des parcours différents. », précise-t-elle.
La liberté de paroles revient de concert entre les trois, tout comme le fait de pouvoir exprimer des questionnements, des réflexions, des ressentis et de se rendre compte qu’ils sont communs au groupe, et plus largement au genre féminin.
« J’aime bien le partage de vécus entre nous. On partage les mêmes soucis sur nos fermes et avec les mecs, les nôtres mais aussi les voisins, etc. On est contentes de partager. Je me posais des questions et je me suis aperçue que je n’étais pas la seule à me les poser. C’est intéressant de pouvoir échanger. Ça permet aussi de prendre du recul. Sur certaines choses par exemple, seule, je serais allée à la confrontation mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. En parler avec les autres agricultrices et réfléchir ensemble, ça permet d’aborder ça plus calmement et de rééquilibrer ce qui ne va pas. Ça m’a beaucoup aidée à me rendre compte de certaines difficultés et ça m’a aidée à les exprimer. Ça me titillait intérieurement et on en a parlé. Puis, chez soi, on re-négocie. Ça nous a déjà permis de changer l’organisation à la maison. Maintenant, c’est Cyril qui emmène les enfants à l’école le matin. On partage mieux et ça soulage. », analyse Stéphanie, précisant ensuite en rigolant :
« Bon, c’est moins facile quand on est enceintes et qu’on allaite… Mais bon, c’est de l’organisation de couple ! »
FORMATION ET TRANSMISSION
La formation apparaît également comme un élément essentiel à la construction de leur légitimité et de leur émancipation. Lynda Renaudin ne s’en cache pas, elle a beaucoup appris sur le tas mais cela n’était pas suffisant. Sa formation lui a permis d’appréhender de manière globale une exploitation et de faire des stages dans une autre ferme, afin d’avoir un regard extérieur.
« La formation, c’est très important. Et j’ai vraiment envie de conseiller aux femmes qui voudraient se former mais n’osent pas, de se renseigner sur ce qui existe, les aides, etc. et de ne pas s’arrêter aux difficultés de la garde d’enfants, de la répartition des tâches durant cette période-là, etc. Je crois que ce qui est important, c’est de communiquer, de parler, ne pas se retrouver seules dans ce qu’on fait. Parce qu’on peut vite être isolées. », explique-t-elle, en concluant :
« Quand on montre qu’on a des connaissances et des compétences, le genre s’efface et on se fait reconnaître en tant qu’agricultrice dans sa globalité. Dépasser le premier regard, c’est important. »
Tout comme Stéphanie Guilloteau met un point d’honneur à éduquer ses enfants dans le respect des autres et de soi, et de l’égalité, Marie Edith Macé insiste sur la transmission au travers de deux exemples. Le premier, lors d’une journée des Elles ouverte aux filles en études pour devenir cheffes d’exploitation :
« On leur a parlé de la formation tracteur faite entre nous et elles ont dit qu’elles voulaient faire ça ! Le fait qu’on suppose que les filles ne savent pas et/ou ne peuvent pas faire du tracteur, c’est un vrai frein. Là, elles étaient très enthousiastes et demandeuses. »
Le deuxième, lors d’une intervention au lycée agricole du Rheu auprès des premières années de BTS avec qui le groupe a fondé un partenariat (l’établissement scolaire a déjà dans le passé mené des travaux sur l’égalité entre les femmes et les hommes) :
« On leur a demandé de se positionner Hommes ou Femmes selon les questions. On a demandé « Qui fait du tracteur ? », bon tout le monde mais du coup pour la société, ce sont les hommes qui font du tracteur. On a demandé « Qui fait les clôtures ? » et un garçon est allé se placer du côté « Hommes » et a dit sous forme de blague « Si on veut qu’elles soient droites ». Là, je lui ai dit que c’est par rapport à ces blagues que la société n’avance pas. Il a écouté, il a compris et il a dit « Ok, vous avez raison, j’avais pas pris conscience de ça. » Parce que la société nous a appris que le rose et les poupées sont pour les filles et que le foot et le bleu sont pour les garçons. Ça crée des inégalités entre les femmes et les hommes. Comme dit une expression d’une copine espagnole, il faut chausser les lunettes violettes. On est alors plus à l’écoute des choses. »

Ainsi, les échanges ont permis d’aborder la question des représentations sur les rôles et les assignations des hommes et des femmes dans les fermes et de pouvoir mettre à plat les idées reçues qui perdurent encore dans la société.
LANCÉES DANS UNE DYNAMIQUE D’EMPUISSANCEMENT ET DE PARTAGE
Les premiers résultats de l’enquête donnent une idée des profils des paysannes, adhérentes de l’Adage 35 et fondent la matière pour les entretiens en cours de réalisation. Tous les échanges et partages d’expériences, les interventions, les données quantitatives et qualitatives constituent désormais une base solide sur laquelle s’appuie les agricultrices des Elles pour impulser la suite de leur belle dynamique.
« Elles veulent travailler à travers deux axes : la communication, les moyens et les supports pour partager en dehors du groupe avec les femmes et les hommes au sein et en dehors de l’association. Que ce soit à travers du théâtre, des illustrations… Elles veulent que ce soit palpable par et pour tout le monde. Elles veulent aussi explorer l’axe des interrogations et des recherches : souvent, on constate que ce sont des femmes qui sont à l’initiative de cercles vertueux, à l’origine des changements, etc.
Elles veulent interroger ça : est-ce vrai ? Comment s’appuyer là-dessus ? Est-ce transférable à tou-te-s ? Cette année, nous avons été soutenues par le Département. Puis on a fait une demande pour les groupe les Elles pour avoir un financement de la part du ministère de l’agriculture sur les trois prochaines années (GIEE, disposition national d’obtention d’aides financières, ndlr) et ça a été accepté cet été. C’est tout frais. C’est une bonne nouvelle et une bonne reconnaissance. », se réjouit Anaïs Fourest.
Elles entendent bien déplacer des montagnes. Et ce, avec humilité. Ensemble, elles œuvrent à la visibilisation de leur présence et de leur travail sur les fermes et leur valorisation, en rééquilibrant au mieux la répartition des tâches. Pour que la répartition des tâches ne mène pas à la dévalorisation de la personne qui les entreprend.
Parce que la partie invisible du travail – les tâches domestiques, l’éducation des enfants, la charge mentale, etc. – reste portée par les femmes, peu importe les générations, comme le souligne à juste titre la coordinatrice du groupe. Petit à petit, elles mettent sur la scène publique les notions de capacité de prises de décisions, de réalisation des envies et des besoins, de l’importance des formations.
Pour les connaissances, pour soi et pour la confiance et le sentiment de légitimité. Pour s’émanciper du regard de la société qui doit se déplacer et déconstruire les préjugés.


 On y trouve des extraits de la bande-dessinée Le potager Rocambole – La vie d’un jardin biologique, dans laquelle l’auteur Laurent Houssin se place en une sorte de disciple de Luc Bienvenu, avec qui il réalise l’ouvrage et qui n’est autre que le créateur des splendides jardins de Rocambole, situés à Corps-Nuds, à quelques kilomètres de Rennes.
On y trouve des extraits de la bande-dessinée Le potager Rocambole – La vie d’un jardin biologique, dans laquelle l’auteur Laurent Houssin se place en une sorte de disciple de Luc Bienvenu, avec qui il réalise l’ouvrage et qui n’est autre que le créateur des splendides jardins de Rocambole, situés à Corps-Nuds, à quelques kilomètres de Rennes. 
 Si le terme agricultrice apparaît pour la première fois en 1961 dans Le Petit Larousse il faut attendre 1999 pour qu’elles soient considérées comme « conjointes collaboratrices » et c’est seulement en 2006, qu’elles deviennent des agricultrices à part entière et peuvent s’émanciper de leurs maris. Pour elle : “C’est encore un métier d’homme même s’il se diversifie”.
Si le terme agricultrice apparaît pour la première fois en 1961 dans Le Petit Larousse il faut attendre 1999 pour qu’elles soient considérées comme « conjointes collaboratrices » et c’est seulement en 2006, qu’elles deviennent des agricultrices à part entière et peuvent s’émanciper de leurs maris. Pour elle : “C’est encore un métier d’homme même s’il se diversifie”.
 Elle soulève aussi l'importance de mobiliser et d’aller chercher les mères. Car le potager peut être un soutien éducatif, faire venir les enfants, leur faire découvrir le potager, comme un cahier de vacances. Majoritairement encore en charge de l’éducation des enfants, en les faisant venir sur les lieux, c’est aussi leur permettre de se réapproprier l’espace. Pour cela des ateliers en non-mixité sont organisésavec la volonté d’instaurer un climat de confiance.
Elle soulève aussi l'importance de mobiliser et d’aller chercher les mères. Car le potager peut être un soutien éducatif, faire venir les enfants, leur faire découvrir le potager, comme un cahier de vacances. Majoritairement encore en charge de l’éducation des enfants, en les faisant venir sur les lieux, c’est aussi leur permettre de se réapproprier l’espace. Pour cela des ateliers en non-mixité sont organisésavec la volonté d’instaurer un climat de confiance. 

 Les 27 et 28 février 2019, la compagnie On t’a vu sur la pointe mêlait témoignages d’agricultrices et récit familial fictionnel dans un théâtre documentaire saisissant et impactant. Les premières représentations, en milieu urbain, de Héroïnes ont eu lieu au théâtre de la Paillette à Rennes (la rédaction y était et avait réalisé un article à la suite du spectacle, publié dans le numéro 78 – mars 2019).
Les 27 et 28 février 2019, la compagnie On t’a vu sur la pointe mêlait témoignages d’agricultrices et récit familial fictionnel dans un théâtre documentaire saisissant et impactant. Les premières représentations, en milieu urbain, de Héroïnes ont eu lieu au théâtre de la Paillette à Rennes (la rédaction y était et avait réalisé un article à la suite du spectacle, publié dans le numéro 78 – mars 2019). 
 Pas étonnant dans cette dynamique que l’on trouve au sein de la structure un groupe non mixte, bien décidé à bouleverser les idées reçues et à interroger les stéréotypes.
Pas étonnant dans cette dynamique que l’on trouve au sein de la structure un groupe non mixte, bien décidé à bouleverser les idées reçues et à interroger les stéréotypes.



 Lynda et Stéphanie parlent toutes les deux de « piqure de rappel », d’attention et de vigilance à avoir au quotidien. Si pour la ferme, les décisions se prennent et se répartissent à deux, il doit en être de même à la maison.
Lynda et Stéphanie parlent toutes les deux de « piqure de rappel », d’attention et de vigilance à avoir au quotidien. Si pour la ferme, les décisions se prennent et se répartissent à deux, il doit en être de même à la maison.




 Le 26 septembre dernier, le sénateur écologiste du Morbihan, Joël Labbé, a rendu public les recommandations de la mission d’information du Sénat sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales.
Le 26 septembre dernier, le sénateur écologiste du Morbihan, Joël Labbé, a rendu public les recommandations de la mission d’information du Sénat sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales.
 Ce sont aussi des impacts conséquents sur la santé. À cause des perturbateurs endocriniens et autres saletés composant les produits nocifs et toxiques répandus très largement dans la nature, les sols, les eaux et l’air. On les ingère à travers l’alimentation, on les respire au quotidien, on se les étale sur la peau, on tapisse les fesses des bébés avec et on les introduit dans les vagins des femmes…
Ce sont aussi des impacts conséquents sur la santé. À cause des perturbateurs endocriniens et autres saletés composant les produits nocifs et toxiques répandus très largement dans la nature, les sols, les eaux et l’air. On les ingère à travers l’alimentation, on les respire au quotidien, on se les étale sur la peau, on tapisse les fesses des bébés avec et on les introduit dans les vagins des femmes… 
 Sur la pépinière de Floridée’o, on trouve de tout. Des tomates poussent au milieu des fleurs de tabac, de l’origan, de la guimauve ou encore de l’onagre. Cette « primevère du soir », comme on l’appelle, est utilisée pour la prévention du cancer du sein, nous prévient Thao qui s’est beaucoup servie des plantes lorsque le sien est survenu :
Sur la pépinière de Floridée’o, on trouve de tout. Des tomates poussent au milieu des fleurs de tabac, de l’origan, de la guimauve ou encore de l’onagre. Cette « primevère du soir », comme on l’appelle, est utilisée pour la prévention du cancer du sein, nous prévient Thao qui s’est beaucoup servie des plantes lorsque le sien est survenu :




 Elle a un franc parler très appréciable. De celui qui évite de prendre des détours et de pratiquer la langue de bois. D’ailleurs, elle en rigole : « Notre installation, c’est une « installation à l’arrache », comme on disait à l’époque, quand on s’est lancés avec Ben, mon compagnon, il y a 8 ans. Aujourd’hui, on dit « installation progressive »… » Pour autant, à l’arrache ne signifie pas sans réflexion mais bel et bien avec les moyens du bord.
Elle a un franc parler très appréciable. De celui qui évite de prendre des détours et de pratiquer la langue de bois. D’ailleurs, elle en rigole : « Notre installation, c’est une « installation à l’arrache », comme on disait à l’époque, quand on s’est lancés avec Ben, mon compagnon, il y a 8 ans. Aujourd’hui, on dit « installation progressive »… » Pour autant, à l’arrache ne signifie pas sans réflexion mais bel et bien avec les moyens du bord.
 « Le résultat a été inattendu pour nous : il faut aller chercher à 15-20 kilomètres de Rennes pour nourrir tout le bassin de la métropole. Attention, bien sûr, ça, c’est applicable à Rennes mais le résultat ne sera pas partout le même. Ici, nous sommes sur un territoire qui a préservé les terres agricoles aux abords de la ville, pas comme Nantes par exemple, qui a un climat assez bon, etc. On a fait l’étude pour Aubagne et ça ne fonctionne pas. »
« Le résultat a été inattendu pour nous : il faut aller chercher à 15-20 kilomètres de Rennes pour nourrir tout le bassin de la métropole. Attention, bien sûr, ça, c’est applicable à Rennes mais le résultat ne sera pas partout le même. Ici, nous sommes sur un territoire qui a préservé les terres agricoles aux abords de la ville, pas comme Nantes par exemple, qui a un climat assez bon, etc. On a fait l’étude pour Aubagne et ça ne fonctionne pas. »
 Elle réalisera ensuite les produits chez elle, dans une pièce qu’elle aménagera à cet effet, avant d’effectuer les tests pharmaceutiques nécessaires à la validation et à la commercialisation.
Elle réalisera ensuite les produits chez elle, dans une pièce qu’elle aménagera à cet effet, avant d’effectuer les tests pharmaceutiques nécessaires à la validation et à la commercialisation.


 À une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rennes, non loin du centre bourg d’Irodouër, la maison d’Anne Guillet est entourée de plusieurs étables à l’abandon et de terrains laissés à l’état naturel. Elle habite Varsovie mais bâtit son projet d’avenir dans la campagne brétillienne.
À une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rennes, non loin du centre bourg d’Irodouër, la maison d’Anne Guillet est entourée de plusieurs étables à l’abandon et de terrains laissés à l’état naturel. Elle habite Varsovie mais bâtit son projet d’avenir dans la campagne brétillienne. Avec attention, elle poursuit son chemin entre les ronces, orties, brins de menthe sauvage, vergers abandonnés, violettes lactées, chèvrefeuille, etc. De la prairie au sous-bois, tout est passé au peigne fin de son observation et de ses dégustations multiples de plantes comestibles qu’elle nous fait partager.
Avec attention, elle poursuit son chemin entre les ronces, orties, brins de menthe sauvage, vergers abandonnés, violettes lactées, chèvrefeuille, etc. De la prairie au sous-bois, tout est passé au peigne fin de son observation et de ses dégustations multiples de plantes comestibles qu’elle nous fait partager. À 30 ans, Marie Ménard formule ce même constat : « Je regrette vraiment qu’on nous élève loin de la Nature. C’est tellement bien de connaître tout ça ! » Plus jeune, elle a été assistante manager et attaque aujourd’hui sa reconversion au sein du Centre de formation professionnel et de promotion agricole (CFPPA) du Rheu pour obtenir son Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole.
À 30 ans, Marie Ménard formule ce même constat : « Je regrette vraiment qu’on nous élève loin de la Nature. C’est tellement bien de connaître tout ça ! » Plus jeune, elle a été assistante manager et attaque aujourd’hui sa reconversion au sein du Centre de formation professionnel et de promotion agricole (CFPPA) du Rheu pour obtenir son Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole.
 « On crée des lieux d’exploration qui reproduisent des écosystèmes les plus naturels possibles. On prend le temps d’observer, de ressentir l’environnement et on s’inspire de la Nature. », explique Marie Ménard. Les exploitations ou jardins permacoles ne ressemblent pas les uns aux autres, même s’ils peuvent présenter des similitudes, et ne sont pas présenté-e-s dans l’esthétique traditionnelle.
« On crée des lieux d’exploration qui reproduisent des écosystèmes les plus naturels possibles. On prend le temps d’observer, de ressentir l’environnement et on s’inspire de la Nature. », explique Marie Ménard. Les exploitations ou jardins permacoles ne ressemblent pas les uns aux autres, même s’ils peuvent présenter des similitudes, et ne sont pas présenté-e-s dans l’esthétique traditionnelle. La permaculture semble pour elle une évidence. Une évidence pour panser les blessures trop longtemps infligées à l’environnement et peut-être espérer guérir la folie qui nous entoure, pour trouver un apaisement collectif, une sérénité pérenne et respectueuse.
La permaculture semble pour elle une évidence. Une évidence pour panser les blessures trop longtemps infligées à l’environnement et peut-être espérer guérir la folie qui nous entoure, pour trouver un apaisement collectif, une sérénité pérenne et respectueuse. Si la permaculture part d’un point individuel pour évoluer en spirale et s’étendre à la communauté, son ciment de respect de son environnement pose les fondations d’un lien social essentiel à la dynamique quotidienne.
Si la permaculture part d’un point individuel pour évoluer en spirale et s’étendre à la communauté, son ciment de respect de son environnement pose les fondations d’un lien social essentiel à la dynamique quotidienne.



 Le dernier Baromètre Agence BIO / CSA, réalisé en 2015, montre que 9 français-es sur 10 consomment bio. Occasionnellement, en tout cas. Contre environ 5 français-es sur 10 en 2003. L’étude révèle également que 65% en consomment régulièrement – au moins une fois par mois – soit 28% de plus qu’il y a 13 ans.
Le dernier Baromètre Agence BIO / CSA, réalisé en 2015, montre que 9 français-es sur 10 consomment bio. Occasionnellement, en tout cas. Contre environ 5 français-es sur 10 en 2003. L’étude révèle également que 65% en consomment régulièrement – au moins une fois par mois – soit 28% de plus qu’il y a 13 ans. Des marchés bio fleurissent, comme tel est le cas le mercredi après-midi dans la capitale bretonne, au début du mail François Mitterand, les restaurateurs-trices optent désormais pour la démocratisation du bio dans les assiettes et les parents d’élèves réclament que cela en soi ainsi dans les cantines scolaires.
Des marchés bio fleurissent, comme tel est le cas le mercredi après-midi dans la capitale bretonne, au début du mail François Mitterand, les restaurateurs-trices optent désormais pour la démocratisation du bio dans les assiettes et les parents d’élèves réclament que cela en soi ainsi dans les cantines scolaires. « C’est un courant agricole que l’on ne peut pas résumer en 3 phrases dans un article mais en gros il place l’agriculteur au cœur d’un système agricole vu comme un organisme vivant. On travaille avec tous les éléments, comme la lune par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails mais ce qui est important, c’est que c’est une agriculture qui repose beaucoup sur l’observation. On prend le temps de faire, on prend le temps de se poser et de regarder nos plantes. Et ça définit le boulot qu’on a car on voit des choses que l’on n’aurait pas vu dans l’urgence. », analyse Sophie.
« C’est un courant agricole que l’on ne peut pas résumer en 3 phrases dans un article mais en gros il place l’agriculteur au cœur d’un système agricole vu comme un organisme vivant. On travaille avec tous les éléments, comme la lune par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails mais ce qui est important, c’est que c’est une agriculture qui repose beaucoup sur l’observation. On prend le temps de faire, on prend le temps de se poser et de regarder nos plantes. Et ça définit le boulot qu’on a car on voit des choses que l’on n’aurait pas vu dans l’urgence. », analyse Sophie. Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se lancent dans la filière. Il n’y a qu’à voir les chiffres. La conversion des éleveurs de vaches laitières est fluctuante et un développement de l’ordre de 30% est attendu d’ici 2018 dans le secteur du lait bio.
Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se lancent dans la filière. Il n’y a qu’à voir les chiffres. La conversion des éleveurs de vaches laitières est fluctuante et un développement de l’ordre de 30% est attendu d’ici 2018 dans le secteur du lait bio. « Parfois, j’ai des demandes pour simplement dessiner et élaborer un plan de jardin. Mais quand je réalise, je travaille en local. Avec un créateur de rosiers ou une productrice de graines et plantes sauvages. Ce que j’aime bien faire aussi, c’est de travailler avec les semis. Les gens ont envie de mettre la main à la patte, on garde donc des coins pour les récupérer les graines et les replanter. Les gens demandent des jardins vivants avec un éco-système qui va intégrer les insectes, etc. », déclare-t-elle. Le geste écologique est donc important et se développe petit à petit, à des échelles différentes.
« Parfois, j’ai des demandes pour simplement dessiner et élaborer un plan de jardin. Mais quand je réalise, je travaille en local. Avec un créateur de rosiers ou une productrice de graines et plantes sauvages. Ce que j’aime bien faire aussi, c’est de travailler avec les semis. Les gens ont envie de mettre la main à la patte, on garde donc des coins pour les récupérer les graines et les replanter. Les gens demandent des jardins vivants avec un éco-système qui va intégrer les insectes, etc. », déclare-t-elle. Le geste écologique est donc important et se développe petit à petit, à des échelles différentes.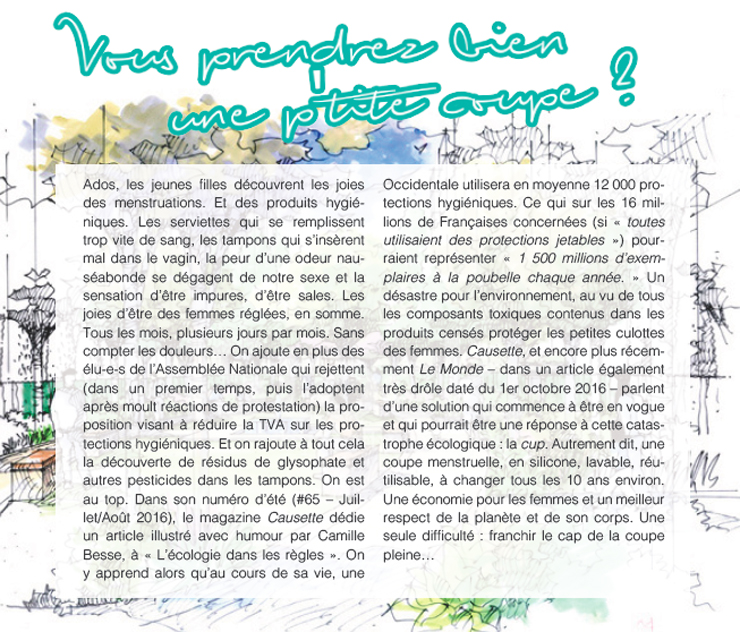
 Maintenant notre enjeu c’est de mettre les gens autour de la table pour créer des passerelles. C’est ce qu’on essaye de faire avec La Belle Déchette et notamment l’étude-action que l’on a lancé début septembre. Au premier comité de pilotage, il y avait autour de la table les partenaires et les financeurs de tous les domaines. C’était très innovant. C’est de la co-construction.
Maintenant notre enjeu c’est de mettre les gens autour de la table pour créer des passerelles. C’est ce qu’on essaye de faire avec La Belle Déchette et notamment l’étude-action que l’on a lancé début septembre. Au premier comité de pilotage, il y avait autour de la table les partenaires et les financeurs de tous les domaines. C’était très innovant. C’est de la co-construction.

 L’image de tord-boyau aura bien du mal à se décoller du breuvage pétillant, et l’Ille-et-Vilaine perdra même son 1er rang en terme de production de cidre au profit des départements normands. L’industrialisation, dans les années 70, standardise le goût du cidre et participe au désintérêt des français hors période de l’Épiphanie, la Chandeleur et Mardi gras.
L’image de tord-boyau aura bien du mal à se décoller du breuvage pétillant, et l’Ille-et-Vilaine perdra même son 1er rang en terme de production de cidre au profit des départements normands. L’industrialisation, dans les années 70, standardise le goût du cidre et participe au désintérêt des français hors période de l’Épiphanie, la Chandeleur et Mardi gras. On situe de nombreux vergers au Nord de l’Espagne et dans le pays Basque, expliquant leur arrivée et la propagation du savoir en Bretagne, Normandie et Angleterre par les routes commerciales au Moyen-Âge. Aidé par l’invention de la presse au XIIIe siècle, le cidre, alors à base de jus de pommes sauvages fermenté, est fabriqué de manière importante et se développe au cours des siècles suivants.
On situe de nombreux vergers au Nord de l’Espagne et dans le pays Basque, expliquant leur arrivée et la propagation du savoir en Bretagne, Normandie et Angleterre par les routes commerciales au Moyen-Âge. Aidé par l’invention de la presse au XIIIe siècle, le cidre, alors à base de jus de pommes sauvages fermenté, est fabriqué de manière importante et se développe au cours des siècles suivants.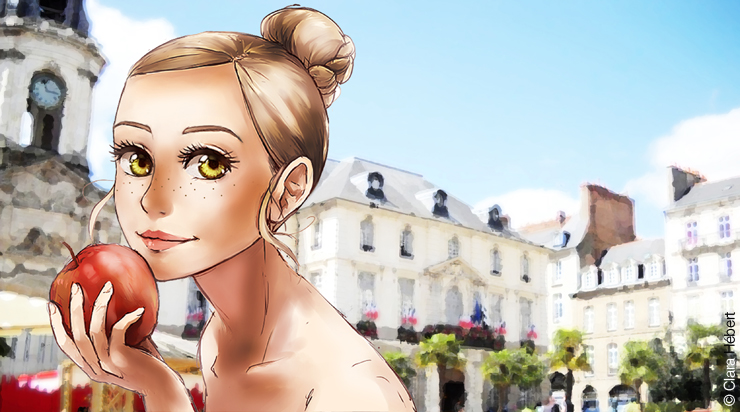
 Selon les cidreries, les fabricant-e-s travaillent avec plus ou moins de choix pour l’assemblage, allant de 6 variétés différentes pour la ferme de Gosne à 40 pour Coat Albret, établissement artisanal fondé et dirigé par Loïc Berthelot à Bédée avant de transmettre le flambeau à sa fille, Morgan, 28 ans, d’ici l’année prochaine.
Selon les cidreries, les fabricant-e-s travaillent avec plus ou moins de choix pour l’assemblage, allant de 6 variétés différentes pour la ferme de Gosne à 40 pour Coat Albret, établissement artisanal fondé et dirigé par Loïc Berthelot à Bédée avant de transmettre le flambeau à sa fille, Morgan, 28 ans, d’ici l’année prochaine. Dernière étape dans la fabrication du cidre : la mise en bouteille. Après suivi régulier de la fermentation et vérification des levures, par microscope ou par filtrage, le jus est embouteillé, la plupart du temps sans être pasteurisé. « Pas question de saper le goût ! », s’exclame Morgan Berthelot, rejointe par Sylvie qui tient particulièrement à obtenir un produit naturel. La fermentation se poursuit encore légèrement et est prêt à la consommation.
Dernière étape dans la fabrication du cidre : la mise en bouteille. Après suivi régulier de la fermentation et vérification des levures, par microscope ou par filtrage, le jus est embouteillé, la plupart du temps sans être pasteurisé. « Pas question de saper le goût ! », s’exclame Morgan Berthelot, rejointe par Sylvie qui tient particulièrement à obtenir un produit naturel. La fermentation se poursuit encore légèrement et est prêt à la consommation.
 « Nous avons l’Identification Géographique Protégée qui mentionne que nos cidres sont 100% bretons. Et nous tenons aussi au 100% pur jus, comme nous l’ont transmis nos parents et grands-parents, nous sommes très exigeants là dessus et sur la qualité des pommes que l’on achète », signale Aurélie Chesnais.
« Nous avons l’Identification Géographique Protégée qui mentionne que nos cidres sont 100% bretons. Et nous tenons aussi au 100% pur jus, comme nous l’ont transmis nos parents et grands-parents, nous sommes très exigeants là dessus et sur la qualité des pommes que l’on achète », signale Aurélie Chesnais.



 Dans des petits enclos, les truies sont allongées, leurs petits se pressant pour venir téter. Une portée est isolée au fond de la pièce. Mélodie saisit les porcelets d’une main, et coupe le cordon de l’autre. « J’aime ce boulot. Pour tout ce qui concerne l’animal, les mises bas, les soins, tout ! Il y a une relation qui se crée avec l’animal et j’aime m’en occuper. Sans oublier l’ambiance qui est très bonne ici. Je suis la seule femme et ça se passe très bien », exprime-t-elle, animée par la passion. Aucune difficulté pour elle à s’intégrer dans une équipe masculine.
Dans des petits enclos, les truies sont allongées, leurs petits se pressant pour venir téter. Une portée est isolée au fond de la pièce. Mélodie saisit les porcelets d’une main, et coupe le cordon de l’autre. « J’aime ce boulot. Pour tout ce qui concerne l’animal, les mises bas, les soins, tout ! Il y a une relation qui se crée avec l’animal et j’aime m’en occuper. Sans oublier l’ambiance qui est très bonne ici. Je suis la seule femme et ça se passe très bien », exprime-t-elle, animée par la passion. Aucune difficulté pour elle à s’intégrer dans une équipe masculine.
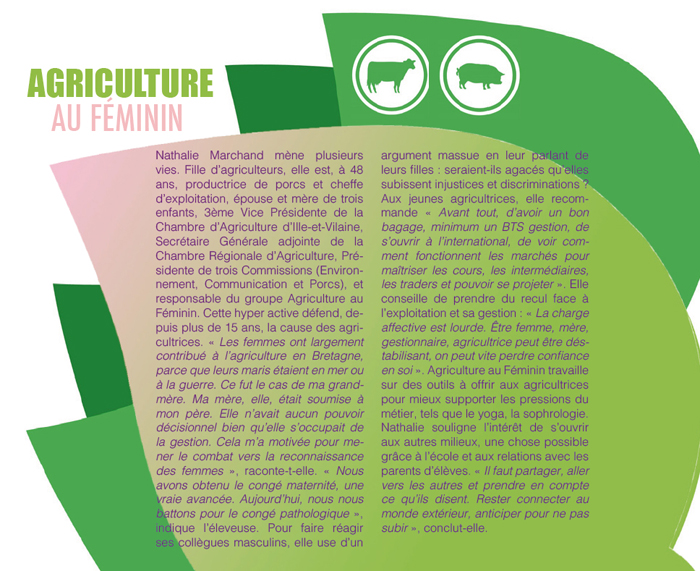
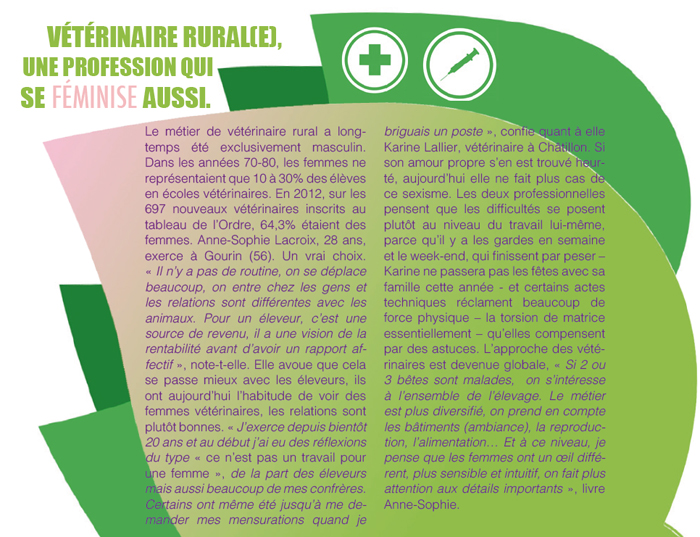
 YEGG : Pouvez-vous dresser votre portrait ?
YEGG : Pouvez-vous dresser votre portrait ? 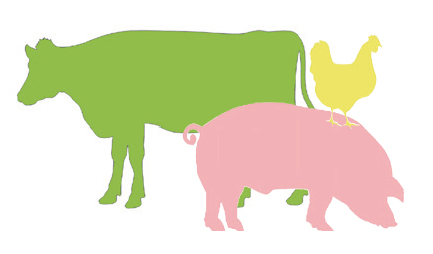 Quels sont vos objectifs en la matière ?
Quels sont vos objectifs en la matière ?