
Harcèlement sexuel. Une notion que chacun-e a dans la tête avec une définition plus ou moins précise. Une notion dont tout le monde parle. Dont de nombreuses femmes sont victimes - souvent sans en être conscientes – mais que peu dénoncent. Qu’il s’agisse de harcèlement sexuel au travail, de harcèlement moral au sein du couple ou de harcèlement de rue, les appellations – officielles ou officieuses – différent mais désignent toutes une forme de violence à l’encontre des femmes. Symbole de domination, peur de l’abandon, besoin d’asseoir une emprise sur l’autre…le harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, s’instaure souvent de manière progressive, pour des raisons diverses et multiples, laissant les femmes victimes à leurs sentiments de honte, de culpabilité, d’humiliation. Une violence psychologique inouïe se dégage de ce fléau terriblement difficile et délicat à percer à jour, y compris dans les structures spécialisées. La loi du 6 août 2012 réactualise le délit de harcèlement sexuel, puni par le code pénal depuis 1992, et le défini dans les articles 222-33-I, II et III :
« I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » Mais le harcèlement sexuel est pernicieux en cela qu’il résulte de l’intimité d’une personne et qu’il en va de la subjectivité de chacun. Où placer l’intolérable ? Peut-on attribuer une norme à la sexualité d’un individu ou d’un couple ? Comment repérer le harcèlement et se prémunir de ce fléau ? YEGG a enquêté sur le territoire rennais.
Si le harcèlement sexuel au travail semble être de plus en plus connu, il est malgré tout tabou et incarne une des formes de violence des plus délicates à dénoncer. Souvent tétanisées face à ce fléau, les femmes ressentent honte et culpabilité. Comment identifier le harcèlement sexuel dans le cadre du travail et vers qui peut-on se tourner pour agir et réagir ?

Allusions sexistes, blagues potaches un peu lourdes, tentatives de drague... Lorsque ces faits deviennent répétitifs et portent atteinte à la dignité et à la bonne santé d’une personne, cela relève d’un délit puni par la loi. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à oser en parler. En 2013, près de 37% des femmes qui témoignent auprès de l'AVFT (Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail) sont confrontées au harcèlement sexuel. Pire encore, selon les résultats de l'enquête établie par le Défenseur des Droits en février 2014, ce fléau touche encore 1 femme sur 5. Le 24 mars dernier, un communiqué de l’AVFT annonçait ne plus pouvoir recevoir de dossier en raison de la saturation des demandes, jusqu'à ce que l’association le puisse à nouveau; « le problème n’étant pas que nous ne soyons pas assez nombreuses pour répondre à toutes les sollicitations mais qu’il y a trop d’agresseurs et donc trop de victimes ».
Seule association spécialisée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail en France – qui en 1999 était l’un des pays où le taux des violences sexistes ou sexuelles sur le lieu de travail est le plus élevé, selon une étude du Bureau International du Travail - elle se mobilise également dans le Grand Ouest et peut intervenir aux côtés du CIDFF de Rennes.
Pourtant, « elles ont encore beaucoup de mal à expliquer la cause de leur détresse psychologique », explique Frédérique Chartier, psychologue du travail formée au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) de Paris en clinique du travail, installée à Rennes et proposant une consultation spécialisée « santé et souffrance au travail ».
« Ces femmes vont consulter car elles se trouvent dans un tel état de souffrance qu’elles souhaitent en sortir le plus rapidement possible, mais ne pensent pas forcément être victimes de harcèlement sexuel. »
En effet, à la difficulté d’analyser une situation qui leur est anxiogène voire insoutenable, s’ajoute parfois la honte et la culpabilité, leur faisant se sentir - à tort – en partie responsables. « Les victimes peinent à garder leurs repères, car le harceleur joue beaucoup sur la déstabilisation», ajoute t-elle.
Mais qu’est-ce que le harcèlement sexuel exactement ? L’article L1153-1 du code du travail le définit et interdit les « agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ». Et précise dans l’article L1153-2 qu’«aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ».
EMPÊCHER LA VICTIME DE BÉNÉFICIER DU SOUTIEN DES AUTRES
Les mêmes situations reviennent fréquemment, comme des plaisanteries sexistes ou des questions très intrusives sur la vie personnelle et sur le conjoint… Il peut y avoir des regards malsains, une présence insistante, des gestes déplacés ou des attitudes qui jouent sur la proximité physique. Le/la harceleur-euse peut très bien être le/la patron-ne, un-e supérieur-e ou un-e collègue de bureau. Les sources sont multiples, rendant la situation encore plus complexe.
« On retrouve très souvent un processus d’isolement social, physique associé à un processus de déstabilisation dans quasiment chaque situation. Le harceleur tente de couper la victime du soutien du collectif de travail, ce qui l’amène à se replier socialement »
Frédérique Chartier, psychologue.
Une telle pression crée rapidement un environnement de travail cauchemardesque. Quel autre recours que de se faire arrêter par le médecin traitant afin de préserver sa santé mentale ? Et cela peut parfois aller plus loin et mener à l’inaptitude professionnelle et au licenciement. Un véritable cercle vicieux ! « Attention. Si le licenciement est lié à la base au harcèlement sexuel, on peut saisir le tribunal des Prud’hommes pour licenciement abusif, puisqu’il est sans cause réelle et sérieuse, » précise Maître Lara Bakhos, avocat au barreau de Rennes, experte en droit du travail.
DÉPRESSION, STRESS, HONTE, INSOMNIES...
Dépression, crises d’angoisse, honte, autant de symptômes auxquels s’ajoutent d’autres troubles psychosomatiques tels que les insomnies ou les pertes de mémoire... Ces derniers doivent alerter la personne concernée ou son entourage proche, afin de trouver une échappatoire à cette situation qui peut paraître sans issue. « Il est nécessaire pour la victime de trouver un espace d’écoute à son vécu et de l’aider à comprendre ce qui s’est passé pour elle dans cette situation, afin de l’aider à en sortir puis de restaurer ce qui a été cassé », explique Frédérique Chartier qui reçoit régulièrement des patientes confrontées au harcèlement sexuel.
« Une part du processus d’accompagnement psychologique va consister à identifier la situation de harcèlement, notamment sexuel, en repérant le processus à l’œuvre, le nommant pour le mettre progressivement à distance. Mon rôle est aussi de crédibiliser la parole des victimes. »
Frédérique Chartier, psychologue.
Elle insiste sur l'importance de retrouver des repères, de déculpabiliser et de retrouver confiance afin qu’elles puissent reprendre la main et se projeter dans un devenir différent, y compris à l’extérieur de l’entreprise. Il est nécessaire de protéger la victime en la sortant de la situation délétère, avec l’appui d’autres professionnels, notamment le médecin du travail et le médecin traitant. Aucune sphère professionnelle n’est épargnée. Même si certains milieux sont identifiés comme potentiellement plus propices au harcèlement sexuel, comme les environnements où la proportion femmes/hommes est très inégalitaire et où la référence à la virilité peut faire partie de certaines cultures de métier, auxquelles il est difficile de ne pas adhérer sous peine de rejet.
Néanmoins, la professionnelle nous précise que la majorité des femmes qui viennent la consulter ont généralement des postes à responsabilité et se trouvent à des niveaux hiérarchiques aussi élevés. Plusieurs psychologues travaillent à Rennes sur cette même problématique, apportant à ces femmes un véritable recours à leur traumatisme.
NÉGOCIER UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE
S’il est bénéfique pour les victimes de harcèlement sexuel de se faire aider psychologiquement, celles-ci ne vont que très rarement devant les Prud’hommes. Ne se sentant pas toujours capables de faire face au long processus juridique qui les attend, souhaitant sortir au plus vite de cette situation. Mais souvent aussi pour manque de preuves inexistantes, comme le déplore Lara Bakhos, les témoins ne voulant pas se prononcer, préférant nier la situation plutôt que risquer de perdre leur emploi.
« Les situations parfois ambigües sur le lieu de travail peuvent peser en la défaveur de la victime ».
Lara Bakhos, avocat au barreau de Rennes
Les pré-supposés jeux de séduction n’ont en effet pas de traces écrites et lorsque les seules preuves de harcèlement sont orales, elles sont non recevables devant un tribunal.
Valérie Kerauffret, membre de la CGT (Confédération Générale du Travail) de Rennes, regrette elle aussi la longue procédure. « La plupart préfère négocier une rupture conventionnelle, quant elles n’ont pas déjà démissionné, car elles sont tellement traumatisées qu’elles ne peuvent pas continuer. On pousse beaucoup sur l'indemnisation pour réparer le préjudice, même si ce n’est pas ce que l’on aimerait, mais pour l’instant on fait avec », explique t-elle.
Il est impératif que l’employeur ainsi que les délégués du personnel en soient avertis le plus vite possible. « Parfois, cela suffit à arrêter le harceleur, ajoute Lara Bakhos, surtout dans de grosses structures. J’ai eu le cas d’une hôtesse d’accueil qui recevait des sms salaces sur son portable. Elle a alerté son patron qui a réussi à identifier le harceleur grâce au numéro de téléphone d’où provenaient les sms. » Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), le CE ou encore les élus du personnel peuvent également être alertés.
Si, malgré tout l’employeur ne semble pas agir pour faire cesser les faits dénoncés, la victime peut se retourner contre lui pour manquement à son devoir de protection envers elle, en référence à la circulaire du 4 mars 2014, qui rappelle « les obligations des employeurs et leur nécessaire mobilisation dans la mise en place des mesures préventives à l’encontre des faits de harcèlement ».
Il est tout de même nécessaire de savoir que les juridictions compétentes à saisir en cas de harcèlement sexuel au travail sont soit le tribunal des Prud’hommes, au quel cas la victime attaque l’entreprise pour faire respecter les conditions de travail et demande des dommages et intérêts; soit le tribunal correctionnel qui oppose la victime à l’auteur, le coupable encourant une peine de prison de 2 ans et le versement d’une amende de 30 000€.
Malgré la recrudescence importante de cas de harcèlement sexuel dans le cadre du travail, les compétences juridictionnelles sont encore bien sourdes face aux victimes.
« Les salariés en parlent de plus en plus, c’est un fait, un peu comme un effet de mode »
conclu Lara Bakhos.
À la différence que ce fléau n’a rien d’éphémère ou de ponctuel. Pourtant, dans la plupart des cas, les victimes préfèrent démissionner plutôt que de se lancer dans des procédures juridictionnelles à n’en plus finir. Certaines doutent de la recevabilité de leur plainte, ayant souvent ce réflexe infondé de se demander si elles ne l’ont pas cherché. « Elles en viennent quelquefois à se demander ce qu’elles ont bien pu faire pour attirer cette situation, si elles ne sont pas en partie responsables ou consentantes », observe Frédérique Chartier, insistant sur la nécessité de se défaire de cette culpabilité et de l’emprise psychologique du processus à l’œuvre.
La psychologue constate par ailleurs que le harcèlement sexuel est souvent englobé dans d’autres formes de violence ou situations délétères. Un processus de harcèlement moral peut s’enclencher aussi après un refus à des sollicitations plus directes.
Bien que les femmes trouvent plus ou moins des parades, appelées stratégies d’évitement, en évitant les conflits au sein de leur entreprise, ce n'est aujourd'hui plus suffisant pour combattre ce mal. L’hyper-sensibilisation et la prévention à outrance seraient-ils les seuls moyens de casser le système de domination qui infuse à tous les niveaux de la société ?
À Rennes, comme ailleurs, la mobilisation se poursuit – mise en place du site stop-harcelement-sexuel.gouv.fr par le ministère des Droits des femmes et actions quotidiennes des structures et organismes compétents en matière de droits des femmes - mais avec un visible manque de moyens visant à inciter les femmes à dénoncer les violences subies.
La question du harcèlement sexuel dans le couple est certainement la plus complexe et la plus épineuse à cerner et à dénoncer. D’une part puisqu’elle touche à l’intimité profonde d’une personne, et d’autre part car elle se confronte alors au problème de la norme concernant la sexualité d’un couple. Concrètement, comment agir ?
Les voies de lutte contre le harcèlement sexuel au sein d’un couple sont tumultueuses, voire obscures. Il semble même que la problématique se heurte au mutisme des femmes qui en sont victimes soit parce qu’elles n’en ont pas conscience, soit parce qu’elles se trouvent démunies de solutions et de recours. « Souvent la femme n’identifie pas le harcèlement sexuel mais elle emploie beaucoup d’énergie à éviter l’acte sexuel », explique Solen Degabriel, juriste au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) depuis 6 ans. Et pour éviter l’acte sexuel non consenti, les femmes mettent en place des stratégies d’évitement :
« Ne pas aller se coucher en même temps, ne pas se retrouver seule avec lui, attendre qu’il se soit assoupi pour aller au lit si jamais il boit, faire chambre à part… Tout dépend du niveau de contrôle de sa vie, de ses actes. Il se peut même qu’elle s’enferme à clé dans sa chambre car elle a pu déjà être réveillée par une relation sexuelle forcée. »
Bien souvent, le processus de harcèlement est lent et évolutif. Difficile à repérer car le conjoint, pacsé, concubin ou compagnon passe par des phases dans lesquelles il se montre attentionné, aimant et à l’écoute. Outre le fait qu’il soit extrêmement complexe de dénoncer son partenaire, il est déjà compliqué de le formuler et de l’intégrer. « Quand les femmes viennent nous voir pour nous parler, notre rôle est de voir où elles en sont à ce moment précis et quels sont leurs freins. Mais nous avons très peu de cas de femmes qui viennent nous parler d’un problème de harcèlement sexuel. C’est une infime minorité de femmes qui en parlent », précise la juriste.
Et les cas ne sont quasiment pas chiffrés ou chiffrables. Même son de cloches du côté de l’Asfad, association rennaise spécialisée contre les violences faites aux femmes, qui a inauguré fin novembre 2013 son accueil de jour, ouvert les lundis et mercredis après-midi ainsi que les jeudis. Virginie Thoby, éducatrice employée par la structure, comptabilise deux situations de harcèlement sexuel sur une centaine de femmes reçue depuis l’ouverture du lieu. « La qualification du fait est compliquée. Le harcèlement sexuel ne figure même pas dans les fiches que nous remplissons après chaque entretien. Il faut cocher la case Autres », dit-elle en examinant de près cette fameuse fiche.
IDENTIFIER LE PROBLÈME
 « C’est la forme de violence dont les femmes ont le plus de mal à parler et pourtant elle est très souvent présente. La violence sexuelle comprend un spectre très large allant du harcèlement sexuel à l’exploitation sexuelle, en passant par le viol conjugal ». C’est ainsi qu’est définie la violence sexuelle dans l’ouvrage Femmes sous emprise – les ressorts de la violence dans le couple, écrit par la psychiatre et docteur en médecine Marie-France Hirigoyen.
« C’est la forme de violence dont les femmes ont le plus de mal à parler et pourtant elle est très souvent présente. La violence sexuelle comprend un spectre très large allant du harcèlement sexuel à l’exploitation sexuelle, en passant par le viol conjugal ». C’est ainsi qu’est définie la violence sexuelle dans l’ouvrage Femmes sous emprise – les ressorts de la violence dans le couple, écrit par la psychiatre et docteur en médecine Marie-France Hirigoyen.
Le harcèlement sexuel a la spécificité de ne pas inclure l’agression sexuelle dans ce délit. C’est aussi pour cette raison qu’il n’est pas immédiatement identifié et reconnaissable : « Souvent, elles vont dire « Il ne va pas me lâcher jusqu’à la relation sexuelle » ou alors « il revient constamment à la charge » », déclare Solen Degabriel. Et la compagne va céder pour éviter la crise, apaiser le conflit et espérer une paix temporaire, un répit.
« c’est un mode de règlement de crise. Refuser la sexualité de son conjoint, c’est prendre le risque qu’une crise éclate, explose »
Virginie Thoby, éducatrice employée par l'Asfad Rennes.
Un moyen donc de se sortir d’une situation de harcèlement. Un harcèlement qui prend des formes diverses selon la personne qui peut exiger de regarder à deux des films pornographiques, alimenter la relation d’objets, vouloir que sa compagne porte des tenues spéciales, etc. Rien de choquant pour qui consent et s’épanouit librement dans la relation. « Cela peut se jouer dans l’attitude, les paroles, les gestes, il peut aussi simplement la frôler pour exercer une forme de pression tout en faisant croire qu’il s’agit d’un jeu de séduction », ajoute Solen Degabriel.
Tout cela, va alors peser sur la femme qui, elle, ne s’épanouit pas dans la sexualité imposée par son partenaire. Dans son livre, Marie-France Hirigoyen explique que la « relation sexuelle imposée est souvent passée sous silence parce qu’elle fait partie du « devoir conjugal », considéré aujourd’hui comme un droit pour l’homme et une obligation pour la femme. Beaucoup de femmes acceptent des rapports sexuels qu’elles ne désirent pas, simplement pour que le partenaire cesse de les harceler ». Car en 2005, au moment de la parution du livre, le devoir conjugal est toujours inscrit dans le code civil. Depuis, en 2006, la mention a été retirée. Mais elle n’en est pas moins gravée dans les mémoires.
« Si on a retiré la notion de devoir conjugal pour la notion de respect, il n’en reste pas moins que les femmes ont du mal à parler de violence sexuelle à cause de ça. C’est très ancré dans les idées, alors qu’aujourd’hui il n’y a plus d’obligation de dire oui ».
Solenn Degabriel, juriste au CIDFF.
Dans un témoignage que relate la psychiatre, elle décrit une situation dans laquelle Sophie manquait de confiance en elle et était en incapacité de poser des limites aux demandes sexuelles de son compagnon : « Il exige que, le soir, elle mette des tenues sexy (porte-jarretelles, bas fins, chaussures à talons très hauts…). « Au début, je le faisais pour lui faire plaisir, maintenant je le fais pour avoir la paix car, sinon, il finit par être violent. » »
LA QUESTION DE LA NORME SEXUELLE
L’obligation de ne pas dire oui signifie donc pouvoir dire non. Et non, c’est non. Une évidence malgré tout bien difficile à mettre en place lorsque l’on subit un telle menace au sein de son couple. « Quand une femme vient parler de harcèlement sexuel, c’est vraiment que c’est insupportable, intolérable ! », déclare Virginie Thoby, qui insiste sur le caractère subjectif du ressenti.
« Ce qui est invivable pour l’une ne l’est pas nécessairement pour l’autre ».
Virginie Thoby
Et c’est malheureusement là que se niche le problème. Comment définir, aux yeux de la loi et dans les consciences, le harcèlement sexuel si ce n’est en imposant une norme visant à contraindre la sexualité des couples à des conventions acceptables ou non ? Et comment définir l’épanouissement sexuel d’une femme ? Si elle est dans le partage ou non de la sexualité de son conjoint ? L’atteinte à l’intégrité et à la dignité n’est alors pas perçue de la même manière et la sonnette d’alarme ne peut venir que de celle qui la subit.
« C’est une expression très personnelle et très personnalisée. Dans mon travail, je ne suis pas dans le domaine juridique mais dans l’échange, le ressenti. Certaines femmes ont l’esprit très marqué par la violence. Il n’y a pas de marques physiques, elles n’ont pas été agressées physiquement mais ont des traumatismes bien plus profonds qui ne se guérissent pas comme une blessure sur le corps », détaille-t-elle. Honte, culpabilité, perte de confiance… les signaux et symptômes sont identiques à ceux du harcèlement moral.
Et c’est d’ailleurs en harcèlement moral que qualifie le code pénal de cette violence conjugale, dans l’article 222-33-2-1 : « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
« S’il y a agression sexuelle, c’est le fait le plus grave qui sera retenu devant un tribunal. Je pense que ça doit être très très rare d’ailleurs qu’une femme aille devant le tribunal pour harcèlement sexuel, en général, il y a eu agression ou viol conjugal », précise Solenn Degabriel.
FEMME, OBJET SEXUEL
L’objectif des structures spécialisées dans les violences à l’encontre des femmes est alors de déculpabiliser la victime, de les aider à identifier qu’il s’agit de violence conjugale et les aider à se reconnecter avec leurs émotions. « Quand on impose une sexualité à quelqu’un, qu’on l’oblige à parler d’une manière particulière, souvent crue, qu’on lui parle de sexe de manière pornographique, etc. on réduit la personne à un objet. Nous sommes là pour écouter la personne, mettre des mots sur ce qu’elle subit et l’aider à se réattribuer le droit de dire non », explique Solen Degabriel.
« Toute violence sexuelle constitue un traumatisme majeur. Il peut se faire qu’une personne à qui l’on a imposé une violence sexuelle vive désormais avec la conviction qu’elle est méprisable et qu’aucun partenaire désormais ne l’acceptera », indique et alerte la psychiatre dans son chapitre sur la violence sexuelle. Définir la situation sans mettre la femme dans une situation dangereuse, lui apprendre à se protéger et à redevenir maitresse et actrice de sa vie. Les structures proposant également des suivis psychologiques ou des groupes de parole dans certains cas.
« Je reçois la personne pour une premier entretien et je la revois quelques temps plus tard. Je peux parfois orienter vers ma collègue psychologue, selon les cas. Après pour les groupes de parole, c’est délicat d’intégrer une nouvelle personne à un groupe qui travaille ensemble. Mais ça arrive. Après, le groupe n’est pas spécifique au harcèlement sexuel mais plus largement aux violences »
précise Virginie Thoby.
Des séances importantes et délicates pour ces femmes qui même des années après la fin des actes de violences restent encore profondément émues. Aucune des participantes à l’espace de paroles du CIDFF n’a été en mesure de répondre à nos questions pour cette raison. Au Planning Familial de Rennes, une psychologue (contactée, elle n’a pas souhaité s’exprimer sur son travail) et une conseillère conjugale animent également un groupe de paroles sur les problèmes de violences.
« On fait un entretien individuel et ensuite on peut choisir de les intégrer au groupe. Pour le harcèlement sexuel, c’est très compliqué, nous avons peu d’informations là-dessus et peu de femmes qui en parlent », nous confie Brigitte Rocher, directrice du Planning Familial 35, qui précise : « Ici, nous recevons toutes les personnes qui passent la porte et ensuite si cela dépasse nos compétences et si nous ne pouvons pas les prendre en charge, nous les orientons vers un partenaire de la plateforme violence ».
LE DÉPÔT DE PLAINTE : UNE DIFFICULTÉ SUPPLÉMENTAIRE
Le harcèlement sexuel a donc quelque chose de pernicieux, infiltrant la plus grande intimité du couple, maintenant le partenaire harcelé dans une spirale cauchemardesque, la séparation n’étant pas une solution pour toutes les femmes. N’osant pas dans un premier temps en parler et encore moins le dénoncer devant un officier de police et un tribunal. Selon Solen Degabriel, « elles ont parfois peur des représailles. Ou parfois, elles veulent juste que ça s’arrête. Elles souhaitent alors se séparer mais ne pas attaquer leur conjoint ou ex-conjoint puisque le harcèlement ne s’arrête pas forcément lors de la séparation – et cela est également condamné par le code pénal. »
La procédure judiciaire n’est donc pas une volonté de toutes les victimes, préférant tourner la page au plus vite, souvent après plusieurs années de harcèlement. « Et puis, on en entend des belles nous aussi sur l’accueil à l’Hôtel de police… Ce n’est pas évident d’aller porter plainte mais alors en plus quand on arrive dans un hall avec une vitre pour parler au policier d’accueil, à qui il faut crier la raison de notre venue et que tout le monde peut nous entendre ! », s’indigne Virginie Thoby. Un accueil déshumanisé, un manque de proximité et un manque de confidentialité. Sans compter que l’on ne sait jamais si notre plainte est comprise ou non.
L’Asfad emploie un assistant social, Dominique Boitard, pour pallier la difficulté de l’exercice. « Il retrace les éléments qui montrent de la violence. Cela permet d’être plus claire et précise lorsque la femme se présente devant l’agent chargé de recueillir sa plainte », nous explique Hubert Lemonnier, chef de service à l’Asfad. Mais même une fois cette étape franchie, l’apport de preuves sera une autre paire de manches. Si l’objectif du ministère aux Droits des femmes est d’amener la victime à déposer plainte, l’institution est bien consciente que c’est un travail de très longue haleine, qui se heurte au final « aux limites du droit, du harcèlement moral à l’agression sexuelle en passant par des faits de harcèlement aggravés, toujours avec des preuves quasi impossibles à apporter ».
Sans oublier que les langues ne sont pas prêtes à se délier même dans l’intimité d’un espace sécurisé et convivial comme l’accueil de jour.
L’espoir des politiques publiques repose alors sur les collectivités locales, les structures spécialisées et la plateforme téléphonique, 3919, permettant de parler et d’être orientées vers des professionnels. Un système qui existe également au niveau local – 02 99 54 44 88 – et qui représente un premier pas vers la prise de conscience et l’accompagnement personnalisé pour se sortir d’une situation dont personne n’arrive encore à parler librement.
Sur la voie publique, ce que l’on nomme harcèlement de rue fait rage. Témoignages, coups de gueule et actions se multiplient pour faire front face à cette calamité qui peut engendrer de sérieux traumatismes chez celles qui subissent réflexions, remarques et menaces d’ordre sexuel. À l’échelle d’une ville comme Rennes, comment lutter contre ce phénomène ?

Infographie : © Sophie Barel
« Se pose forcément la question de la domination d’un sexe sur l’autre. C’est le reflet de l’inégalité des sexes. Travailler l’égalité, c’est désamorcer les formes de domination », explique Geneviève Letourneux, conseillère municipale à Rennes, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité.
Elles ont le goût amer de l’humiliation, résonnent comme des atteintes à la dignité et engendrent une peur de la rue, ces remarques faites dans la rue. Destinées à séduire, à draguer, à importuner ou encore à effrayer… il est indéniable que les supposés effets sont nombreux et variables selon la personne qui contraint l’autre à la relation. Qui ramènent les femmes à un statut d’objet. Et d’objet sexuel qui plus est puisque la nature de la réflexion est uniquement basée sur le physique et se rapporte souvent à l’acte sexuel.
Si les atteintes sont portées sur l’espace public, c’est souvent sur Internet que les langues se délient, comme sur le tumblr Paye ta schnek ou comme le témoignage de Jack Parker à la suite de son agression – à caractère sexuel – dans le métro, rapportant ainsi les propos et les faits subis qu’ils soient de l’ordre du quotidien ou ponctuels. Le traumatisme s’établissant selon la fréquence et/ou selon la gravité de l’acte. Si certains crient à la psychose naissante, on ne peut pourtant nié qu’une prise de conscience éclot au même moment de la part des femmes et des hommes.
ACTIONS, RÉACTIONS ?
Un ras-le-bol général souffle sur la condition féminine qui souhaite que le vent prenne enfin une direction différente. Sans dire que le vent tourne et ne s’abatte dans la figure de ceux pour qui une réflexion faite à une femme dans la rue est un compliment. Et que l’absence de réponse à ce compliment les autorise à proférer une ou toute une série d’insultes nauséabondes.
Ainsi, les medium pour dénoncer ce fléau et faire comprendre l’impact qu’il peut avoir sur les femmes affluent. Éléonore Pourriat, en 2010, réinvente l’Histoire dans le film court Majorité opprimée en imaginant une société dans laquelle les hommes sont victimes de la domination féminine. Deux ans plus tard, une étudiante belge, Sofie Peeters, réalise un documentaire en caméra cachée, Femmes de la rue, pour démontrer la férocité et l’agressivité de ces interpellations, le machisme et le sexisme ambiants dans son quartier, à Bruxelles.
Plus récemment, les internautes se sont épris du blog de l’illustratrice Diglee, qui explique avec ferveur et humour ce qu’éprouvent les femmes victimes de harcèlement de rue. Entre honte, culpabilité et peur de rétorquer… Épris aussi du Projet Crocodile dans lequel Thomas Mathieu illustre des situations vécues par les femmes en BD. La toile est florissante mais l’objectif est unique : viser la prise de conscience en sensibilisant à cette problématique rébarbative qui, au delà de l’exaspération et de la lassitude exprimée par la gente féminine, a de lourdes conséquences sur l’espace public, vidé à certains endroits et certaines heures, des femmes éprouvant un sentiment d’angoisse et d’insécurité.
ELLES DISENT NON
Du « T’es charmante » au « Hey mademoiselle, tu me fais une petite gâterie ? » en passant par « Grosse salope, t’as des grosses cuisses, j’aime bien. Ça te dirait que j’t’encule ?! », ce n’est pas l’inspiration qui manque, comme le souligne Bérangère Krief dans son sketch Cours de répartie anti-relous, ou Noémie de Lattre dans sa chronique du 23 juin sur France Inter, Cons des rues. Mais du côté des outils de lutte, il semblerait qu’il y ait une panne sèche à première vue. Pas tout à fait en réalité.
Traitée dans la rue de « viande à viol », Laura fonde en mai dernier l’association Colère : nom féminin, à Nantes, et lance une collection de sacs à mains et de débardeurs sur lesquels figurent l’inscription : Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule. « Moi, c’est quand je me suis fait cracher sur les jambes, dans un bus bondé et que personne n’a réagi que j’ai eu envie de faire quelque chose », nous précise Alexia Giannerini. Début juin, elle lance, avec Maud Renusson, le collectif Stop au harcèlement de rue Rennes, reprenant la ligne de conduite du collectif éponyme parisien. Leur objectif :
« Qu’on ait en France une loi contre le harcèlement de rue, sur le modèle de celle qu’ils ont en Belgique ».
En effet, dans le pays frontalier, le maire de Bruxelles a instauré en 2012 des amendes pour insultes sexistes allant de 75 à 250€. Le dépôt de plainte ou le flagrant délit étant évidemment obligatoires. Le ministère aux Droits des femmes rappelle, outre l’absence de définition officielle du harcèlement de rue, qu’en France, la loi prévoit également des sanctions en cas d’injure publique (invective, expression outrageante ou méprisante, non précédée d'une provocation et qui n'impute aucun fait précis à la victime).
Une législation spécifique n’est donc pas à l’ordre du jour dans l’Hexagone, la ministre Najat Vallaud-Belkacem insistant sur l’importance de « s’interroger sur les causes et mettre l’accent sur l’éducation. Son outil ? L’ABCD de l’égalité », écrit-elle le 22 avril dernier sur son site officiel. Un outil enterré début juillet par le ministre de l’Éducation mais une ligne de conduite qui semble rester intacte, celle de l’éducation au respect.
C’est d’ailleurs ce que prône l’association rennaise Liberté Couleurs, en organisant chaque année Le printemps de la jupe et du respect auprès des 13-25 ans afin de leur permettre d’exprimer « leurs indignations, leur volonté de faire évoluer les mentalités ainsi qu’un ensemble de valeurs de respect dans les relations aux autres ».
Pour le collectif Stop au harcèlement de rue Rennes, les actions devraient débuter à la rentrée 2014 avec une expo photo dans les bars rennais.
« Je souhaite prendre en photo des femmes, de toutes les nationalités, de toutes les tailles, de tous les âges, en jupe. Les femmes ont honte de porter des jupes à cause du harcèlement de rue ».
Alexia Giannerini, co-fondatrice du collectif Stop au harcèlement de rue Rennes.
Pour les deux initiatrices du mouvement, il est capital d’en parler pour que les victimes n’aient plus honte et que les témoins ne soient plus passifs. Sans oublier l’importance du dépôt de plainte : « Pour la prise de conscience. Pour libérer la culpabilité des femmes. Qu’un maximum de femmes portent plainte contre X ».
Les actions devraient également être semblables à celles du collectif parisien, à savoir la création temporaire de zones sans relous et la distribution de prospectus visant à informer les habitant-e-s. « Notre but n’est pas de pousser les filles à chercher les emmerdes. Il faut savoir s’adapter aux situations selon le moment, le contexte, le gabarit de la personne… », conclut-elle. C’est ce qu’enseigne l’association nantaise La trousse à outils, en partenariat avec l’association féministe rennaise Questions d’égalité, à travers des stages d’auto-défense féministe donnés à Rennes depuis 2013, adaptés aux femmes de différentes tranches d’âge (2 stages seront proposés les 14 et 21 septembre pour les adultes et le 28 septembre pour les 12-14 ans).
« Il s’agit de trouver des attitudes et des stratégies qui permettent de s’extraire d’une situation dangereuse que ce soit au niveau psychologique ou physique. Le but est aussi de partager les vécus et de travailler sur ces expériences »
explique Isabelle Pineau, coordinatrice de Questions d’égalité.
Car si la plupart des femmes craignent l’agression physique – et sexuelle notamment – elles sont nombreuses à garder un violent traumatisme psychologique. Face au harcèlement de rue, l’humiliation et le sentiment d’impuissance, de domination, marquent profondément et s’ancrent dans la mémoire de chaque personne qui en est ou en a été victime. L’auto-défense semble alors être un remède approprié et cohérent. (Re)prendre confiance. Ne plus, ou moins, craindre la rue.
Depuis le 1er juillet, l’association teste à titre expérimental des stages d’auto-défense intellectuelle « pour un sens de la répartie et la construction d’un argumentaire contre les valeurs et discours sexistes, anti-féministes ». Six séances de travail sont organisées durant le second semestre 2014, avec une petite dizaine de femmes, sensibilisées à la question. L’objectif étant de raconter l’expérience dans un blog et un livret mais aussi de rendre compte de l’ampleur du travail à l’occasion du 8 mars 2015. « On voudrait faire une scène slam avec Slam Connexion pour raconter ce qui s’est passé durant les ateliers », dévoile Isabelle Pineau.
MARCHES POUR LA DIGNITÉ
L’association, attentive aux problématiques liées à la condition des femmes, avait en janvier 2011 évoqué le sujet du harcèlement de rue dans une conférence intitulée « Comment mettre fin aux violences contre les femmes dans les espaces publics ? », animée par la sociologue Dominique Poggi, également formatrice et animatrice de marches exploratoires de femmes. Des marches exploratoires qui ne sont généralisées en France que maintenant – au Québec, les marches sont préconisées depuis les années 90.
Le ministère aux Droits des femmes – et de la Ville - devant prochainement annoncer son calendrier concernant la mise en place de ces marches dans une dizaine de villes prioritaires. Rennes figurera-t-elle dans la liste ? Rien n’est encore officiellement défini. Mais on sait déjà que la capitale bretonne projette d’en organiser, cela figurant dans le plan d’actions, validé en juillet 2013 par le conseil municipal de Rennes, qui lui-même découle de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes.
« On est bien conscient qu’il y a des femmes qui ressentent un sentiment d’insécurité. Et on sait qu’il y a moins de femmes sur l’espace public. Mais l’espace public est à tout le monde ! »
s’indigne Elisabeth Malaurie, chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité.
Jamais expérimentées à Rennes, elles consistent à identifier les zones d’insécurité en présence des femmes du quartier qui souhaitent participer. « La méthode préconise un groupe de 10 à 15 femmes environ et de faire les marches à un horaire dans lequel elles ont déjà vécu des situations insécurisantes. C’est de l’ordre de l’observation et du diagnostic sur l’aménagement du quartier ou encore sur l’éclairage des rues par exemple », précise Elisabeth Malaurie.
En attendant, les femmes s’emparent de l’espace urbain, à travers des marches non-mixtes nocturnes – la dernière en date remonte au 18 mars - afin de se réapproprier la rue. Encore plus percutant et marquant, les Slutwalk (Marches des salopes) pour lutter contre le sexisme et la culpabilisation de toutes les victimes. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le collectif est en concertation avec les différents responsables régionaux pour définir de la prochaine date de la marche.
Et Rennes ne sera pas exemptée d’un défilé de salopes, vêtues comme elles l’entendent et fières de marcher dans les rues de la capitale bretonne, main dans la main pour dire STOP au harcèlement de rue.


 Chaque année, 4 000 naissances ont lieu dans cet établissement - excepté en 2014 qui n’a pas passé, de peu, la barre des 4 000. Un chiffre qui n’a pas été détaillé lors de la visite mais qui est un chiffre global comprenant également les nourrissons morts-nés ou décédés au moment de l’accouchement. Pour le professeur Poulain, cette proximité est garantie du bon fonctionnement du service et d’un meilleur pronostic pour l’enfant.
Chaque année, 4 000 naissances ont lieu dans cet établissement - excepté en 2014 qui n’a pas passé, de peu, la barre des 4 000. Un chiffre qui n’a pas été détaillé lors de la visite mais qui est un chiffre global comprenant également les nourrissons morts-nés ou décédés au moment de l’accouchement. Pour le professeur Poulain, cette proximité est garantie du bon fonctionnement du service et d’un meilleur pronostic pour l’enfant.


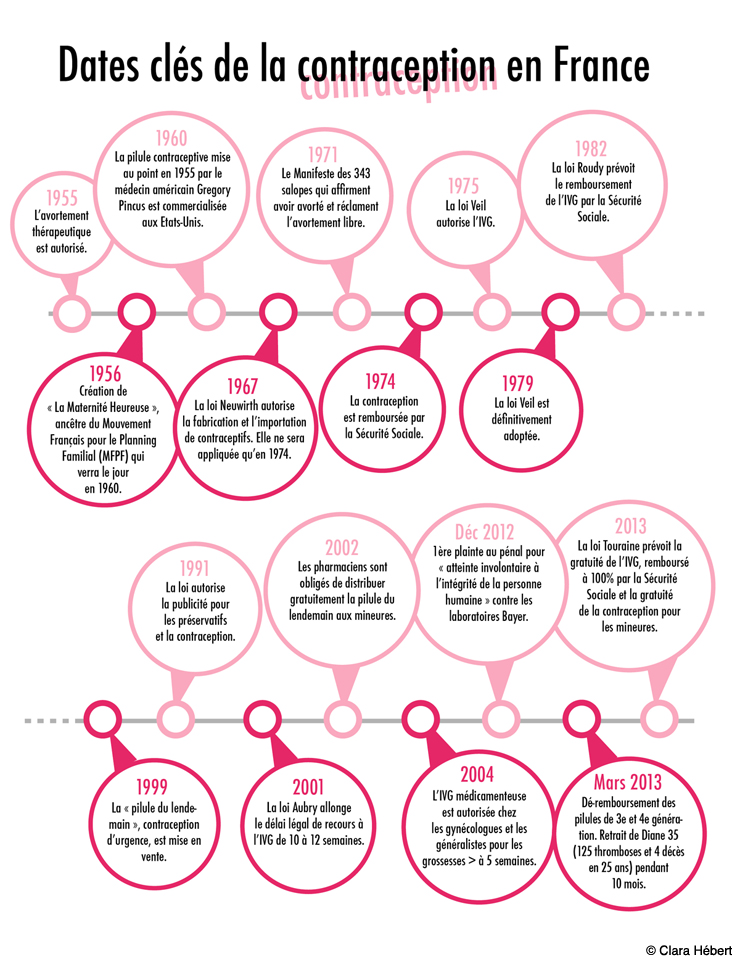
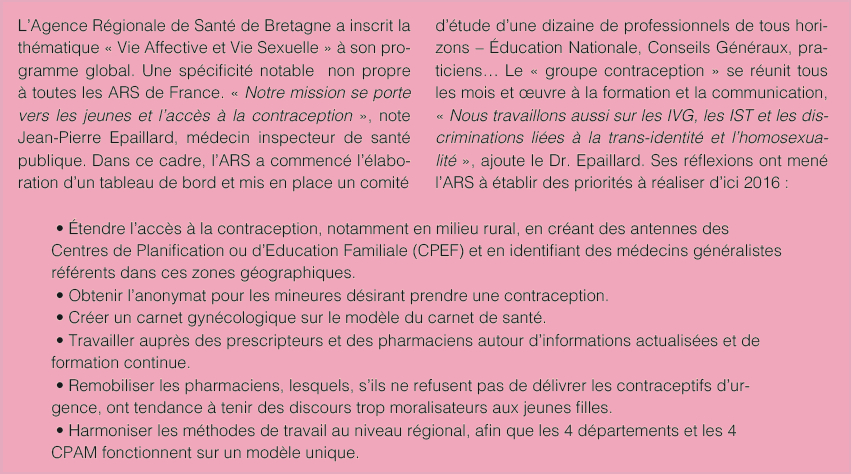
 YEGG : Pourquoi avez-vous choisi la méthode Billings ?
YEGG : Pourquoi avez-vous choisi la méthode Billings ?

 Dans les médias, la sexualité des handicapé-e-s n'est souvent montrée qu'à travers l'assistance sexuelle. Mais il existe autant de sexualités que de handicaps. « Il ne faut pas se dire que nous avons accès qu'à ce moyen là, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas accès à leur corps », déplore cette étudiante rennaise de 22 ans. Depuis février 2014, Lydie Raër a donc décidé de parler de sa sexualité à elle, sur son blog.
Dans les médias, la sexualité des handicapé-e-s n'est souvent montrée qu'à travers l'assistance sexuelle. Mais il existe autant de sexualités que de handicaps. « Il ne faut pas se dire que nous avons accès qu'à ce moyen là, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas accès à leur corps », déplore cette étudiante rennaise de 22 ans. Depuis février 2014, Lydie Raër a donc décidé de parler de sa sexualité à elle, sur son blog. 


 « C’est la forme de violence dont les femmes ont le plus de mal à parler et pourtant elle est très souvent présente. La violence sexuelle comprend un spectre très large allant du harcèlement sexuel à l’exploitation sexuelle, en passant par le viol conjugal ». C’est ainsi qu’est définie la violence sexuelle dans l’ouvrage Femmes sous emprise – les ressorts de la violence dans le couple, écrit par la psychiatre et docteur en médecine Marie-France Hirigoyen.
« C’est la forme de violence dont les femmes ont le plus de mal à parler et pourtant elle est très souvent présente. La violence sexuelle comprend un spectre très large allant du harcèlement sexuel à l’exploitation sexuelle, en passant par le viol conjugal ». C’est ainsi qu’est définie la violence sexuelle dans l’ouvrage Femmes sous emprise – les ressorts de la violence dans le couple, écrit par la psychiatre et docteur en médecine Marie-France Hirigoyen.

 Deux groupes sont constitués au fond de la salle. Laëtitia Mazoyer, au milieu, observe, écoute, attend. Les femmes, et les rares hommes présents, accordent leurs arguments avant de les confronter entre eux. La conférence commence ainsi. Par un débat mouvant. D’un côté, celles qui sont pour l’affirmation « C’est le premier pas qui coûte ».
Deux groupes sont constitués au fond de la salle. Laëtitia Mazoyer, au milieu, observe, écoute, attend. Les femmes, et les rares hommes présents, accordent leurs arguments avant de les confronter entre eux. La conférence commence ainsi. Par un débat mouvant. D’un côté, celles qui sont pour l’affirmation « C’est le premier pas qui coûte ». « Au bout d’un moment, en cours de route, j’ai commencé à marcher avec joie et j’ai tué le prince charmant ». Silence dans la salle, les spectatrices étant piquées par la curiosité. Dans une démonstration théâtrale, Laëtitia illustre la relation de couple.
« Au bout d’un moment, en cours de route, j’ai commencé à marcher avec joie et j’ai tué le prince charmant ». Silence dans la salle, les spectatrices étant piquées par la curiosité. Dans une démonstration théâtrale, Laëtitia illustre la relation de couple.
 Faut-il réellement souffrir pour être belle ? Telle est la question que l’on peut se poser après la publication le 22 avril dernier, d’un article du New York Times qui révélait une tendance de plus en plus courante chez les chirurgiens américains : proposer aux accros des stilettos (chaussures à talons aiguilles d’au moins 10 centimètres) une opération des pieds qui consiste à corriger « un hallus valgus – c’est-à-dire un oignon, responsable de douleurs aux pieds, provoqué par l’usage de ses escarpins – avec une ostéotomie et des vis de fixation ».
Faut-il réellement souffrir pour être belle ? Telle est la question que l’on peut se poser après la publication le 22 avril dernier, d’un article du New York Times qui révélait une tendance de plus en plus courante chez les chirurgiens américains : proposer aux accros des stilettos (chaussures à talons aiguilles d’au moins 10 centimètres) une opération des pieds qui consiste à corriger « un hallus valgus – c’est-à-dire un oignon, responsable de douleurs aux pieds, provoqué par l’usage de ses escarpins – avec une ostéotomie et des vis de fixation ».
 Les féministes sont-elles systématiquement des chieuses sans humour ? Des femmes dont l’unique plaisir est d’emmerder tout le monde ? Il serait plus simple de l’affirmer mais on se priverait alors de grands débats et du spectacle offert par Karine Birot. Dans la vie civile, elle est conseillère au Planning Familial de Nantes. Et au cours de certaines soirées, à Rennes notamment, elle enfile son costume de Wonder Féministe, « la super-hérote qu’il manquait pour sauver le monde ». Parée d’un bandeau étoilé dans les cheveux, d’une cape étoilée, d’un tee-shirt rouge WF, d’une jupe têtes de mort et des bottines rétro, Karine Birot choisit d’incarner l’anti-héroïne des temps modernes.
Les féministes sont-elles systématiquement des chieuses sans humour ? Des femmes dont l’unique plaisir est d’emmerder tout le monde ? Il serait plus simple de l’affirmer mais on se priverait alors de grands débats et du spectacle offert par Karine Birot. Dans la vie civile, elle est conseillère au Planning Familial de Nantes. Et au cours de certaines soirées, à Rennes notamment, elle enfile son costume de Wonder Féministe, « la super-hérote qu’il manquait pour sauver le monde ». Parée d’un bandeau étoilé dans les cheveux, d’une cape étoilée, d’un tee-shirt rouge WF, d’une jupe têtes de mort et des bottines rétro, Karine Birot choisit d’incarner l’anti-héroïne des temps modernes. « Je suis devenue animatrice socio-culturelle mais je me suis vite ennuyée. J’avais besoin d’espace pour développer mes supers pouvoirs parce que j’avais quand même un monde à sauver ! », scande-t-elle en se mordant les lèvres pour ne pas rigoler. Féministe professionnelle, elle le deviendra, c’est décidé.
« Je suis devenue animatrice socio-culturelle mais je me suis vite ennuyée. J’avais besoin d’espace pour développer mes supers pouvoirs parce que j’avais quand même un monde à sauver ! », scande-t-elle en se mordant les lèvres pour ne pas rigoler. Féministe professionnelle, elle le deviendra, c’est décidé.
 C’est à 18h sous une pluie battante qu’une quarantaine de jeunes rennais se sont regroupés devant le Parlement de Bretagne. Un lieu symbolique pour débuter cette manifestation. Car c’est contre la justice qui « protège les machos », précise un de leurs slogans, que les Féministes EnragéEs se mobilisent en ce mercredi 23 avril.
C’est à 18h sous une pluie battante qu’une quarantaine de jeunes rennais se sont regroupés devant le Parlement de Bretagne. Un lieu symbolique pour débuter cette manifestation. Car c’est contre la justice qui « protège les machos », précise un de leurs slogans, que les Féministes EnragéEs se mobilisent en ce mercredi 23 avril.

 Ce documentaire de vingt-six minutes compile dix années de moments d’intimité de la vie d’Eugénie Bourdeau et de sa fille Lucile, 12 ans, diagnostiquée autiste à 4 ans. À la maison, en région parisienne puis à Avignon, en voiture sur un air de Francis Cabrel, lors d’une fête de la musique où l’enfant danse dans la foule ou bien à l’école, tant de moments de la vie quotidienne capturés par la caméra et le smartphone de cette mère, ancienne scripte pour le cinéma, qui décide, lorsqu’elle se retrouve seule avec Lucile à l’âge de un an de passer à la réalisation afin de filmer celle qu’elle considère comme « passionnante ».
Ce documentaire de vingt-six minutes compile dix années de moments d’intimité de la vie d’Eugénie Bourdeau et de sa fille Lucile, 12 ans, diagnostiquée autiste à 4 ans. À la maison, en région parisienne puis à Avignon, en voiture sur un air de Francis Cabrel, lors d’une fête de la musique où l’enfant danse dans la foule ou bien à l’école, tant de moments de la vie quotidienne capturés par la caméra et le smartphone de cette mère, ancienne scripte pour le cinéma, qui décide, lorsqu’elle se retrouve seule avec Lucile à l’âge de un an de passer à la réalisation afin de filmer celle qu’elle considère comme « passionnante ». En voyant ces images, on ne peut que sentir l’émotion, les moments de joie et d’amour de cette relation fusionnelle entre une mère et sa fille. C’est un documentaire joyeux, lumineux, sur un air du groupe Islandais Sigur Rós, que réalise Eugénie Bourdeau, qui a fait le choix de ne pas intégrer les colères de Lucile au montage par souci d’intimité.
En voyant ces images, on ne peut que sentir l’émotion, les moments de joie et d’amour de cette relation fusionnelle entre une mère et sa fille. C’est un documentaire joyeux, lumineux, sur un air du groupe Islandais Sigur Rós, que réalise Eugénie Bourdeau, qui a fait le choix de ne pas intégrer les colères de Lucile au montage par souci d’intimité.
 Elle est auteure d’audio-description. Depuis 5 ans, elle écrit les commentaires qui s’insèrent entre les dialogues et les bruits, dans plusieurs films et téléfilms diffusés sur Arte et France télévision. Ce procédé permet aux non voyants et aux malvoyants de suivre, sans les images, une œuvre audiovisuelle, cinématographique ou théâtrale afin « de transmettre une émotion sans les nommer », décrit cette femme.
Elle est auteure d’audio-description. Depuis 5 ans, elle écrit les commentaires qui s’insèrent entre les dialogues et les bruits, dans plusieurs films et téléfilms diffusés sur Arte et France télévision. Ce procédé permet aux non voyants et aux malvoyants de suivre, sans les images, une œuvre audiovisuelle, cinématographique ou théâtrale afin « de transmettre une émotion sans les nommer », décrit cette femme.