En 2015, 2 296 demandes d’inscription en crèches municipales ont été soumises à la Ville de Rennes qui dispose de 17 structures (accueil collectif et accueil familial). Près de 42% environ, soit 962 demandes, ont été satisfaites. Quelles solutions s’offrent à celles et ceux qui n’obtiennent pas de réponse favorable ? Plusieurs alternatives leur sont proposées par le centre d’information petite enfance L’Étoile, chargée d’orienter les parents vers d’autres modes de garde. Parmi eux, on trouve les crèches parentales, établissement associatif géré par les génitrices et géniteurs, alors employeuses-eurs des professionnel-le-s de la petite enfance.
 Obtenir une place en crèche est une problématique loin d’être nouvelle. Si le plan gouvernemental prévoit l’augmentation du nombre de places au cours du mandat présidentiel actuel, l’objectif de 100 000 places supplémentaires semble compromis pour ce quinquennat qui semble seulement avoir réalisé un tiers de cette mission, selon les chiffres indiqués en 2015. Rennes ne fait pas exception, malgré la création de nouvelles crèches prévues jusqu’en 2017.
Obtenir une place en crèche est une problématique loin d’être nouvelle. Si le plan gouvernemental prévoit l’augmentation du nombre de places au cours du mandat présidentiel actuel, l’objectif de 100 000 places supplémentaires semble compromis pour ce quinquennat qui semble seulement avoir réalisé un tiers de cette mission, selon les chiffres indiqués en 2015. Rennes ne fait pas exception, malgré la création de nouvelles crèches prévues jusqu’en 2017.
Pour les futurs parents, l’inscription de l’enfant qui va arriver peut s’avérer angoissante, la pénurie de places étant avérée. Les solutions alternatives sont de plus en plus mises en lumière. Parmi les plus connues, on cite les assistantes maternelles, les crèches d’entreprise ou encore les haltes garderies qui offrent une aide d’urgence temporaire.
Plus confidentielles dans leur notoriété auprès du grand public, les crèches parentales se développent, trouvant un équilibre dans l’esprit « comme à la maison » puisque le parent fait partie intégrante de la vie quotidienne de la crèche, bénéficiant ainsi d’un accès privilégié à l’équipe éducative et au projet pédagogique. C’est ce que souligne l’exemple de la structure Ty Bugale, fondée en 1986 à Rennes.
ASSOCIATION PARENTALE
La particularité de ce type d’établissement réside principalement dans la gestion parentale. En effet, créé sous la forme associative, ce sont les parents qui en investissent le bureau et le conseil d’administration. Par conséquent, ils sont les employeurs directs des professionnel-le-s de la petite enfance et participent activement à la vie de la crèche.
« Nous sommes très investi-e-s au sein de l’association puisque chacun-e a un poste dans la structure. Et que nous devons remplir 4h30 de permanence par semaine. », explique Yohanna Millet, présidente de Ty Bugale depuis septembre 2015. Concrètement, le parent intervient durant les heures d’accueil, souvent à la demi journée, comme tel est le cas dans la majorité des crèches parentales, au nombre de 6 à Rennes (selon les structures, la durée de la permanence varie).
Et aide au bon fonctionnement de la journée en gérant plus spécifiquement les tâches domestiques comme mettre la table, débarrasser, aider au lever de la sieste, au goûter, ranger, etc.
« Il faut avoir le temps et l’envie de s’investir sinon ça ne peut pas fonctionner. Faut être conscient-e de ça car on ne peut pas entrer dans l’association si on ne peut pas assurer les 4h30 de permanence. »
précise la présidente, infirmière de métier.
Un point sur lequel insiste également Emilie Paillot, qui exerce la fonction de secrétaire au sein de l’établissement. « Je suis enseignante à temps partiel donc ça ne me posait pas de problème de donner une demi journée par semaine. Et ça ne me dérangeait pas d’entrer dans le bureau. Avant cela, j’étais au poste « Approvisionnement », ça tourne. Ma fille a terminé la crèche mais je suis enceinte de mon 3e enfant et je demanderais une place ici pour la rentrée 2017. Ça m’embêterait d’être moins investie en revenant. », s’enthousiasme-t-elle.
 À la crèche parentale, elle a pris goût. Arrivée de Paris en 2012, elle pose ses valises à Rennes avec son compagnon et son fils. En cherchant un mode de garde, sans préférence particulière, ils apprennent qu’une place s’est libérée à Ty Bugale, alors implantée rue de l’Alma, avant de déménager dans les locaux temporaires du boulevard Albert 1er de Belgique (en octobre, la crèche déménagera à nouveau dans des locaux plus grands, rue Mauconseil). Rapidement, ils adhèrent à l’état d’esprit de l’établissement, qui accueillera par la suite leur fille.
À la crèche parentale, elle a pris goût. Arrivée de Paris en 2012, elle pose ses valises à Rennes avec son compagnon et son fils. En cherchant un mode de garde, sans préférence particulière, ils apprennent qu’une place s’est libérée à Ty Bugale, alors implantée rue de l’Alma, avant de déménager dans les locaux temporaires du boulevard Albert 1er de Belgique (en octobre, la crèche déménagera à nouveau dans des locaux plus grands, rue Mauconseil). Rapidement, ils adhèrent à l’état d’esprit de l’établissement, qui accueillera par la suite leur fille.
Agréée par la Direction des Affaires Sociales du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, la crèche est une association de loi 1901 accueillant jusqu’en octobre prochain 16 enfants, les nouveaux locaux permettant de demander un agrément pour 4 enfants supplémentaires.
Les critères sont semblables aux autres crèches : accueil de 8h à 18h30 d’enfants rennais âgés de 2 mois ½ à 4 ans, d’1 à 5 journées par semaine, dispositif d’accueil d’urgence (à partir de 18 mois et en fonction des places disponibles), tarif établi selon les revenus du foyer.
Entre le bureau et les différents rôles (gestion des salaires, inscriptions, bricolage/jardinage, moyens généraux, informatique, archivage, planning, hygiène et sécurité, formation, remplacement, etc.), les parents des enfants inscrits se répartissent les rôles et tournent d’une année sur l’autre.
« On essaie de ne pas être toujours au même poste. On voit par rapport aux intérêts des un-e-s et des autres. Et puis on fait en sorte de ne pas mettre à la trésorerie par exemple quelqu’un qui arrive car ce n’est pas forcément évident au départ. Et puis rien n’est figé car il y a des gens qui sont là pour 6 mois, d’autres pour plusieurs années. On participe également au projet pédagogique puisqu’il faut instaurer un règlement intérieur à faire valider par le conseil général. Avec le déménagement, il devra être revu, signé et voté par le CA. Le projet éducatif, lui, évolue et est construit par les salariés, à qui on fait confiance. », indique Yohanna Millet.
UNE GRANDE FAMILLE
Ce qui lui plait : la possibilité pour les parents d’être acteurs de la crèche sans empiéter sur le territoire des professionnel-le-s. Ici, ils sont au nombre de 2 éducateurs de jeunes enfants à mi-temps, une femme et un homme, et de deux aides EJE. Si ils et elles se côtoient durant les permanences hebdomadaires, des temps plus formels sont organisés pour échanger à travers une réunion mensuelle dont une partie seulement se déroule en compagnie de l’équipe éducative.
« Ce qui est bien dans la formule, c’est qu’on peut avoir le côté parental en s’investissant dans la vie de la structure et en faisant les permanences. Mais c’est aussi que de cette manière, en aidant aux tâches ménagères, les salarié-e-s s’occupent exclusivement des enfants. »
poursuit la présidente.
Et avec un taux d’encadrement plus important que dans une crèche municipale - la législation prévoyant pour cette dernière 1 adulte pour 5 enfants « non marcheurs » et 1 adulte pour 8 enfants « marcheurs » et pour la crèche parentale 1 adulte pour 4 enfants « non marcheurs » - « les enfants ne sont pas du tout délaissés », signale Emilie Paillot.
 Avec Yohanna, elles parlent de grande famille. Passer du temps au sein de la crèche, auprès des enfants, de l’équipe éducative, effectuer des réunions entre parents, organiser des événements avec tout le monde (à l’instar d’un moment convivial en juin dernier pour fêter les 30 ans de la structure) ou encore participer à des sorties avec les petit-e-s, tout cela représente « un chouette moyen de s’intégrer et de développer une grande solidarité entre les parents. »
Avec Yohanna, elles parlent de grande famille. Passer du temps au sein de la crèche, auprès des enfants, de l’équipe éducative, effectuer des réunions entre parents, organiser des événements avec tout le monde (à l’instar d’un moment convivial en juin dernier pour fêter les 30 ans de la structure) ou encore participer à des sorties avec les petit-e-s, tout cela représente « un chouette moyen de s’intégrer et de développer une grande solidarité entre les parents. »
Et Emilie d’ajouter : « J’apprécie cette opportunité de connaître tout le monde et que les enfants nous connaissent bien, qu’ils nous appellent par nos prénoms. »
TROUVER L’ÉQUILIBRE
Néanmoins une difficulté subsiste et les deux femmes ne s’en cachent pas. L’enfant doit apprendre à « partager » son parent présent lors de la permanence.
Ce à quoi les petit-es établi-e-s dans les autres modes de garde ne sont pas confronté-e-s, la distinction entre le cadre familial et le collectif « pédagogique » s’opérant de manière évidente.
Ici, ils/elles apprennent à voir leurs parents interagir avec le reste du groupe, faire des va-et-vient, déplacer leur centre d’attention sur l’ensemble de la crèche et non pas uniquement sur eux/elles comme cela pourrait être le cas à la maison. Emilie Paillot confie :
« Ce n’est pas toujours facile. Tilda était bébé en arrivant et très vite ça a été naturel mais il y a toujours des moments ou des phases où ils peuvent être pénibles car ils ne comprennent pas trop pourquoi on est là à s’occuper d’autres enfants ou la plupart du temps à faire les tâches ménagères au lieu d’être avec eux. »
Mais c’est aussi un challenge pour celles et ceux qui tiennent la permanence. Sans interférer avec les professionnel-le-s, il leur faut trouver un équilibre dans cette formule intégrant le parent à une garde extérieure au foyer. L’attention ne peut pas uniquement se porter sur son enfant mais doit être portée sur la globalité du groupe. Même si Yohanna et Emilie le confirment : chacun-e garde sa personnalité.
Pour Loïc Bernier, éducateur de jeunes enfants à Ty Bugale, « on accueille l’enfant et sa famille. Ce n’est pas évident de se confronter aux regards des parents, on n’est pas toujours très très à l’aise d’agir devant eux. Mais c’est une réelle richesse de travailler avec eux. En les voyant lors des permanences, on apprend à les connaître et donc à les comprendre plus facilement. Et ce qui est avantageux, c’est aussi qu’ils peuvent s’inspirer des pratiques des professionnel-le-s. »
Après avoir effectué sa formation à l’école Askoria de Rennes, il a toujours travaillé en crèche parentale. Pas forcément un choix mais son parcours, entre stages et remplacements, l’a mené à ce type de structure. L’expérience lui permet de ne plus appréhender de la même manière la présence du parent et la réaction de l’enfant.
 Car lui, ainsi que l’ensemble de l’équipe éducative, est présent pour appliquer le projet pédagogique et éducatif, à savoir transmettre les valeurs et règles de vie définies avec le CA et selon les capacités et objectifs d’éveil cohérents à la petite enfance.
Car lui, ainsi que l’ensemble de l’équipe éducative, est présent pour appliquer le projet pédagogique et éducatif, à savoir transmettre les valeurs et règles de vie définies avec le CA et selon les capacités et objectifs d’éveil cohérents à la petite enfance.
VALEURS PARTAGÉES
Et ce qu’il pointe en priorité – les parents également – c’est le respect. Respect des règles, respect des autres au sein de la collectivité et respect de son environnement.
À travers la socialisation de l’enfant, la vie en société, la politesse, etc. Ainsi que son éveil sur l’extérieur.
« On essaye de profiter de ce qui nous entoure, de faire des sorties. Au parc, au marché, à la gare, chez les pompiers, à l’aéroport… Et de ce que le quartier de l’Alma propose en terme de spectacles, etc. Par exemple, juste à côté de la crèche, il y a la structure Terre des arts qui les accueille pour des activités, pour l’éveil musical. Et puis si les parents ont des compétences particulières, ils peuvent aussi proposer des ateliers, s’ils en ont envie évidemment… », liste rapidement Yohanna Millet, sourire aux lèvres. Toujours en gardant la volonté de mélanger le groupe, sans le ciseler en petits comités établis par les catégories d’âge.
« Que les petit-e-s soient avec les grand-e-s et inversement provoquent une émulation entre eux/elles et plein de choses intéressantes se passent dans ces moments-là. Dans un climat serein et sécurisant. »
ajoute l’éducateur qui rappelle aussi l’importance du suivi personnel.
Au cours de la journée, l’équipe se veut donc attentive au développement de l’enfant en tant qu’individu en fonction de son propre rythme et ses besoins. En terme de sommeil, par exemple. Mais pas seulement.
ÉVEIL À L'ÉGALITÉ DES SEXES
 Et c’est ce qui va éveiller le/la tout-e petit-e. La confrontation entre soi et les autres. L’équipe professionnelle couplée au turn over parental permet alors de conjuguer diversité des profils, des cultures et des approches.
Et c’est ce qui va éveiller le/la tout-e petit-e. La confrontation entre soi et les autres. L’équipe professionnelle couplée au turn over parental permet alors de conjuguer diversité des profils, des cultures et des approches.
Et c’est à ce moment-là que va se jouer, dans la petite enfance, l’intégration des assignations genrées. En observant et imitant les adultes référents, l’enfant développe inconsciemment les codes de la société selon son sexe.
Pas de raison a priori que la crèche parentale échappe à ce processus d’identification, tant le marketing genré est force d’accroissement et que les formations des professionnel-le-s résistent encore à inscrire de manière obligatoire des modules sur l’égalité des sexes. Du côté de Ty Bugale, rien à ce sujet n’est mentionné dans les projets pédagogique et éducatif, si ce n’est le principe global d’égalité. Néanmoins, Yohanna Millet et Emilie Paillot s’en défendent.
« Ici, nous avons tous les cas de figure mais en règle générale la parité est plutôt bien respectée. Que ce soit au niveau des enfants filles et enfants garçons. Ou que ce soit au niveau de la répartition des tâches entre les parents. Il n’y a pas a priori plus de femmes qui s’investissent que d’hommes. Après, évidemment, tout dépend du travail. Le papa de mes enfants est beaucoup en déplacement donc là c’est plus moi qui interviens mais pour notre fils il faisait les CA. », justifie la secrétaire.
Même son de cloche pour la présidente qui confirme qu’en prenant la liste des rôles et des personnes missionnées à chaque poste, on ne trouvera pas de différence significative entre l’implication des femmes et celle des hommes. Idem pour les permanences. Un argument important puisqu’il permet aux enfants de ne pas cataloguer la mère comme la préposée à l’éducation et aux tâches ménagères et ne pas associer le père au travail et au divertissement. Concrètement la femme gérant le foyer et l’homme le reste du monde.
Toutefois, Emilie aurait souhaité aller plus loin dans la réflexion en faisant intervenir une personne de l’association Questions d’égalité lors d’une réunion mensuelle.
« J’ai une amie qui était là-bas mais nous n’avons pas réussi à trouver de disponibilités communes et depuis elle a quitté son boulot. Mais je pense que c’est intéressant de pouvoir développer ces questions « philosophiques » et d’être aidé-e-s par des référents. Nous ne sommes pas des professionnel-le-s de la petite enfance, ni de l’égalité des sexes. Nous sommes des bénévoles, des parents, mais nous avons nos limites. Les temps de CA servent aussi à ça. On a déjà fait venir par exemple un médecin pour parler du sommeil des petit-e-s. Aborder l’égalité entre les filles et les garçons, ça me botte vraiment ! », explique Emilie Paillot qui avoue malgré tout qu’avec le déménagement prochain, il fallait bien établir des priorités.
LA DIVERSITÉ AVANT TOUT
 Loïc Bernier, qui assurera dès octobre le poste de référent technique à mi-temps, en plus de son travail d’éducateur, apporte de son point de vue une autre approche.
Loïc Bernier, qui assurera dès octobre le poste de référent technique à mi-temps, en plus de son travail d’éducateur, apporte de son point de vue une autre approche.
Déjà, en tant qu’homme dans un secteur destiné très longtemps aux femmes de par la supposée fibre maternelle innée qu’elles possèderaient, il est conscient du regard que l’on peut porter sur ce type de stéréotype.
« Dans ma promo, sur 20 personnes, on était 2 garçons. Mais j’ai toujours été super bien accueilli, que ce soit à l’école ou sur le terrain. Aujourd’hui, la mixité est de plus en plus recherchée dans les équipes. », souligne-t-il.
Une avancée positive qui permet aux enfants d’être confrontés aux deux sexes. Loïc poursuit :
« C’est bien de sortir des grands clichés, des rôles attribués. Un homme peut être maternant aussi. Et je crois qu’il y a plein de façons d’être un homme et plein de façons d’être une femme. Et c’est bon pour le développement de l’enfant d’être face à des relations différentes, des imitations différentes, des références différentes. »
Il prône avant tout la diversité et l’humain dans son ensemble, dans ses complexités et nuances. Mais toujours en proposant les mêmes activités aux enfants sans le critère du sexe et surtout sans les orienter. « On ne joue pas qu’à un seul jeu, il n’y a pas qu’une seule lecture. C’est le mélange qui compte. Que les petits puissent jouer aux voitures tout comme aux poupées avec des présences masculines et des présences féminines. », conclut-il.
Sans revendiquer un modèle exemplaire, la crèche parentale offre une formule conviviale qui ne dissimule pas un côté contraignant pour celles et ceux qui ne pourraient adapter, selon leur travail et envies (sans jugement ou culpabilisation), leurs emplois du temps. Mais qui propose une alternative et peut-être une autre réflexion autour de la parentalité associée à l’éducation promue par les professionnel-le-s de la petite enfance et inversement.

 Pour cette nouvelle édition, ce sera « Une génération », un thème qui lui plait et qu’iel partage avec une amie, Gabrielle Pichon comédienne et autrice pour l’écriture, qui s’effectue en deux jours, fin août. En septembre, le gouvernement lance son grenelle contre les violences conjugales et à cette occasion, ressort un micro-trottoir de 1979, qu’iel va donc reproduire dans son court-métrage. Iel lance un appel sur les réseaux sociaux et découvre avec joie que les réponses sont nombreuses :
Pour cette nouvelle édition, ce sera « Une génération », un thème qui lui plait et qu’iel partage avec une amie, Gabrielle Pichon comédienne et autrice pour l’écriture, qui s’effectue en deux jours, fin août. En septembre, le gouvernement lance son grenelle contre les violences conjugales et à cette occasion, ressort un micro-trottoir de 1979, qu’iel va donc reproduire dans son court-métrage. Iel lance un appel sur les réseaux sociaux et découvre avec joie que les réponses sont nombreuses :

 Elle va alors se documenter et rencontrer les travailleurs sociaux de Brest afin de constituer une matière réelle et réaliste, dans laquelle elle voit « des enjeux de fiction, le côté romanesque de la vie, de beaux personnages et une belle histoire. »
Elle va alors se documenter et rencontrer les travailleurs sociaux de Brest afin de constituer une matière réelle et réaliste, dans laquelle elle voit « des enjeux de fiction, le côté romanesque de la vie, de beaux personnages et une belle histoire. » Elle le dit elle-même : dans un endroit dur, de l’accouchement sous X à l’adoption, il y a des endroits d’espoir. Pupille fait du bien. Au-delà de la bienveillance qui caractérise la relation qu’entretient la réalisatrice avec ses personnages, Jeanne Herry a aussi la particularité de saisir avec subtilité la finesse des non dits.
Elle le dit elle-même : dans un endroit dur, de l’accouchement sous X à l’adoption, il y a des endroits d’espoir. Pupille fait du bien. Au-delà de la bienveillance qui caractérise la relation qu’entretient la réalisatrice avec ses personnages, Jeanne Herry a aussi la particularité de saisir avec subtilité la finesse des non dits.

 Le discours est frappant. Cette femme a « tué son amour ». Parce qu’il a repris son amour, elle a repris la chair de sa chair. « Je ne suis pas qu’un ventre », explique-t-elle, calmement, pour justifier son infanticide. Ce troisième enfant, elle n’en voulait pas. « Je suis contente que Mitterand ait aboli… Même si j’ai tué quelqu’un. », poursuit-elle.
Le discours est frappant. Cette femme a « tué son amour ». Parce qu’il a repris son amour, elle a repris la chair de sa chair. « Je ne suis pas qu’un ventre », explique-t-elle, calmement, pour justifier son infanticide. Ce troisième enfant, elle n’en voulait pas. « Je suis contente que Mitterand ait aboli… Même si j’ai tué quelqu’un. », poursuit-elle.

 Obtenir une place en crèche est une problématique loin d’être nouvelle. Si le plan gouvernemental prévoit l’augmentation du nombre de places au cours du mandat présidentiel actuel, l’objectif de 100 000 places supplémentaires semble compromis pour ce quinquennat qui semble seulement avoir réalisé un tiers de cette mission, selon les chiffres indiqués en 2015. Rennes ne fait pas exception, malgré la création de nouvelles crèches prévues jusqu’en 2017.
Obtenir une place en crèche est une problématique loin d’être nouvelle. Si le plan gouvernemental prévoit l’augmentation du nombre de places au cours du mandat présidentiel actuel, l’objectif de 100 000 places supplémentaires semble compromis pour ce quinquennat qui semble seulement avoir réalisé un tiers de cette mission, selon les chiffres indiqués en 2015. Rennes ne fait pas exception, malgré la création de nouvelles crèches prévues jusqu’en 2017. À la crèche parentale, elle a pris goût. Arrivée de Paris en 2012, elle pose ses valises à Rennes avec son compagnon et son fils. En cherchant un mode de garde, sans préférence particulière, ils apprennent qu’une place s’est libérée à Ty Bugale, alors implantée rue de l’Alma, avant de déménager dans les locaux temporaires du boulevard Albert 1er de Belgique (en octobre, la crèche déménagera à nouveau dans des locaux plus grands, rue Mauconseil). Rapidement, ils adhèrent à l’état d’esprit de l’établissement, qui accueillera par la suite leur fille.
À la crèche parentale, elle a pris goût. Arrivée de Paris en 2012, elle pose ses valises à Rennes avec son compagnon et son fils. En cherchant un mode de garde, sans préférence particulière, ils apprennent qu’une place s’est libérée à Ty Bugale, alors implantée rue de l’Alma, avant de déménager dans les locaux temporaires du boulevard Albert 1er de Belgique (en octobre, la crèche déménagera à nouveau dans des locaux plus grands, rue Mauconseil). Rapidement, ils adhèrent à l’état d’esprit de l’établissement, qui accueillera par la suite leur fille. Avec Yohanna, elles parlent de grande famille. Passer du temps au sein de la crèche, auprès des enfants, de l’équipe éducative, effectuer des réunions entre parents, organiser des événements avec tout le monde (à l’instar d’un moment convivial en juin dernier pour fêter les 30 ans de la structure) ou encore participer à des sorties avec les petit-e-s, tout cela représente « un chouette moyen de s’intégrer et de développer une grande solidarité entre les parents. »
Avec Yohanna, elles parlent de grande famille. Passer du temps au sein de la crèche, auprès des enfants, de l’équipe éducative, effectuer des réunions entre parents, organiser des événements avec tout le monde (à l’instar d’un moment convivial en juin dernier pour fêter les 30 ans de la structure) ou encore participer à des sorties avec les petit-e-s, tout cela représente « un chouette moyen de s’intégrer et de développer une grande solidarité entre les parents. » Car lui, ainsi que l’ensemble de l’équipe éducative, est présent pour appliquer le projet pédagogique et éducatif, à savoir transmettre les valeurs et règles de vie définies avec le CA et selon les capacités et objectifs d’éveil cohérents à la petite enfance.
Car lui, ainsi que l’ensemble de l’équipe éducative, est présent pour appliquer le projet pédagogique et éducatif, à savoir transmettre les valeurs et règles de vie définies avec le CA et selon les capacités et objectifs d’éveil cohérents à la petite enfance. Et c’est ce qui va éveiller le/la tout-e petit-e. La confrontation entre soi et les autres. L’équipe professionnelle couplée au turn over parental permet alors de conjuguer diversité des profils, des cultures et des approches.
Et c’est ce qui va éveiller le/la tout-e petit-e. La confrontation entre soi et les autres. L’équipe professionnelle couplée au turn over parental permet alors de conjuguer diversité des profils, des cultures et des approches. Loïc Bernier, qui assurera dès octobre le poste de référent technique à mi-temps, en plus de son travail d’éducateur, apporte de son point de vue une autre approche.
Loïc Bernier, qui assurera dès octobre le poste de référent technique à mi-temps, en plus de son travail d’éducateur, apporte de son point de vue une autre approche.

 « Je l’ai annoncé tout de suite à mes enfants alors âgés de 4 et 7 ans. Je ne voulais pas leur mentir et trouver les bons mots pour ne pas les traumatiser, sans minimiser les choses. », explique Rosanne Ribatto.
« Je l’ai annoncé tout de suite à mes enfants alors âgés de 4 et 7 ans. Je ne voulais pas leur mentir et trouver les bons mots pour ne pas les traumatiser, sans minimiser les choses. », explique Rosanne Ribatto.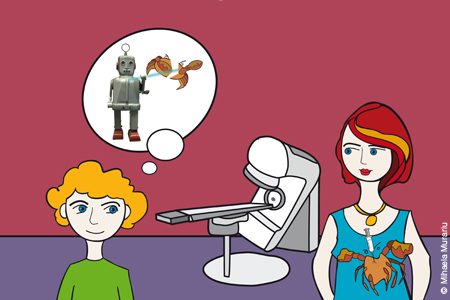 « Ce sont des choses que nous avons fait ensemble. Avec mes enfants, mon mari, ma maman, ma grand-mère. Chaque coup de ciseaux était une victoire ! On a aussi fait une soirée perruques pour dédramatiser un peu », se rappelle l’auteure, partisane de la franche rigolade en toute circonstance. La rémission est le résultat d’un combat collectif : « Mon fils dit « On a tué le cancer ». On était une armée ! »
« Ce sont des choses que nous avons fait ensemble. Avec mes enfants, mon mari, ma maman, ma grand-mère. Chaque coup de ciseaux était une victoire ! On a aussi fait une soirée perruques pour dédramatiser un peu », se rappelle l’auteure, partisane de la franche rigolade en toute circonstance. La rémission est le résultat d’un combat collectif : « Mon fils dit « On a tué le cancer ». On était une armée ! »



 Chaque année, 4 000 naissances ont lieu dans cet établissement - excepté en 2014 qui n’a pas passé, de peu, la barre des 4 000. Un chiffre qui n’a pas été détaillé lors de la visite mais qui est un chiffre global comprenant également les nourrissons morts-nés ou décédés au moment de l’accouchement. Pour le professeur Poulain, cette proximité est garantie du bon fonctionnement du service et d’un meilleur pronostic pour l’enfant.
Chaque année, 4 000 naissances ont lieu dans cet établissement - excepté en 2014 qui n’a pas passé, de peu, la barre des 4 000. Un chiffre qui n’a pas été détaillé lors de la visite mais qui est un chiffre global comprenant également les nourrissons morts-nés ou décédés au moment de l’accouchement. Pour le professeur Poulain, cette proximité est garantie du bon fonctionnement du service et d’un meilleur pronostic pour l’enfant.