Du 8 au 29 mars, Docs au féminin a réglé sa focale sur les luttes féministes et les portraits de personnes sexisées à travers une série de longs et courts métrages documentaires, diffusés en ligne ou à travers des vitrines, à l’occasion du 8 mars à Rennes. Sans oublier celles qui créent, écrivent, produisent, réalisent, œuvrent à la mise en place de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, sélectionnent et partagent des visions et des points de vue, des émotions et des tranches de vie.
En février 2019, on rencontrait la réalisatrice Céline Dréan pour parler avec elle de la place des femmes dans le milieu du cinéma. Elle venait de participer avec Véronique Le Bris, journaliste et fondatrice du magazine en ligne Cine-Woman à une table ronde sur le sujet, animée par HF Bretagne dans le cadre du festival Travelling.
Cet événement était précédé de la projection du film de Clara et Julia Kuperberg, Et la femme créa Hollywood qui s’attache à montrer qu’au départ, dans les années 1910 - 1920 les femmes étaient présentes dans la création cinématographique, et pas qu’un peu ! Elles étaient en nombre, compétentes et à des postes à responsabilité. Mais depuis que s’est-il passé ?
« Je suppose qu’il y a un faisceau assez complexe de causes mais l’essentiel, c’est que l’argent est arrivé. Au départ, le cinéma était un art complètement expérimental, il n’y avait pas d’enjeu financier. C’était plutôt un endroit dans lequel venaient les personnes qui n’avaient pas de travail, c’est-à-dire les femmes, qui n’arrivaient pas à être embauchées ailleurs. C’est quand les industriels ont commencé à s’intéresser au cinéma et donc à y mettre de l’argent que l’enjeu a été modifié. Ce n’était plus seulement un enjeu de création mais c’était également un enjeu économique et c’est là que les hommes sont arrivés et ont pris le pouvoir. Ce qui est assez symptomatique – alors là je m’avance peut-être un peu – de plein d’autres domaines, comme les sciences par exemple. », nous avait alors répondu Céline Dréan.
La situation a-t-elle beaucoup évolué depuis ? Oui, c’est indéniable. Il y a désormais davantage de réalisatrices que dans les années 50. Mais pour la professionnelle, il y a encore de nombreux écarts, notamment dans la répartition femmes-hommes selon les genres cinématographiques. Dans le documentaire, notamment, encore une fois très imprégné de l’esprit expérimental, et peu étiqueté « gros budgets ».
Le cinéma, comme le reste des arts et de la culture, n’est pas un secteur qui fait exception. Il est empreint, à l’instar de tous les domaines de la société, d’une éducation genrée, permise par un système global reposant sur des mécanismes de domination : sexisme, racisme, validisme, LGBTIphobie, grossophobie, classisme, âgisme, etc. Les oppressions pouvant se croiser et se cumuler.
Compter, c’est une des premières étapes essentielles à la prise de conscience générale. C’est ce que rappelle Elise Calvez, membre de HF Bretagne, association œuvrant pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, mardi 23 mars.
Elle animait, en visio, une table ronde autour de la place des femmes dans le cinéma documentaire, à l’occasion de Docs au féminin, réunissant Natalia Gómez Carvajal, chargée de la programmation, Claire Rattier-Hamilton, chargée de mission court-métrage et documentaire à la Région Bretagne, Marine Ottogalli, co-réalisatrice de Ayi, et Leïla Porcher, co-réalisatrice de Je n’ai plus peur de la nuit.
DES CHIFFRES ÉDIFIANTS, ENCORE…
Du côté de la Scam, la Société civile des auteurs multimédia, l’enquête concernant la répartition des autrices et des auteurs sur une décennie (2009 – 2019) montre une évolution très faible du nombre d’autrices membres de la structure. En 2009, elles représentent 36%. Dix ans plus tard, 37%. Le chiffre est dérisoire.
En mars 2021, le CNC publie son étude sur « La place des femmes dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle », de 2010 à 2019, montrant que différents métiers au sein même du secteur de la production cinématographique sont encore profondément genrés et les salaires des femmes encore inférieurs à ceux des hommes (37,3% d’écart entre un réalisateur et une réalisatrice concernant le salaire moyen).
Les postes de scripte et assistant-e scripte, costumier-e et habilleur-euse et de coiffeur-euse et maquilleur-euse sont principalement occupés par des femmes, tandis que les professions techniques comme machiniste, électricien-ne et éclairagiste sont largement occupées par des hommes.
Inégalités encore avec les films français agréés encore majoritairement réalisés ou co-réalisés par des hommes à 74,1%. Et ils coûtent plus chers. En 2019, le devis moyen des films français réalisés par des femmes est inférieur d’environ 2 M€ à celui des hommes.
« Ces écarts s’expliquent en partie par l’absence de très grosses productions réalisées par des femmes et l’importance du genre documentaire au sein des films réalisés par des femmes, genre moins coûteux à produire »
indique l’étude du CNC dans sa synthèse.
LA RÉGION S’Y MET DOUCEMENT
En région, la question des chiffres est complexe, comme l’explique Claire Rattier-Hamilton, chargée de mission Court-métrage et Documentaire à la région Bretagne. Elle a récolté des données à la demande du festival mais insiste sur le fait qu’elles sont à prendre avec précaution. Il n’y a pas encore d’étude précise et officielle sur le sujet.
Ainsi, en 2020, tout genre confondu, elle constate qu’il y a eu plus de projets portés par des hommes aidés au niveau de la production « mais c’est un tout petit peu moins flagrant en développement et en écriture. »Ainsi, les écarts se resserrent : « On a aidé plus de projets en développement et en écriture portés par les femmes. »
D’un point de vue financier, les projets portés par les femmes demandent moins de budget pour les aides à la production. Et l’écart n’est pas fin : « Environ 29 000 euros pour les femmes et environ 47 000 euros pour les hommes. » En revanche, ce qu’elle note, c’est qu’au final, les hommes obtiennent un budget inférieur à leur demande initiale et les femmes obtiennent « à peu près » ce qu’elles demandent.
Elise Calvez le souligne : l’évolution est lente et modeste malgré la prise en compte de ces préoccupations, globalement dans de nombreux secteurs des arts et de la culture depuis plusieurs années. Il faut compter pour établir des données chiffrées parlantes et révélatrices d’une problématique profonde. Il faut compter pour établir une prise de conscience significative.
S’outiller pour comprendre d’où viennent les problématiques, ces sources d’inégalités qui persistent et pouvoir ainsi analyser ces écarts qui non seulement perdurent mais aussi se creusent au fil des échelles que l’on étudie. On sait notamment grâce au diagnostic chiffré établi en 2019 par HF Bretagne sur la place des femmes dans le spectacle vivant et les arts visuels que les femmes représentent :
« 60% des étudiant-e-s, 40% des artistes actif-ves, 20% des artistes aidé-e-s par des fonds publics, 20% des dirigeant-e-s, 20% des artistes programmé-e-s, 10% des artistes récompensé-e-s. »
ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
Cette évolution lente et modeste dont Elise Calvez parlait amène tout de même à faire bouger quelques lignes. Heureusement. Avec l’arrivée par exemple de davantage de réalisatrices mais aussi de productrices. En 2020, par exemple, Claire Rattier-Hamilton précise que la région a aidé 16 productrices et 17 producteurs. Pour que ce chiffre soit satisfaisant, il doit se pérenniser.
Ce constat est partagé également par Leïla Porcher qui a travaillé pour son premier long-métrage avec une équipe quasi exclusivement féminine parce que ses productrices étaient entourées de femmes sur tous les postes, excepté le mixage : « On a sans doute été préservées de ce que ça représente dans la confrontation au quotidien. »
Celle qui a d’abord entrepris des études d’anthropologie avant de se former en documentaire et réalisation à Aix-Marseille, précise : « Dans ma formation, on était une majorité de femmes. À la sortie, par contre, les gens que je connais et qui ont poursuivi en réalisation sont des hommes. »
Marine Ottogalli, elle, a une formation de technicienne. Ce qui l’anime dans le cinéma, c’est d’être cheffe opératrice. Les chiffres cités précédemment ne sont, selon elle, pas surprenants : « Ils me parlent, surtout sur le fait que les femmes arrivent dans la production. »
Ce qu’elle remarque principalement, c’est la difficulté qu’ont les femmes, en règle générale, à imposer un salaire : « Ce sont les hommes autour de moi qui font monter les salaires, souvent. Mais après, je pense aussi qu’il y a une question de personnalité, au-delà de la question du genre. »
Si très rares sont les modèles de cheffes opératrices, en revanche, la réalisatrice précise que dans ces influences lui viennent principalement des femmes, à l’instar de Chantal Akerman. Si elle a eu davantage d’hommes mentors dans son parcours, en revanche « après, dans les stages ou les postes d’assistante, ce sont des femmes qui m’ont aidée à monter dans ma carrière. »
VISIBILISER LES FEMMES
De son côté, Leïla Porcher regrette de n’avoir bénéficié d’aucun modèle de réalisatrices. « J’aurais aimé en avoir. C’est avec Anna Roussillon que j’ai découvert que c’était possible, que oui, on pouvait arriver à ce type d’écriture, etc. », explique-t-elle. Sur le relationnel avec les hommes dans ce secteur, elle n’en a pas encore fait l’expérience.
En revanche, elle l’affirme : le film Je n’ai plus peur de la nuit n’aurait pas pu être réalisé par des hommes. « La société kurde est ségréguée sexuellement. Je pense que ça aurait été impossible d’accès pour des hommes. En tout cas, ils n’auraient pas pu développer les liens qu’on a pu avoir. Nous avons passé beaucoup de temps avec ces femmes, des combattantes kurdes, déjà ça a changé notre regard mais je pense aussi qu’en tant que femmes, on avait moins de risque de tomber dans l’exotisation et la romantisation. », analyse-t-elle.
Au départ du projet documentaire d’Ayi, l’idée était de montrer les cuisines de rue. Au bout de la première année, Marine Ottogalli et Aël Théry ont choisi d’axer autour de la figure d’Ayi, « tellement charismatique que tout s’est polarisé autour d’elle. » Le film est devenu un portrait de femme migrante dans un quartier de Shangaï, racontant « l’émancipation d’une femme partie de son village où elle s’occupait de sa famille et qui a choisi de partir et de trouver une place en ville. »
Donner à voir des luttes féministes et des portraits de femmes. C’est là l’objectif de Docs au féminin, géré par Natalia Gómez Carvajal, sa chargée de programmation au sein de Comptoir du doc depuis septembre 2020. Elle avait l’espoir que l’événement se déroule en présentiel mais la gestion gouvernementale de la situation sanitaire a contraint les salles de cinéma et lieux de culture a fermé leurs portes.
Prévoir les projections en ligne, cela pose question au sein de la structure qui défend l’espace du cinéma comme opportunité de faire du lien et de rencontrer le public. Ainsi, Docs au féminin s’est inspiré d’une initiative grenobloise et a organisé le 13 et 20 mars des séances de courts-métrages, diffusés dans les vitrines de commerces du centre ville et de Maurepas.
Concernant la diffusion via une plateforme ciné, un avantage se profile rapidement : si la manifestation est d’ordinaire organisée à Rennes – aux Champs libres – cette année, tout le monde pourra bénéficier de ses séances gratuitement, sans barrières géographiques.
« Les violences sexistes et sexuelles existent de partout. Surtout dans les foyers, on le sait et on le voit bien depuis les confinements. Là, on fait entrer des films documentaires qui parlent de ces sujets, par différents biais, directement dans les foyers. »
souligne Natalia Gómez Carvajal.
Du 8 au 29 mars, 4 films ont été proposés tous les lundis soirs : In search de Beryl Magoko et Jule Katinka Cramer, sur le rapport à l’excision d’une femme kenyane qui va ensuite découvrir la chirurgie réparatrice, Ayi de Marine Ottogalli et Aël Théry, sur le combat d’une femme migrante qui cuisine dans la rue en évitant les forces de l’ordre dans un quartier de Shangai, The Giverny document de Ja’Tovia Gary sur les conséquences des représentations coloniales des femmes noires sur l’intégrité de leurs corps ainsi que leurs résiliences, et Je n’ai plus peur de la nuit, de Leïla Porcher et Sarah Guillemet, sur la formation politique et militaire des combattantes kurdes.
Natalia Gómez Carvajal nous explique sa manière de procéder pour la sélection de films : « Je regarde un maximum de films sans regarder si c’est fait par un homme ou une femme. C’est vraiment un choix. Je lis le synopsis, s’il me plait, je regarde. Je fais au ressenti. À chaque fois, ça a été des films réalisés par des femmes. J’étais contente ! J’avoue que si ça n’avait été que des hommes à la réalisation, je me serais posée des questions… Ensuite, je travaille avec un groupe de programmation, cette année, constitué de 8 – 9 personnes qui ont vu tous les films et suivi tous les échanges. »
L’objectif a été rempli selon la chargée de programmation qui s’enthousiasme de pouvoir proposer, au sein de la thématique vaste des femmes et des luttes féministes, des visions plurielles et diverses. Pas uniquement centré sur l’occident, sur le corps blanc, etc.
« On aborde dans le festival également la question des identités de genre. Et on réfléchit et on est preneur-euse-s de proposition d’un nom qui pourrait justement inclure davantage toutes les identités de genre. », souligne Natalia Gómez Carvajal.
UN MOMENT DE BASCULEMENT
On questionne la place des femmes et des minorités de genre dans les différents secteurs de la société. On réalise un travail profond de réhabilitation de celles-ci dans l’Histoire. On valorise le matrimoine. On déconstruit au fur et à mesure ce qui fondent les inégalités profondes de notre société. On dénonce les violences sexistes et sexuelles. On compte. Aussi bien en terme de chiffres que dans les récits et les parcours.
« On est peut-être à un moment de basculement. », nous dit la chargée de programmation de Docs au féminin. Elle poursuit : « Ce qui est intéressant avec les deux réalisatrices qui étaient présentes à la table ronde, c’est que pour toutes les deux c’était leur premier film et qu’elles représentent cette nouvelle génération qui arrive avec des nouvelles réalisatrices, des nouvelles productrices. Elles osent davantage. »
Pour elle, les études sont encore très difficiles à analyser et ne peuvent pas tout à fait être considérées comme photographie fidèle et globale du secteur du cinéma : « Mais c’est intéressant car ça interroge. Il y a des choses à creuser à mon avis. Comme cette chute que l’on constate : en ce qui concerne les aides à l’écriture, les femmes demandent partout. Mais ensuite au moment du développement, il y a un écart. Ce qu’il faut voir, c’est que ce sont les boites de production qui font les demandes d’aides financières. Est-ce qu’elles osent demander plus quand ce sont des projets portés par des hommes ? Il faut creuser la question. »
Numériser les projets aiderait à suivre précisément tout le trajet du dossier pour l’analyser plus en détail et en profondeur. La question est encore très complexe et Elise Calvez le signale également : du côté de HF Bretagne, aucun groupe Cinéma n’a encore été constitué. L’appel est lancé. Pour compter, décrypter, prendre conscience, informer, sensibiliser, former, faire bouger les lignes ensemble.

 Dans le body horror, les personnages féminins sont fréquemment utilisés. La grossesse, l’accouchement, les menstruations, le post partum sont des thématiques récurrentes, « parfois abordées de manière catastrophique et parfois abordées de manière innovante ». Elle cite alors Ginger Snaps, de John Fawcett, dans lequel la protagoniste est griffée dans le dos par une bête. A l’approche de ses règles, la jeune femme devient de plus en plus monstrueuse. « Ce qui est drôle, c’est que finalement ce n’est pas parce qu’elle a ses règles qu’elle est comme ça, c’est parce qu’elle est devenue un loup-garou », s’amuse Manon Franken. Ce à quoi Cyrielle Dozières rétorque : « Le cinéma de genre a beaucoup exploité ça pour créer de l’horreur alors que pour les femmes, avoir ses règles, c’est quelque chose de banal… » Voilà qui pose la question du regard porté sur le propos cinématographique.
Dans le body horror, les personnages féminins sont fréquemment utilisés. La grossesse, l’accouchement, les menstruations, le post partum sont des thématiques récurrentes, « parfois abordées de manière catastrophique et parfois abordées de manière innovante ». Elle cite alors Ginger Snaps, de John Fawcett, dans lequel la protagoniste est griffée dans le dos par une bête. A l’approche de ses règles, la jeune femme devient de plus en plus monstrueuse. « Ce qui est drôle, c’est que finalement ce n’est pas parce qu’elle a ses règles qu’elle est comme ça, c’est parce qu’elle est devenue un loup-garou », s’amuse Manon Franken. Ce à quoi Cyrielle Dozières rétorque : « Le cinéma de genre a beaucoup exploité ça pour créer de l’horreur alors que pour les femmes, avoir ses règles, c’est quelque chose de banal… » Voilà qui pose la question du regard porté sur le propos cinématographique. 
 Difficile de parler de représentation de la sexualité et du plaisir féminin sans évoquer la problématique du male gaze, traduit en français par regard masculin. Théorisé en 1975 par Laura Mulvey, il encadre toute une culture visuelle imposant, à travers le corps des femmes, l’expression de leur sexualité, leurs postures, attributs et soumission, une vision patriarcale hétérosexuelle cisgenre dans le but de satisfaire le plaisir masculin. Cyrielle Dozières, directrice du festival Court Métrange à Rennes, rappelle que plus récemment, c’est Iris Brey qui a, en France, réintroduit cette notion sous l’angle du regard féminin qu’elle analyse dans son livre éponyme. Elle décrit la représentation de la sexualité comme un spectacle et non comme une expérience. « Les deux courts-métrages que l’on a sélectionnés ne sont pas dans cette optique-là, mêmes s’ils sont imparfaits et qu’on peut interroger des choses dedans. Il faut déjà préciser qu’en 19 ans de festival, il y a eu très peu de films qui ont présenté le plaisir féminin et la sexualité. Ici, ils montrent le plaisir par l’expérience de la femme, par l’intérieur du personnage. », précise-t-elle, en ajoutant : « C’est très important de pouvoir représenter le corps et le plaisir d’une femme qui n’est pas dépourvue d’une personnalité. »
Difficile de parler de représentation de la sexualité et du plaisir féminin sans évoquer la problématique du male gaze, traduit en français par regard masculin. Théorisé en 1975 par Laura Mulvey, il encadre toute une culture visuelle imposant, à travers le corps des femmes, l’expression de leur sexualité, leurs postures, attributs et soumission, une vision patriarcale hétérosexuelle cisgenre dans le but de satisfaire le plaisir masculin. Cyrielle Dozières, directrice du festival Court Métrange à Rennes, rappelle que plus récemment, c’est Iris Brey qui a, en France, réintroduit cette notion sous l’angle du regard féminin qu’elle analyse dans son livre éponyme. Elle décrit la représentation de la sexualité comme un spectacle et non comme une expérience. « Les deux courts-métrages que l’on a sélectionnés ne sont pas dans cette optique-là, mêmes s’ils sont imparfaits et qu’on peut interroger des choses dedans. Il faut déjà préciser qu’en 19 ans de festival, il y a eu très peu de films qui ont présenté le plaisir féminin et la sexualité. Ici, ils montrent le plaisir par l’expérience de la femme, par l’intérieur du personnage. », précise-t-elle, en ajoutant : « C’est très important de pouvoir représenter le corps et le plaisir d’une femme qui n’est pas dépourvue d’une personnalité. » Le plaisir féminin est souvent tabou. Honteux, caché. À l’instar des organes sexuels qui sont en partis dissimulés et méconnus. « Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, les femmes étaient considérées comme lubriques. Celles qui attirent et qui sont attirées. Parce qu’elles sont facilement corruptibles, sensibles, etc. elles sont davantage tentées par le malin, le diable. Leur appétit sexuel était considéré comme vorace et insatiable, c’est pourquoi on a pensé qu’il fallait endiguer le plaisir féminin. Cette pensée a traversé les siècles. », analyse Maude Robert. Tentation, peur, sexualité, mort, plaisir se croisent, se confrontent et se répondent dans les deux courts-métrages. « Ce sont des thématiques qui irriguent complétement le cinéma de genre. Le genre horreur. », ajoute Cyrielle Dozières. La dualité, le choc, la résistance et l’acceptation semblent des étapes essentielles à la découverte de la sexualité. L’aspect pulsionnel dont parlait déjà Maude Robert refait surface, servant de levier dans la compréhension de l’utilisation de cette figure monstrueuse : « Dans les pulsions, il y a une forme de monstruosité. La vie pulsionnelle en général ne correspond pas aux valeurs morales. Il y a les pulsions de mort, de destruction, d’agression, d’autodestruction. Et il y a les pulsions de vie, d’autoconservation et de sexualité. Tout ne se dit pas en société. Ce n’est pas étonnant d’en passer par le monstre. » Dans La bête, elle y voit une forme de rêve « et le rêve s’achève toujours par la satisfaction du désir. » Si le final indique la jouissance, on peut interroger le rapport de domination montré dans la course poursuite dans la forêt. « Et pourquoi toujours passer par la pénétration ? Est-ce que ce film interroger les limites entre l’acceptable ou non ? On voit une forme de bestialité qui finit par être acceptée. », questionne Cyrielle Dozières.
Le plaisir féminin est souvent tabou. Honteux, caché. À l’instar des organes sexuels qui sont en partis dissimulés et méconnus. « Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, les femmes étaient considérées comme lubriques. Celles qui attirent et qui sont attirées. Parce qu’elles sont facilement corruptibles, sensibles, etc. elles sont davantage tentées par le malin, le diable. Leur appétit sexuel était considéré comme vorace et insatiable, c’est pourquoi on a pensé qu’il fallait endiguer le plaisir féminin. Cette pensée a traversé les siècles. », analyse Maude Robert. Tentation, peur, sexualité, mort, plaisir se croisent, se confrontent et se répondent dans les deux courts-métrages. « Ce sont des thématiques qui irriguent complétement le cinéma de genre. Le genre horreur. », ajoute Cyrielle Dozières. La dualité, le choc, la résistance et l’acceptation semblent des étapes essentielles à la découverte de la sexualité. L’aspect pulsionnel dont parlait déjà Maude Robert refait surface, servant de levier dans la compréhension de l’utilisation de cette figure monstrueuse : « Dans les pulsions, il y a une forme de monstruosité. La vie pulsionnelle en général ne correspond pas aux valeurs morales. Il y a les pulsions de mort, de destruction, d’agression, d’autodestruction. Et il y a les pulsions de vie, d’autoconservation et de sexualité. Tout ne se dit pas en société. Ce n’est pas étonnant d’en passer par le monstre. » Dans La bête, elle y voit une forme de rêve « et le rêve s’achève toujours par la satisfaction du désir. » Si le final indique la jouissance, on peut interroger le rapport de domination montré dans la course poursuite dans la forêt. « Et pourquoi toujours passer par la pénétration ? Est-ce que ce film interroger les limites entre l’acceptable ou non ? On voit une forme de bestialité qui finit par être acceptée. », questionne Cyrielle Dozières. 
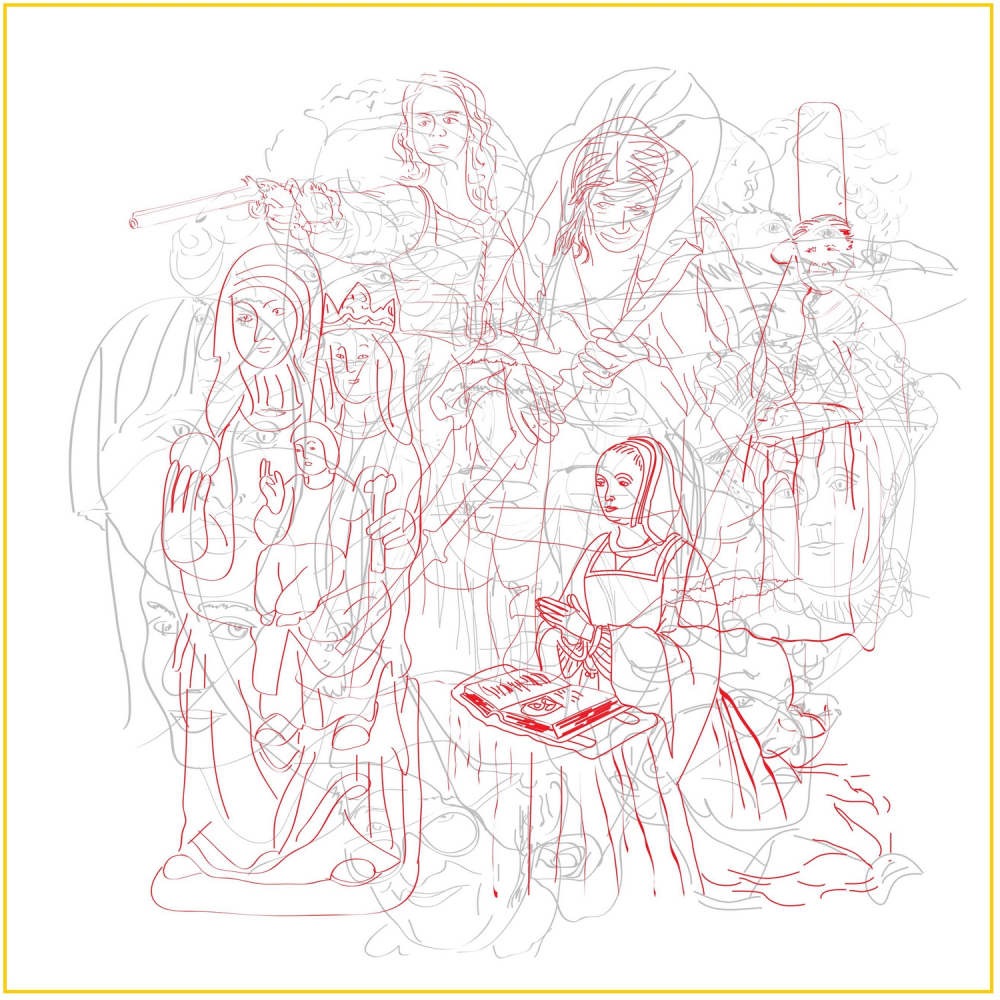 Elles partagent néanmoins cette volonté de mettre en lumière toutes les artistes qui ont participé à la vie culturelle et sociale de la région mais qui ont été oubliées, ignorées, méprisées. Parce qu’elles sont femmes et que l’Histoire est écrite par et pour les hommes.
Elles partagent néanmoins cette volonté de mettre en lumière toutes les artistes qui ont participé à la vie culturelle et sociale de la région mais qui ont été oubliées, ignorées, méprisées. Parce qu’elles sont femmes et que l’Histoire est écrite par et pour les hommes.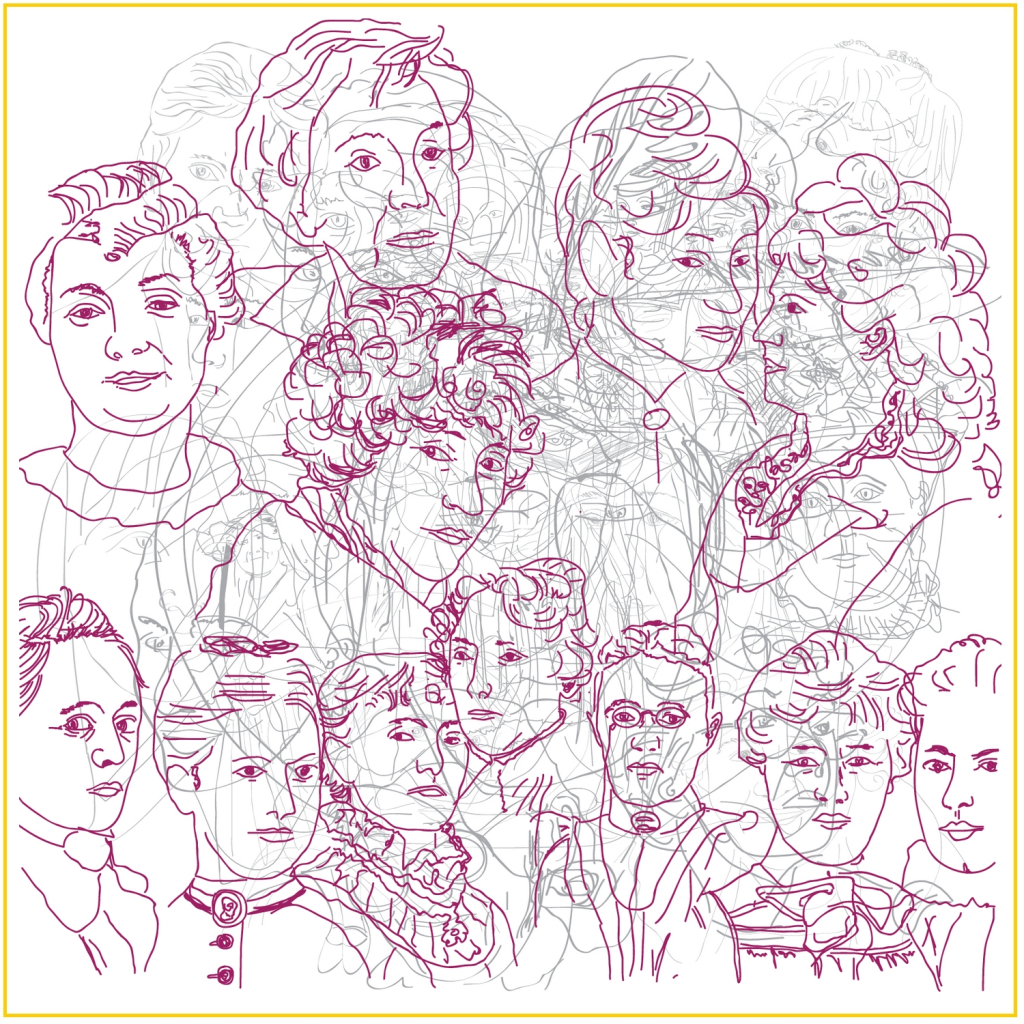 Le podcast s’attache à décrypter ce processus d’invisibilisation subi par les femmes et qui s’étend tout autant aux personnes LGBTIQ+ et aux personnes racisées. Mais il s’attache aussi à mettre en exergue des initiatives actuelles comme le mentorat mis en place par la Fedelima dans le secteur des musiques actuelles, formant des binômes sur des fonctions encore très genrées comme les postes de direction, de technique, etc. Ou encore les actions régulières de l'association Histoire du féminisme à Rennes.
Le podcast s’attache à décrypter ce processus d’invisibilisation subi par les femmes et qui s’étend tout autant aux personnes LGBTIQ+ et aux personnes racisées. Mais il s’attache aussi à mettre en exergue des initiatives actuelles comme le mentorat mis en place par la Fedelima dans le secteur des musiques actuelles, formant des binômes sur des fonctions encore très genrées comme les postes de direction, de technique, etc. Ou encore les actions régulières de l'association Histoire du féminisme à Rennes. Tirer le fil de cette histoire permet de créer un choc. Une prise de conscience. C’est d’ailleurs là le reflet de tout le travail mené par HF Bretagne qui compte et établit un diagnostic chiffré tous les deux ans sur la place des femmes dans les arts et la culture en Bretagne.
Tirer le fil de cette histoire permet de créer un choc. Une prise de conscience. C’est d’ailleurs là le reflet de tout le travail mené par HF Bretagne qui compte et établit un diagnostic chiffré tous les deux ans sur la place des femmes dans les arts et la culture en Bretagne.

 La soirée organisée au cinéma L’Arvor, en partenariat avec le Planning Familial 35 et Amnesty International, à l’occasion de la Journée internationale pour le droit à l’avortement, agit non seulement comme une piqure de rappel mais également comme une sonnette d’alarme.
La soirée organisée au cinéma L’Arvor, en partenariat avec le Planning Familial 35 et Amnesty International, à l’occasion de la Journée internationale pour le droit à l’avortement, agit non seulement comme une piqure de rappel mais également comme une sonnette d’alarme. Sans oublier le traitement médiatique réservé à ces thématiques qui véhicule bien souvent des clichés. Depuis quelques jours en France, la presse s’affole avec des titres chocs concernant le taux de recours à l’IVG qui en 2019 a atteint son chiffre le plus élevé. Depuis 2001, entre 215 000 et 230 000 avortements étaient pratiqués. L’an dernier, le chiffre était de 232 000.
Sans oublier le traitement médiatique réservé à ces thématiques qui véhicule bien souvent des clichés. Depuis quelques jours en France, la presse s’affole avec des titres chocs concernant le taux de recours à l’IVG qui en 2019 a atteint son chiffre le plus élevé. Depuis 2001, entre 215 000 et 230 000 avortements étaient pratiqués. L’an dernier, le chiffre était de 232 000.


 Pour cette nouvelle édition, ce sera « Une génération », un thème qui lui plait et qu’iel partage avec une amie, Gabrielle Pichon comédienne et autrice pour l’écriture, qui s’effectue en deux jours, fin août. En septembre, le gouvernement lance son grenelle contre les violences conjugales et à cette occasion, ressort un micro-trottoir de 1979, qu’iel va donc reproduire dans son court-métrage. Iel lance un appel sur les réseaux sociaux et découvre avec joie que les réponses sont nombreuses :
Pour cette nouvelle édition, ce sera « Une génération », un thème qui lui plait et qu’iel partage avec une amie, Gabrielle Pichon comédienne et autrice pour l’écriture, qui s’effectue en deux jours, fin août. En septembre, le gouvernement lance son grenelle contre les violences conjugales et à cette occasion, ressort un micro-trottoir de 1979, qu’iel va donc reproduire dans son court-métrage. Iel lance un appel sur les réseaux sociaux et découvre avec joie que les réponses sont nombreuses :

 Malgré le postulat de départ qui nous laisse imaginer un humour parodique, la réalisatrice – qui affirme être réellement fan de Céline Dion - accentue la portée dramatique de son propos. Plus épuré au niveau des personnages que dans Tout ce qui brille et Nous York, basés sur des bandes d’ami-e-s, le film se concentre sur un nombre plus restreint de personnalités que Géraldine Nakache peut davantage amplifier et complexifier, rendant centraux les silences et les non-dits.
Malgré le postulat de départ qui nous laisse imaginer un humour parodique, la réalisatrice – qui affirme être réellement fan de Céline Dion - accentue la portée dramatique de son propos. Plus épuré au niveau des personnages que dans Tout ce qui brille et Nous York, basés sur des bandes d’ami-e-s, le film se concentre sur un nombre plus restreint de personnalités que Géraldine Nakache peut davantage amplifier et complexifier, rendant centraux les silences et les non-dits.  Drôles et percutants, les dialogues apportent de la fraicheur et du rythme à cette histoire de famille qui pourrait être celle de milliers de gens. Géraldine Nakache nous surprend de par les subtilités du langage non verbal, qui dévoilent l’étendue de son talent d’actrice - même s’il n’est plus à démontrer, à l’instar d’une Leïla Bekhti à l’interprétation intense et toujours plus captivante de film en film.
Drôles et percutants, les dialogues apportent de la fraicheur et du rythme à cette histoire de famille qui pourrait être celle de milliers de gens. Géraldine Nakache nous surprend de par les subtilités du langage non verbal, qui dévoilent l’étendue de son talent d’actrice - même s’il n’est plus à démontrer, à l’instar d’une Leïla Bekhti à l’interprétation intense et toujours plus captivante de film en film.

 Ce rapport à la religion, elle l’avait déjà noté dans son travail autour des menstruations. Au Brésil déjà elle entreprenait des performances autour des règles et en venant en France pour poursuivre ses études d’arts plastiques, elle a rédigé un mémoire sur ce sujet auquel elle s’est intéressée dans plusieurs pays et plusieurs cultures.
Ce rapport à la religion, elle l’avait déjà noté dans son travail autour des menstruations. Au Brésil déjà elle entreprenait des performances autour des règles et en venant en France pour poursuivre ses études d’arts plastiques, elle a rédigé un mémoire sur ce sujet auquel elle s’est intéressée dans plusieurs pays et plusieurs cultures.