Célian Ramis
PMA pour tou-te-s : Mon choix de famille


La famille pour tou-te-s, ce n’est pas une injonction à fonder une famille, comme l’a souligné la présidente d’Iskis (association anciennement nommée Centre Gay Lesbien Bi et Trans) de Rennes, Selene Tonon, lors de la Marche des Fiertés 2018, qui a défilé le 16 juin dans les rues de la capitale bretonne.
C’est un droit qui doit (devrait déjà) être accordé à toutes les personnes souhaitant avoir un ou plusieurs enfants. Ce ne doit plus être une hypocrisie, un secret de polichinelle dont il faut discrétion garder parce qu’on est une femme lesbienne, obligée d’aller à l’étranger pour espérer avoir un bébé via la Procréation Médicalement Assistée.
Peu importe l’orientation sexuelle, Selene le rappelle, « c’est l’amour inconditionnel qui fait une famille ». On est bien d’accord, comme plus de la moitié de la population selon le dernier sondage IFOP. Alors, pourquoi l’accès à la PMA pour tou-te-s s’intègre-t-elle à la nouvelle loi bioéthique ? Et pourquoi a-t-on encore ce débat en 2018 ?
Ce n’est pas une question d’éthique mais une question d’égalité des droits. Égalité dans le choix de fonder une famille, d’élever un enfant au sein d’un foyer, si on le souhaite. Pourtant, aujourd’hui encore la PMA n’est autorisée, en France, qu’aux couples hétérosexuels. Par lâcheté politique, l’accès à la PMA pour tou-te-s a été sacrifié en 2013, lors de la loi sur le Mariage pour tous. Mais la lutte continue. L’Hexagone s’apprête-t-elle à revivre la même déception qu’il y a 5 ans alors que le candidat Macron promettait l’an dernier de faire face à cette discrimination ? Si l’optimisme prime, il a néanmoins un goût amèrement acide…
 De l’avenue Janvier à la place de la Mairie, en passant par le boulevard Laennec et le quai Chateaubriand, le 16 juin dernier, les rues de Rennes se sont égayées aux couleurs de l’arc-en-ciel. Manifestation festive, la Marche des Fiertés n’en oublie pas de porter avec détermination les revendications pour lesquelles les associations LGBTIQ+ se battent au quotidien.
De l’avenue Janvier à la place de la Mairie, en passant par le boulevard Laennec et le quai Chateaubriand, le 16 juin dernier, les rues de Rennes se sont égayées aux couleurs de l’arc-en-ciel. Manifestation festive, la Marche des Fiertés n’en oublie pas de porter avec détermination les revendications pour lesquelles les associations LGBTIQ+ se battent au quotidien.
Arrêt des mutilations sur les personnes intersexuées, changement de la mention du sexe et du prénom libre et gratuit à l’état civil sur simple déclaration en mairie (sans expertises et sans stérilisations forcées), éducation populaire à l’égalité et la diversité des sexes, identités de genre et relations amoureuses dès l’école, accord systématique du droit d’asile aux personnes LGBTI migrant-e-s fuyant leur pays à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou encore campagnes régulières et adaptées sur les différents moyens de prévention des IST en direction des populations LGBTI… la liste est longue tant les inégalités et discriminations sont nombreuses.
Si aucune hiérarchie n’est établie au sein des revendications, cette journée des Fiertés met en lumière chaque année un sujet sur lequel il y a particulièrement urgence. Ainsi, en juin, les différentes Marches ont scandé haut et fort le droit à la PMA pour tou-te-s en clamant à l’unisson : « PMA, on veut une loi, on veut des droits ! » ou encore « Mon papa est pour la PMA et ma maman, elle veut des petits-enfants ! ».
PAS HOMOPHOBE MAIS…
Un sujet qui fait consensus auprès de la population, excepté pour une minorité qui s’oppose farouchement à une évolution qui ne devrait pas faire débat. « Ce soir, au conseil municipal de Rennes, je fais partie des élus qui refusent de voter l'une des deux subventions destinées au centre LGBT de Rennes, à savoir celle fléchée pour l'organisation de la marche des fiertés 2018. Cette édition a en effet été l'occasion de mettre en avant, dans les discours et les banderoles officielles, la revendication spécifique de l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de même sexe.
La lutte contre les discriminations, et notamment les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, est un objectif louable qui fait consensus. Ce n'est pas le cas de l'extension de la PMA. Je ne pense pas que les impôts des Rennais aient vocation à financer une manifestation en ce sens. Je le réaffirme ici : je suis opposé à l'extension de la PMA aux couples de même sexe. Cautionner une mesure qui aurait pour conséquence de priver de père des enfants à venir, non pas du fait d’un quelconque accident de la vie, mais par un choix volontaire effectué sciemment, voilà l'obscurantisme. », écrit le conseiller municipal du groupe Rennes Alternance 2020, Gurval Guiguen sur sa page Facebook. Un commentaire terrifiant que l’on pourrait ajouter à la sordide catégorie « Je ne suis pas homophobe mais… / Je ne suis pas sexiste mais… ».
Heureusement, le 16 juin, la Marche des Fiertés a réuni plus de 4500 personnes dans la capitale bretonne, là où les années précédentes en comptabilisaient environ 3000. Lors de la prise de parole, Selene Tonon, militante chevronnée du CGLBT, devenu Iskis (Queer en breton), envoie valdinguer ces idées reçues conservatrices en exigeant, à juste titre, que les populations LGBTI soient libres de maitriser leurs vies, de choisir leurs familles et que soient respecter toutes les familles, dans toutes leurs formes : « C’est le mot d’ordre sur les affiches. N’en déplaise à ceux qui ont milité contre nos droits ! » Après tout,« ce sont nos vies, nos amours, nos corps, nos identités et nos familles. »
RAPPEL DES FAITS
Le mariage pour tous figure en janvier 2012 parmi les engagements du candidat Hollande qui, une fois élu, concrétise par l’élaboration d’un projet de loi, porté par Christiane Taubira, alors Garde des Sceaux. Un projet de loi adopté par le Parlement le 23 avril 2013.

« Avec la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous, la France est devenue le 9epays européen et le 14epays au monde à autoriser le mariage homosexuel. Cette loi a ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l’adoption et la succession, au nom des principes d’égalité et de partage des libertés. », peut-on lire sur le site Gouvernement.fr. Une introduction suivie d’une citation de la ministre de la Justice de l’époque :
« Oui, c’est bien le mariage, avec toute sa charge symbolique et toutes ses règles d’ordre public, que le Gouvernement ouvre aux couples de même sexe, dans les mêmes conditions d’âge et de consentement de la part de chacun des conjoints, avec les mêmes interdits (…) avec les mêmes obligations pour chaque conjoint vis-à-vis l’un de l’autre, les mêmes devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des parents vis-à-vis de leurs enfants. Oui, c’est bien ce mariage que nous ouvrons aux couples de même sexe. »
En revanche, au nom de l’opposition réunie sous le drapeau de la manif pour tous - qui prend alors le monopole d’un non-débat et qui décomplexe majoritairement l’homophobie et la lesbophobie - on range au placard les prétendus « principes d’égalité et de partage des libertés. » D’un revers de la main, on balaie ce qui aurait dû découler de fait du mariage pour tous : la PMA pour tou-te-s et la filiation automatique, sans discrimination.
QU’EST-CE QUI CLOCHE ?
La technique de la PMA serait-elle différente selon que la femme est hétéro ou homo ? Non, bien évidemment que non et encore non. La problématique n’est donc pas médicale. Elle serait soi-disant éthique. D’où l’arrivée du sujet au sein des États généraux de la bioéthique, organisés par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) de janvier à avril 2018, en guise de phase préalable à la révision de la loi de bioéthique prévue pour la fin de l’année.
Pourquoi y intégrer l’ouverture de la PMA pour tou-te-s ? Et qu’attend-on puisque le candidat Macron en avril 2017 se disait « favorable à une loi qui ouvrira la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires » ? Un avis positif de la part de la CCNE ? C’est chose faite depuis bientôt un an. Le Comité juge que « L’ouverture de la PMA à des personnes sans stérilité pathologique peut se concevoir pour pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d’orientations personnelles. »
Pourtant, depuis, aucun projet de loi n’a été déposé par le gouvernement en place. Au contraire, il semble même reculer ou au moins essayer de gagner du temps... Un temps qui laisse place aux LGBTIphobies dans toute leur ignominie.
LE COLLECTIF, CONTRE L’HYPOCRISIE
C’est pourquoi en décembre 2017, à l’approche des Etats généraux, 5 associations LGBTI et/ou féministes – CGLBT Rennes, SOS Homophobie Bretagne, Commune Vision, Les Effronté-e-s Rennes et Le Planning Familial 35 – ont fondé le Collectif breton pour la PMA, « afin de se rassembler autour d’un avis commun, en local », souligne Véronique Madre, co-déléguée territoriale de SOS Homophobie Bretagne.
 Ainsi, le Collectif a au fil des mois informé des actualités et des événements liés au Etats généraux et à la consultation du Comité, essayant de faire en sorte que les débats ne soient pas monopolisés par les opposant-e-s, organisé une manifestation le 21 avril pour revendiquer l’ouverture de la PMA pour tou-te-s (femmes lesbiennes, femmes célibataires, personnes trans, personnes non binaires) et s’est saisi de la fête des mères pour distribuer des cartes postales Faites des mères, envoyées également aux élu-e-s, députés, ministres et au Président de la République.
Ainsi, le Collectif a au fil des mois informé des actualités et des événements liés au Etats généraux et à la consultation du Comité, essayant de faire en sorte que les débats ne soient pas monopolisés par les opposant-e-s, organisé une manifestation le 21 avril pour revendiquer l’ouverture de la PMA pour tou-te-s (femmes lesbiennes, femmes célibataires, personnes trans, personnes non binaires) et s’est saisi de la fête des mères pour distribuer des cartes postales Faites des mères, envoyées également aux élu-e-s, députés, ministres et au Président de la République.
« J’aimerais être optimiste sur la future loi et le vote mais les signes montrent qu’il faut être prudent. Le résultat des Etats généraux fait craindre pour la suite, à cause de la mobilisation des opposant-e-s qui représentent pourtant qu’une minorité de la population, qui était la même à protester contre le mariage pour tous, l’ABCD de l’égalité, etc. mais qui est bruyante et fermée. Surtout que le gouvernement n’appuie pas totalement. Il se dit favorable dans son ensemble mais certains ministres s’affichent contre. », souligne Véronique Madre, mitigée face au rapport de synthèse publié début juin par le CCNE, qui rendra son avis complet et définitif à la rentrée.
A l’argument des « lois naturelles » visant à se baser uniquement sur le fait que pour procréer il faut l’accouplement d’un homme et d’une femme, s’oppose l’évolution des schémas familiaux, de plus en plus divers et réalistes. Contraindre les femmes lesbiennes à aller à l’étranger pour avoir le droit à la PMA puis à déposer une demande d’adoption – rendue possible uniquement si le couple est marié - auprès du Tribunal de Grande Instance – pour celle qui n’a pas porté physiquement l’enfant, définie comme la « mère sociale » – est hypocrite :
« Ce n’est pas une question d’éthique, c’est une question d’égalité. En quoi la société a son mot à dire sur nos vies ? En quoi la population devrait avoir une opinion sur les couples que l’on reconnaît ou pas, les familles que l’on reconnaît ou pas ? Les familles homoparentales existent déjà, c’est la réalité. Des études montrent que les enfants sont aussi heureux que dans des familles hétéros. C’est une hypocrisie de leur interdire l’accès à la PMA puis de reconnaître les familles, en autorisant les adoptions par les conjointes. Nous demandons l’ouverture de la PMA à toutes les personnes ayant un utérus, dans les mêmes conditions de couple et dans les mêmes conditions de remboursement. »
PARCOURS DES COMBATTANTES
Adeline et sa femme se sont rendues en Belgique, dans une clinique à Liège, pour avoir recours à la PMA et avoir leurs deux filles : « Ma compagne a porté la première et moi la deuxième. Ce sont globalement les mêmes procédures sauf que la deuxième fois nous n’avons pas eu l’entretien visant à expliquer notre projet. À la clinique, ils nous connaissaient déjà, on n’a pas refait le premier rendez-vous. »
Un premier rendez-vous suivi d’un délai légal de réflexion de deux mois. Puis vient le deuxième rendez-vous dédié aux examens médicaux. Jusque là, outre les déplacements à l’étranger, pas trop de difficultés. Les choses se compliquent lorsqu’il faut trouver un médecin qui accepte de suivre les couples lesbiens dans ce type de démarche.
« Ce n’est pas évident, certains disent non, il faut prendre le temps de trouver les bons médecins. Surtout que nous étions à Paris pour la première et que pour la deuxième nous avions déménagé en Bretagne, il fallait donc retrouver quelqu’un… Quelqu’un qui accepte de faire une prescription pour le traitement de stimulation ovarienne qui se fait par piqures. Certains médecins acceptent mais signalent « non remboursé » sur l’ordonnance. C’est une centaine d’euros, qu’il faut renouveler à chaque essai ! Et puis c’est important d’obtenir la compréhension médicale pour qu’on nous explique bien comment bien faire les piqures. Ce n’est pas très compliqué mais on le fait nous-mêmes et ce qui n’est pas évident, c’est que si on manque d’informations, on n’ose pas tellement demander par peur de la situation. », précise Adeline.
En parallèle, un donneur doit être choisi. Il peut être anonyme ou semi anonyme, signifiant que l’enfant pourra s’il le désire connaître l’identité du donneur, qui signe une convention pour renoncer à la reconnaissance de l’enfant. Les deux femmes ont fait ce choix-là : un donneur semi anonyme, dans une banque de sperme au Danemark. « On achète les paillettes (le terme utilisé pour le sperme) et la banque envoie directement à la clinique en Belgique. », souligne-t-elle.
Dernière étape avant de pouvoir réaliser l’insémination : trouver un laboratoire qui puisse définir un rendez-vous pour le matin d’une date précise – dépend évidemment du cycle - et qui accepte de donner les résultats avant midi pour les envoyer à la clinique, qui appelle ensuite les personnes :
« En fonction des ovocytes, ils te disent qu’il faut encore attendre un peu ou alors ils te disent de venir le lendemain pour procéder à l’insémination des paillettes dans l’utérus. C’est un-e gynéco qui le fait par cathéter, pas comme la PMA artisanale qui se fait avec une seringue… ça dure 10-15 minutes et puis on rentre à la maison. À partir de là, si ça fonctionne, la prise en charge de la grossesse se fait en France et là ce n’est plus du tout la même chose, on est cocoonées comme les autres, les infirmières et sages-femmes ne posent pas de questions intrusives, sont bienveillantes et sans jugement. »
AVOIR UN « ENFANT LÉGITIME »
Malheureusement, le parcours de la combattante ne s’arrête pas à la naissance de l’enfant dont la filiation avec la mère sociale n’est pas automatique. Une demande d’adoption doit être déposée auprès du Tribunal de Grande Instance. Une demande qui ne peut se faire que si les femmes sont mariées.
« Quand j’ai fait mes enfants, je ne pouvais pas me marier en France. Maintenant, c’est devenu normal que les couples homos puissent se marier. Le problème, c’est que le mariage n’est pas un droit pour les lesbiennes, c’est un devoir. Nous sommes obligées de nous marier pour déposer un dossier d’adoption au tribunal. Tout le monde n’a pas envie de se marier ! »
s’insurge Céline Cester, présidente de l’association Les enfants d’arc-en-ciel, créée il y a 11 ans par un couple de femmes militant pour l’instauration du congé d’accueil de l’enfant, mis en place en 2012 pour le père ou la personne mariée à la mère biologique.
Pour Adeline, les 3 jours à la naissance et les 11 jours de congé ont été obtenus sans obstacle. Pas comme sa demande de congé parental à 80%, d’abord refusée par son employeur :
 « Il m’a dit qu’il l’accorderait quand j’aurais reçu l’accord du tribunal pour l’adoption. Sauf que ça prend un an et demi – la durée du traitement des dossiers, comme la procédure de demande d’adoption (on peut par exemple être convoquées à la gendarmerie, au tribunal, pour une enquête de mœurs, une enquête sociale) dépend de chaque tribunal – et que la CAF donne l’allocation uniquement la première année de naissance de l’enfant. Je n’aurais donc pas pu l’obtenir si j’avais du attendre la décision du tribunal.
« Il m’a dit qu’il l’accorderait quand j’aurais reçu l’accord du tribunal pour l’adoption. Sauf que ça prend un an et demi – la durée du traitement des dossiers, comme la procédure de demande d’adoption (on peut par exemple être convoquées à la gendarmerie, au tribunal, pour une enquête de mœurs, une enquête sociale) dépend de chaque tribunal – et que la CAF donne l’allocation uniquement la première année de naissance de l’enfant. Je n’aurais donc pas pu l’obtenir si j’avais du attendre la décision du tribunal.
En fait, il jouait sur les termes de la loi qui sont assez flous et qui parlent des « enfants légitimes ». Mais c’est quoi un enfant légitime ? Bref, il a fini par accepter car on a réussi à faire valoir que l’adoption prend effet à la date du dépôt de la requête. Il a vraiment eu une posture discriminatoire ! Et surtout il m’a dit des choses ridicules disant que c’était comme donner un congé parental à une femme qui vit en colocation avec quelqu’un qui a des enfants… Ridicule ! »
Des situations complexes et douloureuses, il y en a un paquet à cause de la PMA non accessible aux couples lesbiens et de la non filiation automatique. Le blog de l’association Les enfants d’arc-en-ciel en témoigne, permettant ainsi de donner une visibilité à tous les parcours vécus et subis.
SITUATIONS COMPLEXES ET DOULOUREUSES
« Le parcours de PMA est très lourd, y compris pour les hétéros. Mais pour les homos, il faut aller à l’étranger, sans pouvoir expliquer les raisons de son absence puisque c’est hors du cadre légal, il n’y a pas le droit aux congés médicaux. Sachant qu’en plus, on vous appelle un jour à 14h pour le lendemain 8h. C’est toute une organisation, selon là où on habite, c’est très compliqué. Et puis, il faut avoir les moyens financiers d’aller en Belgique ou en Espagne. Plusieurs fois. Surtout si ça ne marche pas au premier essai. Il y a aussi des différences de dosage pour le traitement entre la France et l’Espagne par exemple, ça peut créer des situations très difficiles. C’est compliqué au-delà des difficultés physiques et psychologiques de la PMA. », explique Céline Cester.
Des expériences dramatiques, on lui en a rendu compte à la pelle depuis 2 ans qu’elle est présidente de la structure. À cause du cadre légal qui aujourd’hui en France ne protège pas les liens familiaux en dehors de ceux du sang. En cas de séparation, lorsqu’elles ne sont pas mariées, les mères sociales n’ont pas de droits sur les enfants qu’elles pourront continuer à voir selon la volonté des mères biologiques.
« J’ai l’exemple d’une maman sociale de jumelles de 11 mois. Elle vient de se séparer de sa compagne qui ne veut plus lui laisser voir ses filles. Elle n’a pas de recours parce qu’elles n’étaient pas mariées, elle n’a donc pas pu adopter. Ce statut de hors-la-loi laisse des marques… », regrette Céline.
On sent dans les arguments adverses l’exigence de la famille parfaite. Parce qu’elles sont homosexuelles, elles devraient redoubler d’effort pour incarner cet idéal alors même que ce modèle hypocrite s’effondre depuis plusieurs décennies chez les hétéros. Obligation de se marier, obligation d’adopter l’enfant, obligation de s’aimer à vie…
 « Ce n’est pas parce qu’on est homos qu’on est des couples parfaits. Ce n’est pas parce qu’on est homos qu’on doit s’aimer toute la vie ! Déjà quand tout se passe bien, cette sensation de manque de légitimité à fonder une famille laisse des traces alors vous imaginez quand ça se passe mal ?! », s’indigne la présidente.
« Ce n’est pas parce qu’on est homos qu’on est des couples parfaits. Ce n’est pas parce qu’on est homos qu’on doit s’aimer toute la vie ! Déjà quand tout se passe bien, cette sensation de manque de légitimité à fonder une famille laisse des traces alors vous imaginez quand ça se passe mal ?! », s’indigne la présidente.
Adeline pointe également l’appréhension de l’échec de l’insémination (sans parler des grossesses qui n’arriveront pas à terme, comme tel est le sujet de la bande-dessinée Écumes, d’Ingrid Chabbert et Carole Maurel). Ce qui a été son cas lors de son premier essai.
« C’est toute une organisation. Il y a les contraintes géographiques, financières, se rendre aux consultations, payer les soins non remboursés, le train, l’hôtel… Il faut s’absenter de son travail. Nous sommes toujours aller à 2 avec ma compagne donc il faut aussi que l’autre s’absente de son travail. Personnellement, je n’ai pas ressenti de découragement extrême mais c’était difficile. Je savais que j’avais l’énergie pour le faire mais je n’aurais peut-être pas tenu une 3e, 4e, 5etentative… Après, en Belgique, nous avons été très bien reçues. On avait préparé notre premier rendez-vous comme un entretien d’embauche et en fait nous avons simplement dit qu’on voulait fonder une famille. On nous répondu « Bienvenues ! ». C’est leur quotidien là-bas donc ça ne leur pose aucun souci. C’est très différent en France. », commente-t-elle.
TRANSPARENCE ET ENTOURAGE
Au-delà de l’incompréhension face à la lâcheté politique et la souffrance endurée à cause de la contestation LGBTIphobe, elle s’inquiète de ce que peuvent entendre les enfants de familles homoparentales. Tout comme Céline Cester, Adeline prône la transparence, expliquant le schéma familial dès l’entrée à la crèche, aux adultes comme aux enfants :
« Et il n’y a aucun souci. Mais ça dépend toujours des gens sur qui on tombe. On doit encore un peu prouver qu’on est une famille « normale » alors qu’on ne devrait pas avoir à le faire, même si ce n’est pas une famille « normale » dans le sens où nous avons dû nous rendre à l’étranger pour la PMA et adopter nos enfants ensuite. Mais on sort, on se montre. »
Ne pas rester cachées. Ne pas rester isolées. Même si l’entourage est présent, Adeline et sa compagne se sont orientées vers l’association Les enfants d’arc-en-ciel pour obtenir des renseignements sur les démarches, les vécus et expériences, et pour partager des informations et des moments conviviaux. C’est là le cœur des actions de la structure : l’accompagnement des couples et des familles, l’accessibilité aux informations et le conseil adapté à chaque parcours.
« Lorsque l’on organise des rencontres – qui sont ouvertes à tout le monde – l’idée est de pouvoir échanger, dans un espace sécurisé et sans jugement, autour des situations et voir comment on peut les traiter. Et souvent, on se rend compte que tout n’est pas lié à l’homoparentalité. Loin de là. Ce sont des questions qui concernent le développement de l’enfant, la parentalité, etc. Ce sont des questions plus larges de société. », analyse Céline Cester qui prône la mise en avant des éléments positifs dans le débat public :
« Oui, c’est difficile. Oui, il y a des situations dramatiques. Oui, avec une loi, ça irait beaucoup mieux c’est vrai. Mais il faut aussi dire que nos enfants grandissent. Qu’ils grandissent bien, que ça va bien ! On vit des choses très positives avec nos familles. C’est important aussi de le voir sous cet angle-là. D’être maitre de sa vie et de ses choix. »
Dans toutes les paroles des concernées, que ce soit dans les discours militants, les débats, les témoignages ou sur le blog de l’association (qui a également un site fourni et complet en informations), il y a l’immense regret du manque de courage politique qui a autorisé un mariage au rabais, sacrifiant l’accès à la PMA et la reconnaissance de la filiation, « laissant ainsi des familles sur le bord du chemin » et menant dans certaines situations à des inséminations artisanales « non par choix mais bien par défaut ».
Mais il y a aussi et surtout une détermination à se battre jusqu’au bout pour faire reconnaître leurs droits. Leurs droits d’avoir des enfants si elles le désirent, quand elles le désirent et avec qui elles le désirent, de se marier uniquement par choix, d’être libres de vivre leurs vies et leurs désirs sans justification permanente. Comme le dit Adeline :
« Ça ne devrait pas être une question de chance de tomber sur les bonnes personnes, ça devrait juste être possible pour tout le monde ! »




 « C’est un fardeau que vous portez. Ce n’est pas juste une lésion, ce sont des gênes, des douleurs. À nous, médecins, d’utiliser tous les mots/maux de la patiente pour la diagnostiquer. Souvent, ça arrive dès les premières règles. Et la femme va entendre dire « C’est normal » de la part de son entourage. Et le médecin va dire aussi « C’est normal ». On fera le diagnostic 10 ans plus tard. Pourquoi un délai si long ? Parce que ce n’est pas aussi simple… Il y a un mélange de chose qui fait qu’on a du mal à établir le diagnostic. »
« C’est un fardeau que vous portez. Ce n’est pas juste une lésion, ce sont des gênes, des douleurs. À nous, médecins, d’utiliser tous les mots/maux de la patiente pour la diagnostiquer. Souvent, ça arrive dès les premières règles. Et la femme va entendre dire « C’est normal » de la part de son entourage. Et le médecin va dire aussi « C’est normal ». On fera le diagnostic 10 ans plus tard. Pourquoi un délai si long ? Parce que ce n’est pas aussi simple… Il y a un mélange de chose qui fait qu’on a du mal à établir le diagnostic. »





 L’objectif des bénévoles est de faire découvrir ou redécouvrir les méthodes de contraceptions féminines et masculines à travers des quizz, des échanges, des jeux et même de la couture. “Toutes les salles, ou presque, ont été transformées en ateliers imaginés par l’équipe”, explique Anne-Claire Bouscal, directrice du planning familial rennais.
L’objectif des bénévoles est de faire découvrir ou redécouvrir les méthodes de contraceptions féminines et masculines à travers des quizz, des échanges, des jeux et même de la couture. “Toutes les salles, ou presque, ont été transformées en ateliers imaginés par l’équipe”, explique Anne-Claire Bouscal, directrice du planning familial rennais. Dans “l’atelier capote”, toutes les contraceptions hormonales ou naturelles - pilules, préservatifs, diaphragme, stérilets, implant et même digue buccale qui permet un sexe oral protégé des maladies sexuellement transmissibles - sont à portée de main.
Dans “l’atelier capote”, toutes les contraceptions hormonales ou naturelles - pilules, préservatifs, diaphragme, stérilets, implant et même digue buccale qui permet un sexe oral protégé des maladies sexuellement transmissibles - sont à portée de main. Et ce n’est pas la seule méthode à être occultée. L’injection hormonale hebdomadaire ou la vasectomie, légalisée en France seulement en 2001, sonnent encore comme des crimes contre la virilité. Pourtant, l’intervention qui consiste en la section des canaux déférents n’est pas une fatalité. André, présent au planning familial, a eu recours à la vasectomie à 24 ans, dans les années 70.
Et ce n’est pas la seule méthode à être occultée. L’injection hormonale hebdomadaire ou la vasectomie, légalisée en France seulement en 2001, sonnent encore comme des crimes contre la virilité. Pourtant, l’intervention qui consiste en la section des canaux déférents n’est pas une fatalité. André, présent au planning familial, a eu recours à la vasectomie à 24 ans, dans les années 70.


 Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population.
Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population. « Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans.
« Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans. « Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans.
« Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans.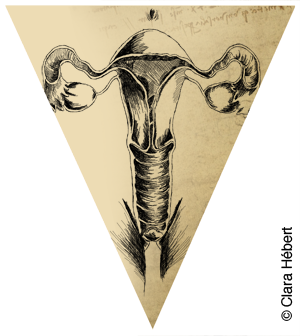 Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».
Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».
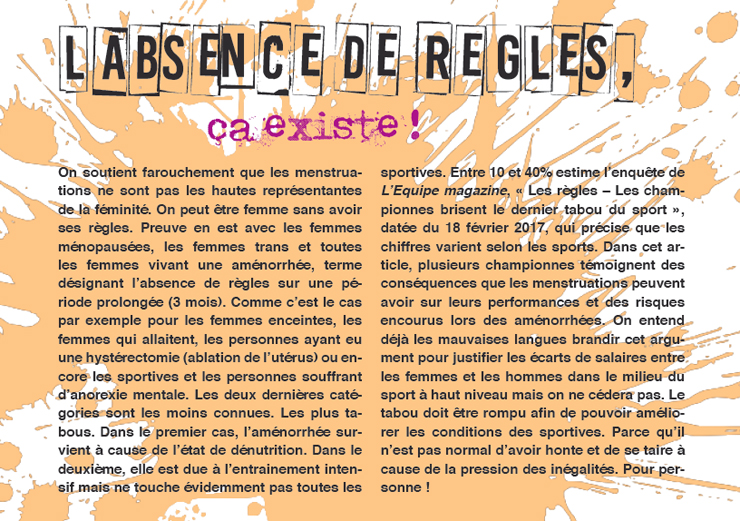
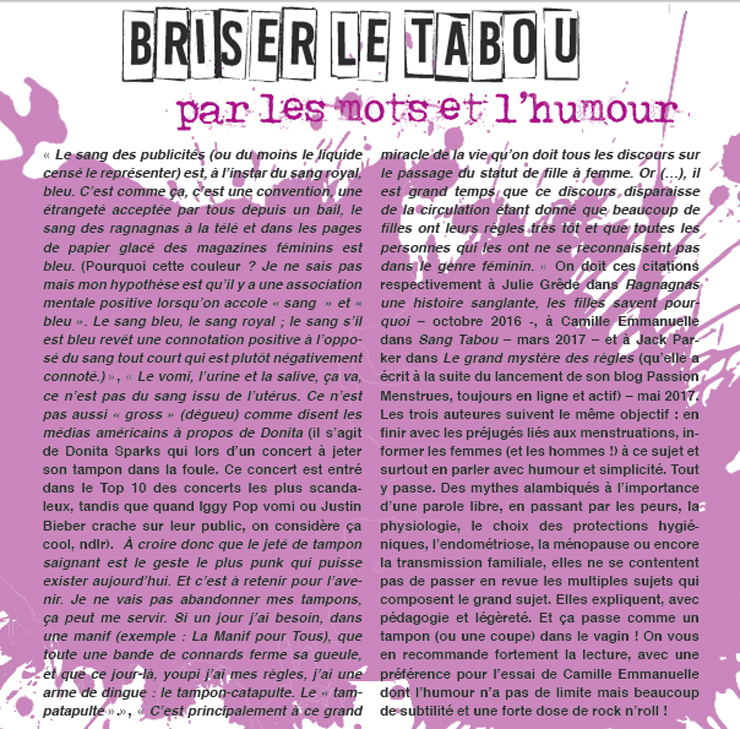


 Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique.
Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique. Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale.
Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale. Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.
Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.



 Le dernier Baromètre Agence BIO / CSA, réalisé en 2015, montre que 9 français-es sur 10 consomment bio. Occasionnellement, en tout cas. Contre environ 5 français-es sur 10 en 2003. L’étude révèle également que 65% en consomment régulièrement – au moins une fois par mois – soit 28% de plus qu’il y a 13 ans.
Le dernier Baromètre Agence BIO / CSA, réalisé en 2015, montre que 9 français-es sur 10 consomment bio. Occasionnellement, en tout cas. Contre environ 5 français-es sur 10 en 2003. L’étude révèle également que 65% en consomment régulièrement – au moins une fois par mois – soit 28% de plus qu’il y a 13 ans. Des marchés bio fleurissent, comme tel est le cas le mercredi après-midi dans la capitale bretonne, au début du mail François Mitterand, les restaurateurs-trices optent désormais pour la démocratisation du bio dans les assiettes et les parents d’élèves réclament que cela en soi ainsi dans les cantines scolaires.
Des marchés bio fleurissent, comme tel est le cas le mercredi après-midi dans la capitale bretonne, au début du mail François Mitterand, les restaurateurs-trices optent désormais pour la démocratisation du bio dans les assiettes et les parents d’élèves réclament que cela en soi ainsi dans les cantines scolaires. « C’est un courant agricole que l’on ne peut pas résumer en 3 phrases dans un article mais en gros il place l’agriculteur au cœur d’un système agricole vu comme un organisme vivant. On travaille avec tous les éléments, comme la lune par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails mais ce qui est important, c’est que c’est une agriculture qui repose beaucoup sur l’observation. On prend le temps de faire, on prend le temps de se poser et de regarder nos plantes. Et ça définit le boulot qu’on a car on voit des choses que l’on n’aurait pas vu dans l’urgence. », analyse Sophie.
« C’est un courant agricole que l’on ne peut pas résumer en 3 phrases dans un article mais en gros il place l’agriculteur au cœur d’un système agricole vu comme un organisme vivant. On travaille avec tous les éléments, comme la lune par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails mais ce qui est important, c’est que c’est une agriculture qui repose beaucoup sur l’observation. On prend le temps de faire, on prend le temps de se poser et de regarder nos plantes. Et ça définit le boulot qu’on a car on voit des choses que l’on n’aurait pas vu dans l’urgence. », analyse Sophie. Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se lancent dans la filière. Il n’y a qu’à voir les chiffres. La conversion des éleveurs de vaches laitières est fluctuante et un développement de l’ordre de 30% est attendu d’ici 2018 dans le secteur du lait bio.
Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se lancent dans la filière. Il n’y a qu’à voir les chiffres. La conversion des éleveurs de vaches laitières est fluctuante et un développement de l’ordre de 30% est attendu d’ici 2018 dans le secteur du lait bio. « Parfois, j’ai des demandes pour simplement dessiner et élaborer un plan de jardin. Mais quand je réalise, je travaille en local. Avec un créateur de rosiers ou une productrice de graines et plantes sauvages. Ce que j’aime bien faire aussi, c’est de travailler avec les semis. Les gens ont envie de mettre la main à la patte, on garde donc des coins pour les récupérer les graines et les replanter. Les gens demandent des jardins vivants avec un éco-système qui va intégrer les insectes, etc. », déclare-t-elle. Le geste écologique est donc important et se développe petit à petit, à des échelles différentes.
« Parfois, j’ai des demandes pour simplement dessiner et élaborer un plan de jardin. Mais quand je réalise, je travaille en local. Avec un créateur de rosiers ou une productrice de graines et plantes sauvages. Ce que j’aime bien faire aussi, c’est de travailler avec les semis. Les gens ont envie de mettre la main à la patte, on garde donc des coins pour les récupérer les graines et les replanter. Les gens demandent des jardins vivants avec un éco-système qui va intégrer les insectes, etc. », déclare-t-elle. Le geste écologique est donc important et se développe petit à petit, à des échelles différentes.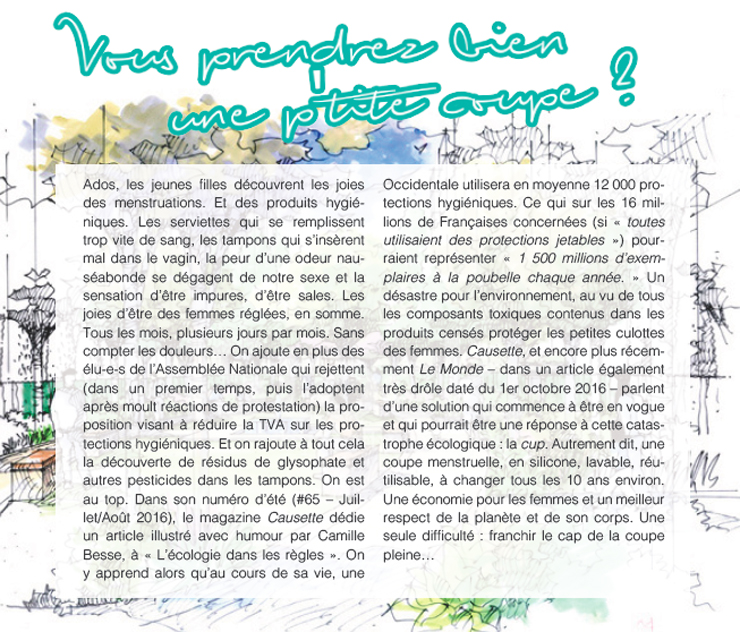
 Maintenant notre enjeu c’est de mettre les gens autour de la table pour créer des passerelles. C’est ce qu’on essaye de faire avec La Belle Déchette et notamment l’étude-action que l’on a lancé début septembre. Au premier comité de pilotage, il y avait autour de la table les partenaires et les financeurs de tous les domaines. C’était très innovant. C’est de la co-construction.
Maintenant notre enjeu c’est de mettre les gens autour de la table pour créer des passerelles. C’est ce qu’on essaye de faire avec La Belle Déchette et notamment l’étude-action que l’on a lancé début septembre. Au premier comité de pilotage, il y avait autour de la table les partenaires et les financeurs de tous les domaines. C’était très innovant. C’est de la co-construction.
 Son dernier film en tant que réalisatrice a été un succès. Sorti en 2015, La tête haute a ouvert la 68e édition du festival de Cannes l’an dernier, a fait remporté des César à Rod Paradot et Benoit Magimel et a été fortement salué par la critique.
Son dernier film en tant que réalisatrice a été un succès. Sorti en 2015, La tête haute a ouvert la 68e édition du festival de Cannes l’an dernier, a fait remporté des César à Rod Paradot et Benoit Magimel et a été fortement salué par la critique. « D’abord, mon père, aujourd’hui décédé, était chirurgien cardiaque ; or, il est précisément question de maladie cardiaque dans l’affaire du Mediator (l’autorisation de la mise en vente sur le marché a été suspendue par l’Agence du médicament en raison de sa toxicité avec risque avéré de vulvopathies susceptibles d’entrainer la mort, ce qui a d’ailleurs été le cas en France, ndlr). Mais surtout, il était très remonté contre l’industrie pharmaceutique et ses lobbies. On en parlait souvent chez nous. C’est pour ça que je lui dédie ce film : c’était un homme d’une grande intégrité, très à cheval sur la déontologie ; des valeurs que j’ai retrouvées chez le Dr Irène Frachon. »
« D’abord, mon père, aujourd’hui décédé, était chirurgien cardiaque ; or, il est précisément question de maladie cardiaque dans l’affaire du Mediator (l’autorisation de la mise en vente sur le marché a été suspendue par l’Agence du médicament en raison de sa toxicité avec risque avéré de vulvopathies susceptibles d’entrainer la mort, ce qui a d’ailleurs été le cas en France, ndlr). Mais surtout, il était très remonté contre l’industrie pharmaceutique et ses lobbies. On en parlait souvent chez nous. C’est pour ça que je lui dédie ce film : c’était un homme d’une grande intégrité, très à cheval sur la déontologie ; des valeurs que j’ai retrouvées chez le Dr Irène Frachon. »
 À la lecture du synopsis, l’histoire peut rebuter. C’est sans compter sur le talent de la réalisatrice Katell Quillévéré, qui réunit ici un joli casting, composé entre autre de Tahar Rahim, Emmanuelle Seignier, Bouli Lanners, Anne Dorval, Kool Shen ou encore Alice Taglioni et Alice de Lencquesaing. Tou-te-s dans des seconds rôles.
À la lecture du synopsis, l’histoire peut rebuter. C’est sans compter sur le talent de la réalisatrice Katell Quillévéré, qui réunit ici un joli casting, composé entre autre de Tahar Rahim, Emmanuelle Seignier, Bouli Lanners, Anne Dorval, Kool Shen ou encore Alice Taglioni et Alice de Lencquesaing. Tou-te-s dans des seconds rôles.