Célian Ramis
Danse : Puissance waack


Los Angeles. Bienvenue dans les années 70. Homosexuels afro-latinos, faites-vous discrets. Voire invisibles. Le mépris et les discriminations rodent encore, même si les premières gay prides apparaissent, les mentalités sont loin d’avoir évolué.
Dans les clubs, à l’abri des regards de celles et ceux qui voient en vous de la perversité, vous pourrez waacker à volonté. Ici, tout est permis. Sous les feux des projecteurs et les flashs des photographes ébahis, vous diffusez de la liberté, du glamour et de la sensualité. Vous dansez et vous êtes magnifiques !
Si on parle d’élégance à la française, on doit bien avouer malgré tout que le waacking n’est pas très répandu dans l’Hexagone. Pourtant, nous en avons des waackeuses d’excellence, dignes héritières de cette danse afro-américaine gay, inspirée par les stars du cinéma hollywoodien des années 50. Changement d’époque, changement de contexte, changement de pays, les ambassadrices d’aujourd’hui tendent à montrer que le waacking peut aussi rimer avec la francophonie. Rencontre avec Princess Madoki et le collectif dont elle fait partie, Ma Dame Paris, dont l’objectif est de faire connaître cette danse, la démocratiser, en montrant comment chacun-e peut se l’approprier, sans jamais en oublier son origine.
« Le waackeur, il aime être beau, il aime être vu, il est le premier personnage du film, pas autre chose, on ne filme que lui. Mais y a un truc que je ne vous ai pas dit. Ça fait super mal au bras ! », rigole Josépha Madoki. Dimanche 10 mars, à partir de 16h, elle mène le Bal Waack sur la scène de L’Étage du Liberté, à Rennes.
 Invitée par Le Triangle, elle est entourée de deux assistantes : Sonia Bel Hadj Brahim, membre du collectif Ma Dame Paris, et Viola Chiarini, fondatrice du collectif Mad(e) in Waack. Face à elles, une foule pailletée et strassée – avec modération – de femmes et d’hommes suspendu-e-s aux funky steps de Princess Madoki, qui décompose les pas, sans musique dans un premier temps.
Invitée par Le Triangle, elle est entourée de deux assistantes : Sonia Bel Hadj Brahim, membre du collectif Ma Dame Paris, et Viola Chiarini, fondatrice du collectif Mad(e) in Waack. Face à elles, une foule pailletée et strassée – avec modération – de femmes et d’hommes suspendu-e-s aux funky steps de Princess Madoki, qui décompose les pas, sans musique dans un premier temps.
Elle avait raison, les douleurs se font ressentir rapidement, les mouvements de bras étant à la base de la danse : « C’est très important en waacking, la posture du corps. On est fier-e-s et on a la tête haute. La traduction de « waack », c’est « tu crains », et pour le dire, on fait un geste de la main, vous savez quand on lève la main en l’air et on envoie balader quelqu’un ?! À partir de là, on peut freestyler, s’amuser ! On va vous mettre un son et vous allez improviser sur le geste du jeté. »
DRAMA, DRAMA, DRAMA…
Du disco et du funk pour les accompagner « et un peu de drama ». Parce que le waacking, c’est aussi basé sur le punking : « On raconte une histoire, on est un personnage de film, on rajoute du drama, de l’émotion, on en fait des caisses ! » Le public se prend facilement au jeu, entre dans la peau d’une grande vedette de cinéma digne des années 50 et jette les bras à la figure des voisin-e-s. Façon de parler, évidemment… Puis d’un personnage, on passe à un autre.
On apprend à manier le jeté mais aussi le rattrapé. On fait semblant de lancer des dés en l’air ou par terre, on freestyle avec des partenaires d’une chanson. « On adore se prendre pour des stars, nous, les waackeurs. Imaginez, vous êtes à Los Angeles, Hollywood. Vous tournez avec Dicaprio. Naturellement, il a le second rôle et vous avez le premier. Y a des caméras braquées vers vous, des photographes, vous êtes belles, vous êtes beaux. Vous êtes sur-e-s de vous. Vous prenez la pose de star, vous croisez les bras, vous jetez un regard de star… », détaille Princess Madoki, tout en simulant des attitudes de diva afin d’expliquer ce qu’est le posing.
Derrière elle, s’affichent des photos de celles (et ceux) qui ont inspiré la communauté à l’initiative de cette danse : Greta Garbo, Audrey Hepburn, Fred Astaire ou encore Marilyn Monroe. De profil avec la jambe légèrement pliée, la tête droite, le menton levé et l’arrogance faussement naturelle, le sourire franc ou le regard rempli de sensualité, la grâce de ces célébrités est travaillée, façonnée, fabriquée et figée à jamais.

« À vous de créer vos propres poses », lance la meneuse avant de proposer de terminer en beauté par un soul train (couloir formé par les danseurs-seuses qui passent dedans deux par deux pour danser, encouragé-e-s par les autres participant-e-s), en référence à l’émission Soul train, diffusée aux Etats-Unis de 1971 à 2006.
C’est grâce à ce show télévisé que le waacking a pu être mis en lumière, mais aussi grâce à des personnalités influentes de la soul comme Diana Ross. En un peu plus de deux heures, Josépha, Sonia et Viola font la démonstration du potentiel et de l’esprit développés par le waacking, sans pouvoir explorer tous les recoins de l’étendue de cette danse.
AVANT DE WAACKER
Cette danse, elle ne la connaissait pas avant les années 2005/2006. Mais Josépha Madoki a toujours dansé. D’aussi loin que ses souvenirs remontent et d’après les dires de sa famille, dès qu’elle a pu, elle a dansé. Vers 8 ou 9 ans, elle prend ses premiers cours et montre un goût certain pour le mouvement. Dans son quartier, elle se forme au modern jazz et à la danse africaine.
« À 16/17 ans, j’ai découvert le hip hop, j’ai eu un coup de foudre. J’ai dit : c’est ça que je veux faire de ma vie. », se rappelle la danseuse qui a l’air de revivre instantanément ce déclic. À Lille, là où elle grandit, son professeur de danse souhaite créer une compagnie semi professionnelle et la faire monter sur scène pour les spectacles.
 « Je voulais vraiment en faire mon métier et mes parents ont dit non. J’ai continué mes études de droit, ça faisait la fierté de mes parents. Mais la danse était plus forte. J’allais à l’université la semaine et je partais en tournée régionale le week-end. J’avais envie de bouger, j’avais envie d’être sur scène. J’ai voulu faire une école de danse à Paris qui forme au milieu du spectacle. Mes parents ont redit non. Mon père est très carré. Mais ce qu’il n’avait pas compris, c’est que ce n’était pas une question. », souligne Josépha qui va alors se démener pour trouver un travail et un logement dans la capitale.
« Je voulais vraiment en faire mon métier et mes parents ont dit non. J’ai continué mes études de droit, ça faisait la fierté de mes parents. Mais la danse était plus forte. J’allais à l’université la semaine et je partais en tournée régionale le week-end. J’avais envie de bouger, j’avais envie d’être sur scène. J’ai voulu faire une école de danse à Paris qui forme au milieu du spectacle. Mes parents ont redit non. Mon père est très carré. Mais ce qu’il n’avait pas compris, c’est que ce n’était pas une question. », souligne Josépha qui va alors se démener pour trouver un travail et un logement dans la capitale.
À la fin des vacances, elle prend sa valise et part faire ce qu’elle a envie de faire : « C’était un stress parce que mon père m’a dit « Si tu pars, tu ne reviens plus ». Il faut être déterminée dans son choix et sa volonté. J’étais certes la meilleure danseuse de la région mais à Paris, il fallait que je me fasse ma place. »
Là encore, elle témoigne d’une grande volonté et d’une détermination d’acier. Et elle remercie ses parents de lui avoir mis la pression. « Sur une centaine d’auditions, tu en rates 80. Beaucoup de danseuses lâchent. Moi, la voix de mon père résonnait dans ma tête. À l’Académie internationale de danse, j’ai reçu une formation en danse contemporaine, danse classique, jazz, etc. », poursuit-elle, en précisant :
« Quand tu es une femme dans le milieu de la danse, tu dois être pluridisciplinaire. Cette formation m’a permis d’apprendre d’autres choses et de faire autre chose de mon corps. Je suis devenue danseuse professionnelle à ce moment-là. »
DE GRANDES COLLABORATIONS
Elle collabore avec des chorégraphes comme Marguerite M’Boulé et Ousmane Babson Sy – chorégraphe des talentueuses Paradoxsal et membre du Collectif Fair(e) qui dirige aujourd’hui le Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne – avec qui elle explore une gestuelle hip hop.
Mais aussi avec James Carles dans Danses et Continents Noirs, projet reprenant les répertoires des danseuses afro-américaines du début du XXe siècle ou encore, côté plus contemporain, avec Sylvain Groud dans Elles, pièce chorégraphique pour cinq danseuses hip hop.
Plusieurs années et une multitude d’expériences plus tard, Josépha Madoki monte son propre solo, Mes mots sont tes maux, dans lequel elle dresse le portrait des femmes meurtries dans leur chair à cause de l’excision subie et contrainte et dénonce ici cette pratique, les douleurs physiques et les souffrances de l’âme infligées.
Entre temps, elle a décroché un gros contrat dans la comédie musicale Kirikou et Karaba, mise en scène et chorégraphiée par Wayne Mc Gregor. Trois mois au Casino de Paris, trois ans de tournée internationale :
« J’ai goûté à la scène tous les soirs, c’était super intense. J’ai invité mes parents. La scénographie était magnifique et c’était un très beau spectacle visuel. Leur vision a changé, ils ont vu la danse comme un vrai travail. Ils ont vu le côté professionnel. Ils ont vu qu’il n’y avait rien de dégradant. C’était ça, la peur qu’ils avaient. »
C’est là que son père va lui dire pour la première fois qu’elle danse comme son arrière-grand-mère. La meilleure danseuse de son village au Congo, pays natal de Josépha. Pour elle, ces propos font sens. Tout comme le fera la rencontre avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui qui en 2013 organise une audition à Londres pour son nouveau spectacle tiré de la pièce de théâtre d’Aimé Césaire Une saison au Congo.

Au-delà de l’enthousiasme provoqué par l’éventualité d’une collaboration avec ce professionnel qui la subjugue, elle explique qu’il s’agit là de sa propre histoire, celle de sa famille. Elle est prise et elle réitère l’expérience dans Babel, de ce même chorégraphe qui la fera également danser dans le clip de la chanson « Apeshit » de Beyonce et Jay-Z, tourné au Louvre. Elle est la seule danseuse française dans le groupe et se paye le luxe d’un solo de waacking devant La Joconde.
RENCONTRE AVEC LE WAACKING
Depuis 2005, Josépha Madoki poursuit son rêve d’adolescente, en étant danseuse professionnelle. De battles hip hop en compagnies, de cours en chorégraphes pluridisciplinaires, elle fige son regard sur une danseuse japonaise qui pratique le waacking.
Cette danseuse, c’est Yoshie, une figure importante et renommée au Japon : « C’était trop beau, c’était trop bien ! Je ne savais pas ce que c’était mais je me suis renseignée sur elle et sur le waacking. » Nouvelle révélation pour la Lilloise qui aime apprendre et se nourrir de nouveautés.
Elle fait des stages à Paris, c’est la renaissance du waacking à cette époque mais en France, cette danse n’a jamais connu le grand essor. À cette époque également, Josépha doute de sa féminité.
« Je venais du hip hop, je n’avais pas encore exploré cette facette-là de moi. Et puis en 2012, je me suis lancée. Je suis allée à Los Angeles, à New York, rencontrer les waackeurs et je me suis aussi beaucoup entrainé toute seule. »
signale la danseuse qui fait encore une fois preuve de détermination dans sa volonté.
 Une détermination qui l’emmène l’année suivante en Suède pour participer à Street Star, un des plus grands événements mondiaux. Elle se qualifie pour la demi finale où elle doit y affronter la célèbre Yoshie. Celle qui a fait que tout a commencé pour elle : « Elle m’a inspirée, j’étais trop contente de danser avec elle. Tu vois, je dis danser avec elle et pas contre elle. J’étais sure de perdre mais j’étais trop contente. Et j’ai tellement bien dansé que j’ai gagné. J’ai perdu ensuite mais pour moi, c’était incroyable ! »
Une détermination qui l’emmène l’année suivante en Suède pour participer à Street Star, un des plus grands événements mondiaux. Elle se qualifie pour la demi finale où elle doit y affronter la célèbre Yoshie. Celle qui a fait que tout a commencé pour elle : « Elle m’a inspirée, j’étais trop contente de danser avec elle. Tu vois, je dis danser avec elle et pas contre elle. J’étais sure de perdre mais j’étais trop contente. Et j’ai tellement bien dansé que j’ai gagné. J’ai perdu ensuite mais pour moi, c’était incroyable ! »
Sa carrière prend son envol à cet instant précis. La vidéo de cette demi finale est vue par des centaines de milliers de personnes : « Les gens voulaient apprendre de moi, c’était fou ça pour moi ! » Son personnage, Princess Madoki, elle l’a créé en 2012 et en parle comme une espèce d’exutoire. Elle qui n’avait pas encore exploré sa féminité peut la pousser à son paroxysme dans le waacking.
Talons hauts, faux cils, des airs de diva, « on peut être une queen ou un king, tout est normal, tout le monde est perché dans son monde. » À la différence des battles hip hop dans lesquelles on performe, dans le waack, on s’interroge sur l’histoire que l’on raconte et on se donne « la possibilité de se réinventer ».
À L’ORIGINE
L’histoire de cette danse part de cette essence-là. « Le waacking est né dans les années 70 et est venu de la communauté gay afro-américaine et latino à Los Angeles. C’était une communauté discriminée à qui on disait « tu n’as pas le droit d’être là, tu n’as pas le droit d’exister ». Mais ce monde-là du cinéma hollywoodien, ils avaient envie de le toucher eux aussi et l’ont reproduit dans les clubs en partant du principe qu’ici on peut être qui on veut être. Beaucoup de danses naissent de frustrations. Ces espaces qu’ils ont créés étaient des lieux d’échange et de liberté. C’est une social dance le waacking ! », se passionne Josépha.
Aujourd’hui, elle puise dans l’esprit initial de cette danse mais insiste sur le fait que l’époque a changé, ainsi que le contexte, « et surtout, ce n’est pas le même pays. » La démarche est différente mais elle a en commun ce besoin de liberté, cette envie de se réinventer.
« En France, de manière générale, il ne faut pas trop en faire et il ne faut pas en dire trop. Le waacking permet la réappropriation. », souligne la waackeuse. Cela signifie la réappropriation de son corps qui ne doit pas être définie par les diktats :
« En tant que femmes, que femmes noires, que femmes racisées, on en est constamment assaillies de diktats au niveau du corps. En waacking, on voit tous les types de corps et personne ne va se juger. Tous les corps sont beaux, toutes les poses sont belles. C’est un espace de liberté ! »
C’est certainement ce qui fait la réussite du Bal Waack. Si personne n’a poussé l’habillement à l’extravagance, les touches argentées et pailletées ornent les hauts et les coiffures des participant-e-s qui, timides au départ, se laissent séduire et se prennent au jeu sans porter trop d’attention aux regards qui pourraient se poser sur leurs mouvements ou attitudes. Le lâcher prise semble imminent.
ESPACE DE MILITANTISME
Pour la danseuse et chorégraphe Ari de B, formée d’abord au hip hop et ensuite au voguing et au waacking, « c’est un détournement des codes de l’élégance parce que c’est une élégance qui n’est pas accessible. C’est l’élégance blanche, l’élégance riche, qui n’est pas celle des personnes qui incarnent le waacking. Du coup, c’est créer un espace nous aussi en tant que communauté queer, gay, racisée, où on peut se sentir exister et se sentir légitimes dans une élégance et une norme de beauté ou des normes de beauté qui seraient nôtres. Qu’on crée pour nous, par nous. »

Elle poursuit son interview, donnée à Nova en décembre 2017 : « Si on décale un peu le regard, ce qui est un peu le but justement de ma militance ou de mon activisme, de la façon de représenter la danse et dans la façon de me représenter dans la danse, on voit que l’élégance, la beauté et la classe, c’est ailleurs. Dans le waacking, les mouvements de mains, les mouvements de bras sont là pour raconter une histoire, pour attraper la lumière, dire « non ne me regarde mais si regarde moi ». Pour moi, danser, c’est me réapproprier mon corps, me réapproprier ma prise d’espace, c’est me réapproprier mon intérieur et je trouve que c’est vraiment un moyen de résilience, résistance. »
La puissance et la portée politique, on pourrait passer à côté en découvrant le waack d’un seul œil, pensant que cette danse véhicule finalement une forme de féminité caricaturale et mène à revêtir un masque d’hypocrisie, notamment quand on se réfère à l’écart entre l’image renvoyée par Marilyn Monroe et son vécu dans sa vie privée. Ce serait se fendre de la partie très engagée du waacking d’aujourd’hui, comme ont pu l’exprimer Ari de B et Princess Madoki.
Cette dernière, en plus de défendre la liberté impulsée et insufflée par cette discipline, milite pour la développer en France. « Avec d’autres danseuses avec qui on partage la même énergie et la même vision, on a fait le constat qu’on ne connaissait pas le waacking en France. On apparente ça à du voguing alors que c’est différent. On s’est alors dit qu’on allait s’associer pour faire connaître cette danse. On a alors monté le collectif Ma Dame Paris. », explique Josépha.
MA DAME PARIS, POUR WAACKER EN FRANÇAIS
Le trio se compose d’elle-même, de Sonia Bel Hadj Brahim et de Mounia Nassangar. Ensemble, elles créent un spectacle court, de moins de 8 minutes, intitulé Waackez-vous français ? pour répondre à cette dérangeante réflexion entendue à plusieurs reprises à l’étranger, visant à leur faire remarquer qu’elles étaient des françaises qui dansaient sur des paroles écrites et chantées en anglais.
Elles décident alors de danser sur des musiques exclusivement francophones pour en effet orienter une danse à travers laquelle le corps bouge en résonnance avec la musique et les mots. « Ça résonne sur notre waacking de danser sur notre langue maternelle. Ça fait évoluer notre danse. », analyse Princess Madoki. De cette version courte, elles ont gardé l’idée du répertoire francophone et ont réalisé une deuxième création, plus longue cette fois, appelée Oui, et vous ? pour répondre à la première. Comme un fil rouge.
Et c’est d’ailleurs de rouge qu’elles sont vêtues dans cette pièce présentée au Triangle le 1ermars, lors de deux représentations dans la même journée. Et ça commence fort. On est secoué-e-s d’emblée avec la célèbre chanson « Les nuits d’une demoiselle » de Colette Renard, parue en 1963.

« Ça frappe directement. Nous, on a aimé sa façon d’utiliser les mots, de jouer avec les mots et de parler de sexe. Alors, c’est un peu osé d’ouvrir le bal là-dessus mais ça démontre bien la richesse de la langue française et nous, on est fières d’être françaises. », sourit malicieusement Josépha qui pointe avec le même enthousiasme qu’elles font un pied de nez au cliché que l’on pourrait avoir du waacking :
« Comme c’est très féminisé, on nous attend sur le côté belles filles qui font des poses. On n’est pas rentrées dans un côté d’hypersensualité, on a justement intégré très rapidement un tableau froid et robotisé. »
Dans Oui, et vous ?, elles poussent le waacking dans une forme de théâtre chorégraphique et montrent comment à partir d’énergies différentes elles composent une histoire commune. Elles jouent avec les rythmes, effectuent des jeux de miroir, contrebalancent lâcher prise et contrôle, démontrent la puissance de cette danse et de l’étendue de ses possibilités, jusqu’à une forme de transe dans laquelle les mouvements sont tellement rapides et répétitifs que l’on ne distingue plus les doigts de leurs mains ni même leurs bras.
Puis survient le relâchement qui opère comme une descendante de désinhibants en fin de soirée ou en lendemain de fête. Trente minutes durant, elles témoignent du côté technique très exigeant de cette danse dans les arms control qu’elles confrontent à un côté très brut puisqu’elles poussent au maximum leurs capacités physiques et corporelles.
C’est une danse à découvrir le waacking, à observer mais surtout à tester. Elle peut être divertissante et légère mais aussi, forte d’une histoire qui ne s’est jamais terminée – les personnes LGBTIQ+ et les personnes racisées étant encore largement discriminées – politique et militante.
On peut d’ailleurs croiser les qualificatifs mais surtout on peut embrasser la liberté que waacker procure. Parce que laisser libre cours à sa féminité n’est pas toujours accepté, on est bien décidé-e-s à faire ce qu’il nous plait !



 Elles dansent dans un cercle, formé au sol à la craie et délimité au niveau des points cardinaux par leurs chaussures. Elles alternent partitions synchronisées, solis et moments à deux. Tandis que Cécile danse, Morgane sort du cercle, passe derrière les rideaux, traverse le fond de la scène – à l’endroit où seront situés les musiciens – revient. Elle prend ses marques. Cécile jette un coup d’œil de temps en temps pour les parties synchronisées.
Elles dansent dans un cercle, formé au sol à la craie et délimité au niveau des points cardinaux par leurs chaussures. Elles alternent partitions synchronisées, solis et moments à deux. Tandis que Cécile danse, Morgane sort du cercle, passe derrière les rideaux, traverse le fond de la scène – à l’endroit où seront situés les musiciens – revient. Elle prend ses marques. Cécile jette un coup d’œil de temps en temps pour les parties synchronisées. Cécile poursuit, expliquant son petit chaperon rouge à elle, différent de celui interprété par Juliette Guillevin dans le quatuor, sans être moins intéressant et complet : « En fait, je suis partie d’une phrase qui dit que c’est la première racaille de l’histoire. Et ouais, c’est vrai, c’est ça. Et là, je dois donc faire une petite fille qui se construit tout en étant une adulte qui le raconte. Je me réimprègne en fait de l’état de petite fille, qui prend la confiance et y va ! Je revis ça comme dans un souvenir. »
Cécile poursuit, expliquant son petit chaperon rouge à elle, différent de celui interprété par Juliette Guillevin dans le quatuor, sans être moins intéressant et complet : « En fait, je suis partie d’une phrase qui dit que c’est la première racaille de l’histoire. Et ouais, c’est vrai, c’est ça. Et là, je dois donc faire une petite fille qui se construit tout en étant une adulte qui le raconte. Je me réimprègne en fait de l’état de petite fille, qui prend la confiance et y va ! Je revis ça comme dans un souvenir. »


 Chacune se concentre, déambule, tâtonne, effectue son mouvement en boucle jusqu’à saisir l’esprit de son personnage avant d’interpréter les solos en duo : « Allez on fait un duo petit chaperon – grand-mère. Dans ce duo, le petit chaperon doit dominer la grand-mère, on inversera après. »
Chacune se concentre, déambule, tâtonne, effectue son mouvement en boucle jusqu’à saisir l’esprit de son personnage avant d’interpréter les solos en duo : « Allez on fait un duo petit chaperon – grand-mère. Dans ce duo, le petit chaperon doit dominer la grand-mère, on inversera après. »


 « La peur du loup » revient dans les entretiens avec Morgane, Delphine, Pauline et Juliette. Aucune des quatre en occulte l’image. Si le reste du conte ne retient pas particulièrement l’attention des petit-e-s devenu-e-s grand-e-s – mais qui pourtant s’inscrit bel et bien l’inconscient collectif – cette partie en revanche les marque au fer rouge.
« La peur du loup » revient dans les entretiens avec Morgane, Delphine, Pauline et Juliette. Aucune des quatre en occulte l’image. Si le reste du conte ne retient pas particulièrement l’attention des petit-e-s devenu-e-s grand-e-s – mais qui pourtant s’inscrit bel et bien l’inconscient collectif – cette partie en revanche les marque au fer rouge.


 Exit le manichéen et le binaire. Sous la forme d’un solo amateur (la conteuse), d’un duo professionnel (le petit chaperon rouge et Morgane dans les 3 rôles : forêt-grand-mère-loup) et d’un quatuor amateur, la compagnie Erébé Kouliballets aime explorer la complexité, la modernité, le mélange et le métissage, l’équilibre du féminin et du masculin. Pour tendre vers plus d’authenticité et de liberté. On admire la capacité à le faire sans lisser ou édulcorer la réalité.
Exit le manichéen et le binaire. Sous la forme d’un solo amateur (la conteuse), d’un duo professionnel (le petit chaperon rouge et Morgane dans les 3 rôles : forêt-grand-mère-loup) et d’un quatuor amateur, la compagnie Erébé Kouliballets aime explorer la complexité, la modernité, le mélange et le métissage, l’équilibre du féminin et du masculin. Pour tendre vers plus d’authenticité et de liberté. On admire la capacité à le faire sans lisser ou édulcorer la réalité.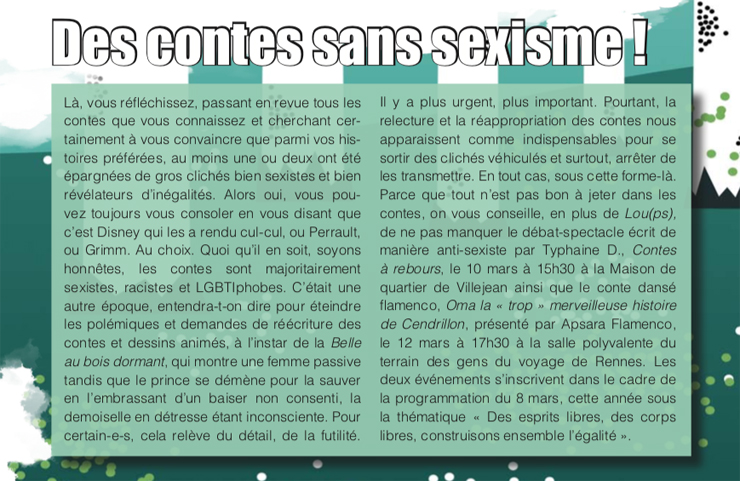


 Toute de noir vêtue, elle court doucement en arc de cercle. D’un point A à un point B, elle va et elle vient. Sans cesse. Ses pieds nus foulent à petit pas la pelouse et s’emballent follement, au même titre que son souffle ébranlé qui se fait de plus en plus court, de plus en plus rapide et de plus en plus bruyant. Le regard apeuré, elle cherche à échapper à la laisse qui la retient.
Toute de noir vêtue, elle court doucement en arc de cercle. D’un point A à un point B, elle va et elle vient. Sans cesse. Ses pieds nus foulent à petit pas la pelouse et s’emballent follement, au même titre que son souffle ébranlé qui se fait de plus en plus court, de plus en plus rapide et de plus en plus bruyant. Le regard apeuré, elle cherche à échapper à la laisse qui la retient. Elle explore pour la première fois la performance publique à Lahore, au Pakistan, où elle intègre la Beaconhouse National University, après avoir étudié les Beaux Arts à Kaboul.
Elle explore pour la première fois la performance publique à Lahore, au Pakistan, où elle intègre la Beaconhouse National University, après avoir étudié les Beaux Arts à Kaboul. L’essence du projet de l’édition 2018, tel qu’elle est décrite sur le site de Danse à tous les étages, est claire : « Danse, photo, musique… seront autant de supports pour permettre l’échange et le tissage de liens au sein du groupe. À partir de la poésie de ces corps métissés, « Déplaces » saura se nourrir des matières, des paroles, des gestes échangés pour construire un propos chorégraphique. "Pour le projet Déplaces, nous proposons de nous rencontrer autour des rituels du quotidien. La cuisine, les repas, la toilette, les soins du corps, l'investissement de l'espace public, le repos, etc..., mais aussi les rituels qui rythment une année tels que les anniversaires, les célébrations diverses, les évènements comme la mort, ou la naissance. À travers eux, nous chercherons à trouver ce qui est commun, et ce qui est spécifique à chacun (…)." »
L’essence du projet de l’édition 2018, tel qu’elle est décrite sur le site de Danse à tous les étages, est claire : « Danse, photo, musique… seront autant de supports pour permettre l’échange et le tissage de liens au sein du groupe. À partir de la poésie de ces corps métissés, « Déplaces » saura se nourrir des matières, des paroles, des gestes échangés pour construire un propos chorégraphique. "Pour le projet Déplaces, nous proposons de nous rencontrer autour des rituels du quotidien. La cuisine, les repas, la toilette, les soins du corps, l'investissement de l'espace public, le repos, etc..., mais aussi les rituels qui rythment une année tels que les anniversaires, les célébrations diverses, les évènements comme la mort, ou la naissance. À travers eux, nous chercherons à trouver ce qui est commun, et ce qui est spécifique à chacun (…)." »



 À base de pigments naturels de couleur, de pâte de riz et de chaux, les peintures faciales peuvent demander plusieurs heures de préparation. Parce qu’il en va là de la symbolique des personnages. Sur le tapis tressé voisin, la chorégraphe Brigitte Chataignier, assise en tailleur, écouteurs fixés aux oreilles, se concentre sur les mouvements qu’elle va devoir effectuer.
À base de pigments naturels de couleur, de pâte de riz et de chaux, les peintures faciales peuvent demander plusieurs heures de préparation. Parce qu’il en va là de la symbolique des personnages. Sur le tapis tressé voisin, la chorégraphe Brigitte Chataignier, assise en tailleur, écouteurs fixés aux oreilles, se concentre sur les mouvements qu’elle va devoir effectuer.
 Exceptions faites pour les femmes étrangères, comme nous le dira Brigitte Chataignier lors de l’atelier qu’elle animait avec Djeya Lestrehan, au Triangle, dans l’après-midi du 27 janvier.
Exceptions faites pour les femmes étrangères, comme nous le dira Brigitte Chataignier lors de l’atelier qu’elle animait avec Djeya Lestrehan, au Triangle, dans l’après-midi du 27 janvier.
 Autre code qui sert de référence au public : le maquillage. On reconnaitra la valeur d’un personnage à la couleur prédominante de son visage. Le vert pour les personnages nobles et vertueux, le vert et le rouge pour les personnages ambivalents (héroïques mais avec un ego surdimensionné), le noir pour les chasseurs cruels et sauvages, le rouge pour les démons, le jaune pour les personnages féminins.
Autre code qui sert de référence au public : le maquillage. On reconnaitra la valeur d’un personnage à la couleur prédominante de son visage. Le vert pour les personnages nobles et vertueux, le vert et le rouge pour les personnages ambivalents (héroïques mais avec un ego surdimensionné), le noir pour les chasseurs cruels et sauvages, le rouge pour les démons, le jaune pour les personnages féminins.
 « Ça demande beaucoup de force mais si elle arrive à un certain niveau, oui, c’est possible. Mais il y en a très peu. On peut accéder à tout si on assume ce que l’on fait. Si on sert l’art, il n’y aura pas de problème. Les femmes en Inde sont très respectées dans ce milieu-là mais après, il faut avoir envie de se retrouver seule au milieu uniquement d’hommes. Faut être bien dans ces baskets, ce n’est pas évident… »
« Ça demande beaucoup de force mais si elle arrive à un certain niveau, oui, c’est possible. Mais il y en a très peu. On peut accéder à tout si on assume ce que l’on fait. Si on sert l’art, il n’y aura pas de problème. Les femmes en Inde sont très respectées dans ce milieu-là mais après, il faut avoir envie de se retrouver seule au milieu uniquement d’hommes. Faut être bien dans ces baskets, ce n’est pas évident… »



 Le spectacle s’articule autour de deux fantasmes. Celui indéterminé de la femme nue peinte par Hopper et celui de Perrine Valli. Sans oublier que le désir peut avoir plusieurs facettes, la chorégraphe fait un choix :
Le spectacle s’articule autour de deux fantasmes. Celui indéterminé de la femme nue peinte par Hopper et celui de Perrine Valli. Sans oublier que le désir peut avoir plusieurs facettes, la chorégraphe fait un choix : Un phénomène qui n’a pas échappé à la Franco-Suisse : « Pour moi c’est vraiment banal, d’autant que j’ai grandi à Aix-en-Provence. Quand j’étais adolescente, tout le monde faisait seins nus sur les plages. Mais il y a un changement, qui est grave je pense. [...] Ça m’a vraiment marqué quand j’étais en Corse il y a quelques années. Pour moi il était clair que j’allais faire seins nus. Je n’aime pas avoir les marques et le maillot mouillé sur moi. Et puis au fur et à mesure des jours, je me sentais de moins en moins à l’aise, il y a comme une autocensure qui s’est mise en place [...] Pour nous les danseurs, ce n’est rien, mais en fait voilà, d’un coup cette expérience à la plage m’a fait dire que c’est peut-être important qu’on continue à dire que ça devrait être rien. »
Un phénomène qui n’a pas échappé à la Franco-Suisse : « Pour moi c’est vraiment banal, d’autant que j’ai grandi à Aix-en-Provence. Quand j’étais adolescente, tout le monde faisait seins nus sur les plages. Mais il y a un changement, qui est grave je pense. [...] Ça m’a vraiment marqué quand j’étais en Corse il y a quelques années. Pour moi il était clair que j’allais faire seins nus. Je n’aime pas avoir les marques et le maillot mouillé sur moi. Et puis au fur et à mesure des jours, je me sentais de moins en moins à l’aise, il y a comme une autocensure qui s’est mise en place [...] Pour nous les danseurs, ce n’est rien, mais en fait voilà, d’un coup cette expérience à la plage m’a fait dire que c’est peut-être important qu’on continue à dire que ça devrait être rien. »

 Au cours d’un travail de répertoire, elles sont amenées à reprendre un duo de Miguel Pereira : « On ne se connaissait pas plus que ça, on n’avait pas particulièrement d’atomes crochus, du coup, j’étais un peu surprise qu’Alina me propose de travailler ensemble. Et en fait, c’était bien comme rencontre parce que le duo racontait justement l’histoire de deux personnes qui veulent être une seule et même personne. Il fallait en fait faire un solo à deux. »
Au cours d’un travail de répertoire, elles sont amenées à reprendre un duo de Miguel Pereira : « On ne se connaissait pas plus que ça, on n’avait pas particulièrement d’atomes crochus, du coup, j’étais un peu surprise qu’Alina me propose de travailler ensemble. Et en fait, c’était bien comme rencontre parce que le duo racontait justement l’histoire de deux personnes qui veulent être une seule et même personne. Il fallait en fait faire un solo à deux. » « C’est une vraie séparation mais sans se séparer complètement. C’est un peu schizophrénique en fait ! », plaisante Alina Bilokon. Parce qu’elles ont au fil des années et des expériences développé un langage commun, elles ont éprouvé l’envie de créer chacune leur solo. « Sur TYJ, ça a été compliqué de collaborer, on a eu quelques difficultés à communiquer. On se l’a dit spontanément et ça s’est fait très naturellement. », souligne Léa Rault.
« C’est une vraie séparation mais sans se séparer complètement. C’est un peu schizophrénique en fait ! », plaisante Alina Bilokon. Parce qu’elles ont au fil des années et des expériences développé un langage commun, elles ont éprouvé l’envie de créer chacune leur solo. « Sur TYJ, ça a été compliqué de collaborer, on a eu quelques difficultés à communiquer. On se l’a dit spontanément et ça s’est fait très naturellement. », souligne Léa Rault. « Ça souligne assez bien le rapport que j’ai au temps. Prendre le temps, ça n’existe pas. On passe notre temps à entendre les gens se plaindre parce qu’ils n’ont le temps de rien ou dire « je vais lire ce livre quand j’aurais le temps », « je ferais ça quand j’aurais le temps mais je l’ai jamais ». Il faut accepter que le temps court ! En Ukraine, on dit qu’on se repose quand on est mort ! », rigole Alina Bilokon.
« Ça souligne assez bien le rapport que j’ai au temps. Prendre le temps, ça n’existe pas. On passe notre temps à entendre les gens se plaindre parce qu’ils n’ont le temps de rien ou dire « je vais lire ce livre quand j’aurais le temps », « je ferais ça quand j’aurais le temps mais je l’ai jamais ». Il faut accepter que le temps court ! En Ukraine, on dit qu’on se repose quand on est mort ! », rigole Alina Bilokon. Dans les prochaines semaines, Alina Bilokon et Léa Rault vont s’atteler au démarrage de leur nouvelle création (prévue pour janvier 2019), qui réunira le duo, ainsi que Jérémy Rouault et Laura Perrudin, harpiste rennaise remarquée du public lors du festival I’m from Rennes et à découvrir à l’Aire Libre (St Jacques de la Lande), pendant les Transmusicales 2017.
Dans les prochaines semaines, Alina Bilokon et Léa Rault vont s’atteler au démarrage de leur nouvelle création (prévue pour janvier 2019), qui réunira le duo, ainsi que Jérémy Rouault et Laura Perrudin, harpiste rennaise remarquée du public lors du festival I’m from Rennes et à découvrir à l’Aire Libre (St Jacques de la Lande), pendant les Transmusicales 2017.

 Dans la salle, environ 12 danseuses/seurs sont allongé-e-s sur le dos, sur un tapis de sol, un plaid sur les jambes pour la plupart. La voix de Nathalie Schulmann, danseuse contemporaine, professeure de danse et analyste du corps dans les mouvements dansés, les guide pour les inviter à s’intéresser au poids de la tête se déposant sur le ballon placé à l’arrière de leur crâne. Mais aussi à s’aider de leur respiration et de la sonorisation du souffle.
Dans la salle, environ 12 danseuses/seurs sont allongé-e-s sur le dos, sur un tapis de sol, un plaid sur les jambes pour la plupart. La voix de Nathalie Schulmann, danseuse contemporaine, professeure de danse et analyste du corps dans les mouvements dansés, les guide pour les inviter à s’intéresser au poids de la tête se déposant sur le ballon placé à l’arrière de leur crâne. Mais aussi à s’aider de leur respiration et de la sonorisation du souffle. Pour elle, prendre soin est un acte fort aujourd’hui. Car cela n’est pas dans la culture des professionnel-le-s de la danse. « Le danseur prend soin de son corps quand il est cassé ou vieux. Le besoin d’équilibre, de se recentrer, de trouver des moteurs autrement, de se mettre en disponibilité émerge cependant chez les danseurs. Ce ne sera jamais tout le monde mais c’est de plus en plus présent. », souligne-t-elle.
Pour elle, prendre soin est un acte fort aujourd’hui. Car cela n’est pas dans la culture des professionnel-le-s de la danse. « Le danseur prend soin de son corps quand il est cassé ou vieux. Le besoin d’équilibre, de se recentrer, de trouver des moteurs autrement, de se mettre en disponibilité émerge cependant chez les danseurs. Ce ne sera jamais tout le monde mais c’est de plus en plus présent. », souligne-t-elle. Elle poursuit : « J’aime proposer un autre corps que le sien. Parce que ces séances sont collectives, la femme peut penser à son vagin mais va aussi se projeter dans le corps d’un homme présent dans la salle. On est entre des corps. Cette transposition des corps m’intéresse davantage que les codifications du corps féminin et masculin, qui n’est qu’une catégorisation comme une autre. J’ai aussi construit une séance chorégraphique où on passait des organes sexuels féminins aux organes sexuels masculins constamment, au point d’en perdre la notion du masculin et du féminin, on est alors obligé d’inventer un autre corps qui n’existe pas encore. » Et finalement, le corps n’a jamais été aussi réel que lorsque cette fiction nous a permis de le ressentir, de l’imaginer et de l’envisager.
Elle poursuit : « J’aime proposer un autre corps que le sien. Parce que ces séances sont collectives, la femme peut penser à son vagin mais va aussi se projeter dans le corps d’un homme présent dans la salle. On est entre des corps. Cette transposition des corps m’intéresse davantage que les codifications du corps féminin et masculin, qui n’est qu’une catégorisation comme une autre. J’ai aussi construit une séance chorégraphique où on passait des organes sexuels féminins aux organes sexuels masculins constamment, au point d’en perdre la notion du masculin et du féminin, on est alors obligé d’inventer un autre corps qui n’existe pas encore. » Et finalement, le corps n’a jamais été aussi réel que lorsque cette fiction nous a permis de le ressentir, de l’imaginer et de l’envisager.




 Elles pourraient être des nymphes. Des divinités de la Nature. Autour d’une bûche qui pleure sa souffrance ou son angoisse, elles tentent d’apaiser la source de ses cris. Leur langage est animal, primitif. Leur danse est légère et virevoltante.
Elles pourraient être des nymphes. Des divinités de la Nature. Autour d’une bûche qui pleure sa souffrance ou son angoisse, elles tentent d’apaiser la source de ses cris. Leur langage est animal, primitif. Leur danse est légère et virevoltante. « Qu’est-ce que c’est le sauvage au féminin ? », s’interroge il y a 3 ans Sarah Crépin, chorégraphe et interprète pour La BaZooka. À cette époque, elle est intriguée par la relation entre le féminin et le sauvage, notion machinalement – et injustement - imaginée au masculin.
« Qu’est-ce que c’est le sauvage au féminin ? », s’interroge il y a 3 ans Sarah Crépin, chorégraphe et interprète pour La BaZooka. À cette époque, elle est intriguée par la relation entre le féminin et le sauvage, notion machinalement – et injustement - imaginée au masculin. Le metteur en scène la rejoint : « On ne veut pas figer les choses. On essaye d’agir de manière très libre. Par association d’idées, avec beaucoup d’improvisation et de l’évolution au fil des répétitions. C’est aussi un travail de transmission. On voit ce qui s’adapte aux corps des interprètes, ce qui se passe à travers la puissance du groupe et comment cela résiste au temps et à l’accueil des enfants selon les représentations. »
Le metteur en scène la rejoint : « On ne veut pas figer les choses. On essaye d’agir de manière très libre. Par association d’idées, avec beaucoup d’improvisation et de l’évolution au fil des répétitions. C’est aussi un travail de transmission. On voit ce qui s’adapte aux corps des interprètes, ce qui se passe à travers la puissance du groupe et comment cela résiste au temps et à l’accueil des enfants selon les représentations. »