
Voilà l’idée que prône la culture du hip-hop, selon les artistes interviewées. Exprimer et assumer son individualité, sans la pression de la conformité. La scène devient alors un espace d’expression dans lequel se croisent différents corps et langages.
Du 28 janvier au 13 février, plusieurs créations, proposées à Rennes dans le cadre du festival Waterproof porté par le Triangle et le collectif FAIR-E, ont suscité notre curiosité de par les engagements et les réflexions qui s’en dégageaient. Féminités, masculinités, intimités, singularités, recherche de sa place dans le collectif, fragilités et puissances.
Du popping à la danse contemporaine, en passant par le locking, le voguing, la dance house et le waacking, les multiples facettes et identités d’une culture riche de son histoire et de son évolution ont ébranlé notre vision jusqu’ici trop réductrice du hip-hop français.
Sur un rectangle blanc entouré de lumières pointées vers le centre, sept danseuses soutiennent un regard de guerrières. Elles s’observent et se tournent autour. Se jaugent, s’imitent et s’entrainent jusqu’à la formation d’une masse finalement non toxique dans laquelle les individualités s’expriment librement. Chaque mouvement témoigne de leur force et de l’intensité de leurs intentions.
 C’est une véritable prouesse technique qu’elles entreprennent à plusieurs reprises sur le plateau du TNB, du 28 au 30 janvier. Il y a quasiment un an, les membres de Paradox-sal dévoilaient pour la première fois Queen blood à Rennes, après deux semaines de résidence au Garage, avant de présenter officiellement la création à La Villette à Paris, fin mars 2019.
C’est une véritable prouesse technique qu’elles entreprennent à plusieurs reprises sur le plateau du TNB, du 28 au 30 janvier. Il y a quasiment un an, les membres de Paradox-sal dévoilaient pour la première fois Queen blood à Rennes, après deux semaines de résidence au Garage, avant de présenter officiellement la création à La Villette à Paris, fin mars 2019.
De retour dans la capitale rennaise, elles s’affirment toujours prêtes à sublimer les danses dont elles sont des pointures. Hip-hop, dance house, krump, popping, locking, danse contemporaine et danses africaines, s’entremêlent, se confrontent et s’enlacent. Quelle puissance ! Quelles énergies !
Pendant près d’une heure entière, on retient notre respiration au son des leurs qui résonnent lors du tableau électrisant sur lequel elle danse, alignées face au public sur la chanson « Four women » de Nina Simone. La tension est palpable, l’émotion grandissante. Entre les instants suspendus de ce type et les moments d’accélération, les danseuses sont toujours en mouvement, seules, à plusieurs ou toutes ensemble.
C’est viscéral, ça prend aux tripes et ça nous saisit les entrailles ce qu’elles racontent, sans filtre et sans solution de repli, puisque même une fois sorties du rectangle blanc, on les voit encore, sur les bords du plateau imaginés comme des coulisses. Tout au long de cette performance qui nous hypnotise littéralement, elles se confrontent à nos regards mais aussi à leurs propres regards sur elles-mêmes.
L’émotion nait et grandit constamment de par la violence des affrontements, collectifs et individuels, mais aussi de par les instants partagés d’écoute, de solidarité et de sororité. Avec toujours ce sentiment planant de liberté, cette volonté de dépassement de soi et cet esprit d’équipe au sein de laquelle s’affirment des personnalités différentes et combattantes, à l’instar des lignes qu’elles exécutent durant leurs chorégraphies : jamais droites, elles présentent toujours une multitude de trajectoires possibles.
L’ESPRIT COLLECTIF DE PARADOX-SAL
« Je voulais cette frontalité. Vous voyez, y a pas de loges, rien, vous les voyez même quand elles sortent du plateau. Tout ça, c’est assumé, pour se rendre compte de l’effort physique. Envoyer ce qu’elles envoient, moi, je peux pas le faire ! », avait commenté Ousmane Sy, chorégraphe de Paradox-sal et membre du collectif FAIR-E, après la représentation au Garage.
En 2012, il fonde un crew exclusivement féminin qui rassemble des danseuses issues du hip-hop, du popping, du locking, du dancehall, du krump, des danses africaines ou encore de la danse contemporaine, autour d’une base commune : la house.
 « J’ai souvent fait partie de groupes essentiellement masculins. Je travaillais avec des filles comme Allauné Blegbo et Anaïs Imbert-Clery, elles m’ont parlé d’autres filles qu’elles connaissaient, etc. La house, c’est très androgyne. Le talent est là, peu importe le sexe. Ce que je veux avec elles, c’est apprendre et échanger. Pas diriger. Ce qui m’intéresse, c’est de décortiquer les états de corps. C’est la gestuelle, pas le corps finalement. », analyse-t-il.
« J’ai souvent fait partie de groupes essentiellement masculins. Je travaillais avec des filles comme Allauné Blegbo et Anaïs Imbert-Clery, elles m’ont parlé d’autres filles qu’elles connaissaient, etc. La house, c’est très androgyne. Le talent est là, peu importe le sexe. Ce que je veux avec elles, c’est apprendre et échanger. Pas diriger. Ce qui m’intéresse, c’est de décortiquer les états de corps. C’est la gestuelle, pas le corps finalement. », analyse-t-il.
Avec Fighting Spirit, premier spectacle de Paradox-sal, créé en 2014 – lire notre article « Fighting Spirit, l’esprit guerrier des danses urbaines à l’Opéra » publié sur yeggmag.fr le 16 février 2015 – « le challenge était de monter sur scène et d’impressionner par nos techniques et nos talents. Ousmane ne nous a pas formées, il nous a choisies pour nos forces individuelles, quelque soit la danse. », précise Odile Lacides, également assistante chorégraphe sur la création Queen Blood.
FÉMINITÉ PLURIELLE
C’est l’acte II de l’exploration à laquelle le groupe contribue, autour des gestuelles et des énergies féminines. Des énergies animales et combattives qui réussissent toujours à allier collectif et individuel, qui vont s’exprimer également dans les propositions d’Anne Nguyen et de Sandrine Lescourant également programmées lors du festival.
Ici, c’est la notion de féminité qui est développée à travers les techniques, la performance et la scénographie. Et surtout, elles s’expriment. Dans le processus de création comme sur la scène. Dans les parties dansées en groupe comme dans les solos. Si la dance house est leur langage commun, aucune ne danse comme sa voisine, aucune ne ressemble à une autre même dans les mouvements synchronisés et chaque spectacle de Paradox-sal fait jaillir la puissance de cette diversité des parcours, des profils et des propos.
Comme le souligne la chorégraphe Anne Nguyen, l’imitation n’a pas sa place dans la culture hip-hop. « Dans nos solos, on a carte blanche pour exprimer qui on est. », signale Allauné Blegbo qui poursuit : « Je me suis posée des questions sur qu’est-ce que c’est la féminité ? Qu’est-ce qu’on attend de moi dans cette féminité ? Qu’est-ce qu’on attend de nous ? Qu’est-ce que c’est savoir être soi ? Ça m’a fait réfléchir et évoluer, pas que professionnellement, mais personnellement aussi. Aller au-delà de la caricature. »
Le corps des danseuses au fil de la création passe par tous les états, emprunte les codes normés, genrés et sexués mais aussi et surtout les chemins de traverse puisque sept ou huit danseuses – cela dépend des représentations - sur scène impliquent par conséquent sept ou huit féminités différentes qui se rencontrent, se confrontent, s’allient jusqu’à la libération, en marge de la scène, montrant que tous les espaces peuvent être investis par les femmes.
« Il y a un tableau qu’on fait toutes ensemble, qui s’appelle « Dolce & Gabbana », où on est dans la caricature avec des gestes de diva. C’est aussi une vision de la féminité. Quand on fait notre solo, par contre, là, on exprime notre féminité à nous et on dit qu’il n’y a pas besoin d’être féminine dans le sens où tout le monde l’entend pour être féminine. »
détaille Odile Lacides.
Qu’elles jouent l’exagération, qu’elles incarnent une féminité normée ou singulière, qu’elles dévoilent une partie masculine plus ou moins prégnante et dominante, elles ne définissent aucune limite à une féminité plurielle et évolutive, non figée dans le temps et l’espace. Une féminité All 4 House qu’elles visitent avec hargne et sensibilité, qui nous reste viscéralement à l’esprit. Puissant et bouleversant.

S’INSPIRER DU HIP-HOP POUR RÉCONCILIER LA SOCIÉTÉ
Dans son article, publié sur le site du HuffingtonPost en septembre 2016, la philosophe Benjamine Weill, spécialiste du rap et co-fondatrice de l’association « Nous sommes Hip-Hop », aborde la question de l’engagement comme base d’émancipation dans la culture hip-hop.
Ainsi, dans son introduction, elle écrit que « depuis son émergence, le Hip-Hop, consiste à mettre en avant notre capacité à l’émancipation collective, malgré nos déterminants initiaux. En exprimant son point de vue, chacun prend parti dans le monde sans attendre que cette place soit laissée. »
Si elle analyse particulièrement le prisme du rap, elle conclut tout de même en élargissant à la culture hip hop qu’elle voit comme « moyen par lequel chacun s’extrait de ses déterminants de départ pour aller plus loin, faire valoir sa dignité humaine en transformant sa souffrance en force, sa haine en rage, sa solitude en rencontre. L’émulation et la compétition entendues comme le moyen de se confronter à l’autre, non pour soi-même mais pour que l’un et l’autre s’augmentent, favorisent une forme d’émancipation et de dépassement de soi ainsi que la rencontre. C’est une manière de « s’ouvrir sur le monde » et de « changer les parcours » à partir de son vécu, de son histoire, mais aussi d’une conscience que je ne suis rien sans l’autre et que cet autre même s’il est différent de moi, vaut autant que moi. Rien ne sert de l’écraser, mieux vaut s’y associer. »
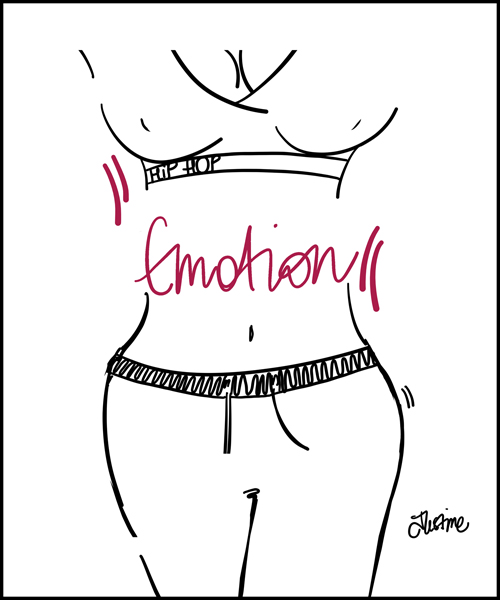 En août 2019, un collectif d’acteurs des cultures urbaines publie une tribune dans Le Monde, appelant à « s’inspirer du hip-hop, né dans la rue et qui n’exclut personne, pour réconcilier une société française en morceaux. »
En août 2019, un collectif d’acteurs des cultures urbaines publie une tribune dans Le Monde, appelant à « s’inspirer du hip-hop, né dans la rue et qui n’exclut personne, pour réconcilier une société française en morceaux. »
HIP-HOP OLD SCHOOL
Le 5 février 2020, au Garage à Rennes, la breakeuse et chorégraphe Anne Nguyen animait une conférence sur les danses hip-hop et revenait rapidement sur l’histoire de celles-ci. Le break, c’est pour elle la « seule et vraie danse hip-hop ». Pourquoi ? Parce qu’elle nait en même temps que la musique éponyme.
Mais d’autres danses existent, comme le popping et le locking, qui vont être assimilées à la culture hip-hop. Ce sont ce qu’elle appelle les trois danses old school hip-hop, et chaque style puise dans des inspirations différentes, entre rites ancestraux et culture populaire.
« L’inspiration se retrouve dans d’autres disciplines. Dans ces danses, on a le droit de tout faire, les mouvements appartiennent à tout le monde, on fait appel à un patrimoine. On voit que dans le break, il y a de l’inspiration indienne, dans le popping, qui consiste en des contractions musculaires, il y a de l’inspiration égyptienne, et dans le locking, qui est une déformation du popping, on retrouve l’inspiration des danseurs de claquettes et des cabarets noirs américains. », explique-t-elle, en introduction.
Aux Etats-Unis, quand une nouvelle musique envahit le continent, celle-ci est toujours assortie d’une nouvelle danse. De nouveaux styles se créent, et parfois restent à l’état de mode, et parfois perdurent et évoluent. Le popping et le locking apparaissent un tout petit peu avant les années 80, lorsque les Eletric Boogaloos (style funk) déboulent dans l’émission Soul Trainet initient une danse empreinte de mouvements militaires et robotiques.
C’est le début du popping, reconnaissable grâce à ses mouvements très carrés et ses contractions musculaires qui marquent le beat, le son, « comme du pop corn qui éclate ! » Le locking est un dérivé de cette danse : « En fait, il y avait un mec qui n’arrivait pas à popper et quand les gens se moquaient de lui, il les pointait du doigt, c’est pour ça que dans le locking, on a souvent des mouvements comme ça avec les bras. »
FUSION DE GENRES ET D’INFLUENCES
On aurait pu en rester là. Le popping et le locking auraient pu n’être que des modes. Quelques temps plus tard, le break arrive. Nous sommes dans les années 70, à New York, et « c’est la première fois que les gens sont amassés comme ça, dans les quartiers. Quelque chose de nouveau se crée. ».
 Et ce quelque chose, c’est une Block Party. Ça éclot dans différents secteurs de la ville : les DJs organisent des soirées en bas des immeubles et repèrent que c’est au moment du solo du batteur ou du percussionniste que les gens se mettent à danser. Ils vont rapidement se mettre à isoler ces parties, appelées « break », afin de créer des boucles avec ces morceaux : « Ça donne naissance au break et à la musique hip-hop ».
Et ce quelque chose, c’est une Block Party. Ça éclot dans différents secteurs de la ville : les DJs organisent des soirées en bas des immeubles et repèrent que c’est au moment du solo du batteur ou du percussionniste que les gens se mettent à danser. Ils vont rapidement se mettre à isoler ces parties, appelées « break », afin de créer des boucles avec ces morceaux : « Ça donne naissance au break et à la musique hip-hop ».
Là aussi, les influences sont multiples puisque les danseurs puisent leurs mouvements dans les films de kung fu mais aussi dans la guerre des gangs qui sévit à New York, utilisant le « rocking » comme technique visant à faire croire aux flics que les membres dansaient en imitant le combat, sans se toucher.
Les mouvements sont saccadés, la musique également. « Les battles vont naitre de la compétition entre la communauté afroaméricaine et la communauté latina. Selon l’histoire, ce serait plutôt les afroaméricains qui auraient inventé le break et les latinos les auraient défié. A force, les groupes essayaient de se renouveler et aller de plus en plus vers la performance, d’où les tours sur le dos, les mouvements plus acrobatiques. Ensuite, le break s’est fluidifié, réunissant l’esprit des clubs – parce que ça part des danses de clubs, puis de la rue – et l’esprit des battles. », souligne Anne Nguyen.
En parallèle, il existe un gang dans le Bronx, le Black Spades, dont Afrika Bambaataa est le chef. Il crée l’Organization dans le but de proposer une alternative pacifiste aux différents gangs. En 1975, lorsque son cousin est tué par la police, il quitte les Black Spades et concrétise son organisation en la nommant Zulu Nation, qui réunit des jeunes dont les moyens d’expression sont la danse, le graffiti, le rap et le djing :
« Peace, love, unity and having fun. Ce sont les valeurs du hip-hop et c’est sous la houlette de ces valeurs que vont se rassembler les trois danses old school. La danse est alors une alternative pour ne pas rentrer dans un gang. On peut arriver à un statut, sans avoir besoin de tuer. En battle, on se défie mais on mime, on ne violente pas. Et c’est par le biais des battles que le hip-hop sort du Bronx et se propage. »
ARRIVÉE EN EUROPE ET ÉVOLUTION
Les JI américains importent le hip-hop en Allemagne. En Angleterre, ça prend également et en 1984, TF1 lance une émission qui popularise le hip-hop en France. Mais aux Etats-Unis, dans les années 90, les journalistes commencent à le critiquer de manière péjorative :
« Là-bas, ça meurt quasiment. Alors qu’ici, ça continue. Le hip-hop monte sur la scène du théâtre. Depuis plusieurs années en France, il existe le groupe Black Blanc Beur, fondé par une ancienne danseuse classique, Christine Coudun, qui a rassemblé une trentaine de danseurs de Trappes avec qui elle a monté un spectacle. »
 Aujourd’hui, la compagnie compte une vingtaine de créations à son actif et des milliers de représentations et d’ateliers. Le hip-hop prend racine et poursuit son chemin.
Aujourd’hui, la compagnie compte une vingtaine de créations à son actif et des milliers de représentations et d’ateliers. Le hip-hop prend racine et poursuit son chemin.
« On a beaucoup fait venir des danseurs américains, des pionniers, pour transmettre des informations. On a créé notre propre style ici et là-bas, ils n’ont quasi plus de break. Mais le flexing est né, le krump aussi. Le hip-hop est maintenant la fusion des différentes danses adaptées aux musiques d’aujourd’hui. Le beat a ralenti, c’est pour ça qu’on voit des vagues, des déplacements, des effets spéciaux dans les clips. Mais aux USA, c’est devenu de l’entertainment. », précise-t-elle.
En marge de toute cette évolution, se trouve différentes communautés qui ne se retrouvent pas dans les battles et vont alors créer et développer leur propre culture de la danse dans les clubs. Ainsi, le voguing, le waacking, la house dance, etc. sont issues du milieu queer, underground, gay et des personnes racisées. On les assimile aujourd’hui au hip-hop.
HOMMAGE À LA CULTURE HIP-HOP
De ce bouillonnement et de cette histoire, Anne Nguyen va s’en inspirer pour créer son spectacle, À mon bel amour, présenté le 4 février au Triangle, dans lequel elle rassemble huit virtuoses – quatre danseuses et quatre danseurs - de différentes disciplines. Elle convoque le popping, le locking, le waacking, le voguing, la danse contemporaine, la danse classique et le krump (ce soir-là, Emilie Ouedraogo était malheureusement absente et était donc remplacée).
Les regards sont francs et frontaux. Le public regarde les artistes qui eux aussi fixent l’assemblée spectatrice. La pièce est chorégraphiée comme un défilé et les interprètes se prêtent au jeu jusqu’à pousser leurs mouvements à l’extrême. En solo, en duo ou à plus, iels s’affirment, occupent l’espace, s’affranchissent des regards et prennent leur liberté à travers des corps et des gestuelles affranchi-e-s.
Tou-te-s représentent des archétypes, revendiquent leur appartenance à une culture et défient qui que ce soit de leur interdire l’accès à la beauté. À mon bel amour est un hommage à la culture hip-hop et à ses valeurs, telles que les défend la chorégraphe qui manifeste régulièrement ses inspirations multiples.
Elle a fait de la gymnastique et des arts martiaux. Elle a entrepris des études de maths et de physique. Et elle a rencontré le monde du break, en commençant interprète et en faisant ses classes lors de battles. Elle lâche la physique pour se consacrer au hip-hop mais ses spectacles seront souvent très imprégnés de l’esprit scientifique.

Revenons dans les années 90. Anne Nguyen prend le calendrier des radios libres et enregistre toutes les émissions sur sa passion. À la télé, elle voit du break dans les clips mais ce n’est pas suffisant pour en apprendre les tenants et les aboutissants.
« Je voyais les breakeurs à Chatelet, j’osais pas y aller… J’ai fait des cours de hip-hop mais y avait pas de break et je n’arrivais pas à trouver le truc. Je suis partie un an à Montréal, en 98/99, où j’ai fait de la capoeira. Dans ma fac, il y avait des filles qui faisaient du break, elles m’ont emmenées avec elles. Je ne suis pas restée longtemps dans leur groupe, j’ai rejoint un autre groupe, dans lequel là j’étais la seule fille. », nous raconte-t-elle.
De retour en France, elle aborde les danseurs et les danseuses avec qui elle a envie de continuer son apprentissage : « J’alternais, c’est comme ça qu’on se forme. Je regardais les gens danser en entrainement et en battle, j’allais leur parler, ils m’invitaient, c’était comme ça que ça fonctionnait ! Comme une sorte de culture orale, de chemin qu’on doit faire. Il n’y a pas de cursus académique, c’est un parcours qu’on doit faire soi-même, en fonction de sa sensibilité. »
RÉFLEXION SUR LA DANSE ET L’ARTISTE
Elle voit les danseuses et danseurs comme des super-héroïnes et des super-héros, chacun-e-s avec des supers pouvoirs, chacun-e-s avec son propre style. Pendant les 5 années durant lesquelles elle est interprète, Anne Nguyen commence à se poser des questions sur la danse et son sens, et de ses réflexions émerge le Manuel du guerrier de la ville, un recueil de poèmes décortiquant le ressenti de la danseuse qui par le mouvement et l’énergie de ses pieds et jambes choisit et déplace son centre de gravité afin de transcender sa réalité et trouver sa liberté.
Et c’est souvent par la contrainte qu’elle va sublimer ses créations, comme Racine carrée(née de son recueil poétique) par exemple ou d’autres, dans lesquelles elle cherche à limiter le déplacement d’une seule manière (danser dans un espace géométrique réduit, faire circuler les interprètes sur des lignes, que ce soit de profil ou face au public…).
Pour autant, elle n’a pas envisagé tout de suite de chorégraphier des spectacles : « Ça ne m’intéressait pas trop. Souvent, les danseurs hip-hop sont des esprits libres qui n’aiment pas trop être dirigés. À ce moment-là, je sortais beaucoup dans les soirées, j’avais des groupes de potes dans le funk, dans le rap… Des lockeurs ont monté un spectacle et m’ont proposé qu’on fasse une créa’. Je l’ai fait, le spectacle n’a pas tourné mais ça m’a donné envie de continuer. J’ai compris que j’avais un rôle à jouer. »
 Depuis, avec sa compagnie Par Terre, elle a chorégraphié de nombreux spectacles, largement salués par la critique. « Avant ça, j’ai fait du journalisme. Analyser, parler, vient avant de chorégraphier. C’est important car le milieu de la danse est atypique, libre. Les gens qui en font partie s’expriment rarement. Personnellement, j’ai toujours été frustrée qu’il y ait une vision faussée du hip-hop dans les journaux. Cette vision d’une danse réduite à une danse de cités. Je me suis posée en défenseure des valeurs du hip-hop pour dire « Parlons de danse, parlons des artistes, parlons des principes. » Ce que je veux, c’est sortir, à travers la danse, l’essence des différents styles. Le hip-hop, ce n’est pas juste des jeunes des cités qui n’ont rien d’autre à faire. Il y a un état transcendantal quand ils dansent. Ce sont des êtres humains qui font des choses profondes. C’est un langage pour exprimer quelque chose de plus universel. », scande-t-elle.
Depuis, avec sa compagnie Par Terre, elle a chorégraphié de nombreux spectacles, largement salués par la critique. « Avant ça, j’ai fait du journalisme. Analyser, parler, vient avant de chorégraphier. C’est important car le milieu de la danse est atypique, libre. Les gens qui en font partie s’expriment rarement. Personnellement, j’ai toujours été frustrée qu’il y ait une vision faussée du hip-hop dans les journaux. Cette vision d’une danse réduite à une danse de cités. Je me suis posée en défenseure des valeurs du hip-hop pour dire « Parlons de danse, parlons des artistes, parlons des principes. » Ce que je veux, c’est sortir, à travers la danse, l’essence des différents styles. Le hip-hop, ce n’est pas juste des jeunes des cités qui n’ont rien d’autre à faire. Il y a un état transcendantal quand ils dansent. Ce sont des êtres humains qui font des choses profondes. C’est un langage pour exprimer quelque chose de plus universel. », scande-t-elle.
DIVERSITÉ DE CARACTÈRES
Son engagement est là et il est gravé en elle. Et il transpire dans la pièce À mon bel amour, qui porte une réflexion sur l’individualité et l’individualisme de chaque danseur-euse et le collectif :
« La culture de la différence, c’est ça qui m’attire. Pourquoi des choses me limitent ? J’ai voulu voir ce que ça donnait quand on enlevait ces limites-là et comment on se rassemblait, sans niveler par le bas. On crée avec nos différences et on n’essaye pas de ressembler à des normes de beauté. On joue avec ce qu’on a, ce qui nous constitue. Un danseur qui va être plutôt nerveux par exemple, il va jouer la vitesse dans son mouvement, sa gestuelle. Un danseur plutôt mastoc, il va jouer la puissance. L’idée, c’est de mettre en valeur ce qui nous différencie. C’est comme ça qu’on apporte quelque chose. Dans chaque archétype, j’ai quand même essayé d’aller vers des individualités originales. Avoir un danseur de danse classique, une danseuse de krump… »
Parce que les choses évoluent et que le genre interagit encore aujourd’hui avec le regard que l’on porte sur les sociétés. On parle de diversité, de mixité mais pour Anne Nguyen, les critères de sexe, de couleur de peau, d’âge, etc. sont superficiels, ils ne sont qu’une enveloppe.
C’est vrai qu’ils le sont et pourtant, ils sont l’objet d’une multitude de discriminations et le terrain privilégié des rapports de domination. Pour elle, la diversité se joue dans les valeurs.
« Mon pari, c’est que quand on a une diversité de caractères dans le collectif et que chacun assume sa personnalité, on peut agir ensemble et chacun peut avoir sa place. »
souligne-t-elle, précisant qu’il s’agit là d’un idéal de collectif.
« C’est super compliqué de parler des relations femmes-hommes mais pour moi, ce qui est hyper important, c’est d’assumer son caractère, dire ce qu’on est. C’est très sensible quand on parle de ça. La diversité pour moi, c’est avant tout la diversité de caractères. Accepter les différences dans le caractère des gens. Juger les gens sur leur caractère avant tout. C’est ça le message du hip-hop. Moi, je n’ai pas très envie de dire que je suis engagée car quand on dit « engagée », ça devient souvent synonyme de militante. Et quand on est trop dans une pensée engagée, on se laisse vite limiter par le biais de ne voir que ce qui confirme notre idée. », répond la chorégraphe, que l’on sent pas très à l’aise sur la question.

Elle poursuit néanmoins : « Je suis engagée pour l’art comme pensée créatrice. C’est ça que je veux défendre. La personnalité des artistes est parfois politiquement incorrecte, et c’est là l’essence de l’artiste : aller au-delà des bornes. Il faut leur laisser la chance d’aller trop loin dans leurs paroles. »
Et quand on lui demande si l’artiste a le droit, parce qu’il est artiste, d’aller trop loin et cela même aux dépens d’une partie de la population, elle confirme sa pensée : « Je suis engagée pour le droit d’avoir tort. »
ARME DE PAIX, POUR LA PAIX
La réalité, et elle le dit elle-même, c’est « qu’on n’accepte pas la différence. » Elle revient à sa vision de super-héro et super-héroïne : « Il faut essayer de ressembler le moins possible aux autres danseurs et danseuses. On est dans une danse qui est à l’antithèse de l’académisme ! Le principe du hip-hop, c’est la réunion d’individualités fortes dans un collectif. Un collectif qui ne se conforme pas ! »
Sandrine Lescourant, danseuse et chorégraphe, est convaincue que le hip-hop est un engagement social. Et c’est d’ailleurs bien ce qui la motive. « C’est une arme de paix, pour la paix, pour éloigner les violences. La danse hip-hop, elle part de rien, elle est dans la rue et sa culture, c’est le vivre ensemble, faire ensemble. Les valeurs, peace, love, unity and having fun, sont essentielles pour tout un chacun. Dénuer de tout ça, ça n’aurait pas d’intérêt. », explique-t-elle.
Au départ, elle pratique plutôt le dancehall et le modern jazz. Elle est alors en BTS communication des entreprises et sur le parvis du musée d’art moderne à Nice, des danseurs hip hop s’entrainent : « L’entrainement de rue va me faire grandir en tant que danseuse et en tant que personne. J’ai pris des cours au début et puis, j’ai acheté une sono. Je mélangeais les styles, je travaillais sur la musicalité. Je suis née dans le 93 et on écoutait beaucoup de hip-hop. »
Elle se demande alors comment faire corps avec cette musique, se forme en faisant des battles et aussi en enseignant, « parce qu’en réfléchissant à une pédagogie, on continue d’apprendre tout le temps. »
Le hip-hop est pour elle un endroit de transfert des bonnes énergies, un espace de liberté, un lieu fédérateur qui a la capacité de transcender le quotidien, les vécus et les conditions de vie et qui nourrit son âme. Dans le cadre du festival Waterproof, on retrouvait deux fois Sandrine Lescourant.
En tant que chorégraphe et danseuse, elle présentait le 6 février au Triangle, son spectacle Acoustique, défini comme la conclusion d’un triptyque, qui au départ n’était pas fait pour l’être.
« C’est en fonction de ce que j’apprends de mon parcours initiatique de vie que je fais un spectacle. Personnellement, j’ai beaucoup voyagé toute seule et j’ai fait beaucoup de chose toute seule. Les filles ont été mes cobayes. En exprimant le « je », il y a eu un magnifique « nous » qui est apparu. »
précise-t-elle.
Quelques explications : en 2015, elle fonde la compagnie Kilaï et s’accompagne de quatre danseuses pour sa première création chorégraphique, intitulée Parasite. Comme Anne Nguyen et comme Paradox-sal, elle s’appuie sur l’essence même du hip-hop pour développer une réflexion autour du collectif et comment organiser ce collectif quand nos différences parasitent la rencontre de l’autre.
 Dans un second temps, c’est en regardant de nombreux documentaires qu’elle va créer Icône : « Je voyais un côté très sombre de l’être humain et j’en voulais à la terre entière de toutes ces injustices. C’était une période très dure et j’en voulais aux icônes d’aujourd’hui, mis et mises en avant mais qui n’aident pas le commun des mortel-le-s. »
Dans un second temps, c’est en regardant de nombreux documentaires qu’elle va créer Icône : « Je voyais un côté très sombre de l’être humain et j’en voulais à la terre entière de toutes ces injustices. C’était une période très dure et j’en voulais aux icônes d’aujourd’hui, mis et mises en avant mais qui n’aident pas le commun des mortel-le-s. »
La conclusion est là, dans Acoustique, œuvre basée sur l’échange et le partage. Sur ces six protagonistes – quatre danseuses et deux danseurs – qui observent le public de très très près. Puis s’observent entre eux. Iels n’ont pas la parole mais le regard et le corps. Les mouvements s’enchainent, s’intensifient et se répètent.
Comme un apprentissage, comme une recherche d’un vocabulaire commun tout en conservant une gestuelle propre à chacun-e. Il y a de la confrontation, de l’échange, de l’incompréhension, du mime sans qu’il soit poussé au jeu de miroir, et cela va jusqu’à l’amusement, le plaisir d’être ensemble, de communier.
C’est heureux cette légèreté et cette allégresse. Puis vient le balbutiement du langage, des premières sonorités aux premières phrases d’un discours clair et puissant : « Nous ne sommes pas que des silhouettes insignifiantes. Nous sommes âmes, nous sommes elles, nous sommes eux… »
La découverte de l’autre, l’affirmation de soi, la rencontre et le partage. Sandrine Lescourant amène tout ça sur le plateau avec une énergie communicative réjouissante. Elle le dit, elle croit fortement en l’être humain et ça transperce ses chorégraphies, qu’elle en soit la créatrice ou l’interprète.
Et c’est un vrai moment de communion lorsque les participant-e-s de son atelier, donné durant la semaine, montent sur scène et envahissent le plateau, démontrant l’aspect participatif et inclusif de l’esprit du hip-hop dont se nourrit Sandrine Lescourant qui parle régulièrement du côté fédérateur de cette culture.
ENTRE VIOLENCES ET ESPOIR
Le 31 janvier, au CCNRB, elle incarnait un panel de personnages qu’elle résume ainsi : « Je fais beaucoup le côté fragile du mec qui a pas encore confiance et qui pense que c’est par la violence et l’agressivité qu’il va trouver sa liberté. »
Cette pièce, c’est Hope Hunt, créée et dansée par la chorégraphe nord-irlandaise Oona Doherty, et pour la deuxième fois, Sandrine Lescourant campe le rôle du multiple protagoniste. Ce n’est pas vraiment une reprise de rôle, ce serait plutôt une sorte d’adaptation, façonnée par les deux artistes.
Dans les deux tableaux, c’est une danse de l’impuissance et de la virilité, comme l’annonce le programme. De son côté, Oona Doherty a puisé dans les mots et les attitudes corporelles des jeunes exclus de Belfast pour en révéler plusieurs stéréotypes de masculinité.
Elle tend ensuite à proposer un renouveau, atteindre une rédemption. Le travail de Sandrine Lescourant n’a pas simplement été d’apprendre une chorégraphie et de se l’approprier, il a également été de transcender l’histoire de par son histoire à elle, de par le contexte dans lequel elle évolue.
« Je suis seule au plateau mais je ne me sens pas seule du tout. Il faut dépasser le solo et incarner toutes ces personnes, ces violences de la rue, ces situations vécues par les plus démunis. Ça s’est fait rapidement, j’ai appris le rôle en 3 jours. Ça a été une très belle rencontre avec Oona, c’est une chorégraphe très engagée et très investie qui m’a nourrie de ses images et avec qui on a échangé à partir de mes images, de mes influences. Ça a fait grandir en moi une lumière, l’universalité de nos engagements. Je me considère comme un vecteur pour faire apparaître tous les personnages et sublimer la beauté de leurs fragilités. J’ai de l’amour pour ces gens-là, surtout que j’en connais beaucoup. J’ai donc puisé dans ce que j’aime, dans ce que j’ai pu traverser, sans me laisser ensevelir par ce sac d’émotions et d’inspirations. », développe-t-elle.
 Cet après-midi là, entourée de Lise Marie Barry, régisseuse lumières qui la guide dans ses placements, et de Joss Carter, son binôme au démarrage du spectacle qui l’accompagne dans ses intentions et ses attitudes masculines lorsqu’elle est encore « too girly », elle engage tout son être pour atteindre les états de corps et de psyché nécessaires à cette incroyable performance qui nous frappe de son intensité.
Cet après-midi là, entourée de Lise Marie Barry, régisseuse lumières qui la guide dans ses placements, et de Joss Carter, son binôme au démarrage du spectacle qui l’accompagne dans ses intentions et ses attitudes masculines lorsqu’elle est encore « too girly », elle engage tout son être pour atteindre les états de corps et de psyché nécessaires à cette incroyable performance qui nous frappe de son intensité.
Elle dégage l’espoir qu’elle prône, elle nous donne envie de chialer et de rire en même temps, et surtout elle nous donne envie de tendre la main. Que ce soit dans Acoustique ou Hope Hunt. « Danser pour transcender sa vie, ses conditions de vie, en terme d’énergie et de partage, c’est hyper fort ! Faire partie de la culture hip-hop, c’est déjà être engagé-e, c’est un acte social en lui-même. Et à partir du moment où on pose nos yeux sur ce qui nous intéresse, ça prend de l’ampleur. Alors, en hip-hop, il y a aussi des propositions plus légères mais pour ma part, l’engagement est quand même ce qui m’anime. C’est essentiel. Et plus je m’intéresse à tout ça, plus j’ai l’impression que la plupart des propositions sont engagées. », conclut la danseuse et chorégraphe.
LA SORORITÉ, SUR ET EN DEHORS DU PLATEAU
Le trio de Mon âme pour un baiser, réuni par le chorégraphe Bernardo Montet et présenté au Triangle le 11 février, élargit l’horizon et la réflexion dans une danse qui mêlent violences des vécus, émancipation par le récit corporel et énoncé et puissance de la sororité. Les trois danseuses sont engagées corps et âmes dans leurs mouvements.
On sort ici du hip-hop pour s’approcher de la danse contemporaine. Ou plutôt d’une danse hybride qui ne répond plus à des codes normatifs. Seulement à un propos intérieur et intime que les danseuses choisissent de mettre en partage. Nadia Beugré par exemple ne définit pas sa danse, par volonté de ne pas se cloisonner.
Isabela Fernandes Santana a entrepris des études chorégraphiques et a collaboré avec des chorégraphes dans le champ de la danse contemporaine, mais ne définit pas pour autant sa danse non plus. Suzie Babin, elle, se dit danseuse, mettant tout son être au service de ce qu’elle relate sur le plateau.
« J’aime ce côté interprète, il y a une liberté d’être et de décloisonner. La pièce m’a aidée et les filles aussi. Je me sens vecteur de quelque chose. C’est le côté psychologique de la danse. A l’école, je ne savais pas ce que j’étais. J’ai fait jazz et contemporain et puis maintenant j’évolue. », dit-elle.
Pour élaborer cette pièce chorégraphique, le trio a dû se plonger dans leur intimité, comme l’explique Isabela Fernandes Santana : « Cette matière fonde notre travail et on avait besoin de cet endroit très intime pour aller au-delà et déconstruire. Qu’est-ce que c’est qu’être ces trois personnes et avancer ensemble, trouver des solutions aux conflits, etc. Il y a trois corps différents entre eux, comment être interprètes ensemble, avec Bernardo qui travaille comme s’il était le réalisateur d’un documentaire ? Nous sommes les sujets de ce documentaire et c’est intéressant. »
Nadia Beugré est traversée par le portrait de la Vierge à travers les sociétés et les époques. Isabela Fernandes Santana est traversée par le portrait du leader du peuple autochtone brésilien krenak. Et Suzie Babin est traversée par le portrait d’un frère qu’elle aurait eu.
« Nous sommes trois femmes différentes, trois femmes qui vivons le fait d’être femme de façon différente. Le Brésil est un des pays qui tue et viole le plus de femmes au monde. Quand tu grandis en tant que femme dans ce contexte, faut toujours être attentive. J’ai eu tout un entrainement pour me protéger. Il y a un poids et un pouvoir sur le corps des femmes. Tu ne peux jamais lâcher, tu dois toujours cacher. C’est très libérateur de pouvoir être à l’aise avec elles deux. On peut toucher dans des endroits parfois intimes sans sentir le danger et sans avoir peur d’être sensuelles. », indique Isabela, rejointe par Suzie :
« Je suis une femme mais je ne revendiquais pas le côté artiste femme. C’est pas ce qui était important. On peut prendre part de sa part masculine et c’est d’autant plus valorisant. J’étais complexée par ça et aujourd’hui, je ne me définis pas garçon manqué, je me définis femme. »
Nadia, elle, se définit « comme un être tout d’abord. » Ce qui prime, c’est le fait de s’exprimer :
« Nos frustrations, nos désirs, il faut dire ce qu’on pense, on a le droit de parler d’orgasme, on a le droit d’être maladroit. Sans être jugé-e-s. Il y a urgence de dire car ce monde est en danger. Urgence de dire qu’on n’a plus peur. »
Au sein de cette pièce, de nombreux sujets sont abordés de front ou non. De par leurs propos, leurs gestuelles, leurs êtres, ce qu’elles sont, ce qu’elles dégagent, ce qu’elles interprètent, on voit poindre des corps blancs, des corps racisés, des corps musclés, des corps non épilés, des masculinités, des féminités, des sexualités, et puis les histoires s’affinent et les paroles nous envahissent :
« Il n’y aura pas de trêve, de soumission, de oui mais, de renoncement, de colère, de murmure, de territoire volé, de clitoris coupé. Il y a aura de la joie d’être là, d’être moi, de crier, de pleurer, de bouger le cul (…) de transgresser, de s’assumer, de piétiner, de se défoncer, de prendre du plaisir, d’être fou, de danser. »

Et dans les mots et les corps des danseuses résonnent des multitudes de violences sexistes, sexuelles, racistes et colonialistes. Elles déconstruisent les mythes et tissent les liens d’une sororité libératrice et émancipatrice. Autant sur le plateau qu’en dehors de la scène. Partant d’histoires personnelles, fictives ou non, contemporaines ou non, elles dénoncent les conditions des femmes et se libèrent des carcans en osant exprimer ce qu’elles sont individuellement et ce qu’elles représentent dans le collectif.
C’est souvent là la portée de l’art en général. Véhiculer des messages forts, reflets de la société qu’il vient mettre en exergue pour la critiquer et/ou la transcender. « En tant qu’artiste constamment en mouvement, on ne peut pas arriver sur le plateau pour dire que tout va bien. Dansons les maux ! », réagit Nadia Beugré.
CONSTRUIRE À PARTIR DE L’EXISTANT
Qu’elles revendiquent un engagement social ou non, elles expriment cependant toutes la même idée : la culture hip-hop prône l’affirmation de soi au sein d’un collectif qui ne cherche pas à nous conformer. On aime cette idée, même si on ne peut s’empêcher de penser que la notion d’appartenance à une culture est déjà en soi une forme de conformité.
Toutefois, sur scène, on voit effectivement se mouvoir des corps dont les gestuelles divergent sans pour autant s’opposer. Elles cohabitent et vont même plus loin - et c’est là le propos des diverses propositions auxquelles nous avons assisté – en cherchant à construire ensemble, non pas dans le compromis qui pourrait s’apparenter à l’élaboration d’une norme, mais à partir de ce que chacun-e est et comment iel l’exprime. C’est brut et c’est puissant.
Peut-être utopique en l’état actuel de la société telle que nous la subissons mais elle a au moins le mérite de transcender notre réalité pour la rendre meilleure, sans être si inaccessible que ça. Elle nous montre que chacun-e a des spécificités et des spécialités. Et que l’on peut en tirer de nombreuses richesses, dans le respect et la reconnaissance de celles-ci et non pas dans l’imitation et dans l’appropriation.


 D’un bout à l’autre de la manifestation, se font entendre le bruit et le vacarme de la colère et de la révolte. Sur les pancartes trônent des messages engagés et solidaires: « Soyez écolos, plantez des riches », « Nous sommes les voix de celles qui n’en ont pas – Free Palestine », « Viva la vulva », « Pas de fachos dans nos quartiers – pas de quartier pour les fachos », « Contre l’utilisation raciste de nos luttes féministes », « Justice pour les incesté-es » ou encore « Mon corps mon choix », « On te croit », « Un silence n’est pas un oui – Un viol n’est jamais un accident » et « Destruction totale et irrévocable du patriarcat – BADABOUM ». Les mines sont enjouées, les poings levés, les corps dansent et les percussions vibrent et résonnent dans un espace public animé par les luttes féministes.
D’un bout à l’autre de la manifestation, se font entendre le bruit et le vacarme de la colère et de la révolte. Sur les pancartes trônent des messages engagés et solidaires: « Soyez écolos, plantez des riches », « Nous sommes les voix de celles qui n’en ont pas – Free Palestine », « Viva la vulva », « Pas de fachos dans nos quartiers – pas de quartier pour les fachos », « Contre l’utilisation raciste de nos luttes féministes », « Justice pour les incesté-es » ou encore « Mon corps mon choix », « On te croit », « Un silence n’est pas un oui – Un viol n’est jamais un accident » et « Destruction totale et irrévocable du patriarcat – BADABOUM ». Les mines sont enjouées, les poings levés, les corps dansent et les percussions vibrent et résonnent dans un espace public animé par les luttes féministes. Intitulé L’art de la joie en femmage à l’œuvre littéraire de Goliarda Sapienza, le projet est aujourd’hui porté par la Brave Compagnie « mais il est parti d’une initiative collective et amicale », précise Johanna Rocard, co-fondatrice de la structure, aux côtés d’Estelle Chaigne et Amandine Braud. « En 2023, on s’est retrouvées à plusieurs dans la manif du 8 mars. Il y avait moins de mobilisation cette année-là, ce qui s’explique par la guerre en Ukraine et les actus qui se priorisent… On n’était pas très fières de notre engagement, on était un peu à la va vite », poursuit-elle.
Intitulé L’art de la joie en femmage à l’œuvre littéraire de Goliarda Sapienza, le projet est aujourd’hui porté par la Brave Compagnie « mais il est parti d’une initiative collective et amicale », précise Johanna Rocard, co-fondatrice de la structure, aux côtés d’Estelle Chaigne et Amandine Braud. « En 2023, on s’est retrouvées à plusieurs dans la manif du 8 mars. Il y avait moins de mobilisation cette année-là, ce qui s’explique par la guerre en Ukraine et les actus qui se priorisent… On n’était pas très fières de notre engagement, on était un peu à la va vite », poursuit-elle. Au cours des deux semaines, l’événement a proposé des journées en accès libre et des temps d’aide à la couture, des ateliers cagoules ou chorales et des créneaux pour accueillir des structures partenaires comme le GPAS et les enfants de Maurepas. « Ce sont des publics qu’on ne toucherait pas sans ce lieu dédié. Il y a par exemple des femmes d’un certain âge qui sont venues à un atelier et sont revenues ensuite. On aurait aimé aussi faire quelque chose avec les femmes de la prison de Rennes, qu’elles puissent porter leurs voix et manifester avec nous mais c’est tombé à l’eau », souligne Cassandre, plasticienne investie dans L’art de la joie.
Au cours des deux semaines, l’événement a proposé des journées en accès libre et des temps d’aide à la couture, des ateliers cagoules ou chorales et des créneaux pour accueillir des structures partenaires comme le GPAS et les enfants de Maurepas. « Ce sont des publics qu’on ne toucherait pas sans ce lieu dédié. Il y a par exemple des femmes d’un certain âge qui sont venues à un atelier et sont revenues ensuite. On aurait aimé aussi faire quelque chose avec les femmes de la prison de Rennes, qu’elles puissent porter leurs voix et manifester avec nous mais c’est tombé à l’eau », souligne Cassandre, plasticienne investie dans L’art de la joie. UN LIEU VIVANT ET JOYEUX
UN LIEU VIVANT ET JOYEUX Cassandre, ce jour-là, s’affaire à la couture pour terminer sa bannière : « J’avais un slogan en tête mais je ne savais pas comment le mettre en forme. Sans compter qu’on ne se rend pas compte le temps que ça prend, c’est très long ! » Sur un tissu orange, elle inscrit et ajuste le message, lettre bleue par lettre bleue : « Aux violeurs de Gisèle et aux autres nous n’oublierons jamais vos visages ni vos noms ni vos actions » Pour elle, ce lieu est important : « Si on ne l’avait pas, il n’existerait pas ! » Cet endroit, c’est un espace de rencontres et de partages. De mutualisation du matériel et des compétences. D’engagement et de militantisme.
Cassandre, ce jour-là, s’affaire à la couture pour terminer sa bannière : « J’avais un slogan en tête mais je ne savais pas comment le mettre en forme. Sans compter qu’on ne se rend pas compte le temps que ça prend, c’est très long ! » Sur un tissu orange, elle inscrit et ajuste le message, lettre bleue par lettre bleue : « Aux violeurs de Gisèle et aux autres nous n’oublierons jamais vos visages ni vos noms ni vos actions » Pour elle, ce lieu est important : « Si on ne l’avait pas, il n’existerait pas ! » Cet endroit, c’est un espace de rencontres et de partages. De mutualisation du matériel et des compétences. D’engagement et de militantisme.  Ensemble, elles investissent un espace résolument engagé, un militantisme féministe « au croisement très clair des luttes décoloniales, queer et migrantes », au service et en soutien du mouvement collectif. Elle le dit : « On ne théorise pas plus que ça dans ce lieu de création. On ne fait pas le travail de NousToutes 35, du Cridev et des autres associations qui à l’année font un travail de fond que l’on vient ici soutenir et rendre visible. » Elle aborde le contexte actuel, l’importance et l’impact des images, le besoin et l’intérêt de créer des visuels joyeux. Proposer un cortège flamboyant et lumineux pour affirmer les éléments positifs existants dans la société. Valoriser les savoir-faire et les joies partagées : « Il y a des choses qui vont mal mais il n’y a pas que ça. Face à l’effet de sidération que nous apporte l’actualité, c’est important de visibiliser toutes les personnes qui font des choses incroyables, dans ce travail de la forme et de la création. »
Ensemble, elles investissent un espace résolument engagé, un militantisme féministe « au croisement très clair des luttes décoloniales, queer et migrantes », au service et en soutien du mouvement collectif. Elle le dit : « On ne théorise pas plus que ça dans ce lieu de création. On ne fait pas le travail de NousToutes 35, du Cridev et des autres associations qui à l’année font un travail de fond que l’on vient ici soutenir et rendre visible. » Elle aborde le contexte actuel, l’importance et l’impact des images, le besoin et l’intérêt de créer des visuels joyeux. Proposer un cortège flamboyant et lumineux pour affirmer les éléments positifs existants dans la société. Valoriser les savoir-faire et les joies partagées : « Il y a des choses qui vont mal mais il n’y a pas que ça. Face à l’effet de sidération que nous apporte l’actualité, c’est important de visibiliser toutes les personnes qui font des choses incroyables, dans ce travail de la forme et de la création. » Si l’événement s’empare des codes et valeurs de la tradition carnavalesque et de sa manière de se costumer pour dénoncer et critiquer les systèmes de domination, les participant-es s’approprient l’expérience. « J’ai longtemps été dans le collectif Mardi Gras et pour moi, ce que l’on fait là est un peu différent. Au Carnaval, on renverse les situations et on s’autorise à être qui on n’est pas. Ici, je me sens très moi-même au contraire ! La symbolique est différente et je ne porte pas de la même manière le costume au carnaval qu’au 8 mars », analyse Sophie. C’est une forme d’exutoire qui lui donne accès à son identité et sa personnalité, hors des injonctions sociales et patriarcales : « J’ai l’impression d’être moi-même, d’être une version de moi-même que je ne peux pas incarner tous les jours parce qu’elle est trop intense cette version ! » Bas les masques, désactivés les filtres du quotidien. Pour Sophie, c’est un sentiment de grand soulagement. En enfilant le costume, elle a la sensation de révéler qui elle est :
Si l’événement s’empare des codes et valeurs de la tradition carnavalesque et de sa manière de se costumer pour dénoncer et critiquer les systèmes de domination, les participant-es s’approprient l’expérience. « J’ai longtemps été dans le collectif Mardi Gras et pour moi, ce que l’on fait là est un peu différent. Au Carnaval, on renverse les situations et on s’autorise à être qui on n’est pas. Ici, je me sens très moi-même au contraire ! La symbolique est différente et je ne porte pas de la même manière le costume au carnaval qu’au 8 mars », analyse Sophie. C’est une forme d’exutoire qui lui donne accès à son identité et sa personnalité, hors des injonctions sociales et patriarcales : « J’ai l’impression d’être moi-même, d’être une version de moi-même que je ne peux pas incarner tous les jours parce qu’elle est trop intense cette version ! » Bas les masques, désactivés les filtres du quotidien. Pour Sophie, c’est un sentiment de grand soulagement. En enfilant le costume, elle a la sensation de révéler qui elle est :
 Créé fin 2022, le spectacle Désirs Plurielles nait d’une enquête réalisée auprès de 25 femmes et d’une nécessité personnelle, ressentie par Anne-Laure Paty. « En 2020, on a lancé le projet autour d’une grille d’entretiens abordant la question des femmes et de leur relation aux désirs à travers l’axe du transgénérationnel, du rapport à la transgression et du vécu », souligne la comédienne. Résultat : 25 témoignages, 40 heures de dérush… et une matrice globale pour écrire le spectacle. Elle poursuit : « Après ma première grossesse, le sujet du désir était très compliqué pour moi. J’ai fait une thérapie et c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse un spectacle ! » Dire sa relation au désir passe aussi par l’exploration des ressentis d’autres femmes. Parce que si ce rapport au désir est intime, il relève également d’une expérience collective pour les jeunes filles et femmes grandissant et se construisant dans une société patriarcale.
Créé fin 2022, le spectacle Désirs Plurielles nait d’une enquête réalisée auprès de 25 femmes et d’une nécessité personnelle, ressentie par Anne-Laure Paty. « En 2020, on a lancé le projet autour d’une grille d’entretiens abordant la question des femmes et de leur relation aux désirs à travers l’axe du transgénérationnel, du rapport à la transgression et du vécu », souligne la comédienne. Résultat : 25 témoignages, 40 heures de dérush… et une matrice globale pour écrire le spectacle. Elle poursuit : « Après ma première grossesse, le sujet du désir était très compliqué pour moi. J’ai fait une thérapie et c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse un spectacle ! » Dire sa relation au désir passe aussi par l’exploration des ressentis d’autres femmes. Parce que si ce rapport au désir est intime, il relève également d’une expérience collective pour les jeunes filles et femmes grandissant et se construisant dans une société patriarcale. 

 Point de départ de l’histoire, le viol n’est pas directement au centre du spectacle qui s’attache, avec rage et panache, à valoriser la quête de Paillette vers la résilience. Pour cela, elle sera accompagnée de la resplendissante sirène, aux gros jambons, à l’allure décapante et aux airs de diva. Dans l’océan de larmes, le trou, le chemin qui pue, le pays magique… Paillette le dit : « Il ne faut pas mourir, je ne courberais pas l’échine. » Annihiler la souffrance. La faire disparaitre. La nier pour ne plus y penser. La colère, contre la culture du viol. L’ivresse, pour s’en échapper et ne plus étouffer. Mais même dans un pays enchanté, sans grues et sans mort-e-s, Paillette est hantée par les questions incessantes et culpabilisantes. Se justifier. Sans arrêt. Elle, la femme qui jouit sans honte et sans détour, la femme qui prend le mic’ face à un gang de mecs qui rappent, la femme qui n’a pas peur de se lancer à l’aventure, d’assouvir ses désirs et de l’ouvrir… Elle se perd. Ne sait plus ce qu’elle veut. Assaillie par la dureté des jugements, elle manque de souffle dans un univers qu’elle croyait bon mais qu’elle découvre nauséabond. Dès lors, une seule obsession : retrouver Cindy.
Point de départ de l’histoire, le viol n’est pas directement au centre du spectacle qui s’attache, avec rage et panache, à valoriser la quête de Paillette vers la résilience. Pour cela, elle sera accompagnée de la resplendissante sirène, aux gros jambons, à l’allure décapante et aux airs de diva. Dans l’océan de larmes, le trou, le chemin qui pue, le pays magique… Paillette le dit : « Il ne faut pas mourir, je ne courberais pas l’échine. » Annihiler la souffrance. La faire disparaitre. La nier pour ne plus y penser. La colère, contre la culture du viol. L’ivresse, pour s’en échapper et ne plus étouffer. Mais même dans un pays enchanté, sans grues et sans mort-e-s, Paillette est hantée par les questions incessantes et culpabilisantes. Se justifier. Sans arrêt. Elle, la femme qui jouit sans honte et sans détour, la femme qui prend le mic’ face à un gang de mecs qui rappent, la femme qui n’a pas peur de se lancer à l’aventure, d’assouvir ses désirs et de l’ouvrir… Elle se perd. Ne sait plus ce qu’elle veut. Assaillie par la dureté des jugements, elle manque de souffle dans un univers qu’elle croyait bon mais qu’elle découvre nauséabond. Dès lors, une seule obsession : retrouver Cindy. Paillette, protagoniste et artiste créatrice, s’affranchit des codes et des étiquettes. Elle convoque les émotions, les paroles, les styles, les notions et les concepts, les secoue et se les approprie. Ne pas déranger. Ne pas faire de bruit. Ne pas bouleverser l’ordre établi. Ne pas baigner dans la vulgarité. Ne pas déborder. Paillette et Sirène envoient tout péter. Elles prennent leur place et leur espace, elles vont trop loin, elles sombrent dans la caricature, elles crient, elles tapent des pieds, elles éclatent les carcans de leur condition de femmes, elles ne revendiquent pas un engagement en particulier. Elles disent, elles font, elles cherchent, elles questionnent, elles avancent, elles s’aident, elles expérimentent et ressentent, elles s’accompagnent, elles nous embarquent avec elles, dans leurs peurs, angoisses, combats, forces, singularités, univers artistiques, succès, etc. Et on plonge. On plonge avec elles dans le trou. On tombe dans le désarroi et la solitude et on comble le vide et le trauma. On remonte à la surface, avec la puissance de l’espoir et la force de la sororité. On se délecte de cette proposition sensible qui explore les recoins d’une âme en souffrance sur le chemin de la résilience. Avec son lot de doutes, de contradictions, de faiblesses, de déni mais aussi de forces, de capacités à rebondir, à s’adapter et à sublimer et à nuancer la noirceur de la réalité. Sans la renier. Ne pas juste survivre. Remonter à la surface, respirer et vivre.
Paillette, protagoniste et artiste créatrice, s’affranchit des codes et des étiquettes. Elle convoque les émotions, les paroles, les styles, les notions et les concepts, les secoue et se les approprie. Ne pas déranger. Ne pas faire de bruit. Ne pas bouleverser l’ordre établi. Ne pas baigner dans la vulgarité. Ne pas déborder. Paillette et Sirène envoient tout péter. Elles prennent leur place et leur espace, elles vont trop loin, elles sombrent dans la caricature, elles crient, elles tapent des pieds, elles éclatent les carcans de leur condition de femmes, elles ne revendiquent pas un engagement en particulier. Elles disent, elles font, elles cherchent, elles questionnent, elles avancent, elles s’aident, elles expérimentent et ressentent, elles s’accompagnent, elles nous embarquent avec elles, dans leurs peurs, angoisses, combats, forces, singularités, univers artistiques, succès, etc. Et on plonge. On plonge avec elles dans le trou. On tombe dans le désarroi et la solitude et on comble le vide et le trauma. On remonte à la surface, avec la puissance de l’espoir et la force de la sororité. On se délecte de cette proposition sensible qui explore les recoins d’une âme en souffrance sur le chemin de la résilience. Avec son lot de doutes, de contradictions, de faiblesses, de déni mais aussi de forces, de capacités à rebondir, à s’adapter et à sublimer et à nuancer la noirceur de la réalité. Sans la renier. Ne pas juste survivre. Remonter à la surface, respirer et vivre.

 Elles les font vivre. Elles les font vibrer, ces femmes qui constituent ce que l’on nomme le matrimoine. C’est-à-dire ce qui nous vient des mères. Des femmes. Dire qui elles sont, mettre en lumière des filles et des femmes d’âges et de champs d’explorations différents, aussi que d’époques et d’origines différentes, c’est rétablir cette Histoire arrachée, confisquée, déformée.
Elles les font vivre. Elles les font vibrer, ces femmes qui constituent ce que l’on nomme le matrimoine. C’est-à-dire ce qui nous vient des mères. Des femmes. Dire qui elles sont, mettre en lumière des filles et des femmes d’âges et de champs d’explorations différents, aussi que d’époques et d’origines différentes, c’est rétablir cette Histoire arrachée, confisquée, déformée. Y compris pour les deux créatrices de ces lectures théâtralisées. « Ça m’a fait avancer dans mon féminisme. Découvrir toutes ces histoires extraordinaires, ça permet de réaliser le combat de certaines femmes… Et d’être plus vigilantes à ne pas se faire substituer sa place. Ça provoque aussi des questionnements. Chaque portrait m’interroge à un endroit différent. Quand on prend l’exemple de Wu Zetian, première femme régnante en Chine au 7esiècle, on pense à la résonnance avec aujurd’hui, où on assiste pour la première fois en France à une quasi mixité aux élections présidentielles… On peut presque tout ramener à aujourd’hui. », s’enthousiasme Lety Pardalis.
Y compris pour les deux créatrices de ces lectures théâtralisées. « Ça m’a fait avancer dans mon féminisme. Découvrir toutes ces histoires extraordinaires, ça permet de réaliser le combat de certaines femmes… Et d’être plus vigilantes à ne pas se faire substituer sa place. Ça provoque aussi des questionnements. Chaque portrait m’interroge à un endroit différent. Quand on prend l’exemple de Wu Zetian, première femme régnante en Chine au 7esiècle, on pense à la résonnance avec aujurd’hui, où on assiste pour la première fois en France à une quasi mixité aux élections présidentielles… On peut presque tout ramener à aujourd’hui. », s’enthousiasme Lety Pardalis.
 Dans les musiques actuelles et les musiques traditionnelles, on retrouve les plus grosses inégalités avec des chiffres choquants : sur 562 concerts étudiés, 3 se sont déroulés sans aucun homme et 71 sans aucune femme. Soit 12,5% des concerts sans femmes.
Dans les musiques actuelles et les musiques traditionnelles, on retrouve les plus grosses inégalités avec des chiffres choquants : sur 562 concerts étudiés, 3 se sont déroulés sans aucun homme et 71 sans aucune femme. Soit 12,5% des concerts sans femmes.


 C’est une véritable prouesse technique qu’elles entreprennent à plusieurs reprises sur le plateau du TNB, du 28 au 30 janvier. Il y a quasiment un an, les membres de Paradox-sal dévoilaient pour la première fois Queen blood à Rennes, après deux semaines de résidence au Garage, avant de présenter officiellement la création à La Villette à Paris, fin mars 2019.
C’est une véritable prouesse technique qu’elles entreprennent à plusieurs reprises sur le plateau du TNB, du 28 au 30 janvier. Il y a quasiment un an, les membres de Paradox-sal dévoilaient pour la première fois Queen blood à Rennes, après deux semaines de résidence au Garage, avant de présenter officiellement la création à La Villette à Paris, fin mars 2019. « J’ai souvent fait partie de groupes essentiellement masculins. Je travaillais avec des filles comme Allauné Blegbo et Anaïs Imbert-Clery, elles m’ont parlé d’autres filles qu’elles connaissaient, etc. La house, c’est très androgyne. Le talent est là, peu importe le sexe. Ce que je veux avec elles, c’est apprendre et échanger. Pas diriger. Ce qui m’intéresse, c’est de décortiquer les états de corps. C’est la gestuelle, pas le corps finalement. », analyse-t-il.
« J’ai souvent fait partie de groupes essentiellement masculins. Je travaillais avec des filles comme Allauné Blegbo et Anaïs Imbert-Clery, elles m’ont parlé d’autres filles qu’elles connaissaient, etc. La house, c’est très androgyne. Le talent est là, peu importe le sexe. Ce que je veux avec elles, c’est apprendre et échanger. Pas diriger. Ce qui m’intéresse, c’est de décortiquer les états de corps. C’est la gestuelle, pas le corps finalement. », analyse-t-il.
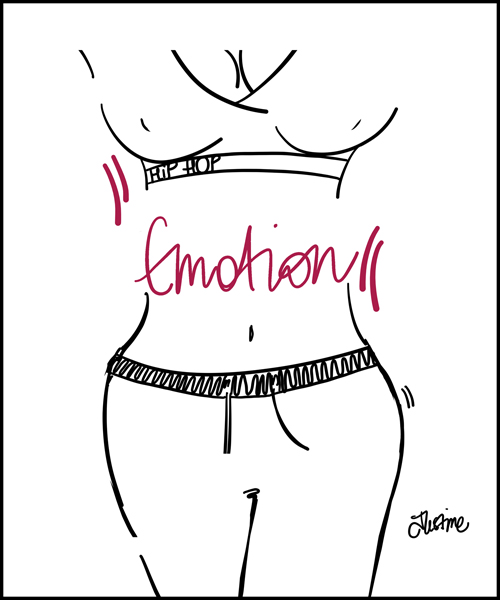 En août 2019, un collectif d’acteurs des cultures urbaines publie une tribune dans Le Monde, appelant à « s’inspirer du hip-hop, né dans la rue et qui n’exclut personne, pour réconcilier une société française en morceaux. »
En août 2019, un collectif d’acteurs des cultures urbaines publie une tribune dans Le Monde, appelant à « s’inspirer du hip-hop, né dans la rue et qui n’exclut personne, pour réconcilier une société française en morceaux. »  Et ce quelque chose, c’est une Block Party. Ça éclot dans différents secteurs de la ville : les DJs organisent des soirées en bas des immeubles et repèrent que c’est au moment du solo du batteur ou du percussionniste que les gens se mettent à danser. Ils vont rapidement se mettre à isoler ces parties, appelées « break », afin de créer des boucles avec ces morceaux : « Ça donne naissance au break et à la musique hip-hop ».
Et ce quelque chose, c’est une Block Party. Ça éclot dans différents secteurs de la ville : les DJs organisent des soirées en bas des immeubles et repèrent que c’est au moment du solo du batteur ou du percussionniste que les gens se mettent à danser. Ils vont rapidement se mettre à isoler ces parties, appelées « break », afin de créer des boucles avec ces morceaux : « Ça donne naissance au break et à la musique hip-hop ». Aujourd’hui, la compagnie compte une vingtaine de créations à son actif et des milliers de représentations et d’ateliers. Le hip-hop prend racine et poursuit son chemin.
Aujourd’hui, la compagnie compte une vingtaine de créations à son actif et des milliers de représentations et d’ateliers. Le hip-hop prend racine et poursuit son chemin.
 Depuis, avec sa compagnie Par Terre, elle a chorégraphié de nombreux spectacles, largement salués par la critique. « Avant ça, j’ai fait du journalisme. Analyser, parler, vient avant de chorégraphier. C’est important car le milieu de la danse est atypique, libre. Les gens qui en font partie s’expriment rarement. Personnellement, j’ai toujours été frustrée qu’il y ait une vision faussée du hip-hop dans les journaux. Cette vision d’une danse réduite à une danse de cités. Je me suis posée en défenseure des valeurs du hip-hop pour dire « Parlons de danse, parlons des artistes, parlons des principes. » Ce que je veux, c’est sortir, à travers la danse, l’essence des différents styles. Le hip-hop, ce n’est pas juste des jeunes des cités qui n’ont rien d’autre à faire. Il y a un état transcendantal quand ils dansent. Ce sont des êtres humains qui font des choses profondes. C’est un langage pour exprimer quelque chose de plus universel. », scande-t-elle.
Depuis, avec sa compagnie Par Terre, elle a chorégraphié de nombreux spectacles, largement salués par la critique. « Avant ça, j’ai fait du journalisme. Analyser, parler, vient avant de chorégraphier. C’est important car le milieu de la danse est atypique, libre. Les gens qui en font partie s’expriment rarement. Personnellement, j’ai toujours été frustrée qu’il y ait une vision faussée du hip-hop dans les journaux. Cette vision d’une danse réduite à une danse de cités. Je me suis posée en défenseure des valeurs du hip-hop pour dire « Parlons de danse, parlons des artistes, parlons des principes. » Ce que je veux, c’est sortir, à travers la danse, l’essence des différents styles. Le hip-hop, ce n’est pas juste des jeunes des cités qui n’ont rien d’autre à faire. Il y a un état transcendantal quand ils dansent. Ce sont des êtres humains qui font des choses profondes. C’est un langage pour exprimer quelque chose de plus universel. », scande-t-elle. 
 Dans un second temps, c’est en regardant de nombreux documentaires qu’elle va créer Icône : « Je voyais un côté très sombre de l’être humain et j’en voulais à la terre entière de toutes ces injustices. C’était une période très dure et j’en voulais aux icônes d’aujourd’hui, mis et mises en avant mais qui n’aident pas le commun des mortel-le-s. »
Dans un second temps, c’est en regardant de nombreux documentaires qu’elle va créer Icône : « Je voyais un côté très sombre de l’être humain et j’en voulais à la terre entière de toutes ces injustices. C’était une période très dure et j’en voulais aux icônes d’aujourd’hui, mis et mises en avant mais qui n’aident pas le commun des mortel-le-s. » Cet après-midi là, entourée de Lise Marie Barry, régisseuse lumières qui la guide dans ses placements, et de Joss Carter, son binôme au démarrage du spectacle qui l’accompagne dans ses intentions et ses attitudes masculines lorsqu’elle est encore « too girly », elle engage tout son être pour atteindre les états de corps et de psyché nécessaires à cette incroyable performance qui nous frappe de son intensité.
Cet après-midi là, entourée de Lise Marie Barry, régisseuse lumières qui la guide dans ses placements, et de Joss Carter, son binôme au démarrage du spectacle qui l’accompagne dans ses intentions et ses attitudes masculines lorsqu’elle est encore « too girly », elle engage tout son être pour atteindre les états de corps et de psyché nécessaires à cette incroyable performance qui nous frappe de son intensité.



 En Matriarcate, on sait soigner l’endométriose, les femmes ne souffrent plus de douleurs menstruelles, les hommes développent des tas de complexes et un des plus gros tabous est l’érection hors mariage. « Mais vous avez quand même des privilèges les copains, on vous ouvre la porte quand vous passez ! », scande Typhaine D. cynique à souhait.
En Matriarcate, on sait soigner l’endométriose, les femmes ne souffrent plus de douleurs menstruelles, les hommes développent des tas de complexes et un des plus gros tabous est l’érection hors mariage. « Mais vous avez quand même des privilèges les copains, on vous ouvre la porte quand vous passez ! », scande Typhaine D. cynique à souhait. Tout ce qu’elle relate est affreux, dans les faits. Mais qu’est-ce qu’elle les met bien en perspective ! On est ébahi-e-s par sa prestation et par l’énergie que ça dégage et procure dans la salle. Elle contrecarre les discours haineux visant à réduire les féministes à des hystériques rabat-joie et pointent toutes les dissonances de nos sociétés actuelles en matière d’égalité femmes-hommes.
Tout ce qu’elle relate est affreux, dans les faits. Mais qu’est-ce qu’elle les met bien en perspective ! On est ébahi-e-s par sa prestation et par l’énergie que ça dégage et procure dans la salle. Elle contrecarre les discours haineux visant à réduire les féministes à des hystériques rabat-joie et pointent toutes les dissonances de nos sociétés actuelles en matière d’égalité femmes-hommes. 



 À base de pigments naturels de couleur, de pâte de riz et de chaux, les peintures faciales peuvent demander plusieurs heures de préparation. Parce qu’il en va là de la symbolique des personnages. Sur le tapis tressé voisin, la chorégraphe Brigitte Chataignier, assise en tailleur, écouteurs fixés aux oreilles, se concentre sur les mouvements qu’elle va devoir effectuer.
À base de pigments naturels de couleur, de pâte de riz et de chaux, les peintures faciales peuvent demander plusieurs heures de préparation. Parce qu’il en va là de la symbolique des personnages. Sur le tapis tressé voisin, la chorégraphe Brigitte Chataignier, assise en tailleur, écouteurs fixés aux oreilles, se concentre sur les mouvements qu’elle va devoir effectuer.
 Exceptions faites pour les femmes étrangères, comme nous le dira Brigitte Chataignier lors de l’atelier qu’elle animait avec Djeya Lestrehan, au Triangle, dans l’après-midi du 27 janvier.
Exceptions faites pour les femmes étrangères, comme nous le dira Brigitte Chataignier lors de l’atelier qu’elle animait avec Djeya Lestrehan, au Triangle, dans l’après-midi du 27 janvier.
 Autre code qui sert de référence au public : le maquillage. On reconnaitra la valeur d’un personnage à la couleur prédominante de son visage. Le vert pour les personnages nobles et vertueux, le vert et le rouge pour les personnages ambivalents (héroïques mais avec un ego surdimensionné), le noir pour les chasseurs cruels et sauvages, le rouge pour les démons, le jaune pour les personnages féminins.
Autre code qui sert de référence au public : le maquillage. On reconnaitra la valeur d’un personnage à la couleur prédominante de son visage. Le vert pour les personnages nobles et vertueux, le vert et le rouge pour les personnages ambivalents (héroïques mais avec un ego surdimensionné), le noir pour les chasseurs cruels et sauvages, le rouge pour les démons, le jaune pour les personnages féminins.
 « Ça demande beaucoup de force mais si elle arrive à un certain niveau, oui, c’est possible. Mais il y en a très peu. On peut accéder à tout si on assume ce que l’on fait. Si on sert l’art, il n’y aura pas de problème. Les femmes en Inde sont très respectées dans ce milieu-là mais après, il faut avoir envie de se retrouver seule au milieu uniquement d’hommes. Faut être bien dans ces baskets, ce n’est pas évident… »
« Ça demande beaucoup de force mais si elle arrive à un certain niveau, oui, c’est possible. Mais il y en a très peu. On peut accéder à tout si on assume ce que l’on fait. Si on sert l’art, il n’y aura pas de problème. Les femmes en Inde sont très respectées dans ce milieu-là mais après, il faut avoir envie de se retrouver seule au milieu uniquement d’hommes. Faut être bien dans ces baskets, ce n’est pas évident… »
