Célian Ramis
Danse : Animées par le mouvement


Cette phrase de Pina Bausch, danseuse et chorégraphe allemande, grande figure de la danse contemporaine, résonne en tout un chacun. « Dansez, sinon nous sommes perdus », comme une nécessité, une urgence, un besoin… Pourquoi ? Certainement parce que la danse n’a pas de parole. Chaque corps en mouvement est alors invité à inventer son propre langage, sa propre manière de s’exprimer et surtout à prendre conscience de cette enveloppe charnelle et osseuse et des possibilités offertes par cette dernière. Il est ainsi évident que cet art s’impose comme tisseur de lien social, levier d’insertion et créateur d’ouverture sur la société. Au croisement des genres et des cultures, la danse nous a transporté ce mois-ci dans une valse enivrante et bienveillante, libératrice, et parfois réparatrice de corps et esprits meurtris par les épreuves de la vie.
Les danses en couple, avec ou sans échange de partenaire, répondent à l’appellation de danses sociales, dites aussi danses de société. Un terme qui interpelle. À partir de là, la réflexion est lancée : la pratique de la danse serait un art social, levier d’insertion et créateur de lien entre les individus.

Dimanche 3 mai, de timides rayons de soleil percent les nuages flottant au dessus de la capitale bretonne. Cet après-midi là, l’ancien Champs de Mars est devenu l’esplanade dansante des pratiques amateures, entremêlées aux performances professionnelles. Cercles de danses urbaines, rondes bretonnes et celtiques, entrainements collectifs… Fous de danse, manifestation initiée par le Musée de la danse, a réussi son coup d’une main de maitre à l’occasion des Premiers dimanches aux Champs Libres, réunissant des milliers de Rennaises et de Rennais au cœur d’une piste de danse éphémère et fédératrice.
Quel attrait pour cette pratique artistique ? Quelles actions développer pour maintenir et susciter du lien et de l’échange entre les populations ? Décryptage d’un langage sociétal, personnel et universel.
PRENDRE CONSCIENCE DE SON CORPS
« Ces ateliers permettent d’avoir conscience de son corps, ce qui permet de reprendre confiance en soi, et au niveau social de rencontrer des gens, d’être plus à l’aise dans la relation avec les autres. », explique Sandra, entourée de Lucie et Ségolène, et rapidement rejointe par Stéphanie qui apprécie également de travailler « sur les sensations que l’on peut ressentir dans son corps alors que l’on avait pu se mettre en pilote automatique et que l’on ne prenait plus le temps de se poser, de ressentir notre corps. »
Ces ateliers, ce sont ceux proposés par l’association Danse à tous les étages – implantée à Rennes et à Brest - dans le cadre du programme Les Créatives (existant aussi à Brest, Morlaix et Guichen) à destination des femmes en situation de précarité et en recherche d’emploi. Ce matin du 9 avril, les participantes arrivent au compte goutte au Garage, prêtes à travailler sur le spectacle « Temps de pose » qu’elles dévoileront au public le 19 mai, au Triangle.
Deux fois par semaine, depuis le mois de mars, elles se réunissent et à travers les techniques artistiques de la danse contemporaine, enseignées et transmises par la chorégraphe Anne-Karine Lescop – en binôme avec le photographe Richard Louvet - pour cette 11e édition, composent des enchainements nourris par leurs émotions, leurs envies et leurs motivations diverses.
Au fil de cette expérience, elles prennent conscience de leurs capacités à créer un projet et à le faire aboutir.
« La notion d’engagement est importante. Participer aux Créatives permet de se dire que l’on est capables, de prendre confiance en nos capacités pour ensuite peut-être accéder à une formation ou à un boulot. En tout cas, cela nous remobilise autour d’un projet, c’est très intéressant »
concède volontairement Lucie.
Engagement et remobilisation, deux termes qui reviennent souvent dans la bouche de Malika Teneur, coordinatrice 35 au sein de Danse à tous les étages : « Les Créatives, c’est une étape pour continuer leurs parcours, un tremplin. Certaines lancent des projets, d’autres trouvent du travail, pour d’autres encore ce sont des souvenirs et des émotions. Il y en a qui abandonnent, ce n’était pas le bon moment pour elles. »
Des femmes de différents âges, milieux sociaux, avec des histoires diverses, accompagnées et orientées vers ces ateliers par des structures partenaires de l’association, que ce soit Pôle emploi, Fil Rouge, le CIDFF, le CCAS, ou encore le CDAS, pour n’en citer que quelques uns. En amont, des réunions d’informations sont organisées, et tout au long de l’expérience, les participantes sont régulièrement amenées à s’entretenir avec les référents associatifs, sociaux et professionnels.
L’ART DE L’EXIGENCE
Mettre la danse contemporaine au cœur d’un accompagnement socioprofessionnel n’est pas un hasard. Au-delà de la confiance acquise et de la valorisation éprouvée, c’est une reconstruction personnelle qui est engagée, basée sur un ressenti interne et intime, délayée dans un langage collectif et commun. Les participantes, pour certaines dubitatives au départ de l’approche contemporaine, parlent maintenant de « liberté », de « relâchement », de « moments d’échange ». Et apprécient l’exigence requise par la chorégraphe « qui sait bien ce qu’elle veut », sourit Ségolène, et « qui attache beaucoup d’importance à la dimension de sensation ».
Concentration, rigueur et dépassement de soi transparaissent lors de cette matinée de travail. Les danseuses avancent et reculent lentement, passant de la pénombre à la lumière, du regard fuyant au regard déterminé. Arrivées à quelques mètres des gradins, elles posent, dévoilent des figures travaillées, en constante évolution d’un aller à un autre, montant en intensité. « Le regard, il est où ? La pose, il faut la montrer… Tu poses pour un peintre, il y a une relation à l’autre ! Voilà, c’est bien, très bien. », commente Anne-Karine Lescop. Alice, à l’entrée remarquée pour son retard, s’agace de ne pas réussir à entreprendre ce qu’elle voudrait. Ramenée sur la scène par une autre danseuse, elle poursuit néanmoins l’exercice.
« Il faut qu’elles apprennent à concilier les ateliers à la vie quotidienne, à être à l’heure, à s’investir dans les projets pour lesquels elles s’engagent. En général, ça se passe bien, un noyau dur se forme lors des premiers ateliers et puis nous essayons de créer des groupes hétérogènes avec des personnalités qui peuvent s’entendre. On se demande principalement à qui cela sera le plus bénéfique, qui a envie de travailler sur son projet personnel, toujours dans l’idée d’une insertion professionnelle », détaille Malika Teneur.
L’AFFIRMATION DE SOI
Même discours du côté de Portraits en mouvement, autre initiative de Danse à tous les étages. Des ateliers proposés de novembre à fin mai – pour une représentation en juin - à Brest et à Rennes, à destination des 16-25 ans en situation de décrochage scolaire ou professionnel, toujours en partenariat avec des structures socio-professionnelles, telles que la Mission locale, la Mission d’insertion des jeunes de l’enseignement catholique de Rennes, l’Afpa, etc.
Un jeudi après-midi d’avril, 4 jeunes s’entrainent à la MJC Bréquigny avec le chorégraphe Fadil Kasri, co-fondateur en 2004 de la compagnie Eskemm (échange en breton) basée à Lorient, qui réunit danse contemporaine et danse hip-hop. « Avec Karine Le Bris, on développe nos créations autour d’échanges. Nous avons travaillé avec un comédien, fait un spectacle avec des marionnettes, intégré la Langue des Signes… Et nous travaillons quasiment toujours avec des publics amateurs. », explique ce Rennais d’origine qui a découvert le hip-hop à la télé en 1983.
Alors âgé de 14 ans, il suit les 42 leçons données par l’animateur Sydney. Il avait déjà eu un attrait pour la danse, sept ans auparavant avec la série Fame : « Il y avait des mecs qui dansaient et des gens de couleurs ! C’était fou. J’ai voulu faire de la danse jazz mais je ne m’y suis pas retrouvé. »
À cette époque, il fait des détours dans le quartier du Blosne pour aller suivre ses cours de danse, pour ne pas être vu par ses copains, qui eux font du foot. Un autre déclic aura lieu au lycée, il reprend le jazz, mais arrête à nouveau, puis lance un trio avec une connaissance et un camarade de classe et monte sur la scène du Triangle – qu’il a vu se construire lorsqu’il était gamin – et de là commencera à donner des leçons à la Cité de danse. Il oscillera ensuite entre son activité d’animateur, des stages de hip-hop, des groupes qu’il monte, des période sans danser, avant de décider en 1999 de se consacrer à la pratique artistique et de se sentir enfin légitime et reconnu.
« En dansant, on s’affirme. Et le hip-hop a la particularité d’être très accessible, il y a très vite des publics et des corps différents. Personnellement, quand je danse, je ne peux pas tricher. Quand j’ai décidé d’en faire mon métier, j’ai eu comme l’impression de renaitre », confie-t-il.
S’affirmer, se sentir libre et à l’aise dans son corps, décoincer le corps… Voilà ce qu’il veut transmettre aux jeunes qu’il encadre dans cet atelier. Avec la langue des signes, il opte pour une approche ludique des gestes et des mouvements. Une manière de démocratiser la danse « qui n’est pas uniquement spectaculaire pour le hip-hop ou élitiste pour la danse contemporaine ». Mélange de genres et de styles, accélération ou décélération des enchainements, présentation individuelle et collective signée, la palette d’outils de Fadil Kasri est large.
Et le groupe touche de plus en plus à son but avec des danseurs amateurs dont les bustes et mentons se relèvent, dont les langages corporels se personnalisent, s’affinent et se développent et dont les corps se libèrent, malgré quelques réticences passagères ou quelques tensions du quotidien. « Les voir s’affirmer, c’est fort. Dans ce que l’on construit ensemble, il y a une marche commune, des valeurs du vivre ensemble, des identités individuelles, et tout les relie à la fin. », s’émeut le chorégraphe, qui n’hésite pas à les encourager et féliciter ; chose qui n’est pas sans impact sur eux, décontenancés par les compliments et la confiance accordée.
DANS LES PAS DE LA DÉMOCRATISATION
Linda Claire, péruvienne d’origine, installée en France depuis plus de 10 ans, a dû se passer du soutien de sa famille, ne reconnaissant pas la danse comme un métier. Mais depuis son arrivée à Rennes – elle n’avait auparavant reçu qu’une initiation à la danse classique, dispensée par sa mère lorsqu’elle était enfant – elle persévère et puise dans toutes les danses qu’elle découvre, de la salsa au hip-hop, en passant par le flamenco, la samba et la danse contemporaine.
« J’ai fait des études pour rassurer mes parents et m’assurer un diplôme. », déclare-t-elle avant d’ajouter, convaincue, que sa vie réside dans les arts du spectacle. Aujourd’hui, elle navigue entre Rennes et Paris, et évolue principalement dans des compagnies spécialisées dans les danses latines. Mais elle avoue avoir un vrai coup de cœur pour la danse contemporaine, permettant le lien entre techniques, intériorité personnelle et mouvements du corps.
« On peut véritablement le vivre ! », s’enthousiasme-t-elle. Linda Claire est de nature pudique, réservée. Quand elle exécute des enchainements libres, son rapport à l’autre change. Elle incarne alors la passion qu’elle vit au quotidien et se livre sans timidité à l’exercice.
De son côté, Laina Fischbeck n’a jamais connu de réticence familiale face à son choix de vie professionnelle. Rien d’étonnant pour cette américaine de Philadelphie, fille de parents danseurs et fondateurs d’une compagnie en Allemagne, puis au Etats-Unis.
« Ma mère a dansé jusqu’à 7 mois de grossesse quand elle était enceinte de moi. J’ai donc toujours dansé, et même avant de naitre », plaisante-t-elle.
Elle apprend la danse à 4 ans, pratique cet art « à l’école publique, au milieu du ghetto », vit dans le théâtre avec la troupe et entre dans la compagnie de son père, avant de venir s’installer en France et de perpétuer la tradition de la danse en transmettant sa passion à son fils. Aujourd’hui, la danseuse et chorégraphe réunit au sein de sa danse expérimentale, dans la compagnie qu’elle a lancé en 2003 à l’Élaboratoire – D.E.A.D Company (Driving Evolutionary artistic dimensions) - le butô, le condomblé, la capoeira, la danse jazz, le yoga mais aussi la musique, le chant, la sculpture, la vidéo, le théâtre d’objets…
« J’ai toujours pensé que la danse et la musique allaient sauver le monde. C’est la plus vieille langue universelle ! », explique-t-elle, dans le hall du Triangle, structure dans laquelle elle enseigne. La danse est vitale et accessible, physique et spirituelle, outils d’expression inépuisable et inébranlable, langue unique et comprise de tous : « C’est très riche comme art, c’est plein d’échange entre les disciplines, de liberté. Y a pas de cadre, de règle. C’est pour ça que je n’aime pas la catégorie ‘Danse contemporaine’, ça fait chiant, pas accessible. On est trop dans la tête, le conceptuel, alors qu’il s’agit de l’expression du corps. Ça libère les gens, ça sort de la tête justement vers une sorte de transe. Personnellement, quand je suis malade, je danse pour me guérir. »
Plus qu’une pratique sportive et/ou artistique, elle s’en saisit comme un mode de vie. Une vie en communauté, que ce soit avec la troupe de ses parents, avec les gens qu’elle rencontre à l’Élabo – elle vit alors dans une caravane à Talensac – ou dans les stages qu’elle effectue chez l’habitant ou dans la nature. Tout est une histoire de rencontres et de partage, dont l’origine est la danse, et elle y ajoute et croise les disciplines.
Sa prochaine création, Shadows of light, visible le 8 mai au festival de l’Élabo, réunit ainsi la danse, la musique et la sculpture. Une manière de sans cesse enrichir son langage corporel et scénique, mais aussi personnel. « Dans les danses à 2 par exemple, on apprend à écouter l’autre, à donner, à recevoir, à lâcher prise, à faire confiance. Dans le kung-fu, avec le contact, on va apprendre à anticiper par le mouvement. », précise Laina Fischbeck.
UN LANGAGE PERSONNALISÉ
 Ce que décrit cette dernière est précisément ce qui a séduit Marie Houdin, chorégraphe de la compagnie Engrenage depuis 2004, orientée hip-hop funkstyle. Elle pratique la danse depuis ses 8 ans mais découvre le hip-hop à la fin du collège, malgré « une pratique peu répandue à Laval. » Elle se passionne pour son histoire, mais aussi celle de la diaspora africaine, pour les danses afro-américaines et les claquettes.
Ce que décrit cette dernière est précisément ce qui a séduit Marie Houdin, chorégraphe de la compagnie Engrenage depuis 2004, orientée hip-hop funkstyle. Elle pratique la danse depuis ses 8 ans mais découvre le hip-hop à la fin du collège, malgré « une pratique peu répandue à Laval. » Elle se passionne pour son histoire, mais aussi celle de la diaspora africaine, pour les danses afro-américaines et les claquettes.
Et continue encore aujourd’hui d’effectuer des recherches, « notamment sur les danses de la Nouvelle-Orléans, qui n’ont pas forcément de noms, d’étiquettes, mais qui continuent d’exister et de rassembler. » Celle qui s’est entrainé à danser au Colombier ou à la maison de quartier Villejean, en parallèle de ses études dans la capitale bretonne, est happée par l’énergie de la danse, sa spontanéité et surtout par son message :
« Peu importe qui tu es, tu dois t’inventer. Ta place, si tu la veux, il faut te la créer. Ça m’a interpelée. »
La liberté, l’expression, le rapport à la musique, le croisement des danses, l’esprit festif, traditionnel, les rites… Marie Houdin n’est pas avare d’arguments expliquant son épanouissement dans cet art dans lequel elle a inventé son propre langage. Mais surtout qui permet partages et rencontres. « Le spectacle est un prétexte pour les rencontres avec les publics. Le Soul Train ou le Bal funk par exemple ont une visée pédagogique. Et dans le processus de création, notre démarche implique toujours des actions culturelles et de médiation. », souligne la chorégraphe.
Ainsi, les écoles, centres sociaux, les prisons, les maisons de quartier, les MJC, etc. deviennent des laboratoires expérimentaux autour du déracinement, de l’identité et de l’enracinement, comme tel a été le cas avec la création de Roots.
Chaque public, chaque individu, apporte son propre langage, sa propre manière de penser et donc de s’exprimer à travers le corps. Les cultures se mélangent, offrant ainsi des danses métissées, en évolution constante, et ainsi susceptibles d’être accessible à toutes et à tous. À 50 ans, la chorégraphe de la compagnie Erébé Kouliballets, Morgane Rey, croit toujours en la force et la résonnance des rencontres humaines dans l’inspiration à la création.
Que ce soit pour Burkas Gurkkas ou encore Le solo d’amour, des témoignages ont été recueillis auprès de plusieurs femmes faisant état de leur enfermement physique et mental, « sans forcément porter le voile », pour le premier, et de leur histoires d’amour pour le second. « Le lien à l’autre est très fort et très présent dans notre danse. Par exemple, au sein de la compagnie, nous dansons toujours sans miroir. Cela oblige à être présent à soi, aux autres, aux sons… », explique la chorégraphe.
Originaire du Bénin, elle a toujours refusé de s’enfermer dans les danses traditionnelles, souhaitant développer une écriture, un vocabulaire propre à sa compagnie, liant comédiens, musiciens et danseurs. « Il ne faut pas être isolés dans notre tour d’ivoire. Nous faisons partis de l’éducation populaire, nous avons un rôle de citoyen à jouer. », conclut Morgane Rey, qui présentera sa prochaine création Notre terre qui êtes aux cieux, autour des rites funéraires en Afrique, le 9 mai au Garage, à Rennes.
UN LIEN INDÉFECTIBLE
Partir du témoignage pour énoncer un message universel, s’emparer de son rôle d’artiste pour briser les tabous, dénoncer, ou simplement faire parti de la cité, de la société, du monde… C’est aussi la démarche de Mireille Abaka, musicienne et danseuse, et Gladys Tchuimo, chorégraphe et fondatrice de la compagnie Poo-Lek.
Toutes les deux sont nées au Cameroun, se sont rencontrées à Yaoundé, la capitale, et ont décidé de créer le spectacle Plus femme que femme, « pour faire prendre conscience aux femmes du pouvoir qu’elles ont, les amener à comprendre la place qu’elles ont, que dans la douceur, on dépasse la guerre. Ainsi, le sexe fort, il se situe dans la douceur ! », selon Gladys.
En résidence au Triangle tout au long du mois d’avril, elles dévoileront leur création le 28 mai, initieront des training, tous les mercredis, et des spectacles courts hors les murs (principalement dans le quartier du Blosne mais aussi à République) et inviteront les habitant-e-s de Rennes à un temps d’échange intitulé « De Rennes à Yaoundé, le quotidien de femmes d’aujourd’hui », le 20 mai.
« On parle aussi de nous dans le spectacle. La danse permet de dire avec le corps ce que je ne peux pas dire avec la voix »
explique Mireille, qui vient pour la première fois en France.
Ainsi, elles ont rencontré les participantes des Créatives lors d’une discussion : « Elles se sont beaucoup intéressées à la démarche de notre pièce mais aussi aux femmes que nous sommes, c’était un très bon échange. » Les liens se tissent au fur et à mesure, entre les professionnelles, les danseuses amateures et le public, venu assister à un spectacle ou interpelé par des actions culturelles. La danse est un lien indéfectible entre les individus et à l’intérieur même de l’individu.
Emmanuelle Huynh, chorégraphe et fondatrice de la compagnie Mua, est à l’initiative de Cribles, pièce créée en 2009 sur le principe de la ronde. Elle adapte aujourd’hui cette création à Rennes, rebaptisée Cribles Gold, dans le cadre des ateliers Corps Sensibles – proposés par Danse à tous les étages – à destination des personnes âgées, retraitées isolées, rencontrant des difficultés sociales. Un mardi après-midi, fin avril, de nouvelles têtes se présentent au Centre de prévention Agirc-Arrco pour expérimenter l’atelier, lancé au début du mois, tandis que d’autres annoncent qu’elles ne pourront poursuivre les séances.
 L’une d’entre elles s’étant foulée la cheville, une autre devant s’occuper de son mari, la prise en charge par une tierce personne entrainant des frais bien trop lourds. L’échauffement permet une détente globale du corps, les participant-e-s (un homme figure dans le groupe ce jour-là, au milieu d’une petite dizaine de femmes) étant invité-e-s à masser les différentes parties du ventre, de buste et du visage avant de se lier par les mains pendant plusieurs dizaines de minutes. La ronde dévoile ses vertus à mesure que le temps passe et que les rires se font entendre.
L’une d’entre elles s’étant foulée la cheville, une autre devant s’occuper de son mari, la prise en charge par une tierce personne entrainant des frais bien trop lourds. L’échauffement permet une détente globale du corps, les participant-e-s (un homme figure dans le groupe ce jour-là, au milieu d’une petite dizaine de femmes) étant invité-e-s à masser les différentes parties du ventre, de buste et du visage avant de se lier par les mains pendant plusieurs dizaines de minutes. La ronde dévoile ses vertus à mesure que le temps passe et que les rires se font entendre.
L’ambiance est sérieuse, studieuse, et se voit dynamisée par des instants de rigolade et d’échanges. Si certaines se font plus timides que d’autres, que l’une se plaint de douleurs chroniques aux jambes, tout le monde participe et persévère dans l’exercice d’un cercle fermé par les liens des mains, dans lequel l’écoute de son corps et de celui des autres prime, dans lequel les contraintes s’expriment avec force et dans lequel chaque individu doit prendre sa place et reconnaître ses responsabilités.
« Il y a de la solidarité, du vivre ensemble et de l’écoute. On doit écouter nos corps, c’est ce qui se passe dans la danse contemporaine », commente Emmanuelle Huynh, enthousiaste à l’idée de perpétuer cette ronde chorégraphique avec des personnes âgées de 60 ans et plus « qui ont d’autres aptitudes physiques, et surtout ce qui m’intéresse aussi c’est la question des corps. »
Claudine vient, invitée par une amie, pour la première fois. Sa motivation première : la danse. « Je ne suis pas là pour écouter les malheurs des autres. Je veux bien redonner de l’élan, que ce soit un tremplin pour bien repartir dans la vie, mais je ne veux pas porter. », confie-t-elle avec une grande franchise. Cette ancienne prof d’éducation physique, tout juste âgée de 60 ans, a déjà pratiqué à diverses reprises, à droite à gauche comme elle dit, et apprécie le côté « Bien vieillir » de l’atelier :
« Cela transcende les émotions, et permet de développer la créativité. Et dans retraite, j’entends re-traite. Se traiter de manière différente, prendre soin de soin dégager les émotions par le mouvement. »
Un principe qu’il serait bon d’adapter sans attendre. Vraiment, on insiste lourdement mais joyeusement : Dansez, sinon nous sommes perdus (Pina Bausch) !



Comédienne, metteure en scène, art-thérapeute et plasticienne, elle s'intéresse notamment dans son travail au rapport entre masculin et féminin. À travers les pratiques artistiques, elle développe, à Rennes, des pistes pour prendre conscience de soi, des autres et ainsi agir sur ce qui nous entoure.
YEGG : En 2013, vous avez monté, en tant que directrice artistique, le spectacle Alternatives avec 10 danseurs et danseuses amenés à réfléchir sur les relations hommes-femmes. D'où est venue cette idée ?
Véronique Durupt : Ce projet m'a été proposé par Jean-Luc Dussort, coordinateur du pôle jeunesse de la MJC Bréquigny et Benoît Bauchy, animateur, car ils travaillent depuis longtemps sur les questions de discriminations et du masculin-féminin. J'ai accompagné des jeunes danseurs hip-hop, avec leurs spécialités, sur le plan dramaturgique pour savoir ce qu'ils avaient envie de dire sur le sujet et comment les danses des uns et des autres pouvaient s'interpeller.
Je leur ai amené des univers chorégraphiques différents, comme Pina Bausch et Anna Teresa de Keersmaeker, issues de l'école allemande. Ils s'en sont emparés, parfois avec réticence. Les détours vers d’autres pratiques que la danse hip-hop sont très importants pour nourrir leurs univers. C'est bien d'aller voir complètement ailleurs, sans renier la genèse de son travail.
Qu'est-ce qui en est ressorti ?
C'est un spectacle sur l'altérité. Des fois, on est dans l'accueil, la défense ou l'observation. Tout ça fait qu'une relation est complexe mais riche car elle nous fait découvrir des choses. Il y a eu pour eux la découverte de travailler sur une thématique commune et de nourrir son propre langage gestuel.
Vous êtes principalement metteure en scène, pourquoi avoir choisi la danse hip-hop pour aborder ce sujet ?
Je viens du théâtre gestuel donc je m'intéresse énormément à la danse, comme toute autre forme de représentation. Il y a un investissement corporel fort. J'ai accepté la direction artistique d'Alternatives parce qu'il y a une complicité entre les porteurs du projet et moi sur ces questions sociétales engagées.
Et je m'intéresse beaucoup à la danse hip-hop, à son émergence et son arrivée en France. Quant à la rencontre avec les jeunes danseurs, c'est réjouissant de voir des artistes, amateurs et semi-professionnels, s'emparer d'une question comme ça et chercher à y répondre avec leurs univers, leurs imaginaires et même leurs peurs.
 Est-ce que la danse permet de mieux prendre conscience de son corps ?
Est-ce que la danse permet de mieux prendre conscience de son corps ?
Oui, elle donne d'autres outils ! Sur scène, il y a un mouvement par rapport à l'espace. Ce mécanisme d'impression sensorielle va nous permettre d'écrire avec notre corps. Donc automatiquement, on accueille des émotions, des énergies, des rythmes, des silences.
J'aime bien le mot de « vocabulaire » qui recherche, avec une syntaxe et une grammaire propres, une dramaturgie du geste et des tensions dramatiques pour porter quelque chose. Dans la genèse d'un spectacle, on doit toujours l'alimenter et le redécouvrir. En tant qu'artiste, c'est aussi notre travail.
En 2012, vous avez travaillé avec des élèves de l’Établissement Régional d'Enseignement Adapté (EREA) de Rennes sur les thèmes de la boxe et du respect. Comment cela s'est mis en place ?
Je travaille avec l'EREA depuis plus de six ans sur des projets artistiques autour du masculin-féminin. Le but est d'impulser un spectacle avec les jeunes, à travers des improvisations, des recherches et des thèmes. Nous avons beaucoup travaillé sur l'écriture gestuelle. Cela leur a permis de découvrir leurs corps comme moyen d'expression.
Pour ce spectacle, on s'est inspirés des cordes qui composent le ring et autour du masculin-féminin, de l'offensif et du défensif dans des duos composés d'un personnage fragile et l'autre plus fort. En mars dernier, j'ai fini un nouveau projet avec des élèves autour de la figure de l'acteur dans le cinéma muet. Les personnages, habillés et maquillés en noir et blanc, se rencontrent de façon positive, des fois négative, et explorent leur altérité.
Comment réagissent-ils face à ces questions de masculin-féminin, relations hommes-femmes ?
On discute beaucoup de ça ! Il y a de nombreux questionnements, de la pudeur, de la défense. C'est complexe de toute manière et c'est intéressant ! Au niveau de la question artistique, ils ne sont plus filles ou garçons, ils sont interprètes. On s'entraide comme une vraie équipe.
Ce sont des personnes dites en grande difficulté scolaire, est-ce que créer un spectacle sur le long terme leur permet d'avoir une cohésion ?
J'aime bien le mot cohésion. De partage, de confiance en eux-mêmes, dans les autres, d'affirmation, de ce qu'ils ont envie de faire et de quelle manière, leurs goûts, de travailler une curiosité. Ils se rendent compte également que tout est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît et qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des difficultés. La question du sensible est aussi importante. Tout ça, c'est à travers la création de ce spectacle. C'est ça qui est intéressant.
Vous êtes également plasticienne et art-thérapeute. Qu'est-ce l'art en général apporte dans sa recherche d'identité ?
Plein de choses ! Faire une pratique artistique, notamment pour des personnes en difficulté, permet de développer leur sensorialité, leur goût, leur style, leur conscience d'être, découvrir l'autre... C'est beau, bon, ça fait du bien ! (Sourire) Tout le monde a ce droit qui nous permet d'agir sur le monde. C'est important. Cela permet de se battre aussi contre des évidences, des préjugés, d'être ouverts sur l'autre et soi-même. C'est aussi pour ça que je fais ce métier-là. Tous ces publics m'apportent énormément. Mon travail en est enrichi.


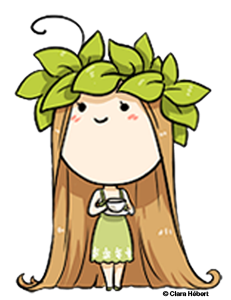 Une vieille rengaine héritée de génération en génération, qui révèle finalement que rien ne bouge, les jeunes filles d’aujourd’hui ressemblent à celles d’hier. Pourtant, on continue de vouloir les classer dans une seule et même case. « Dans notre monde il n’y a pas d’écoute de la singularité, il faut tous marcher au même pas. Or, c’est à chacun de se fabriquer ses réponses, en se débarrassant des lieux communs et des discours des autres », indique la psychanalyste Laurence Ruas-Texier. Un sentiment partagé par sa consœur Emmanuelle Borgnis-Desbordes pour laquelle il est important de comprendre qui sont ces adolescentes et ce qu’elles veulent, de saisir leur spécificité et leur personnalité à part entière.
Une vieille rengaine héritée de génération en génération, qui révèle finalement que rien ne bouge, les jeunes filles d’aujourd’hui ressemblent à celles d’hier. Pourtant, on continue de vouloir les classer dans une seule et même case. « Dans notre monde il n’y a pas d’écoute de la singularité, il faut tous marcher au même pas. Or, c’est à chacun de se fabriquer ses réponses, en se débarrassant des lieux communs et des discours des autres », indique la psychanalyste Laurence Ruas-Texier. Un sentiment partagé par sa consœur Emmanuelle Borgnis-Desbordes pour laquelle il est important de comprendre qui sont ces adolescentes et ce qu’elles veulent, de saisir leur spécificité et leur personnalité à part entière.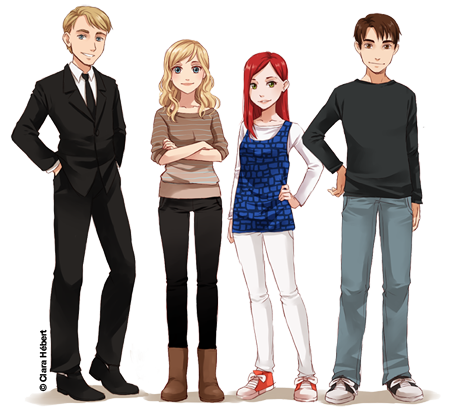 Aujourd’hui, on dit, on parle, on se montre. On peut s’en réjouir quand la lumière est mise sur des sujets graves comme le harcèlement ou les attouchements sexuels, desquels on ne parlait pas avant. Caroline Moulin parle, elle, de déplacement des zones d’intimité, influencé par les médias, la télé-réalité et le web. « Il y a une vraie érotisation du corps ces dernières années, c’est inquiétant », confie-t-elle. Ces nouveaux problèmes liés aux technologies modernes se traduisent par l’apparition de photos et de vidéos de filles dénudées ou ridiculisées, prises par le petit copain ou la bande de copines.
Aujourd’hui, on dit, on parle, on se montre. On peut s’en réjouir quand la lumière est mise sur des sujets graves comme le harcèlement ou les attouchements sexuels, desquels on ne parlait pas avant. Caroline Moulin parle, elle, de déplacement des zones d’intimité, influencé par les médias, la télé-réalité et le web. « Il y a une vraie érotisation du corps ces dernières années, c’est inquiétant », confie-t-elle. Ces nouveaux problèmes liés aux technologies modernes se traduisent par l’apparition de photos et de vidéos de filles dénudées ou ridiculisées, prises par le petit copain ou la bande de copines. Rien de tel pour voir surgir de nouveaux troubles : scarifications et mutilations, phobie scolaire voire agoraphobie et rupture sociale, addictions aux substances alcooliques, tabagiques, chimiques, médicamenteuses (neuroleptiques, amphétamines). « Il y a augmentation et banalisation de ce type de conduites, comme les attaques contre le corps. On voit aussi de plus en plus d’adolescentes qui ne sortent plus de chez elles, cela s’est beaucoup développé chez les plus fragiles, les réseaux sociaux et les jeux vidéos étant un moyen de ne plus se confronter au monde extérieur, à la réalité », observe Gilles Clainchard.
Rien de tel pour voir surgir de nouveaux troubles : scarifications et mutilations, phobie scolaire voire agoraphobie et rupture sociale, addictions aux substances alcooliques, tabagiques, chimiques, médicamenteuses (neuroleptiques, amphétamines). « Il y a augmentation et banalisation de ce type de conduites, comme les attaques contre le corps. On voit aussi de plus en plus d’adolescentes qui ne sortent plus de chez elles, cela s’est beaucoup développé chez les plus fragiles, les réseaux sociaux et les jeux vidéos étant un moyen de ne plus se confronter au monde extérieur, à la réalité », observe Gilles Clainchard.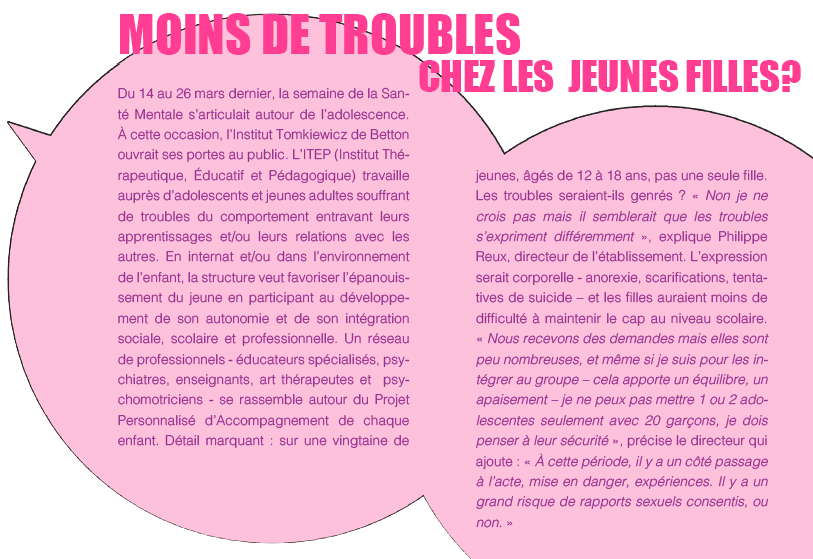
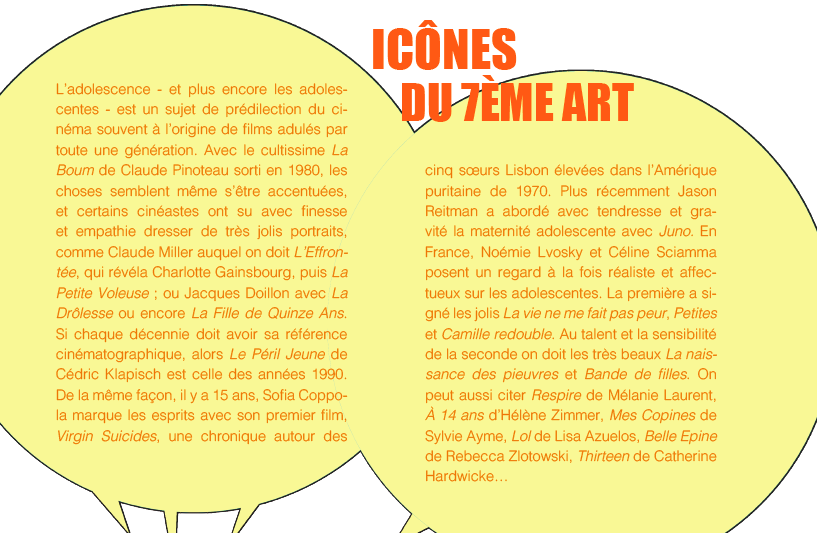
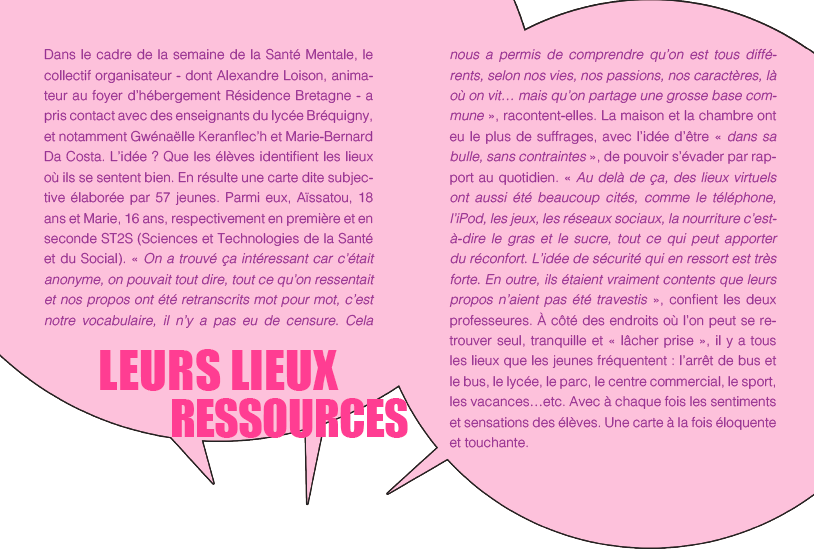
 Les difficultés éprouvées par les parents avec les adolescents sont-elles genrées ?
Les difficultés éprouvées par les parents avec les adolescents sont-elles genrées ?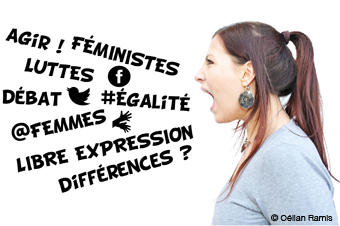
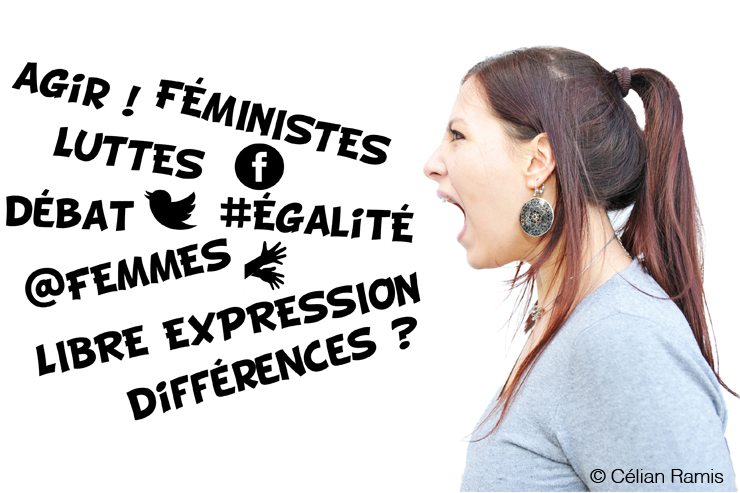








 L’indifférence face aux critiques qui peuvent être formulées quant à son côté dégradant : se déshabiller pour vendre du rêve, pour agrémenter les fantasmes, pour satisfaire les désirs des spectateurs. Elles invoquent aujourd’hui la banalisation de la profession, avec une prolifération du nombre de danseuses – qui n’est pas recensé ou calculé clairement mais qui apparaît au vu du nombre de sites et d’annonces – qui se ressent à travers le regard de la population nocturne. « Avant, quand on se déshabillait dans les boites, tout le monde sortait son portable. Maintenant, ça paraît normal de voir des stripteaseuses et des gogos danseuses. Et puis, les clientes sont encore moins habillées que nous, parfois ! Enfin, elles finissent en soutif...», rigole Julie, alias Bambye.
L’indifférence face aux critiques qui peuvent être formulées quant à son côté dégradant : se déshabiller pour vendre du rêve, pour agrémenter les fantasmes, pour satisfaire les désirs des spectateurs. Elles invoquent aujourd’hui la banalisation de la profession, avec une prolifération du nombre de danseuses – qui n’est pas recensé ou calculé clairement mais qui apparaît au vu du nombre de sites et d’annonces – qui se ressent à travers le regard de la population nocturne. « Avant, quand on se déshabillait dans les boites, tout le monde sortait son portable. Maintenant, ça paraît normal de voir des stripteaseuses et des gogos danseuses. Et puis, les clientes sont encore moins habillées que nous, parfois ! Enfin, elles finissent en soutif...», rigole Julie, alias Bambye. Elle, qui joue des petits rôles dans certains films comme Bodybuilder de Roschdy Zem, aime incarner des personnages de cinéma, comme Jessica Rabbit, Maléfique ou encore les James Bond girls… « Que des personnages dark et sévères qui collent à ma personnalité », précise-t-elle. Pour Priscilla, le striptease ne se résume pas à l’exhibition de son corps. Ou plutôt, elle refuse d’y être réduite. Pas question de simplement « montrer cul et nichons à un mec en particulier », raison pour laquelle elle évite farouchement les clubs de strip, dans lesquels on pratique les shows privés.
Elle, qui joue des petits rôles dans certains films comme Bodybuilder de Roschdy Zem, aime incarner des personnages de cinéma, comme Jessica Rabbit, Maléfique ou encore les James Bond girls… « Que des personnages dark et sévères qui collent à ma personnalité », précise-t-elle. Pour Priscilla, le striptease ne se résume pas à l’exhibition de son corps. Ou plutôt, elle refuse d’y être réduite. Pas question de simplement « montrer cul et nichons à un mec en particulier », raison pour laquelle elle évite farouchement les clubs de strip, dans lesquels on pratique les shows privés.


 Comment êtes-vous arrivé au striptease ?
Comment êtes-vous arrivé au striptease ?




 Pourquoi avoir opté pour la PMA, et non la GPA par exemple, à l’étranger ?
Pourquoi avoir opté pour la PMA, et non la GPA par exemple, à l’étranger ? 


 Dans des petits enclos, les truies sont allongées, leurs petits se pressant pour venir téter. Une portée est isolée au fond de la pièce. Mélodie saisit les porcelets d’une main, et coupe le cordon de l’autre. « J’aime ce boulot. Pour tout ce qui concerne l’animal, les mises bas, les soins, tout ! Il y a une relation qui se crée avec l’animal et j’aime m’en occuper. Sans oublier l’ambiance qui est très bonne ici. Je suis la seule femme et ça se passe très bien », exprime-t-elle, animée par la passion. Aucune difficulté pour elle à s’intégrer dans une équipe masculine.
Dans des petits enclos, les truies sont allongées, leurs petits se pressant pour venir téter. Une portée est isolée au fond de la pièce. Mélodie saisit les porcelets d’une main, et coupe le cordon de l’autre. « J’aime ce boulot. Pour tout ce qui concerne l’animal, les mises bas, les soins, tout ! Il y a une relation qui se crée avec l’animal et j’aime m’en occuper. Sans oublier l’ambiance qui est très bonne ici. Je suis la seule femme et ça se passe très bien », exprime-t-elle, animée par la passion. Aucune difficulté pour elle à s’intégrer dans une équipe masculine.
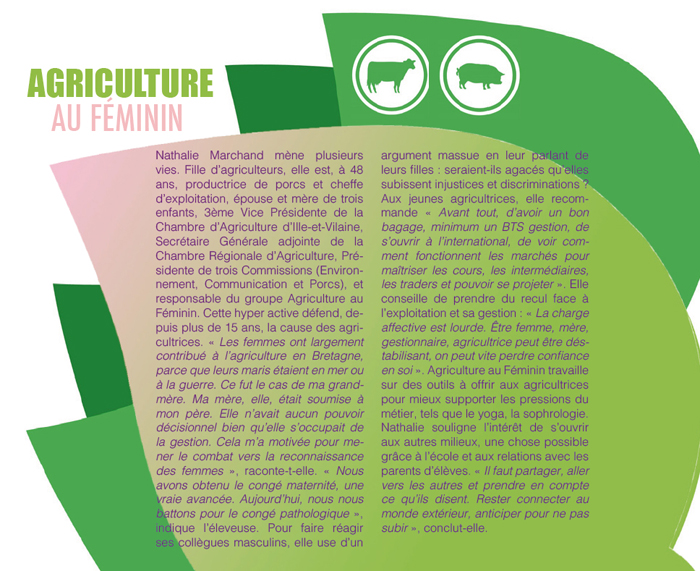
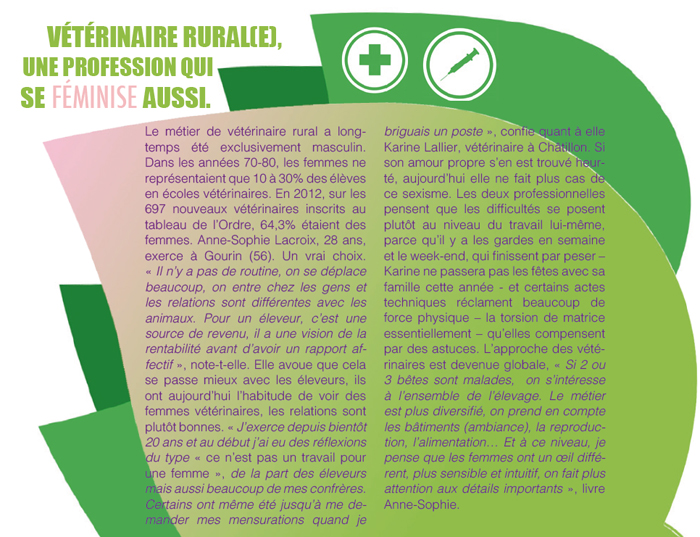
 YEGG : Pouvez-vous dresser votre portrait ?
YEGG : Pouvez-vous dresser votre portrait ? 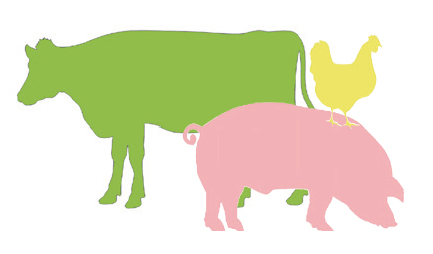 Quels sont vos objectifs en la matière ?
Quels sont vos objectifs en la matière ?


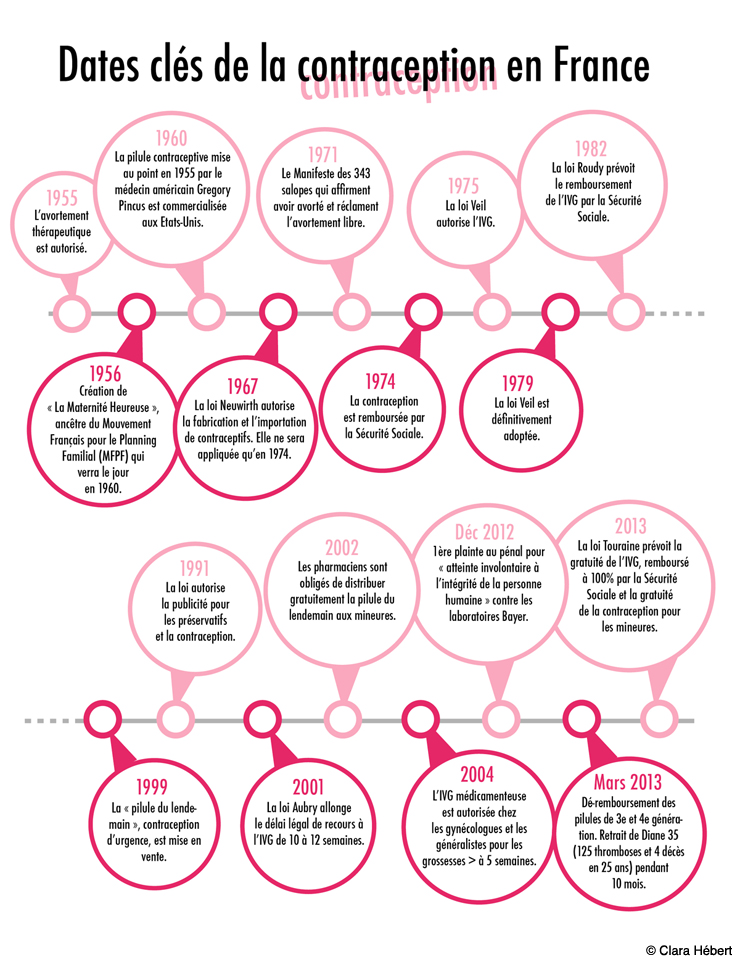
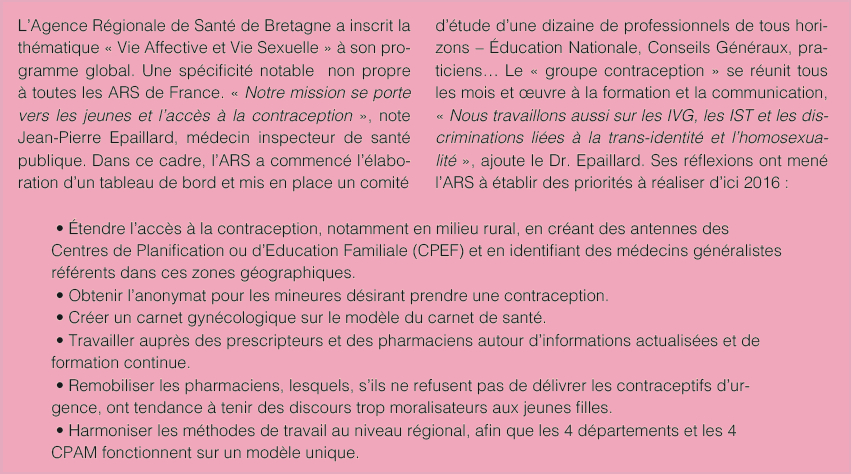
 YEGG : Pourquoi avez-vous choisi la méthode Billings ?
YEGG : Pourquoi avez-vous choisi la méthode Billings ?



 Pour leur entraineur, Nicolas Civadier, la qualité du jeu ne réside pas dans la force et il est important de ne créer aucune distinction sexuée : « Ce que l’on demande aux joueuses, on le demande aussi aux joueurs : assiduité, respect, écoute, rigueur et envie ! Et le dimanche quand il faut jouer – championnat départemental - on joue ! »
Pour leur entraineur, Nicolas Civadier, la qualité du jeu ne réside pas dans la force et il est important de ne créer aucune distinction sexuée : « Ce que l’on demande aux joueuses, on le demande aussi aux joueurs : assiduité, respect, écoute, rigueur et envie ! Et le dimanche quand il faut jouer – championnat départemental - on joue ! »
 Pourquoi avoir eu besoin de créer une commission au tennis féminin ?
Pourquoi avoir eu besoin de créer une commission au tennis féminin ? 

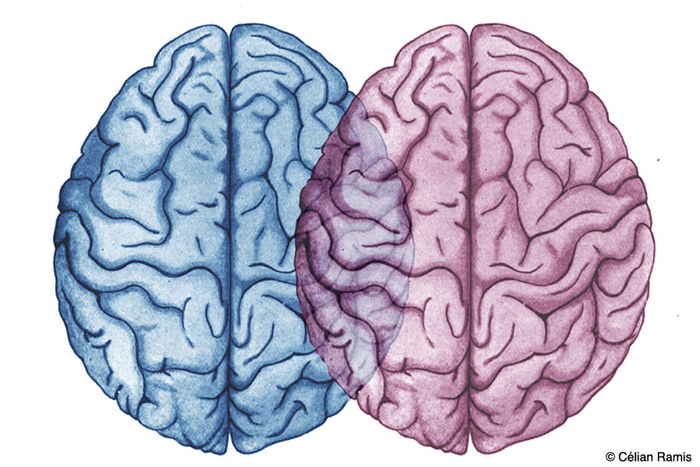
 YEGG : Pourquoi l’éducation à l’égalité vous tient-elle tant à cœur ?
YEGG : Pourquoi l’éducation à l’égalité vous tient-elle tant à cœur ?


 « C’est la forme de violence dont les femmes ont le plus de mal à parler et pourtant elle est très souvent présente. La violence sexuelle comprend un spectre très large allant du harcèlement sexuel à l’exploitation sexuelle, en passant par le viol conjugal ». C’est ainsi qu’est définie la violence sexuelle dans l’ouvrage Femmes sous emprise – les ressorts de la violence dans le couple, écrit par la psychiatre et docteur en médecine Marie-France Hirigoyen.
« C’est la forme de violence dont les femmes ont le plus de mal à parler et pourtant elle est très souvent présente. La violence sexuelle comprend un spectre très large allant du harcèlement sexuel à l’exploitation sexuelle, en passant par le viol conjugal ». C’est ainsi qu’est définie la violence sexuelle dans l’ouvrage Femmes sous emprise – les ressorts de la violence dans le couple, écrit par la psychiatre et docteur en médecine Marie-France Hirigoyen.