Célian Ramis
Maison des naissances : liberté de choisir


Les progrès de la médecine sont fascinants et incontestables. Et le secteur de l’obstétrique, visant l’étude et la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement, ne fait pas exception. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, techniques et connaissances se sont multipliées et développées. En parallèle, les années 60 et 70 ont vu les combats féministes faire avancer les droits des femmes et évoluer vers une libération des corps de la gent féminine.
Mais concernant les questions qui régissent la grossesse, l’accouchement et la maternité, rien n’est jamais acquis. Alors qu’on parle aujourd’hui de surmédicalisation, qu’en est-il du choix ? et de l’écoute de son propre corps ? du respect de la physiologie ? À l’heure où certaines villes françaises se dotent de Maisons de naissances dans le cadre d’une expérimentation, un « Pôle physiologique » ouvre ses portes à Rennes, à la Clinique de la Sagesse.
La grossesse rendrait les femmes rayonnantes, l’accouchement serait un calvaire insurmontable sans péridurale et les kilos pris les derniers mois avant la délivrance seraient compliqués à perdre… Bon nombre d’idées reçues, d’angoisses et d’injonctions planent autour du trio grossesse-accouchement-post partum. Pour pallier aux inquiétudes, la réponse est (trop) souvent médicale. Si les 60 dernières années ont été révolutionnaires pour l’obstétrique en France, quelle place accordons-nous à la physiologie et à la liberté des femmes à choisir et à disposer de leurs corps ?
« J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur… » Voilà un programme réjouissant ! Si les interprétations du texte sacré sont multiples, l’enfantement dans la douleur reste gravé dans les esprits. Tout comme l’idée que l’essence même de la Femme résiderait dans sa vocation à donner la vie et élever sa future progéniture, assurant ainsi la survie de l’espèce humaine.
 Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique.
Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique.
Entre temps, les féministes se sont battues pour que les femmes disposent librement de leurs corps. Et pour que les femmes ne subissent plus la doctrine de l’enfantement avec douleur. Pourtant, depuis plusieurs années, certaines futures ou jeunes mères dénoncent parfois la surmédicalisation du parcours et des violences obstétricales subies, le plus souvent, au moment de l’accouchement.
Créé en 2003, le Collectif interassociatif autour de la naissance (Ciane) veille particulièrement à la parole et aux ressentis des femmes, tout en maintenant la volonté forte de dialoguer avec les professionnel-le-s de la santé – qui ne sont pas à blâmer en toutes circonstances, précise la structure – afin de faire évoluer les pratiques et diminuer la souffrance de celles qui viennent d’accoucher.
Une souffrance qui relève davantage de l’ordre du psychologique que du physique, même si l’enquête réalisée en novembre 2013 sur « Episiotomie : état des lieux et vécu des femmes » révèle des douleurs corporelles non négligeables. Cette étude apporte un éclairage important et significatif sur la gestion médicale de l’accouchement.
INFORMATIONS ET CONSENTEMENT
Le Collectif a recueilli les réponses de plus de 10 000 femmes ayant alors accouché dans les dix dernières années. L’épisiotomie, depuis le début des années 2000, fait l’objet de fortes interrogations. En 2005, le Collège national des gynécologues obstétriciens français publie ses recommandations sur la question, « dans lesquelles il prend acte qu’il n’y a pas d’indications prouvées à l’épisiotomie systématique et définit un objectif de 30% de taux national, au lieu de 47% à l’époque (2002-2003). Le Ciane était en désaccord avec ce taux objectif qui n’était étayé par aucune étude scientifique : au même moment, en Suède et en Grande-Bretagne, les taux d’épisiotomie étaient respectivement de 6% et de 13%. »
L’enquête montre plusieurs points d’évolution des pratiques, comme la liberté de déplacement pendant le travail, dont la proportion de femmes concernées a augmenté aux alentours de 50% (mais serait en stagnation depuis 2007), la possibilité de choisir sa position pendant le travail, dont bénéficient 6 femmes sur 10 ainsi que la liberté de choisir sa position pendant l’expulsion.
Toutefois, ce dernier point ne concerne qu’un tiers des femmes et stagne également depuis 2007. Dans l’ensemble, le choix est davantage donné aux « multipares » - terme qui désigne celles qui ont déjà eu un ou plusieurs enfants – qu’aux « primipares » - désignant ici celles qui donnent la vie pour la première fois. Les chiffres de l’étude démontrent alors que le recours à l’épisiotomie sera moindre dans les cas où les femmes ont été libres de se déplacer, choisir leurs positions lors du travail et de la délivrance.
Des libertés que les équipes médicales doivent parfois bafouer de par l’urgence et/ou les complications pouvant survenir lors de l’accouchement. Néanmoins, le Ciane conclut à ce niveau : « Il y a de nombreux facteurs qui peuvent interférer avec ce lien : une maternité qui a une politique tournée vers le respect de la physiologie pourra favoriser à la fois la liberté de mouvement et la restriction des épisiotomies. Cependant, il semble raisonnable au vu des résultats contrastés que nous présentons d’encourager au maximum la liberté de position et de mouvement tout au long de l’accouchement. »
Autre élément mis en lumière dans le document, et dont les témoignages peuvent bouleverser la sensibilité : 85% des épisiotomies sont réalisées sans le consentement de la femme concernée. Un chiffre qui n’a pas évolué depuis 2005. Chez les multipares, il est demandé à au moins un quart des femmes, tandis que chez les primipares, il n’est demandé qu’une fois sur 7 ou 8.
« Les femmes sont de mieux en mieux informées sur l’épisiotomie par les professionnels de santé. Seule 1/3 d’entre elles avant 2005 estimaient avoir reçu assez d’information, contre 59% en 2010-2013. Malgré ce progrès, elles sont encore 12% à estimer avoir reçu insuffisamment d’information et 29% à ne pas en avoir reçu. Une très petite proportion dit avoir reçu trop d’informations. », souligne le rapport qui signale également un lien intrinsèque entre l’information et la demande de consentement, les femmes les plus avisées étant généralement celles à qui on demande le plus souvent l’autorisation d’agir.
Enfin, le Ciane établit un lien entre la souffrance déclarée de 75% des femmes (ayant subi une épisiotomie) et l’absence de demande de consentement. « Il y a au moins deux explications à envisager : le ressenti de souffrance dépend de la manière dont la femme a été traitée, et la demande de consentement fait partie des bons traitements ; les équipes plus respectueuses du consentement seraient aussi celles qui seraient les plus attentives aux suites de l’épisiotomie. »
En parallèle, les mêmes questions ont été posées à des femmes « qui ont démarré (le travail) dans un espace particulier de l’établissement (espace / pôle physiologique, maison / pavillon de naissance). » Résultat : « Le taux d’épisiotomie est de 31% pour les primipares (contre 47% pour la moyenne des établissements), et de 13% pour les multipares au lieu de 16%. »
RECONNAITRE LES VIOLENCES
 Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale.
Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale.
Et l’affaire du « point du mari » en est la preuve (affreuse et) incontestable ! Et le Collectif propose, au titre d’une évolution efficace, des formations afin de décrypter, analyser et déconstruire ces faits, auprès des professionnel-le-s de la santé. Ancienne psychomotricienne, Christiane David est sage-femme à la Clinique mutualiste de La Sagesse, à Rennes, depuis 1992. Si elle n’a jamais entendu de la bouche des femmes le terme formel de « violence », elle est convaincue que des situations peuvent être ressenties comme tel.
« Par exemple, dans les cas de césarienne non prévue, des femmes vont trouver ça violent, d’autres non. L’accompagnement qu’on leur donne peut modifier ce vécu. Parfois, on ne se rend pas compte mais les mots que l’on emploie sont terriblement violents pour ces femmes. Notre rôle est de transformer cette expérience en quelque chose d’humain, de partageable. Il est important que celle qui le formule soit reconnue dans le fait que c’était difficile. On va pouvoir être à ses côtés. Mais pour cela, il faut du temps et le temps fait défaut dans le milieu hospitalier. Et c’est ça, véritablement, qui forme la violence. Quand quelque chose nous fait violence, il ne faut pas se laisser faire, il faut le dire, merde ! », se passionne-t-elle.
Lors des dix dernières années, elle a lutté, aux côtés d’autres sages-femmes, de parents et de futurs parents, pour la création d’une Maison de Naissance, à Rennes. C’est pour cela qu’a eu lieu en 2003 la création de l’association MAISoùnaitON ?.
POUR QUI, POUR QUOI ?
En réaction à la surmédicalisation de la grossesse et de l’accouchement, plusieurs femmes et sages-femmes ont souhaité, dans les années 70, reprendre le contrôle sur cet aspect-là de leurs vies (et bien d’autres, par ailleurs) et se les réapproprier. La maison de naissance se base sur l’écoute et le respect de la physiologie, proposant un espace autonome et indépendant intégralement dirigé par des sages-femmes.
Les femmes sont alors suivies par une ou plusieurs professionnel-le-s de la structure du début de leur grossesse au post-partum, en passant par l’accouchement naturel. « Les femmes qui sont intéressées par ce système-là sentent que la médicalisation aliène leurs corps. Il ne s’agit pas d’opposer « l’accouchement sans douleur » et « l’accouchement avec douleur », pas du tout, ce n’est pas la question. Elles ne revendiquent pas de souffrir mais de vivre ce qu’elles ont à vivre. Elles veulent avoir le choix, ne pas s’en remettre à une surmédicalisation quand il n’y en a pas besoin. Parce qu’évidemment, on ne crache pas dans le bénitier, il y a parfois besoin de passer par là en cas de pathologie. », explique Christiane David.
Rencontrer les professionnel-le-s (présent-e-s le jour de l’accouchement), tisser des liens, construire une relation de confiance et aboutir à un accouchement simple, tel est le souhait formulé par les futurs parents.
OUI, MAIS…
Depuis 1975, les Maisons de Naissance se sont développées aux États-Unis. Ainsi, le Collège américain des gynéco-obstétriciens se penche régulièrement sur la question de la physiologie et en février 2017 publie, dans le magazine Obstetrics and Gynecology, son Plaidoyer pour un accouchement physiologique :
« L'équipe obstétricale peut aider les patientes à accoucher de manière physiologique en ne faisant appel qu'à un nombre limité d'interventions, ce qui a toutes les chances d'augmenter la satisfaction des parturientes. De nombreuses pratiques passées dans la surveillance de routine ne présentent qu'un bénéfice limité ou incertain pour les femmes en travail spontané et sans risque particulier, et les décisions devraient être le plus souvent partagées entre la patiente et les professionnels. »
L’article liste alors certaines interventions inutiles, comme l’admission trop précoce en salle d’accouchement, l’utilisation du monitorage en continu ou encore la perfusion intraveineuse en continu et recommande à « l'équipe obstétricale qui entoure les parturientes en travail spontané à terme sans risque particulier (de) s'interroger sur la pertinence de ses interventions et les choisir avec discernement en tenant compte du bien fondé de celles-ci ainsi que de l'avis de la patiente, et s'habituer à une approche moins interventionnelle de l'accouchement. »
Dans les années 80, plusieurs pays en Europe, à l’instar de la Suisse, l’Allemagne, la Belgique ou encore la Grande-Bretagne, vont s’équiper également de Maisons de Naissance, allant même jusqu’à créer un réseau européen. Au Québec aussi, il en existe et une dizaine de nouvelles structures est en cours d’installation selon un plan de périnatalité 2008 – 2018.
Pour la France, c’est une autre paire de manches. Les modes « alternatifs » d’accouchement, comme les Maisons de Naissance ou l’accouchement à domicile, étant régulièrement décriés ou discrédités, à coups d’arguments sécuritaires et sanitaires. Des arguments rapidement démontés par les sages-femmes et les structures déjà existantes montrant que les suivis de grossesse et les accouchements concernés ne se font pas sans un maximum d’indicateurs positifs et de solutions en cas de complications.
Pourtant, les mentalités évoluent doucement et ce n’est que très récemment qu’une loi a autorisé l’expérimentation de 9 Maisons de naissance en France (lire encadré), dont la structure rennaise ne fait pas partie. « Les Maisons de Naissance doivent avoir un statut particulier. Et clairement, elles doivent être encadrées par des sages-femmes libérales. Sauf que les consultations de suivi de grossesse et d’accouchement ne suffisent pas à les faire vivre, ce qui les oblige à faire des dépassements d’honoraires, regrette Christiane David, loin de jeter la pierre à ses collègues en libéral. Nous, dès le départ, on a souhaité se mettre à l’écart de ce fonctionnement car nous tenons à ce que ce projet soit accessible à tou-te-s. Et avec des dépassements d’honoraires, ce n’est pas possible. Les familles nous ont soutenues pour que l’on puisse rester sur la ligne intra hospitalière. »
Depuis 2004, l’association MAISounaitON ? organise, en collaboration parfois avec Liber’Naitre, des conférences, des ateliers et des réunions d’informations. Sur les Maisons de Naissance mais aussi sur toutes les questions concernant l’accompagnement global, la liberté de choisir, la liberté de mettre son enfant au monde là où on le souhaite et comme on le souhaite, sur la langue des signes pour les bébés ou encore sur la question très importante de la gestion de la douleur, sujet tabou et angoissant pour un certain nombre de femmes.
Il a fallu batailler pour défendre le projet, rencontrer les élu-es – « Nous avons rencontré des élues qui étaient des femmes issues de 68 et qui ne comprenaient pas cette histoire d’accouchement sans péridurale car elles s’étaient battues pour la libération du corps des femmes et contre le « tu accoucheras dans la douleur », se souvient la sage-femme qui livre cette anecdote avec un grand sourire aux lèvres. On a discuté et échangé. Même si on ne partage pas la même vision, on a pu partagé nos points de vue. » - et convaincre l’institution de s’engager. Le combat a été long et éprouvant : « On a cru que ça allait s’arrêter. On a failli jeter l’éponge. »
Mais l’association n’a rien lâché et la direction de la Clinique mutualiste de La Sagesse a suivi leur engouement et engagement. Depuis décembre 2016, les femmes peuvent s’inscrire pour un accompagnement global auprès du Pôle physiologique de La Sagesse. « Comme on ne fait pas parti de l’expérimentation et que nous avons quelques différences avec les Maisons de Naissance, nous ne pouvons pas prendre la dénomination Maison de Naissance. », précise Hélène Billot, sage-femme exerçant dans cet établissement depuis 2006, impliquée dans l’association et désormais investie parmi les 8 professionnelles gérant le Pôle physiologique.
TOURNANT DE L’OBSTÉTRIQUE EN FRANCE
Intégrer cet espace à un établissement hospitalier est novateur et purge l’espoir que son principe tisse sa toile. Pour Christiane, les arguments, pour se parer d’un pôle tel que celui qui se lance à La Sagesse, ne manquent pas. Bien au contraire.
« La maternité est le phare d’un hôpital. Souvent, c’est là où on accouche que l’on reviendra pour soi ou ses enfants. C’est une vitrine. Et à un moment où la natalité diminue, c’est ceux qui seront novateurs qui verront une incidence sur l’évolution de leur structure. »
analyse-t-elle, à juste titre.
Mais surtout, ce qui elle lui tient particulièrement à cœur est d’interroger l’obstétrique en France. Où en est-on et comment évoluer ? Comment concilier la pratique, toujours plus pointue, des professionnel-le-s de la santé, au respect des envies et besoins des patient-e-s ?
 Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.
Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.
L’intérêt d’intégrer une structure telle que le pôle physiologique à un établissement est que son fonctionnement d’accompagnement – démultiplier les intervenant-e-s si la grossesse ne présente aucune pathologie particulière, accompagnement global, etc. – se diffuse au-delà du service, allant jusqu’à infuser dans les autres branches de la clinique et plus largement dans les autres secteurs du milieu hospitalier et médical :
« Le pôle physiologique travaille avec un réseau de professionnel-le-s et est en lien avec la maternité évidemment. Cela permet de modifier les représentations car les autres voient que le suivi est rigoureux et carré. Les femmes qui s’y rendent sont extrêmement suivies. C’est d’ailleurs aberrant de voir à quel point les exigences sont bien plus grandes. »
Elle salue alors le courage de la direction, qui a engagé des travaux au rez-de-chaussée de la Clinique (jusqu’en avril, le pôle physiologique est installé temporairement au 2e étage, espace Bréhat, pour les consultations) pour y installer deux salles de consultation, deux chambres de naissance et une grande pièce de vie comprenant cuisine, salle à manger et salon convivial. Ainsi, 150 m2 seront destinés à ce nouveau pôle.
« Et vous voyez, ça fonctionne. En s’intéressant à ce projet, le directeur, le directeur financier, les gars du bâtiment se le sont appropriés. Ils ont changé de regard sur le sujet. C’était super chouette de voir les gars du BTP nous dire « si vous voulez quelque chose dans tel ou tel esprit, alors il vaut mieux aménager ça ici, mettre cette couleur là, etc. », vraiment chouette ! », raconte Christiane David.
ENTOURÉ-E-S ET ÉCOUTÉ-E-S
L’esprit de la Maison de Naissance est donc présent dès la création de l’espace concerné, mêlant échange, partage et respect de l’Autre. Mais pas n’importe comment. Comme le précise la sage-femme, le suivi est rigoureux et encadré. « Pour pouvoir en bénéficier, il faut être en santé comme ils disent au Québec. Quand un couple est intéressé, il s’inscrit auprès du pôle physiologique. Le premier rendez-vous, le plus tôt possible dans la grossesse, est une consultation « d’éligibilité » au cours de laquelle on reprend tous les antécédents médicaux. », justifie Hélène Billot.
Ainsi sont admises uniquement les femmes présentant une grossesse à faible risque, puisque le risque 0 n’existe pas. Le dossier de présentation explique : « Certaines conditions médicales rendront ou non un tel accompagnement possible. Si au cours de ce processus, votre condition ou celle de votre bébé requiert des soins, l’avis d’un médecin sera alors sollicité. Et si besoin, une orientation vers le service général de la maternité pour avis et/ou transfert sera organisée. Pour votre bien-être, nos deux équipes se connaissent et travaillent ensemble. Ainsi, une réorientation pourra être envisagée tout au long de votre suivi. Soit : pour des raisons médicales concernant la mère ou le bébé. Suite à un souhait de votre part. »
Fin février, l’équipe a déjà rencontré plus de 70 couples à la consultation d’éligibilité. Au moins une soixantaine est inscrite au Pôle physiologique pour des termes allant de mi mai à mi septembre. L’objectif étant d’accueillir dans les années à venir 300 mamans.
Si toutes les conditions sont réunies, la femme - ou le couple - sera suivie par une sage-femme référente en consultation une fois par mois jusqu’au 7e mois, puis tous les quinze jours dès le 8e mois et toutes les semaines le 9e mois si les femmes le souhaitent. Et à partir du 6e mois, une deuxième sage-femme les recevra en consultation, en alternance avec la professionnelle référente. Et lorsque la future mère commencera les préparations à la naissance, elle rencontrera deux sages-femmes également. « Une des quatre professionnelles sera présente à l’accouchement. », garantit Hélène Billot.
« Ça me tranquilise de savoir que le jour J une personne professionnelle que je connais, qui connaît mes craintes et mes souhaits, sera là. »
avoue Marion, 29 ans, en attendant l’heure de son rendez-vous.
Elle entamera bientôt son 6e mois et intégrera prochainement les préparations à la naissance. « Dans ma famille, il y a eu pas mal de problèmes à l’accouchement. Ça m’a apaisée de venir ici par rapport aux perspectives de ma grossesse. », poursuit-elle. Pour cette post doctorante en anthropologie maritime, rattachée au Museum de Paris, l’accompagnement global correspond à ce qu’elle recherchait, elle qui confesse quelques angoisses en pensant à la péridurale et souhaite s’orienter plutôt vers la gestion de la douleur.
« Je ne me sens pas malade mais enceinte ! », dit-elle en rigolant. Mais sa phrase est pleine de sens. Au cours des face-à-face – ainsi que des appels si besoin de conseils ou en cas de doute, de questionnement – tous les sujets pourront être abordés. Maëlys, 24 ans, et Mathieu, 26 ans, apprécient cette globalité.
« On est très contents. Il n’est pas question que de l’utérus mais aussi du couple, de la mère, du père, de nos émotions, de notre environnement, etc. », explique l’étudiante en ostéopathie animale. Son compagnon, agent de circulation à la SNCF, se sent écouté et rassuré :
« On voulait limiter le médical. Surtout pour un accouchement, ça se pratiquait avant que la médecine existe ! Ici, on connaît les sages-femmes, on dialogue, on échange sur l’émotionnel. Ce ne sont pas que des blouses blanches, c’est bien plus que ça ! »
Tous les deux affichent un sourire contagieux. Ils devraient en mai devenir les parents d’un des premiers bébés à naitre au pôle physiologique.
UN CADRE CONFIDENTIEL ET INTIME
Toutes les questions peuvent être posées. Toutes les angoisses peuvent être livrées. Toutes les émotions dévoilées. Tous les désirs explicités. Les sages-femmes seront présentes pour accompagner, guider, conseiller si besoin. « Une femme qui se sent écoutée tout au long de sa grossesse va généralement mieux accoucher. Si elle est en confiance, elle va fabriquer ce qui lui faut en ocytocine et endorphine pour réagir à la douleur par exemple, mais pas seulement. Si elle est en stress, ne connaît pas les gens qui l’entourent, se sent frustrée de ne pas avoir exprimé ce qu’elle voulait, elle va fabriquer l’hormone du stress et peut avoir un blocage pendant le travail. Ici, l’objectif est d’arriver zen dans le travail et de faire au mieux si des péripéties surviennent. », commente Hélène Billot.
Les professionnelles sont là, oui, mais pour guider et soutenir. Faire de la prévention tout au long de la grossesse pour rester en santé avec une alimentation saine et de l’activité physique. Et surtout pour rendre les couples autonomes et acteurs de l’accueil de leur bébé et les femmes confiantes en leurs capacités. Elle insiste sur ce point :
« Ce n’est pas nous qui accouchons, c’est la femme et elle sait faire. »
La relation de confiance qui s’est créée au fil des consultations permet à la sage-femme de détecter rapidement si un indicateur passe au orange. De dépister et anticiper une éventuelle complication. Elle demandera alors un examen complémentaire ou l’avis d’un-e autre professionnel-le. Elle pourra donner aux futures mamans des outils pour la préparation à la naissance, comme des postures, des massages, des notions sur la respiration, la relaxation, etc. Mais c’est la maman qui choisira sur le moment pour le travail et pour l’accouchement.
« Le moment venu, on intervient le moins possible. On fait le moins de bruit possible. La maman peut se mettre dans l’eau chaude, il y a une baignoire dans la chambre de naissance, se servir d’un système de suspension, marcher, peu importe, elle fait ce qu’elle veut. La maman se laisse guider par son corps. Nous sommes là pour la rassurer sur ses compétences, pour leur donner confiance dans leurs compétences de parents. La maman se met dans la position qui lui fait du bien. Il n’y a pas de technique qui fait qu’une femme accouchera mieux qu’une autre ou des exercices qui remplaceront le pouvoir de l’échange. », souligne la sage-femme.

Les personnes présentes peuvent toutefois moduler, selon leurs attitudes, la douleur de la maman au travail et à l’accouchement. D’où l’intérêt de privilégier au maximum le calme et les lumières tamisées. Un cadre serein. Et notamment un cadre qui laissera travailler le « cerveau primitif ». « Par contre, il est important de signaler que si une femme se dit au moment de l’accouchement qu’elle souhaite avoir une péridurale, ce qui peut arriver, elle sera transférée à la maternité et ne pourra plus bénéficier du suivi global après. », ajoute Hélène.
GÉRER L’APRÈS
Les femmes, ainsi que leurs compagnes ou compagnons, pourront rester dans la chambre de naissance entre 6 et 12h après l’accouchement. Puis seront invité-e-s à rentrer au domicile, ou si le souhait est formulé pourront rejoindre la maternité de la Sagesse.
« La sage-femme se rend au domicile le lendemain de la naissance pour examiner le bébé et la maman, donner des conseils sur l’alimentation, le bain, l’allaitement si besoin, etc. On viendra le 1er, le 2e, le 3e et 5e jour à domicile (il est nécessaire que le domicile se situe dans un périmètre de 35 kms ou si ce n’est pas le cas de se faire loger chez des proches habitant dans cette zone), on sera joignables 24h/24 sur la ligne d’astreinte et on reverra les parents à 3 et 6 semaines, pour savoir comment ils vont. », précise Hélène Billot.
Là encore, la relation de proximité et de confiance jouera un rôle primordial. Christiane David rappelle à ce sujet qu’en France le suivi post accouchement est loin d’être efficace. Les dépressions sont importantes et la pression que l’on met sur une mère n’est pas à négliger. Un cocktail qui peut s’avérer dangereux sur la santé physique et psychologique de la nouvelle maman, à qui on conseille dans les premiers jours d’être entourée de sa compagne, de son compagnon ou d’une tierce personne, « pour qu’elle puisse penser uniquement à elle et son bébé et pas à toute l’intendance autour. »
Le suivi permettra donc là encore d’aborder tous les sujets, de la fatigue à la baisse de moral, en passant par la sexualité par exemple. Selon les ressentis et les vécus, elles pourront être orientées vers des spécialistes ou poursuivre leur chemin vers la parentalité.
Elles pourront également revenir au pôle physiologique qui devrait accueillir une permanence hebdomadaire de l’association MAISoùnaitON ? afin de faire du lien et partager les expériences entre les parents et futurs parents.
« On aimerait aussi qu’il y ait des ateliers, de portage par exemple, de créer une bibliothèque. L’important étant qu’il y ait un lieu de vie, de partage, d’échange. Les gens sont demandeurs car après la grossesse et l’accouchement, il peut y avoir un vide. Il faut éviter que les femmes soient isolées dans un coin avec leur bébé. »
conclut la sage-femme.
L’association continue, pour informer la population, répondre aux questions et toujours aller plus loin sur les connaissances autour de ce sujet, de proposer des réunions chaque deuxième lundi du mois.



 Depuis trois ans, elle retape entièrement sa maison avec son mari. Elle aime le bricolage et en fait depuis longtemps avec ses deux filles. À 46 ans, Elsa Chaderat est infirmière scolaire au lycée Jeanne d’Arc, à Rennes. À mi-temps. Et elle est également, depuis un an et demi environ, la créatrice des Demoiselles. Des sculptures féminines vêtues d’une robe blanche et d’une ou plusieurs roses, fabriquées en papier mâché et fil de fer.
Depuis trois ans, elle retape entièrement sa maison avec son mari. Elle aime le bricolage et en fait depuis longtemps avec ses deux filles. À 46 ans, Elsa Chaderat est infirmière scolaire au lycée Jeanne d’Arc, à Rennes. À mi-temps. Et elle est également, depuis un an et demi environ, la créatrice des Demoiselles. Des sculptures féminines vêtues d’une robe blanche et d’une ou plusieurs roses, fabriquées en papier mâché et fil de fer. Depuis moins d’un an, elle a également intégré l’atelier galerie L’Ombre Blanche, lancé en mai dernier par Sarah Estellé. Un lieu de partage proposant des expositions éphémères ainsi que des ateliers pour enfants et adultes autour de la sculpture, le dessin d’observation, la peinture et les arts créatifs.
Depuis moins d’un an, elle a également intégré l’atelier galerie L’Ombre Blanche, lancé en mai dernier par Sarah Estellé. Un lieu de partage proposant des expositions éphémères ainsi que des ateliers pour enfants et adultes autour de la sculpture, le dessin d’observation, la peinture et les arts créatifs. De son côté, Elisabeth De Abreu, 48 ans, s’est établie depuis quatre ans bientôt, en septembre 2013, en tant que mosaïste professionnelle. Elle aussi s’est saisie d’une annexe de sa maison, à Vern-sur-Seiche, pour en faire un atelier.
De son côté, Elisabeth De Abreu, 48 ans, s’est établie depuis quatre ans bientôt, en septembre 2013, en tant que mosaïste professionnelle. Elle aussi s’est saisie d’une annexe de sa maison, à Vern-sur-Seiche, pour en faire un atelier. ne formation privée de 8 mois dans un atelier privé. « Pour être maitre mosaïste, il faut aller suivre une formation de 3 ans en Italie. Il n’y en a pas en France. Ce n’était pas possible pour moi de faire ça avec ma vie de famille. », précise-t-elle.
ne formation privée de 8 mois dans un atelier privé. « Pour être maitre mosaïste, il faut aller suivre une formation de 3 ans en Italie. Il n’y en a pas en France. Ce n’était pas possible pour moi de faire ça avec ma vie de famille. », précise-t-elle. Pour pouvoir en vivre, elle a tout mis en place pour diversifier un maximum son activité et ne pas se baser uniquement sur la vente de ses œuvres. Ainsi, elle anime cours et stages dans son atelier, en direction des enfants et des adultes, « de 5 à 84 ans, porteurs de handicaps moteurs, de handicaps mentaux, ou non, la mosaïque, c’est pour tout le monde. »
Pour pouvoir en vivre, elle a tout mis en place pour diversifier un maximum son activité et ne pas se baser uniquement sur la vente de ses œuvres. Ainsi, elle anime cours et stages dans son atelier, en direction des enfants et des adultes, « de 5 à 84 ans, porteurs de handicaps moteurs, de handicaps mentaux, ou non, la mosaïque, c’est pour tout le monde. » Elisabeth De Abreu, comme Elsa Chaderat, est particulièrement friande du contact et des rencontres. C’est ce qu’elle aime par dessus tout lors de l’événement L’art et la main, dont la 9e édition a eu lieu les 28 et 29 janvier à la Ferme de la harpe, à Rennes.
Elisabeth De Abreu, comme Elsa Chaderat, est particulièrement friande du contact et des rencontres. C’est ce qu’elle aime par dessus tout lors de l’événement L’art et la main, dont la 9e édition a eu lieu les 28 et 29 janvier à la Ferme de la harpe, à Rennes.
 « Avec une amie parisienne qui travaille dans le secteur de l’artisanat également, on a bossé deux mois ensemble. On a pu constater que les gens se tournent vers l’artisanat pour les pièces uniques que nous produisons. Et au-delà de ça, il y a aussi le rêve qu’on leur vend. On est toutes les deux des voyageuses et on partage l’histoire de chaque pièce. L’argent est une monnaie d’échange pour vivre mais le travail de la matière et le rapport aux gens n’a pas de prix. », souligne-t-elle. D’où le fait qu’elle adapte le prix de ses créations :
« Avec une amie parisienne qui travaille dans le secteur de l’artisanat également, on a bossé deux mois ensemble. On a pu constater que les gens se tournent vers l’artisanat pour les pièces uniques que nous produisons. Et au-delà de ça, il y a aussi le rêve qu’on leur vend. On est toutes les deux des voyageuses et on partage l’histoire de chaque pièce. L’argent est une monnaie d’échange pour vivre mais le travail de la matière et le rapport aux gens n’a pas de prix. », souligne-t-elle. D’où le fait qu’elle adapte le prix de ses créations : À 42 ans, elle est professeure de techno au collège. Et depuis 2 ans et demi a lancé sa boutique en ligne Anne-Cécile Création, fabriquant ainsi sacs à main, portefeuilles et blagues à tabac, très tendances actuellement. Il y a 15 ans, elle a commencé la couture et a choisi de faire ces propres vêtements. Un loisirs créatif et utile qui lui a permis de s’occuper les mains durant un arrêt de travail de trois mois.
À 42 ans, elle est professeure de techno au collège. Et depuis 2 ans et demi a lancé sa boutique en ligne Anne-Cécile Création, fabriquant ainsi sacs à main, portefeuilles et blagues à tabac, très tendances actuellement. Il y a 15 ans, elle a commencé la couture et a choisi de faire ces propres vêtements. Un loisirs créatif et utile qui lui a permis de s’occuper les mains durant un arrêt de travail de trois mois. « C’est la couleur qui m’intéresse !, répète-t-elle. Quand les couleurs ne m’inspirent pas, j’ai moins envie de créer, il faut alors que j’achète de nouveaux cuirs. » Elle se rend parfois en boutique pour acheter des chutes de cuir mais surtout écume les magasins de tissus, qu’elle prend à motifs pour les associer au cuir uni choisi.
« C’est la couleur qui m’intéresse !, répète-t-elle. Quand les couleurs ne m’inspirent pas, j’ai moins envie de créer, il faut alors que j’achète de nouveaux cuirs. » Elle se rend parfois en boutique pour acheter des chutes de cuir mais surtout écume les magasins de tissus, qu’elle prend à motifs pour les associer au cuir uni choisi. La récup’, c’est dans l’ère du temps, comme le dit Anne-Cécile Le Guevel. Surtout quand l’activité se veut déjà du système Débrouille, avec un atelier à domicile et la création d’une boutique en ligne, faisant avec les moyens et techniques du bord. Même si aujourd’hui, les formations et ateliers concernant la communication via les réseaux sociaux et l’investissement du temps passé à actualiser sa boutique en ligne, se développent de plus en plus.
La récup’, c’est dans l’ère du temps, comme le dit Anne-Cécile Le Guevel. Surtout quand l’activité se veut déjà du système Débrouille, avec un atelier à domicile et la création d’une boutique en ligne, faisant avec les moyens et techniques du bord. Même si aujourd’hui, les formations et ateliers concernant la communication via les réseaux sociaux et l’investissement du temps passé à actualiser sa boutique en ligne, se développent de plus en plus.


 Dans la salle, environ 12 danseuses/seurs sont allongé-e-s sur le dos, sur un tapis de sol, un plaid sur les jambes pour la plupart. La voix de Nathalie Schulmann, danseuse contemporaine, professeure de danse et analyste du corps dans les mouvements dansés, les guide pour les inviter à s’intéresser au poids de la tête se déposant sur le ballon placé à l’arrière de leur crâne. Mais aussi à s’aider de leur respiration et de la sonorisation du souffle.
Dans la salle, environ 12 danseuses/seurs sont allongé-e-s sur le dos, sur un tapis de sol, un plaid sur les jambes pour la plupart. La voix de Nathalie Schulmann, danseuse contemporaine, professeure de danse et analyste du corps dans les mouvements dansés, les guide pour les inviter à s’intéresser au poids de la tête se déposant sur le ballon placé à l’arrière de leur crâne. Mais aussi à s’aider de leur respiration et de la sonorisation du souffle. Pour elle, prendre soin est un acte fort aujourd’hui. Car cela n’est pas dans la culture des professionnel-le-s de la danse. « Le danseur prend soin de son corps quand il est cassé ou vieux. Le besoin d’équilibre, de se recentrer, de trouver des moteurs autrement, de se mettre en disponibilité émerge cependant chez les danseurs. Ce ne sera jamais tout le monde mais c’est de plus en plus présent. », souligne-t-elle.
Pour elle, prendre soin est un acte fort aujourd’hui. Car cela n’est pas dans la culture des professionnel-le-s de la danse. « Le danseur prend soin de son corps quand il est cassé ou vieux. Le besoin d’équilibre, de se recentrer, de trouver des moteurs autrement, de se mettre en disponibilité émerge cependant chez les danseurs. Ce ne sera jamais tout le monde mais c’est de plus en plus présent. », souligne-t-elle. Elle poursuit : « J’aime proposer un autre corps que le sien. Parce que ces séances sont collectives, la femme peut penser à son vagin mais va aussi se projeter dans le corps d’un homme présent dans la salle. On est entre des corps. Cette transposition des corps m’intéresse davantage que les codifications du corps féminin et masculin, qui n’est qu’une catégorisation comme une autre. J’ai aussi construit une séance chorégraphique où on passait des organes sexuels féminins aux organes sexuels masculins constamment, au point d’en perdre la notion du masculin et du féminin, on est alors obligé d’inventer un autre corps qui n’existe pas encore. » Et finalement, le corps n’a jamais été aussi réel que lorsque cette fiction nous a permis de le ressentir, de l’imaginer et de l’envisager.
Elle poursuit : « J’aime proposer un autre corps que le sien. Parce que ces séances sont collectives, la femme peut penser à son vagin mais va aussi se projeter dans le corps d’un homme présent dans la salle. On est entre des corps. Cette transposition des corps m’intéresse davantage que les codifications du corps féminin et masculin, qui n’est qu’une catégorisation comme une autre. J’ai aussi construit une séance chorégraphique où on passait des organes sexuels féminins aux organes sexuels masculins constamment, au point d’en perdre la notion du masculin et du féminin, on est alors obligé d’inventer un autre corps qui n’existe pas encore. » Et finalement, le corps n’a jamais été aussi réel que lorsque cette fiction nous a permis de le ressentir, de l’imaginer et de l’envisager.




 Le principe est simple : les tableaux sont joués une première fois au public qui assiste alors à une série d’injustices aujourd’hui banalisées. Le racisme ordinaire sous sa forme la plus primaire. Qui se traduit par une méfiance des passager-e-s d’un bus vis-à-vis de deux hommes noirs, par des contrôles au faciès répétés et insistants ou encore par de la discrimination au logement basée sur le nom et l’accent de la personne.
Le principe est simple : les tableaux sont joués une première fois au public qui assiste alors à une série d’injustices aujourd’hui banalisées. Le racisme ordinaire sous sa forme la plus primaire. Qui se traduit par une méfiance des passager-e-s d’un bus vis-à-vis de deux hommes noirs, par des contrôles au faciès répétés et insistants ou encore par de la discrimination au logement basée sur le nom et l’accent de la personne. Ainsi que de savoir adapter ses partenaires à ses créations, comme le fait la compagnie rennaise 10 doigts. « Nous n'avons pas de diffuseur, et les salles de spectacles ne connaissent pas vraiment notre travail. », expliquent Clémence Colin et Olivia Divelec. La structure passe alors par des réseaux d’associations de sourds mais aussi par des lieux liés au livre et au corps : « Cela dépend du spectacle : Demoiselle au grand manteau est spécifique à la petite enfance donc concerne réseau des crèches, haltes garderie, ce qui ne sera pas le cas de la prochaine création Sedruos, dédiée à des structures culturelles plus grandes. »
Ainsi que de savoir adapter ses partenaires à ses créations, comme le fait la compagnie rennaise 10 doigts. « Nous n'avons pas de diffuseur, et les salles de spectacles ne connaissent pas vraiment notre travail. », expliquent Clémence Colin et Olivia Divelec. La structure passe alors par des réseaux d’associations de sourds mais aussi par des lieux liés au livre et au corps : « Cela dépend du spectacle : Demoiselle au grand manteau est spécifique à la petite enfance donc concerne réseau des crèches, haltes garderie, ce qui ne sera pas le cas de la prochaine création Sedruos, dédiée à des structures culturelles plus grandes. »




 Aujourd’hui, les femmes portent des pantalons, jouent au foot, sont aviatrices, militaires ou encore agents de sécurité, n’attendent plus de trouver un mari pour quitter le domicile familial, peuvent ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de l’époux. Des lois en attestent.
Aujourd’hui, les femmes portent des pantalons, jouent au foot, sont aviatrices, militaires ou encore agents de sécurité, n’attendent plus de trouver un mari pour quitter le domicile familial, peuvent ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de l’époux. Des lois en attestent.
 Pour autant, elle démontre une certaine fermeté. Agir avec souplesse ne rime pas avec se faire marcher sur les pieds et écraser. Elle s’affirme dans l’intégralité de sa personne : « Il faut du respect. Pour tout. C’est important de prendre soin de soi. Le physique et le moral sont très liés. J’ai fait un burn out et récemment une dépression, j’ai pris du poids. Maintenant, je veux faire attention à moi, être dans la douceur avec mon corps. Il a tellement éprouvé ces dernières années que je ne supporte pas du tout qu’on l’insulte en me parlant de mon poids. »
Pour autant, elle démontre une certaine fermeté. Agir avec souplesse ne rime pas avec se faire marcher sur les pieds et écraser. Elle s’affirme dans l’intégralité de sa personne : « Il faut du respect. Pour tout. C’est important de prendre soin de soi. Le physique et le moral sont très liés. J’ai fait un burn out et récemment une dépression, j’ai pris du poids. Maintenant, je veux faire attention à moi, être dans la douceur avec mon corps. Il a tellement éprouvé ces dernières années que je ne supporte pas du tout qu’on l’insulte en me parlant de mon poids. »

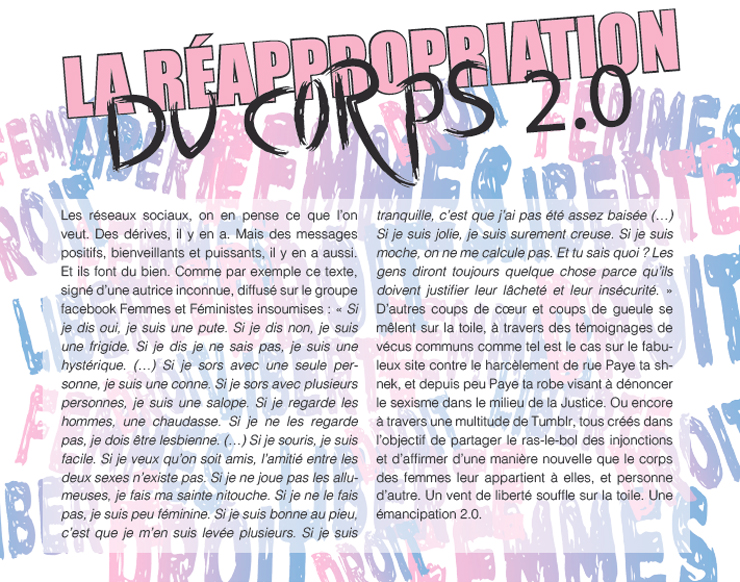


 Le dernier Baromètre Agence BIO / CSA, réalisé en 2015, montre que 9 français-es sur 10 consomment bio. Occasionnellement, en tout cas. Contre environ 5 français-es sur 10 en 2003. L’étude révèle également que 65% en consomment régulièrement – au moins une fois par mois – soit 28% de plus qu’il y a 13 ans.
Le dernier Baromètre Agence BIO / CSA, réalisé en 2015, montre que 9 français-es sur 10 consomment bio. Occasionnellement, en tout cas. Contre environ 5 français-es sur 10 en 2003. L’étude révèle également que 65% en consomment régulièrement – au moins une fois par mois – soit 28% de plus qu’il y a 13 ans. Des marchés bio fleurissent, comme tel est le cas le mercredi après-midi dans la capitale bretonne, au début du mail François Mitterand, les restaurateurs-trices optent désormais pour la démocratisation du bio dans les assiettes et les parents d’élèves réclament que cela en soi ainsi dans les cantines scolaires.
Des marchés bio fleurissent, comme tel est le cas le mercredi après-midi dans la capitale bretonne, au début du mail François Mitterand, les restaurateurs-trices optent désormais pour la démocratisation du bio dans les assiettes et les parents d’élèves réclament que cela en soi ainsi dans les cantines scolaires. « C’est un courant agricole que l’on ne peut pas résumer en 3 phrases dans un article mais en gros il place l’agriculteur au cœur d’un système agricole vu comme un organisme vivant. On travaille avec tous les éléments, comme la lune par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails mais ce qui est important, c’est que c’est une agriculture qui repose beaucoup sur l’observation. On prend le temps de faire, on prend le temps de se poser et de regarder nos plantes. Et ça définit le boulot qu’on a car on voit des choses que l’on n’aurait pas vu dans l’urgence. », analyse Sophie.
« C’est un courant agricole que l’on ne peut pas résumer en 3 phrases dans un article mais en gros il place l’agriculteur au cœur d’un système agricole vu comme un organisme vivant. On travaille avec tous les éléments, comme la lune par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails mais ce qui est important, c’est que c’est une agriculture qui repose beaucoup sur l’observation. On prend le temps de faire, on prend le temps de se poser et de regarder nos plantes. Et ça définit le boulot qu’on a car on voit des choses que l’on n’aurait pas vu dans l’urgence. », analyse Sophie. Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se lancent dans la filière. Il n’y a qu’à voir les chiffres. La conversion des éleveurs de vaches laitières est fluctuante et un développement de l’ordre de 30% est attendu d’ici 2018 dans le secteur du lait bio.
Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se lancent dans la filière. Il n’y a qu’à voir les chiffres. La conversion des éleveurs de vaches laitières est fluctuante et un développement de l’ordre de 30% est attendu d’ici 2018 dans le secteur du lait bio. « Parfois, j’ai des demandes pour simplement dessiner et élaborer un plan de jardin. Mais quand je réalise, je travaille en local. Avec un créateur de rosiers ou une productrice de graines et plantes sauvages. Ce que j’aime bien faire aussi, c’est de travailler avec les semis. Les gens ont envie de mettre la main à la patte, on garde donc des coins pour les récupérer les graines et les replanter. Les gens demandent des jardins vivants avec un éco-système qui va intégrer les insectes, etc. », déclare-t-elle. Le geste écologique est donc important et se développe petit à petit, à des échelles différentes.
« Parfois, j’ai des demandes pour simplement dessiner et élaborer un plan de jardin. Mais quand je réalise, je travaille en local. Avec un créateur de rosiers ou une productrice de graines et plantes sauvages. Ce que j’aime bien faire aussi, c’est de travailler avec les semis. Les gens ont envie de mettre la main à la patte, on garde donc des coins pour les récupérer les graines et les replanter. Les gens demandent des jardins vivants avec un éco-système qui va intégrer les insectes, etc. », déclare-t-elle. Le geste écologique est donc important et se développe petit à petit, à des échelles différentes.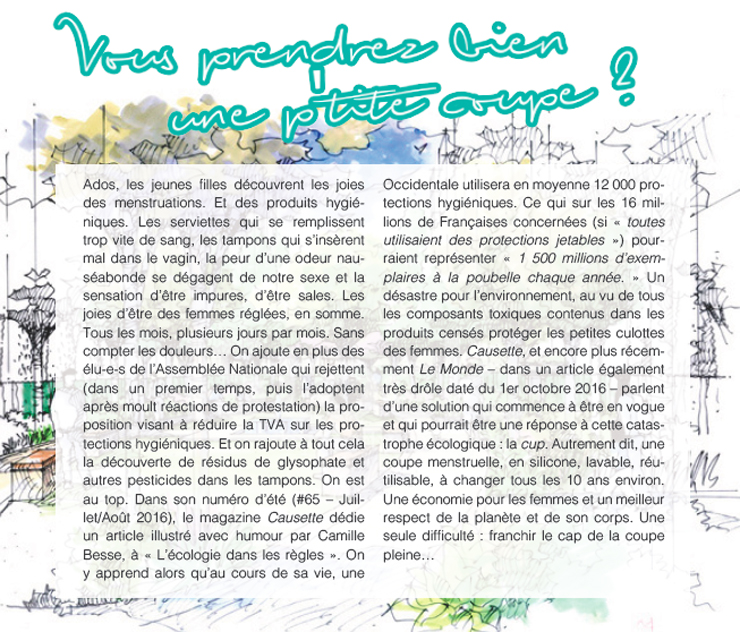
 Maintenant notre enjeu c’est de mettre les gens autour de la table pour créer des passerelles. C’est ce qu’on essaye de faire avec La Belle Déchette et notamment l’étude-action que l’on a lancé début septembre. Au premier comité de pilotage, il y avait autour de la table les partenaires et les financeurs de tous les domaines. C’était très innovant. C’est de la co-construction.
Maintenant notre enjeu c’est de mettre les gens autour de la table pour créer des passerelles. C’est ce qu’on essaye de faire avec La Belle Déchette et notamment l’étude-action que l’on a lancé début septembre. Au premier comité de pilotage, il y avait autour de la table les partenaires et les financeurs de tous les domaines. C’était très innovant. C’est de la co-construction.

 Obtenir une place en crèche est une problématique loin d’être nouvelle. Si le plan gouvernemental prévoit l’augmentation du nombre de places au cours du mandat présidentiel actuel, l’objectif de 100 000 places supplémentaires semble compromis pour ce quinquennat qui semble seulement avoir réalisé un tiers de cette mission, selon les chiffres indiqués en 2015. Rennes ne fait pas exception, malgré la création de nouvelles crèches prévues jusqu’en 2017.
Obtenir une place en crèche est une problématique loin d’être nouvelle. Si le plan gouvernemental prévoit l’augmentation du nombre de places au cours du mandat présidentiel actuel, l’objectif de 100 000 places supplémentaires semble compromis pour ce quinquennat qui semble seulement avoir réalisé un tiers de cette mission, selon les chiffres indiqués en 2015. Rennes ne fait pas exception, malgré la création de nouvelles crèches prévues jusqu’en 2017. À la crèche parentale, elle a pris goût. Arrivée de Paris en 2012, elle pose ses valises à Rennes avec son compagnon et son fils. En cherchant un mode de garde, sans préférence particulière, ils apprennent qu’une place s’est libérée à Ty Bugale, alors implantée rue de l’Alma, avant de déménager dans les locaux temporaires du boulevard Albert 1er de Belgique (en octobre, la crèche déménagera à nouveau dans des locaux plus grands, rue Mauconseil). Rapidement, ils adhèrent à l’état d’esprit de l’établissement, qui accueillera par la suite leur fille.
À la crèche parentale, elle a pris goût. Arrivée de Paris en 2012, elle pose ses valises à Rennes avec son compagnon et son fils. En cherchant un mode de garde, sans préférence particulière, ils apprennent qu’une place s’est libérée à Ty Bugale, alors implantée rue de l’Alma, avant de déménager dans les locaux temporaires du boulevard Albert 1er de Belgique (en octobre, la crèche déménagera à nouveau dans des locaux plus grands, rue Mauconseil). Rapidement, ils adhèrent à l’état d’esprit de l’établissement, qui accueillera par la suite leur fille. Avec Yohanna, elles parlent de grande famille. Passer du temps au sein de la crèche, auprès des enfants, de l’équipe éducative, effectuer des réunions entre parents, organiser des événements avec tout le monde (à l’instar d’un moment convivial en juin dernier pour fêter les 30 ans de la structure) ou encore participer à des sorties avec les petit-e-s, tout cela représente « un chouette moyen de s’intégrer et de développer une grande solidarité entre les parents. »
Avec Yohanna, elles parlent de grande famille. Passer du temps au sein de la crèche, auprès des enfants, de l’équipe éducative, effectuer des réunions entre parents, organiser des événements avec tout le monde (à l’instar d’un moment convivial en juin dernier pour fêter les 30 ans de la structure) ou encore participer à des sorties avec les petit-e-s, tout cela représente « un chouette moyen de s’intégrer et de développer une grande solidarité entre les parents. » Car lui, ainsi que l’ensemble de l’équipe éducative, est présent pour appliquer le projet pédagogique et éducatif, à savoir transmettre les valeurs et règles de vie définies avec le CA et selon les capacités et objectifs d’éveil cohérents à la petite enfance.
Car lui, ainsi que l’ensemble de l’équipe éducative, est présent pour appliquer le projet pédagogique et éducatif, à savoir transmettre les valeurs et règles de vie définies avec le CA et selon les capacités et objectifs d’éveil cohérents à la petite enfance. Et c’est ce qui va éveiller le/la tout-e petit-e. La confrontation entre soi et les autres. L’équipe professionnelle couplée au turn over parental permet alors de conjuguer diversité des profils, des cultures et des approches.
Et c’est ce qui va éveiller le/la tout-e petit-e. La confrontation entre soi et les autres. L’équipe professionnelle couplée au turn over parental permet alors de conjuguer diversité des profils, des cultures et des approches. Loïc Bernier, qui assurera dès octobre le poste de référent technique à mi-temps, en plus de son travail d’éducateur, apporte de son point de vue une autre approche.
Loïc Bernier, qui assurera dès octobre le poste de référent technique à mi-temps, en plus de son travail d’éducateur, apporte de son point de vue une autre approche.


 Parti de l’esplanade Charles de Gaulle, le cortège fait masse boulevard de la Liberté, samedi 4 juin. Plus de 2000 personnes marchent, chantent et dansent pour ce que l’on appelait communément la gay pride, qui rapidement à Rennes – une des premières villes à arborer cet intitulé avec Marseille - se nommera la Gay & Lesbian pride avant de devenir la Marche des fiertés.
Parti de l’esplanade Charles de Gaulle, le cortège fait masse boulevard de la Liberté, samedi 4 juin. Plus de 2000 personnes marchent, chantent et dansent pour ce que l’on appelait communément la gay pride, qui rapidement à Rennes – une des premières villes à arborer cet intitulé avec Marseille - se nommera la Gay & Lesbian pride avant de devenir la Marche des fiertés. « Lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique le rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence. »
« Lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique le rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence. » Toutefois, les humiliations et les discriminations quasi permanentes laissent à penser qu’ils et elles sont considéré-e-s comme une population de seconde zone. « On peut souffrir de discrimination à l’emploi, à la Caf, face à l’administration, ou quand on va retirer un recommandé à La Poste, quand on subit un contrôle policier. », précise-t-elle.
Toutefois, les humiliations et les discriminations quasi permanentes laissent à penser qu’ils et elles sont considéré-e-s comme une population de seconde zone. « On peut souffrir de discrimination à l’emploi, à la Caf, face à l’administration, ou quand on va retirer un recommandé à La Poste, quand on subit un contrôle policier. », précise-t-elle. Et ces sexes de naissance définiront également une hiérarchisation : le masculin prévalant automatiquement sur le féminin. D’où le problème pour l’évolution des mentalités. Le conditionnement et le cadre culturel et éducatif actuel, inconsciemment, ne permettant pas aisément de comprendre le mal-être d’une personne non cisgenre.
Et ces sexes de naissance définiront également une hiérarchisation : le masculin prévalant automatiquement sur le féminin. D’où le problème pour l’évolution des mentalités. Le conditionnement et le cadre culturel et éducatif actuel, inconsciemment, ne permettant pas aisément de comprendre le mal-être d’une personne non cisgenre. La Manif pour tous ne serait plus une menace a priori. Mais les LGBTIphobies décomplexées font toujours rage. La vice-présidente du CGLBT, le porte parole de la Fédération LGBT et la co-présidente de TRANS INTER action sont convaincu-e-s et unanimes : pour désarmorcer les phobies, cela doit passer par l’éducation. Pas n’importe laquelle. L’éducation populaire.
La Manif pour tous ne serait plus une menace a priori. Mais les LGBTIphobies décomplexées font toujours rage. La vice-présidente du CGLBT, le porte parole de la Fédération LGBT et la co-présidente de TRANS INTER action sont convaincu-e-s et unanimes : pour désarmorcer les phobies, cela doit passer par l’éducation. Pas n’importe laquelle. L’éducation populaire.




 Au mois de mai, les averses et les ciels menaçants n’auront pas raison de leur envie d’en découdre avec le ballon rond.
Au mois de mai, les averses et les ciels menaçants n’auront pas raison de leur envie d’en découdre avec le ballon rond.
 Au-delà de cette ambiance chaleureuse et conviviale, argument majeur des sports collectifs, le football gaélique a un avantage non négligeable pour les joueuses de l’Ar Gwazi Guez.
Au-delà de cette ambiance chaleureuse et conviviale, argument majeur des sports collectifs, le football gaélique a un avantage non négligeable pour les joueuses de l’Ar Gwazi Guez. Si une équipe non-mixte conçoit un espace confiné dans lequel chaque sportive peut développer sereinement ses capacités physiques et stratégiques, sans la pression d’être « un poids », et prouve son efficacité par des constats de progression fulgurante, la complémentarité des entrainements est appréciée par un grand nombre, dont Lisa Hamon, 25 ans, service civique pour l’association rennaise Electroni-k, fait partie.
Si une équipe non-mixte conçoit un espace confiné dans lequel chaque sportive peut développer sereinement ses capacités physiques et stratégiques, sans la pression d’être « un poids », et prouve son efficacité par des constats de progression fulgurante, la complémentarité des entrainements est appréciée par un grand nombre, dont Lisa Hamon, 25 ans, service civique pour l’association rennaise Electroni-k, fait partie. Dix joueuses de l’Ar Gwazi Guez étaient pressenties pour l’équipe de France qui sera constituée le 11 juin. C’est à Clermont-Ferrand, à l’occasion de la finale de la coupe de France, qu’elles seront fixées et qu’elles sauront si elles participent au stage de formation début juillet. Jessica Chapel ne cache pas sa joie :
Dix joueuses de l’Ar Gwazi Guez étaient pressenties pour l’équipe de France qui sera constituée le 11 juin. C’est à Clermont-Ferrand, à l’occasion de la finale de la coupe de France, qu’elles seront fixées et qu’elles sauront si elles participent au stage de formation début juillet. Jessica Chapel ne cache pas sa joie :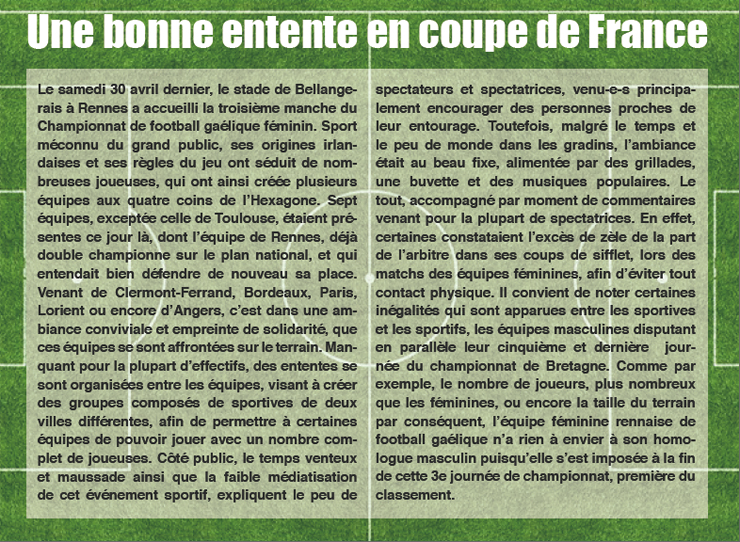



 Acte symbolique pour un événement d'envergure internationale qui donne un coup de projecteur aux femmes derrière les manettes. Puisque, dans ce jeu, elles sont loin d'atteindre la majorité. En 2012, selon son développeur Riot Games, sur 100 joueurs, moins de 10 personnes étaient des femmes.
Acte symbolique pour un événement d'envergure internationale qui donne un coup de projecteur aux femmes derrière les manettes. Puisque, dans ce jeu, elles sont loin d'atteindre la majorité. En 2012, selon son développeur Riot Games, sur 100 joueurs, moins de 10 personnes étaient des femmes. Les gameuses partent avec un double handicap puisqu'elles découvrent ce loisir sur le tard. « Je me suis mise à League of Legends en 2013, trois ans après sa sortie. C'est mon ex qui m'a fait connaître ce jeu », explique Floriane, 21 ans, qui a commencé à s'y intéresser car son copain se passionnait pour World of Warcraft et cela « l'agaçait ».
Les gameuses partent avec un double handicap puisqu'elles découvrent ce loisir sur le tard. « Je me suis mise à League of Legends en 2013, trois ans après sa sortie. C'est mon ex qui m'a fait connaître ce jeu », explique Floriane, 21 ans, qui a commencé à s'y intéresser car son copain se passionnait pour World of Warcraft et cela « l'agaçait ». L'atmosphère décontractée lui plaît. La jeune femme de 24 ans décide alors de devenir bénévole. Depuis, elle fait partie du conseil d'administration et passe souvent « voir les copains » aux évènements, même lorsqu'elle n'a pas forcément le temps de jouer.
L'atmosphère décontractée lui plaît. La jeune femme de 24 ans décide alors de devenir bénévole. Depuis, elle fait partie du conseil d'administration et passe souvent « voir les copains » aux évènements, même lorsqu'elle n'a pas forcément le temps de jouer.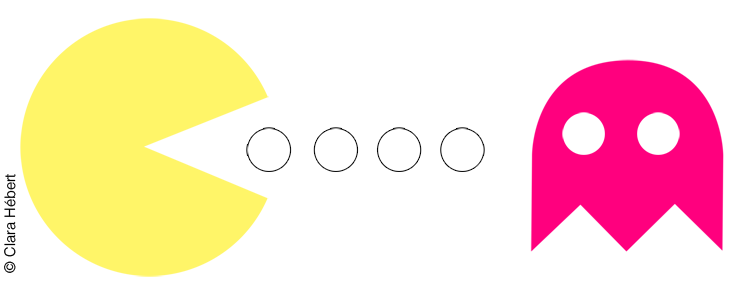
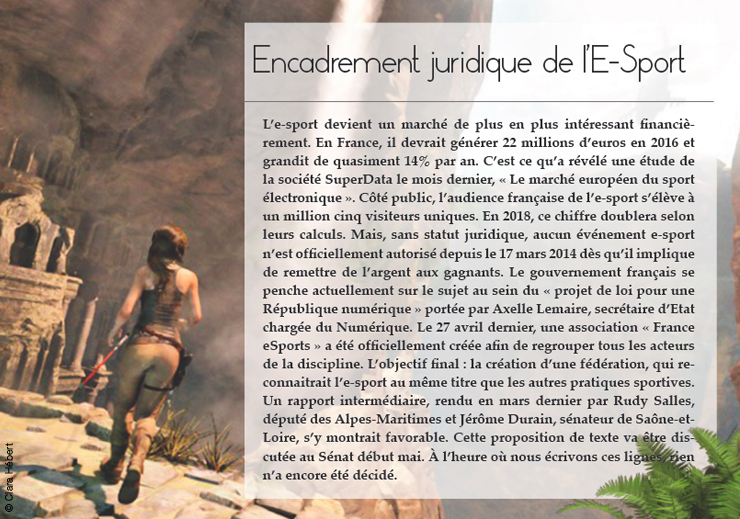
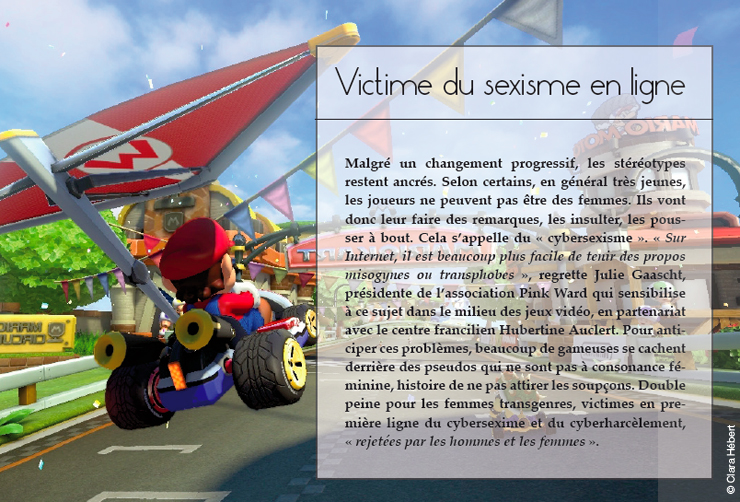
 Est-ce qu'en dehors d'un milieu d'initiés, cela touche le grand public ?
Est-ce qu'en dehors d'un milieu d'initiés, cela touche le grand public ?