Célian Ramis
Boxeuses : Combattre les préjugés


Existe-t-il une boxe féminine ? A priori non. La démarche des femmes qui pratiquent ce sport est-elle similaire à celle des hommes ? Tout dépend des personnes. Comment sont accueillies les filles dans cette discipline que l’on pense (trop souvent) réservée aux hommes ? Bien.
Si elles sont encore minoritaires à pousser les portes des clubs, elles sont en revanche indifférentes aux stéréotypes de genre qui existent dans l’imagerie populaire, voulant que la boxe – anglaise, française ou thaï – soit un sport violent exclusivement destiné aux hommes avides de castagne. Un cliché qui prouve que l’on connaît bien mal ce que l’on qualifie de noble art.

La Mézière, dimanche 31 janvier, 19h, salle Cassiopée. Danaé Cuvinot est sacrée championne de Bretagne de boxe thaï, après un combat en 3 rounds de 3 minutes chacun, dans la catégorie amateure des moins de 60 kilos. Elle est maintenant qualifiée pour le tournoi de la zone Nord Ouest, dernière étape avant de pouvoir conquérir les championnats de France.
Pendant plus de 10 minutes, la jeune boxeuse du club local Naga Muay Thaï a affronté Barbara, de l’Association sportive des cheminots de Rennes. Encouragée dès son entrée, Danaé esquisse un sourire malicieux en montant sur le praticable. Selon le rituel d’arrivée sur le ring, elle longe les cordes des quatre côtés, salue son public ainsi que les juges et vient se placer au centre, à l’appel de l’arbitre. Un check du gant avec son adversaire et le combat débute. Elle déclenche plusieurs coups de pied, jambe bien droite, dont elle semble parfaitement maitriser la technique.
« Shoote, shoote », crie son entraineur, Jérôme Juin. La sportive gagne en assurance dès le deuxième round, au cours duquel elle se montre de plus en plus offensive, concentrée, battante. Les 30 dernières secondes se font intenses, les encouragements vrombissent dans les gradins, laissant finalement éclater une vive émotion dans l’assistance mêlant satisfaction et soulagement à l’annonce de sa victoire, lorsque l’arbitre saisit son bras. Signe de bataille gagnée.
BANDE DE FILLES
 Plus tôt dans l’après-midi, c’est Anaïs Serralta qui s’est illustrée sur le ring, ouvrant le bal des combats féminins. Quatre ans que la jeune adolescente de 15 ans pratique la boxe thaï et un an qu’elle évolue en compétition. Ce dimanche, elle perd son combat d’assauts mais démontre qu’elle en veut et qu’elle possède un potentiel technique. Et révèle également, à l’instar des 5 autres boxeuses du championnat, l’esthétisme de ce sport, fascinante chorégraphie gracieuse et puissante.
Plus tôt dans l’après-midi, c’est Anaïs Serralta qui s’est illustrée sur le ring, ouvrant le bal des combats féminins. Quatre ans que la jeune adolescente de 15 ans pratique la boxe thaï et un an qu’elle évolue en compétition. Ce dimanche, elle perd son combat d’assauts mais démontre qu’elle en veut et qu’elle possède un potentiel technique. Et révèle également, à l’instar des 5 autres boxeuses du championnat, l’esthétisme de ce sport, fascinante chorégraphie gracieuse et puissante.
« De plus en plus de filles viennent faire de la boxe. Et elles ont des bons niveaux. Vous pouvez donc nous envoyer vos sœurs et vos filles… », précise le speaker dont le commentaire, interprété à double sens, suscitera les ricanements des spectatrices et spectateurs. Sur les 180 licenciés du club Naga Muay Thaï, un peu moins d’un tiers sont des femmes et environ 30 d’entre elles s’entrainent dans le groupe non mixte du lundi soir mis en place lors de la saison 2014/2015, à La Mézière.
« Ça fait 6 ans que le club existe, explique Jérôme Juin, boxeur depuis 25 ans. Lors de la 4e saison, j’ai perdu une dizaine de filles. En les croisant, j’ai discuté avec elles des raisons de leur départ. Elles m’ont demandé une section féminine. J’ai dit ok mais je voulais qu’il y ait minimum 20 filles. » Dès le lancement, l’offre connaît le succès. Aujourd’hui, l’effectif est variable selon les semaines, oscillant entre 20 et 30 participantes. L’objectif étant de renforcer leur aisance technique et tactique, pour pouvoir s’intégrer aux autres cours, mixtes.
Ce moment entre boxeuses pallie au manque de confiance instauré par l’éducation genrée dès la petite enfance. « Les garçons, ils se bagarrent dès la cour d’école. Les filles, non, et elles n’osent pas frapper car elles ont peur de faire mal. Depuis toutes petites, elles entendent dire que ce n’est pas bien. Ici, elles se disent ‘j’ai le droit de le faire’. Mais attention, il ne faut pas assimiler la boxe à la violence. C’est un sport de combat mais les entrainements sont très protégés. Personne n’a envie d’aller bosser le lendemain avec la figure abimée. », analyse l’entraineur.
 Pourtant, l’idée persiste inconsciemment et il est difficile de passer outre, même pour une fille : « Un groupe de filles, ça change, c’est bien, assure Anaïs, un lundi soir de janvier à l’entrainement non mixte. Mais je préfère m’entrainer avec les gars. En combat avec eux, on peut taper. » Ce soir-là, une quinzaine de boxeuses, âgées entre 15 et 45 ans environ, travaille les différentes techniques au fil d’une série d’exercices en duo. « J’ai du mal avec l’esquive », « Moi, c’est avec le crochet » ou encore « ah, je ne peux pas m’empêcher de réagir alors que c’est à ton tour »…
Pourtant, l’idée persiste inconsciemment et il est difficile de passer outre, même pour une fille : « Un groupe de filles, ça change, c’est bien, assure Anaïs, un lundi soir de janvier à l’entrainement non mixte. Mais je préfère m’entrainer avec les gars. En combat avec eux, on peut taper. » Ce soir-là, une quinzaine de boxeuses, âgées entre 15 et 45 ans environ, travaille les différentes techniques au fil d’une série d’exercices en duo. « J’ai du mal avec l’esquive », « Moi, c’est avec le crochet » ou encore « ah, je ne peux pas m’empêcher de réagir alors que c’est à ton tour »…
Les unes et les autres affrontent leurs difficultés, dans une ambiance détendue. Aux alentours de 20h15, les sportifs du cours suivant foulent le plancher de la salle et s’amusent à taquiner : « C’est tout de suite plus le bordel avec les femmes, ça bavarde ! » Plaisanterie, à n’en pas douter, qui assoie une supériorité dans l’implication des licencié-e-s : le loisirs pour les femmes, le sérieux pour les hommes. Une image stéréotypée qui n’a pas épargné Anne-Gaëlle Derriennic, championne de France Élite, de boxe française - savate (lire son interview p.22 et 23).
Malgré tout, lors des combats, la notion de sexe s’évapore. Compétiteurs et compétitrices sont jugés, respectés et encouragés de manière similaire par le public.
ELLES ARRIVENT !
À 70 ans, Jean-Claude Guyard ne compte même plus combien de temps il a boxé. Après 18 ans au Cercle Paul Bert à mener la section boxe anglaise, il a fondé en 2005 le Club Pugilistique Rennes Villejean, dont il est président. Il parle comme s’il était né les mains dans les gants, aujourd’hui raccrochés mais pas délaissés. Loin de là. Il se souvient, avec Jacques Marguerite, entraineur du club, de l’arrivée des premières filles. Il y a à peine 20 ans. D’abord dans la boxe éducative, où on apprend à toucher l’adversaire, sans appuyer, sans frapper. Puis en catégorie amateure.

« Il y a eu des réactions oui, évidemment, certains n’étaient pas d’accord mais ils se sont adaptés. Quand elles font leurs preuves, ils ne disent plus rien. Elles doivent faire deux fois plus d’effort que les gars », commente Jacques. « Les filles dans les équipes, généralement, ce sont des têtes ! Avocates, médecins, ingénieures, cadres… Alors oui certains ont dit que ce n’était pas un sport féminin, que les femmes ne pouvaient pas prendre des coups… Mais ce sont des a priori ! À part certains qui restent dans leur connerie, les autres se sont ouverts et ont changé d’avis. Et heureusement ! », vient préciser Jean-Claude qui se délecte chaque soir de l’ambiance qui règne dans le gymnase loué par le CPRV, qui manque d’une salle de sport qui lui soit propre.
À l’image du Naga Muay Thaï, les femmes représentent presque 1/3 de l’effectif du Club, comptant près de 40 boxeuses sur environ 120 licenciés.
LA BOXE LIBÈRE
 Audrey Chenu, militante féministe, boxeuse depuis 5 ans et entraineure pour les petites filles, était de passage à Rennes en novembre 2014. Elle défendait bec et ongles la place des femmes dans ce sport : « Il faut prendre l’espace, il y a plein de choses à déconstruire ! » La boxe se révèle comme un des sports les plus complets et exigeants, qui permet de prendre confiance en soi et de se forger un mental d’acier.
Audrey Chenu, militante féministe, boxeuse depuis 5 ans et entraineure pour les petites filles, était de passage à Rennes en novembre 2014. Elle défendait bec et ongles la place des femmes dans ce sport : « Il faut prendre l’espace, il y a plein de choses à déconstruire ! » La boxe se révèle comme un des sports les plus complets et exigeants, qui permet de prendre confiance en soi et de se forger un mental d’acier.
« On nous fait croire qu’on n’est pas capables. Qu’on est faibles. Quand on regarde dans le métro, les femmes sont recroquevillées. La boxe libère l’agressivité, dresse le corps des femmes et développe la force musculaire. », avait-elle alors déclarée, passionnée et engagée (lire notre article « Audrey Chenu, son combat de femme vers l’émancipation » - 19/12/2014 – yeggmag.fr).
Mettre du rythme, ne pas être contracté, effectuer des mouvements amples, ne pas gaspiller de l’énergie en se dispersant… Les conseils prodigués par Maxime Cuminet, coach de boxe anglaise au sein du club Défenses tactiques, de Rennes, résonnent dans l’esprit des boxeurs/boxeuses. Dynamisme, précision, fluidité, rapidité, la boxe demande rigueur et discipline. Les cordes fouettent le sol d’un côté du tatami, les poings fendent l’air de l’autre. Une chaleur moite envahit la salle.
Par deux, les participant-e-s se concentrent sur les feintes. L’objectif : apprendre à percer la défense de l’adversaire. Il faut élaborer sa stratégie rapidement. Avant que l’autre ne provoque l’action et ne déclenche en premier. « Les bases techniques nous aident à maitriser nos coups et à les recevoir. Les six premiers mois, ma famille s’inquiétait un peu de me voir avec des bleus. Sur la peau noire, ça surprend », s’amuse une participante. À 26 ans, elle prend des cours de boxe depuis 2 ans et de krav maga depuis 5 ans.
 À force d’entrainement, elle se sent de plus en plus à l’aise, progresse et n’hésite pas à s’entrainer avec des hommes. Si les femmes sont en minorité, ne représentant qu’un quart de l’effectif de boxe anglais (environ 15 filles sur 60), la question ne se pose pas lors de l’entrainement.
À force d’entrainement, elle se sent de plus en plus à l’aise, progresse et n’hésite pas à s’entrainer avec des hommes. Si les femmes sont en minorité, ne représentant qu’un quart de l’effectif de boxe anglais (environ 15 filles sur 60), la question ne se pose pas lors de l’entrainement.
SE DÉFOULER
L’intérêt majeur avoué réside dans le défoulement et le dépassement qu’il permet. Toutes évoquent les bienfaits physiques de la boxe. Cardio, gainage, abdos, pompes, sauts à la corde, la pratique régulière entraine musculation et perte de poids. La sueur coule à chaque séance.
Les sacs de frappe sont indispensables aux entrainements du CPRV pour le cardio et le développement du haut du corps, la boxe anglaise n’utilisant que cette partie-là (touches au buste et au visage), tandis que la savate fait appel aux poings et aux pieds, tout comme le muay thaï qui ajoute les genoux et les coudes. Un sport complet et adéquat pour entretenir son corps et aérer son esprit. Mais pas uniquement.
« Je suis venue à la boxe car on m’a dit que ça m’irait bien. Je suis de base assez nerveuse et impulsive mais je déteste la violence. On se défoule dans un état d’esprit que j’aime bien, on se respecte, petits, grands, débutants, doués, femmes, hommes : on est tous ensemble, c’est mixte et tout le monde est accueilli. », confie Adeline Coupeau, 26 ans, qui boxe depuis 3 ans au CPRV.
LA RÈGLE DU RESPECT
 Si bon nombre de clichés s’accumule autour de la discipline, vue comme un sport de rue, une occasion de se bastonner, la notion de respect est bien réelle. Le combat est codifié. Les règles doivent être intégrées, sous peine d’être de sanction. Saluer les juges, respecter son adversaire, ne pas remettre en cause les décisions de l’arbitre, écouter son entraineur, ne pas frapper avec l’intérieur du gant… des points qui peuvent paraître évidents mais qui nécessitent une rigueur mentale qui s’applique comme un réflexe sur le ring mais également en dehors.
Si bon nombre de clichés s’accumule autour de la discipline, vue comme un sport de rue, une occasion de se bastonner, la notion de respect est bien réelle. Le combat est codifié. Les règles doivent être intégrées, sous peine d’être de sanction. Saluer les juges, respecter son adversaire, ne pas remettre en cause les décisions de l’arbitre, écouter son entraineur, ne pas frapper avec l’intérieur du gant… des points qui peuvent paraître évidents mais qui nécessitent une rigueur mentale qui s’applique comme un réflexe sur le ring mais également en dehors.
« Pour moi, c’est l’école de la vie, il y a un règlement très dur. », note Jean-Claude Guyard. Il connaît tous les membres de son club dans lequel les différentes nationalités et milieux sociaux se côtoient. Il prône la boxe sociale, la mixité, et a un mot pour chaque personne qui foule la porte du gymnase de la rue de Lorraine. Du coin de l’œil, il scrute la salle et observe toutes les personnes présentes, se nourrit de l’énergie communicative qui s’en dégage.
Et défend l’idée d’un club convivial et familial. Dans un quartier populaire comme Villejean/Kennedy, une salle de boxe est un argument d’intégration. Plutôt que de trainer dehors, les jeunes s’entrainent. Et s’entraident, et c’est là la fierté de Jean-Claude : les plus grands aident les plus petits aux devoirs, les liens se tissent, la notion de confiance en l’autre s’aiguise.
VALEURS DÈS L’ENFANCE
Un soir d’entrainement, une petite fille de 7 ans, Noémie, attend son papa qui boxe. Il ne lui faut pas plus d’une minute avant d’enfiler des gants et de commencer à déclencher des directs du droit et du gauche contre les palettes que lui présente son grand oncle de 17 ans. Nul doute qu’elle rejoindra à la rentrée prochaine le groupe de boxe éducative, premier pas des enfants dans ce sport pour les assauts. Toucher sans appuyer, c’est la devise de cette pratique.
On y apprend la maitrise de soi, le respect mais aussi à mettre des coups, en recevoir et à découvrir ainsi ses propres capacités. L’apprentissage de la boxe favorise alors la confiance en soi, en prenant conscience de ses capacités. D’autant plus quand on est une femme dans un sport jugé pour les hommes. Le président du CPRV se souvient d’une jeune fille prénommée Rose qui venait aux entrainements mais restait sur le banc à regarder : « Un jour, je l’ai emmenée à Brest. Elle a boxé, elle a gagné. J’ai croisé un peu plus tard la directrice de son collège qui m’a dit que c’était incroyable car Rose avait énormément pris en assurance. »
 La boxe force à se dépasser et à se découvrir. Se découvrir une résistance, une capacité à aller encore plus loin, à aller de l’avant, à canaliser son énergie et à maitriser son corps, simultanément au développement d’une réflexion rapide, qui se doit d’être juste et précise. Mais il va plus loin : « Ici, on ne parle pas que de boxe ; on parle de leur vie aussi. »
La boxe force à se dépasser et à se découvrir. Se découvrir une résistance, une capacité à aller encore plus loin, à aller de l’avant, à canaliser son énergie et à maitriser son corps, simultanément au développement d’une réflexion rapide, qui se doit d’être juste et précise. Mais il va plus loin : « Ici, on ne parle pas que de boxe ; on parle de leur vie aussi. »
CONFIANCE EN SOI
La confiance est primordiale et s’acquiert avec le temps. « Certaines sont timides, discrètes. Sur le ring, elles deviennent des guerrières ! », commente Jérôme Juin. Les motivations sont aussi différentes que nombreuses, que ce soit pour s’entretenir, maigrir ou se défendre. Un argument que la plupart des femmes réfutent. « On prend confiance en nous mais faut pas être dupe. Si je me fais agressée, je ne sais pas si je saurais me protéger. », déclare Rozenn Juin, 35 ans, boxeuse dans le club Naga Muay Thaï depuis 4 ans.
Même son de cloche du côté de Juliette Josselin, 24 ans, boxeuse au CPRV depuis la rentrée 2015 : « Je n’en fais pas depuis longtemps, je ne sais pas donc au niveau des répercussions mais je n’en fait pas pour me sentir en sécurité dans la rue. »
Pour Laélia, la boxe est un moteur pour les femmes. À 28 ans, elle pratique pour la 3e année le noble art et a intégré le club Défenses tactiques en arrivant à Rennes en septembre dernier. « Ça a changé énormément de choses pour moi. Avant, je vivais à Paris, je souffrais du harcèlement de rue, du sexisme. Moi, je suis du genre à sourire… », explique-t-elle à la fin du cours. Plusieurs points lui apparaissent. Le premier : le sport de combat, discipline « qui ne va pas de soi pour les filles », alimente la confiance en soi et diminue la peur des interactions et donc les risques d’interaction.
 L’attitude influençant directement les agresseurs. Le second : la boxeuse apprend à ne plus se laisser faire et à réagir lorsqu’elle est victime d’une situation sexiste. « Un jour, un type me harcelait dans le train et m’a craché dessus. Je lui ai mis un coup de poing. Alors je ne dis pas que c’est la solution, pas du tout. Mais en fait il a été tellement surpris, pensant que j’allais pas réagir, qu’il n’a plus rien fait. Et je me dis qu’il ne le fera plus ! », affirme-t-elle.
L’attitude influençant directement les agresseurs. Le second : la boxeuse apprend à ne plus se laisser faire et à réagir lorsqu’elle est victime d’une situation sexiste. « Un jour, un type me harcelait dans le train et m’a craché dessus. Je lui ai mis un coup de poing. Alors je ne dis pas que c’est la solution, pas du tout. Mais en fait il a été tellement surpris, pensant que j’allais pas réagir, qu’il n’a plus rien fait. Et je me dis qu’il ne le fera plus ! », affirme-t-elle.
Tout comme Juliette, Laélia est de celles qui aiment briser les codes genrés et ne surtout pas se laisser enfermer dans les normes sociales. Être une femme ne devrait pas être un frein. Et la jeune femme se réjouit d’avoir intégré le club rennais qui, prend soin d’employer un langage mixte. « Au masculin et au féminin. Il adapte quand il y a des différences (protection de la poitrine par exemple, ndlr) et surtout il ne nous infantilise pas. J’aime le discours que le club tient : une fille peut avoir les mêmes forces de frappe qu’un homme. », souligne Laélia.
Ne manque plus qu’à appliquer cette qualité de parole au domaine du sport, secteur dans lequel les stéréotypes ont souvent la vie dure. Une chance que ce soit le cas aux JO de Rio cette année ? Pas sûre mais quelques boxeuses devraient nous mettre KO de par leur maitrise et leurs compétences. En 2012, elles étaient passées inaperçues…
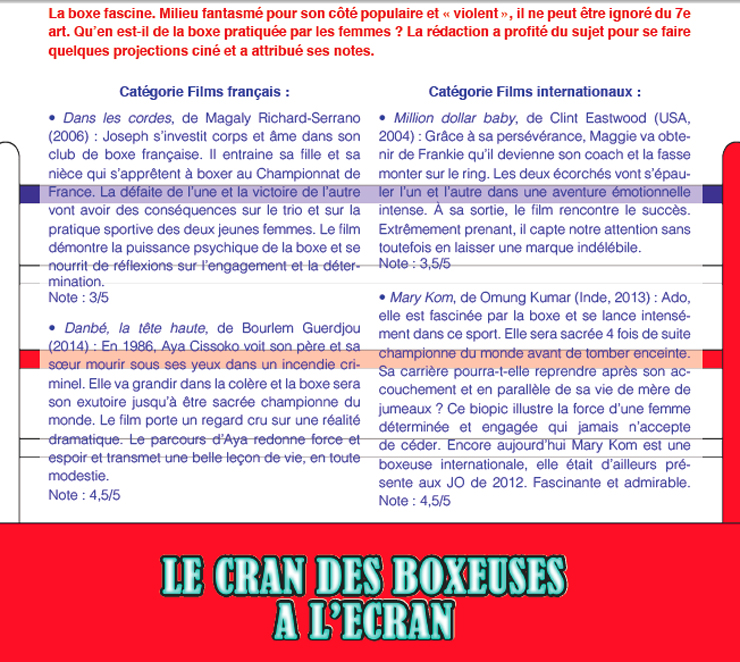
C’est une compétitrice aguerrie. De la gymnastique, elle passe à la boxe française, la savate, un sport qu’elle pratique depuis 10 ans. En arrivant à Rennes il y a 2 ans, Anne-Gaëlle Derriennic se lance dans la compétition. La détermination de la jeune trentenaire, originaire du Sud Ouest, lui vaut d’être sacrée championne de France Elite B en 2015. En parallèle de ses études à l’école de kiné, la sportive vise à présent le podium de l’Elite A, tremplin pour une sélection en équipe de France.
YEGG : Pourquoi avoir choisi la boxe ?
Anne-Gaëlle Derriennic : C’est un sport qui permet de se défouler en peu de temps. En 1h30, on est complètement rincé. Il fait appel à plein de choses comme la souplesse, la coordination, la rapidité… C’est un sport complet ! La boxe française est moins traumatisante car il y a plus de cibles, pas uniquement buste et figure, et de choix dans les armes.
Quel est le rythme d’entrainement ?
Je suis à 3 entrainements de 2h par semaine. Mais ça peut aller jusqu’à 5 entrainements par semaine à l’approche d’une compétition. Ce sont les entraineurs qui planifient les rythmes. Un mois, un mois et demi avant une compétition, je suis à 4 entrainements par semaine. Et ils peuvent choisir d’en rajouter s’il y a besoin de développer la tactique ou la technique.
On dit que la boxe française est la plus féminine. Êtes-vous d’accord ?
Pour moi, il n’y a pas de boxe féminine. Quand on est en combat, les femmes et les hommes ont la même volonté sur le ring. Ce sont les mêmes impacts, proportionnellement au poids, la même intensité. Pour moi, c’est unisexe.
Pourquoi avez-vous voulu passer en compétition ?
J’ai une vision du sport de compétitrice. Pour moi, c’est l’évolution normale. On apprend un sport, les bases, puis on développe, les assauts, les combats, Elite. Mais je comprends que des femmes ne veuillent pas aller au combat. Après, on est préparé-e-s quand on arrive sur le ring. On a une préparation psychologique et physique.
Que vous apporte la boxe ?
Pour une grande partie des gens, la boxe est un sport dans lequel on se met sur la figure. C’est beaucoup plus élaboré que ça. On doit réfléchir, provoquer l’autre pour toucher là où on veut, quand on veut. C’est comme un jeu d’échecs avec une grande rapidité pour réfléchir sous la pression. La boxe française est très codifiée. Elle comporte beaucoup de règles. Ce n’est pas du combat de rue. On a des gants et ça se passe entre des cordes. Pas dans la rue et n’importe comment. C’est comme un art, la boxe. (…) Il faut avoir conscience du danger. On peut prendre un mauvais coup, un KO, il faut bien réfléchir. Quand on va sur le ring, on pense à son combat, il faut faire le vide, être très concentré.
 Quels regards les hommes et les femmes portent sur vous ?
Quels regards les hommes et les femmes portent sur vous ?
Les hommes sont souvent étonnés. Avec mon petit gabarit, ils ne s’imaginent pas que je fais de la boxe. Ou alors en loisirs. Quand je montre mes combats, ils se disent qu’ils ont en face d’eux un bout de femme qui sait se servir de ses pieds et de ses poings sur un ring. Les femmes ont plutôt tendance à dire « Ah oui c’est bien de faire ça… Mais moi je ne le ferais pas ! ». Surtout quand elles me voient avec un cocard (Rires). Mais certaines de mes amies ont testé et ont accroché malgré tout !
Vous souvenez-vous de votre premier combat ?
Oui, c’était un gala, j’étais à l’époque au club de Brest. Il y avait de la musique, des jeux de lumière : le gros stress ! Les entraineurs savent transformer ça en bon stress et puis quand on monte sur le ring, on oublie tout. J’en garde un très bon souvenir.
Un combat vous a-t-il marqué plus qu’un autre ?
Mon premier combat en Élite, ça devait être en avril je crois (2015, ndlr). Mon premier 5 x 2 minutes. Je combattais contre une amie d’un club de Nantes avec qui je me suis beaucoup entrainée. C’était assez fort. On rentrait dans la cour des grandes.
Dans quelle ambiance est-on au Championnat de France ?
C’est assez bizarre et en même temps il ne faut pas trop se mettre la pression. Ce n’est pas comme un gala ; ce sont des combats à la chaine, une soixantaine dans la journée. Il faut alors observer les jeux des adversaires, repérer qui on va peut-être rencontrer. Et vu l’enjeu, on veut aller jusqu’au bout. Il faut être solide psychologiquement.
Vous étiez en catégorie F52 – Coqs, qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est la catégorie des femmes de moins de 52kg. Coqs, c’était le nom à ce moment-là. Et c’était l’Elite B. C’est comme la ligue 2 au foot. Cette année, je suis en Elite A, je me suis qualifiée en janvier pour la demi-finale (qui se jouera le 27 février).
Quel objectif vous fixez-vous ?
C’est la première année en Elite alors l’idée ici est de prendre les combats les uns après les autres. Mais mon rêve est évidemment d’aller en finale !
Et si c’est le cas ?
Les 2 finalistes sont sélectionnables en Equipe de France. Mais il y a beaucoup de prétendants pour peu de places. Dans ma catégorie, l’une des plus grosses catégories, on était 12 femmes. En Elite, il y en a entre 40 et 50. Ça représente environ 1/3 de l’effectif total.
Que diriez-vous aux femmes pour leur donner envie d’intégrer le milieu de la boxe ?
Que malgré l’étiquette de sport d’hommes, les femmes ont leur place dans la boxe. Ce n’est pas un sport de garçon manqué, pas du tout. Il y a une bonne entente aux entrainements entre les femmes et les hommes et nous sommes bien intégrées. Il n’y a pas de différences entre nous. Nous avons les même cours, les mêmes gants, deux pieds, deux mains ! C’est un sport accessible, très physique et ce n’est pas un sport de bagarre. Après, il faut essayer pour voir si on accroche.
Concernant la confiance en soi, la boxe transmet des valeurs utiles sur le ring comme en dehors…
Ah c’est sûr, il vaut mieux avoir confiance en ses armes quand on est sur le ring (Rires) ! Personnellement, je ne suis pas quelqu’un qui a naturellement confiance en soi mais on apprend au fur et à mesure. Evidemment, la boxe transmet aussi sur la vie de tous les jours. On se fixe un objectif et on se donne les moyens d’y arriver.











 Quand on s’intéresse de plus près au fonctionnement de la Corée du Sud, les chances d’avenir pour les nouveaux-nés sont identiques, sans distinction de sexe. Dans l’éducation des enfants, depuis plusieurs années, il ne serait plus question de discrimination envers les petites filles qui effectuent la même scolarité et atteignent le même niveau d’études que les garçons.
Quand on s’intéresse de plus près au fonctionnement de la Corée du Sud, les chances d’avenir pour les nouveaux-nés sont identiques, sans distinction de sexe. Dans l’éducation des enfants, depuis plusieurs années, il ne serait plus question de discrimination envers les petites filles qui effectuent la même scolarité et atteignent le même niveau d’études que les garçons.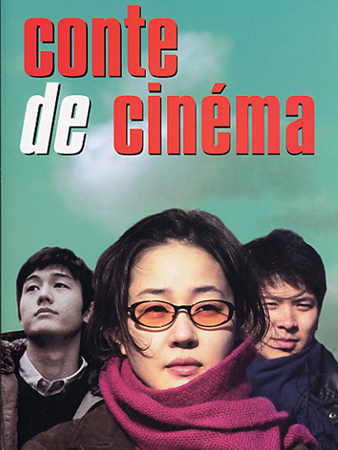 Shin Su-won interroge de son regard critique la société coréenne et propose dans Circle Line (2012) et Madonna (2015), qu’elle présentait en avant-première les 5 et 9 février, de dévoiler des drames sociaux. Jusqu’où va le pouvoir de l’argent ? De quelles difficultés souffrent les habitant-e-s ? La réalisatrice filme les inégalités entre les classes sociales, parfois de manière radicale, pour une prise de conscience terrible mais efficace. On ne ressort pas de la projection indemne.
Shin Su-won interroge de son regard critique la société coréenne et propose dans Circle Line (2012) et Madonna (2015), qu’elle présentait en avant-première les 5 et 9 février, de dévoiler des drames sociaux. Jusqu’où va le pouvoir de l’argent ? De quelles difficultés souffrent les habitant-e-s ? La réalisatrice filme les inégalités entre les classes sociales, parfois de manière radicale, pour une prise de conscience terrible mais efficace. On ne ressort pas de la projection indemne.

 Pour son premier concert en France, elle foule la scène des Trans Musicales, accompagnée d’un batteur, d’un trompettiste, d’un bassiste et d’un guitariste. Les sonorités jazzy se mélangent à des premiers morceaux folk rock qu’elle alimente d’une belle voix grave qui résonne dans le hall 3, rempli de spectateurs-trices envouté-e-s par la proposition.
Pour son premier concert en France, elle foule la scène des Trans Musicales, accompagnée d’un batteur, d’un trompettiste, d’un bassiste et d’un guitariste. Les sonorités jazzy se mélangent à des premiers morceaux folk rock qu’elle alimente d’une belle voix grave qui résonne dans le hall 3, rempli de spectateurs-trices envouté-e-s par la proposition. Le côté Madonna dans Evita à la fenêtre pour entamer « Don’t cry for me Argentina » au début de la chanson « Shake your hands » est magistral et immédiatement suivi d’une rupture dans le rythme du morceau. La voilà qui sautille et parcourt la scène en dansant, derrière les musiciens. Une déferlante de bonne humeur a envahi l’espace de notre bulle et le public, timide au départ, reprend le refrain avec plaisir et enthousiasme.
Le côté Madonna dans Evita à la fenêtre pour entamer « Don’t cry for me Argentina » au début de la chanson « Shake your hands » est magistral et immédiatement suivi d’une rupture dans le rythme du morceau. La voilà qui sautille et parcourt la scène en dansant, derrière les musiciens. Une déferlante de bonne humeur a envahi l’espace de notre bulle et le public, timide au départ, reprend le refrain avec plaisir et enthousiasme.

 En 2009-2010, elle décide d’insuffler un élan féminin au milieu hip hop, secteur à l’origine – et encore aujourd’hui - très masculin. Ainsi, elle crée le crew Swaggers, composé exclusivement de danseuses. « Tous mes mentors étaient des hommes. J’ai voulu fédérer les femmes, leur permettre de faire des battle entre elles, de s’imposer. », explique Marion Motin.
En 2009-2010, elle décide d’insuffler un élan féminin au milieu hip hop, secteur à l’origine – et encore aujourd’hui - très masculin. Ainsi, elle crée le crew Swaggers, composé exclusivement de danseuses. « Tous mes mentors étaient des hommes. J’ai voulu fédérer les femmes, leur permettre de faire des battle entre elles, de s’imposer. », explique Marion Motin. Tout de suite, le jeu de lumière, flirtant avec les nuances feutrées et brumeuses et maniant le contraste du clair-obscur, nous permet de pénétrer dans un univers fascinant dont l’esthétique se rapproche de celle d’un film expérimental.
Tout de suite, le jeu de lumière, flirtant avec les nuances feutrées et brumeuses et maniant le contraste du clair-obscur, nous permet de pénétrer dans un univers fascinant dont l’esthétique se rapproche de celle d’un film expérimental. Les spectateurs-trices voyagent d’un genre à l’autre, grâce au mélange de danse contemporaine, de hip hop, de krump ou encore de house, mais aussi d’une ambiance à une autre. On passe ainsi du saloon à la plage de sable fin, bordant la Méditerranée. D’une battle hispanique quasi flamenca à une culture plus urbaine d’Amérique du Sud. Pour finir en divas féminines-masculines.
Les spectateurs-trices voyagent d’un genre à l’autre, grâce au mélange de danse contemporaine, de hip hop, de krump ou encore de house, mais aussi d’une ambiance à une autre. On passe ainsi du saloon à la plage de sable fin, bordant la Méditerranée. D’une battle hispanique quasi flamenca à une culture plus urbaine d’Amérique du Sud. Pour finir en divas féminines-masculines.


 Morgane a commencé à mixer par hasard. C'était, au départ, pour s'amuser avec son cercle d'amis. Ce parcours, les femmes Djs rennaises l'ont toutes eu, à quelques différences près. L'univers du mix s'est ouvert à elles par la pratique artistique ou grâce à des proches, qui leur ont prêté du matériel et des vinyles pour s'entraîner.
Morgane a commencé à mixer par hasard. C'était, au départ, pour s'amuser avec son cercle d'amis. Ce parcours, les femmes Djs rennaises l'ont toutes eu, à quelques différences près. L'univers du mix s'est ouvert à elles par la pratique artistique ou grâce à des proches, qui leur ont prêté du matériel et des vinyles pour s'entraîner. Pour élaborer chaque programmation, il rencontre les personnes, se déplace à leurs concerts ou les écoute sur Internet : « Je ne me focalise pas sur le sexe, je ne fais pas de calcul. L'objet du festival, c'est de révéler des choses peu montrées ainsi que de partager des coups de cœur. Si on peut donner la visibilité que les femmes méritent, tant mieux ! Car elles travaillent, elles cherchent des morceaux, elles ont une capacité à partager avec les gens, elles ne cherchent pas la facilité. »
Pour élaborer chaque programmation, il rencontre les personnes, se déplace à leurs concerts ou les écoute sur Internet : « Je ne me focalise pas sur le sexe, je ne fais pas de calcul. L'objet du festival, c'est de révéler des choses peu montrées ainsi que de partager des coups de cœur. Si on peut donner la visibilité que les femmes méritent, tant mieux ! Car elles travaillent, elles cherchent des morceaux, elles ont une capacité à partager avec les gens, elles ne cherchent pas la facilité. » « Je suis un peu garçon manqué, j'ai très peu d'amies, la plupart sont des mecs », reconnaît Vanadis. Sur scène, Mac l'Arnaque ne veut pas du tout valoriser sa féminité : « J'ai baigné dans la culture urbaine, je m'habille avec des casquettes et des baskets. »
« Je suis un peu garçon manqué, j'ai très peu d'amies, la plupart sont des mecs », reconnaît Vanadis. Sur scène, Mac l'Arnaque ne veut pas du tout valoriser sa féminité : « J'ai baigné dans la culture urbaine, je m'habille avec des casquettes et des baskets. » 


 Dans le projet, j’écris tout. À quoi je sers ? Attendez, je vais vous montrer (elle se lève et va chercher le projet rédigé sur son bureau, ndlr). J’écris tout le projet artistique que Jean-Louis va mettre en forme. Je fais une Convention aussi pour les partenaires. En fait, je réunis les conditions pour que le projet existe. Avant, j’étais directrice de production et de projet. Mais j’ai délégué.
Dans le projet, j’écris tout. À quoi je sers ? Attendez, je vais vous montrer (elle se lève et va chercher le projet rédigé sur son bureau, ndlr). J’écris tout le projet artistique que Jean-Louis va mettre en forme. Je fais une Convention aussi pour les partenaires. En fait, je réunis les conditions pour que le projet existe. Avant, j’étais directrice de production et de projet. Mais j’ai délégué.