Célian Ramis
Écrire les luttes féministes algériennes au pluriel

Le 13 mars, l’association de Jumelage Rennes-Sétif invitait Amel Hadjadj, co-fondatrice du Journal Féministe Algérien, à la Maison Internationale de Rennes pour une conférence sur les luttes féministes, d’hier et d’aujourd’hui, en Algérie.
« L’Histoire a été écrite par les hommes, pour les hommes. », rappellent la militante féministe Amel Hadjadj. « On manque de ressources et d’archives. On retrouve toujours les mêmes figures féminines dans l’Histoire. Il y en a 6 ou 7 qui reviennent régulièrement. », précise-t-elle. Le matrimoine algérien est minimisé. Ainsi, dans le récit féministe que les militantes entreprennent de raconter, un grand travail est effectué à ce niveau-là. « Les femmes sont la moitié de la société. 44 millions de personnes en Algérie. 22 millions de femmes donc… », souligne-t-elle. Une moitié d’humanité qui a besoin de connaitre son héritage sans que celui-ci soit amputé d’une partie de son histoire et sans que celui-ci soit dénaturé par les stéréotypes de genre. « On décrit les femmes pendant la guerre comme infirmières. C’est très bien, il en fallait mais on minimise leur rôle. Pendant la guerre de libération, les femmes poseuses de bombes ont pris des risques énormes ! Certaines sont mortes, SDF, dans l’anonymat… Pour transporter les armes, il fallait des femmes car les hommes se faisaient fouiller. Si elles se faisaient prendre, elles étaient violées, emprisonnées, etc. », scande Amel Hadjadj. Aux détracteurs qui estiment que la réhabilitation des femmes à travers l’Histoire est un argument biaisé pour simplement se donner une légitimité, elle répond :
« Je veux qu’on rende justice à ces femmes ! »
SCOLARISATION ET TRAVAIL
C’est en 1947 qu’est créée la première association de femmes en Algérie - l’Association des femmes musulmanes algériennes – venant préciser ici la spécificité de la condition des femmes. Quelques années plus tard, l’indépendance est déclarée et l’Algérie organise sa première assemblée constituante. Les femmes y sont quasiment absentes. « Elles sont 5 ou 6 sur plus d’une centaine de personnes ! Même les progressistes disaient que les femmes devaient retourner en cuisine… », signale Amel Hadjadj. L’Union des femmes organise la première manifestation le 8 mars 1965. Les pancartes prônent le soutien à toutes les femmes dans le monde vivant encore sous l’oppression du colonialisme mais ce jour-là est aussi l’occasion de revendiquer leur droit de travailler.
« Seulement 3% des algériennes travaillaient après l’indépendance. Le patriarcat et la mentalité algérienne acceptaient les enseignantes et les infirmières… » Elles se battent également pour la scolarisation des filles et des ainés, de manière générale, souvent envoyés tôt au travail pour aider le patriarche. À Alger, elles marchent du centre de la ville jusqu’à la baie où elles jettent leurs voiles : « C’est un acte éminemment politique mais cela n’a rien à voir avec le débat sur le port du voile. Il s’agit là d’un symbole : elles jettent le voile que portent les femmes au foyer. Les travailleuses, elles, ont une autre tenue. Elles luttent ici pour le travail. »
INSTAURATION DU CODE DE LA FAMILLE
Vont se multiplier les projets de loi concernant un code de la famille. Les codes français (civil, pénal, etc.) seront traduits. « Cela ne s’inscrivait pas du tout dans le reste des progressions du pays. Cela amenait la société vers quelque chose qu’elle n’avait jamais vécue ! », explique la militante. Après deux versions avortées – que les femmes des parlementaires ont faites fuiter auprès des étudiantes pour qu’elles les dénoncent – le code de la famille est promulgué en 1984. Dedans figure, entre autres, « le devoir d’obéissance à son mari et à la famille de son mari et tout un tralala… ». Amel Hadjadj réagit :
« C’est toute une idéologie qui opprimait les femmes des autres pays qu’on a importé ici. Aux luttes pour la scolarisation et le travail, s’ajoute l’abrogation du code de la famille. »
À cette époque, c’est un parti unique qui gouverne le pays. D’autres mouvances s’organisent en souterrain, dans la clandestinité, et font naitre à la fin des années 80 – à la création du multipartisme - des associations luttant contre cette répression politique à l’encontre des femmes. « Mais les années 90 arrivent et avec elles, le terrorisme. » Les féminicides se multiplient. Elles meurent parce qu’elles refusent de porter le voile. Elles meurent parce qu’elles s’assument féministes. Le mouvement est meurtri et entame les années 2000 fatigué. Les associations historiques des années 80/90 disparaissent quasiment toutes.
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
La société algérienne n’est plus la même, signale Amel Hadjadj : « Il y a eu une rupture. On n’est plus dans l’organisation. Certains traumas de l’Histoire du pays n’arrivent pas à être dépassés. Beaucoup de féministes de ces années sont d’ailleurs venues vivre en France. Ma génération arrive et finalement, on revient inconsciemment à la clandestinité. Des associations naissent, les sujets ne sont plus les mêmes… » On y parle harcèlement, communauté LGBT, violences, etc. mais le contexte ne les rend ni visibles ni audibles. Un tournant s’opère en 2015 et, comme elle le dit, la force des réseaux sociaux met en lien des féministes d’hier et d’aujourd’hui et fait la lumière sur l’ampleur des féminicides. « On organise des rencontres intergénérationnelles féministes algériennes. Ce n’est pas simple de se comprendre et de comprendre les traumatismes des anciennes. », poursuit-elle.
En 2016, à Constantine, sa ville natale, un nouveau féminicide pousse les militantes à organiser un sit-in : « L’assassin était en cavale, il fallait qu’on diffuse partout sa photo. Des sit-in ont été organisés à Constantine, à Alger, à Oran et ailleurs. Le bruit incroyable que ça a suscité a permis d’arrêter l’assassin. Et ça nous a obligé à sortir du cocon des réseaux sociaux ! » En 2019, elles réalisent qu’un mouvement d’ampleur s’organise : « J’ai déménagé à Alger pour avoir plus de liberté et pour pouvoir lutter. Un mouvement grandiose se passe. Le collectif féministe d’Alger se cache toujours mais il y a une vraie volonté de rencontrer les autres. » Un besoin immense de reprendre en main l’histoire effacée de toutes les femmes dont le rôle a été minimisé, bafoué, méprisé, écarté, etc. Des carrés féministes s’instaurent dans la capitale mais aussi à Oran et en Kabylie. « Les survivantes des années 90 reprennent les associations qui avaient disparu. Ce qui n’a pas plu à tout le monde. Mais tant pis, le principal, c’est de s’organiser. », se réjouit la militante féministe.
DES FÉMINISMES, AU PLURIEL !
Né ainsi le renouveau des dynamiques féministes. Elles sont de plus en plus dans l’espace public mais aussi dans les sports et d’autres secteurs de la société. Elles s’imposent. Mais cela n’est pas suffisant. De nombreuses revendications perdurent et les militantes sont sans cesse attaquées et décrédibilisées. « On a essayé de mettre les féministes dans les cases de tous les traumas, y compris ceux qui n’ont pas été traités. Pour moi, il y a une urgence à décoloniser les luttes. La peur des autres, de son passé et la violence sont encore présentes. En plus du patriarcat… La révolution, c’est pas les bisounours. Il faut continuer de sortir et de s’organiser malgré les divergences et les rejets. », commente Amel Hadjadj. Les médias et partis politiques adaptent leurs discours, intégrant de plus en plus les problématiques et revendications féministes. En parallèle, est créée l’association du Journal Féministe Algérien. « En 2015, on a ouvert une page sur les réseaux sociaux pour annoncer le sitting. On a eu de l’impact. On couvre tout ce qui se fait, les mouvements féministes, les lettres ouvertes, etc. Il faut continuer à s’organiser. », insiste-t-elle. Elle poursuit :
« Le vécu nous a poussé à réaliser qu’il n’y a pas un seul féminisme, mais plusieurs. C’est pour ça qu’on a fondé l’association. On veut rassembler toutes les femmes, qu’elles soient toutes représentées, qu’elles puissent toutes s’exprimer. »
L’idée : aller à la rencontre des groupes locaux, à travers tout le pays, afin de les accompagner dans leurs luttes. « On travaille à un manifeste des mouvements féministes algériens, pour créer le rapport de force. », signate-t-elle. Intrinsèquement liées aux territoires, les revendications diffèrent selon les zones : manque de gynéco, taux minime de travailleuses, absence de maternité… « Il y a des luttes qui sont plus visibles que d’autres. Notre association lutte pour qu’on ait toutes le même niveau d’informations. », insiste Amel Hadjadj. Visibiliser tous les combats sans les hiérarchiser et les prioriser. Valoriser les militantes, leur courage, leur diversité, leur pluralité, singularité et résilience. « En 2019, proche d’une des frontières Sud de l’Algérie, a lieu un viol collectif d’enseignantes dans leur logement de fonction. En mai 2021, une manifestation est organisée contre le viol. Des femmes sont venues de partout ! Elles n’ont pas simplement dénoncé les viols, les violences et l’insécurité, elles ont aussi réaffirmé leur volonté de travailler. Malgré le drame, elles ont dit : « On n’arrêtera pas de travailler ! » Il n’y a pas une seule région dans le pays où il n’y a pas de femmes en mouvement. », poursuit-elle avec hargne.
De nouvelles générations de militantes féministes émergent en Algérie et Amel Hadjadj témoigne de l’ampleur grandissant de l’engouement. Les revendications se multiplient. Les mouvements prônent la liberté d’être et d’agir, la pluralité des voix et des voies de l’émancipation, la diversité des identités et l’importance de la reconnaissance et de la prise en considération de toutes les personnes concernées, leurs spécificités, leurs trajectoires, traumatismes, souffrances et moyens d’organisation.




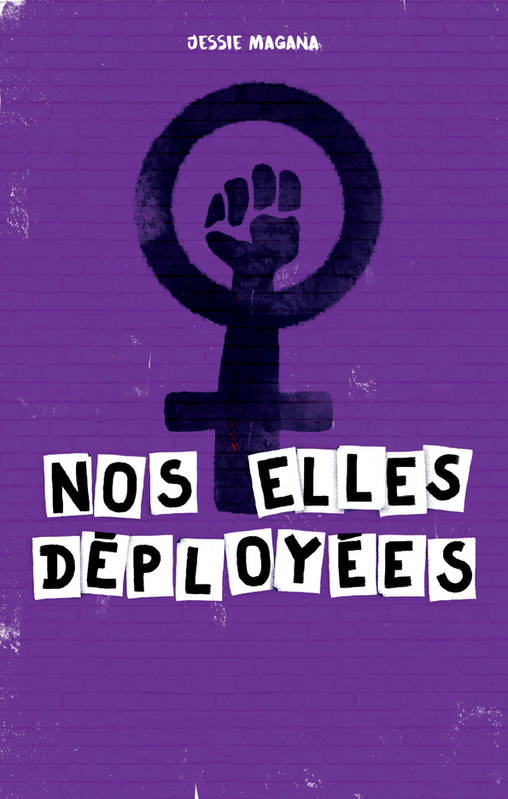 « Avec les réseaux sociaux, les #, des actrices, chanteuses, femmes comme vous et moi sans audience médiatique ont pu s’exprimer. Grâce à ces mouvements, la parole d’une femme devient mondiale. », s’enthousiasme-t-elle.
« Avec les réseaux sociaux, les #, des actrices, chanteuses, femmes comme vous et moi sans audience médiatique ont pu s’exprimer. Grâce à ces mouvements, la parole d’une femme devient mondiale. », s’enthousiasme-t-elle.



 Toutes sont emplies de messages et de valeurs. Sur la sagesse, la confiance, l’amour de soi, le fait de profiter de la vie, les relations amoureuses, l’accomplissement personnel, l’amitié. Avec toujours beaucoup de malice et d’ingéniosité, les personnages, incarnés par des humains ou des animaux, tissent eux-mêmes la toile de leurs aventures et deviennent acteurs de leur quotidien et de leur destin.
Toutes sont emplies de messages et de valeurs. Sur la sagesse, la confiance, l’amour de soi, le fait de profiter de la vie, les relations amoureuses, l’accomplissement personnel, l’amitié. Avec toujours beaucoup de malice et d’ingéniosité, les personnages, incarnés par des humains ou des animaux, tissent eux-mêmes la toile de leurs aventures et deviennent acteurs de leur quotidien et de leur destin.

 Sa musique est imprégnée de celle de Martha Jean-Claude, exilée à Cuba dans les années 50 qui chantait son Haïti. Et elle, se souvient d’entendre des bribes de conversations entre sa mère et ses tantes qui parlent en créole, langue qu’elle n’a jamais apprise, qu’elle ne connaît que par fragments.
Sa musique est imprégnée de celle de Martha Jean-Claude, exilée à Cuba dans les années 50 qui chantait son Haïti. Et elle, se souvient d’entendre des bribes de conversations entre sa mère et ses tantes qui parlent en créole, langue qu’elle n’a jamais apprise, qu’elle ne connaît que par fragments. L’engagement de Mélissa Laveaux ne se réduit pas à conter l’histoire des bons contre els méchants ou des victimes contre les bourreaux. Il est bien plus subtil que ça. Il réside dans chaque recoin de sa personnalité, dans chaque note de sa musique, dans chacun de ses choix artistiques.
L’engagement de Mélissa Laveaux ne se réduit pas à conter l’histoire des bons contre els méchants ou des victimes contre les bourreaux. Il est bien plus subtil que ça. Il réside dans chaque recoin de sa personnalité, dans chaque note de sa musique, dans chacun de ses choix artistiques.

 Elle dévoile cet épisode au cours duquel elle a menacé ses parents avec un couteau, épisode qui lui a valu un séjour à l’hôpital, au service pédopsychiatrie. L’enfermement provoque en elle une danse qui ne la quitte jamais et quand elle danse, elle sourit. Sa porte de sortie : le jour où sa mère a parlé. Où elle a dit toute la vérité aux médecins sur son mari qui bat sa fille depuis des années.
Elle dévoile cet épisode au cours duquel elle a menacé ses parents avec un couteau, épisode qui lui a valu un séjour à l’hôpital, au service pédopsychiatrie. L’enfermement provoque en elle une danse qui ne la quitte jamais et quand elle danse, elle sourit. Sa porte de sortie : le jour où sa mère a parlé. Où elle a dit toute la vérité aux médecins sur son mari qui bat sa fille depuis des années. Une révolte dans laquelle elles puisent afin de transformer la souffrance des épreuves et des injonctions en flammes de l’espoir et de l’accomplissement. Sans s’affranchir de tous les codes et s’émanciper de toutes les normes, elles questionnent, remettent en cause, dénoncent, échangent et partagent.
Une révolte dans laquelle elles puisent afin de transformer la souffrance des épreuves et des injonctions en flammes de l’espoir et de l’accomplissement. Sans s’affranchir de tous les codes et s’émanciper de toutes les normes, elles questionnent, remettent en cause, dénoncent, échangent et partagent.
 En une dizaine de minutes, la réalisatrice nous propose un docu-fiction animé onirique et poétique, dans lequel les non-dits se brisent sans un mot. L’histoire de trois femmes héritières d’une transmission douloureuse.
En une dizaine de minutes, la réalisatrice nous propose un docu-fiction animé onirique et poétique, dans lequel les non-dits se brisent sans un mot. L’histoire de trois femmes héritières d’une transmission douloureuse. Sophie est une adolescente, repliée sur elle-même, en prise à la colère identitaire qui se fait sentir depuis plusieurs décennies dans les banlieues françaises. « Il y a aujourd’hui des jeunes issu-e-s de la 4e génération qui se disent vietnamiens, pas français, alors qu’ils ne connaissent rien du Vietnam. C’est révélateur ! », souligne Marie-Christine.
Sophie est une adolescente, repliée sur elle-même, en prise à la colère identitaire qui se fait sentir depuis plusieurs décennies dans les banlieues françaises. « Il y a aujourd’hui des jeunes issu-e-s de la 4e génération qui se disent vietnamiens, pas français, alors qu’ils ne connaissent rien du Vietnam. C’est révélateur ! », souligne Marie-Christine.