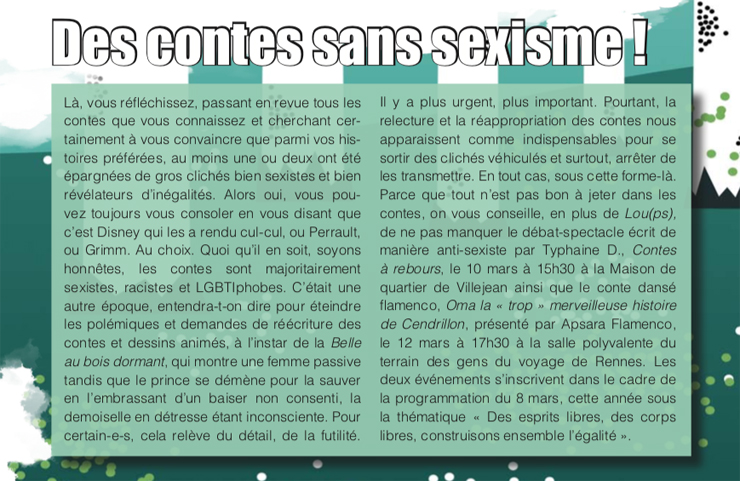Âmes sensibles, s’abstenir ! Parce qu’ici les oiseaux ne chantonnent pas gaiment sur l’épaule d’une enfant candide. Parce qu’ici personne d’autre qu’eux-mêmes ne viendra sauver les personnages des dangers de la vie. Parce qu’ici, il est question de sang, de sexe, de violences, de féminin et de masculin, de dépassement de soi et de transmission. Parce qu’ici la compagnie Erébé Kouliballets flanque les frères Grimm, Charles Perrault et leur morale patriarcale au tapis, reprenant le conte originel issu de la tradition orale du XIVe siècle. Rassurez-vous, nul besoin de vous asseoir ou de vous accrocher à vos sièges, il suffit simplement de connecter corps et esprits à cette création féministico-rock’n’roll pour que libération et émancipation s’opèrent.

Le 25 octobre, dans la salle Escapade de l’espace Le Goffic à Pacé, Morgane Rey, Delphine Chilard, Juliette Guillevin et Pauline Gérard sont allongées, ventres contre le sol, visages relevés les uns en direction des autres. Elles n’ont pas encore l’entièreté de la trame mais sont d’accord sur l’esprit général : que tout le monde sorte gagnant-e, grâce au respect et à l’écoute. Si cela paraît clair, les propos ne nous sont pourtant pas tout à fait compréhensibles ou plutôt accessibles.
« Le petit chaperon rouge, direction. La forêt, lien terre ciel. La grand-mère, ancrage. Le loup, le poids. Les quatre personnages forment une entité. On n’a pas la même force quand on est tout seul que quand on est quatre. Imaginez donc votre force seule qui s’additionne à celle des autres. L’énergie du conflit devient positive. Alors si je récapitule, on a petit chaperon – grand-mère – loup, petit chaperon – forêt – loup,… Les triangles donnent l’espace scénique ! Parfait. On va reprendre la trame de chaque solo. C’est chouette de commencer ce travail, je suis contente ! », enchaîne Morgane Rey, chorégraphe de la compagnie de danse afrocontemporaine, Erébé Kouliballets.
On comprend les mots, perçoit l’idée mais le message reste brouillé à certains niveaux. Tandis que les danseuses s’échauffent, on feuillette leurs carnets de bord, outil incontournable dans la pratique de la professionnelle. Il y a des textes, des poèmes, des collages, des couleurs, des mots, des illustrations dont celles réalisées par Gustave Doré sur le Petit chaperon rouge, des formes, des matières… et même des exercices et des annotations.
« Dans ce poème, je veux que tu tires ton intention de ça. Lis ce mot et tu te le répètes en boucle. Toi, tu te nourris en regardant ça et de ce dessin, tu tires un mot qui t’amène à une dynamique. »
PREMIERS PAS
 Chacune se concentre, déambule, tâtonne, effectue son mouvement en boucle jusqu’à saisir l’esprit de son personnage avant d’interpréter les solos en duo : « Allez on fait un duo petit chaperon – grand-mère. Dans ce duo, le petit chaperon doit dominer la grand-mère, on inversera après. »
Chacune se concentre, déambule, tâtonne, effectue son mouvement en boucle jusqu’à saisir l’esprit de son personnage avant d’interpréter les solos en duo : « Allez on fait un duo petit chaperon – grand-mère. Dans ce duo, le petit chaperon doit dominer la grand-mère, on inversera après. »
Juliette, troublée, abandonne la peau du petit chaperon un instant : « Faut que je sois méchante ? » Ce à quoi Morgane lui rétorque :
« Dominer ne veut pas dire méchante. Mais tu dois avoir un impact sur elle. Là on cherche, c’est la première séance. Te bile pas. »
C’est un ping-pong verbal et chorégraphique qui se dévoile sous nos yeux ébahis et légèrement perdus. Les discussions sont essentielles dans l’exploration profonde de l’histoire et ses interprétations, le ressenti face à un vieux conte que l’on cherche ici à transposer dans sa complexité et dans la modernité et l’énergie corporelle que l’on veut donner à l’intention initiale.
Morgane observe, enregistre dans sa mémoire, interromps l’échange chorégraphique, invite les danseuses à creuser davantage dans le mouvement, dans la connexion au corps, dans la puissance du squelette. Toujours en partant d’un mot, d’une idée, d’un sentiment :
« Ok on refait. Le petit chaperon, tu me rajoutes du cross fit. La grand-mère en version prada. Et le loup, plus fort qu’une libellule. »
Si les trois danseuses se connaissent des cours qu’elles suivent ensemble au Triangle avec la chorégraphe, les séances de travail créent une connexion spécifique, une complicité se tisse au fil des idées et des éclats de rire, qui sont nombreux dans cette ambiance sérieuse et décontractée, caractéristiques propres à la pétillante Morgane Rey. La répétition se termine par une danse de réjouissance du Mali et des exercices collectifs de relaxation à partir d’éléments naturels.
LA CONSTRUCTION DES FILLES, FIL CONDUCTEUR DE LA COMPAGNIE
Le 25 octobre donc, à l’espace Le Goffic de Pacé, la création amateure Loups– qui vient graviter autour de la pièce professionnelle Lou, écrite par Morgane Rey et interprétée par elle-même et Cécile Colin (partie que nous aborderons dans d’autres articles) - vient de se concrétiser.
Encore un peu hésitante, bancale dans le déroulé de l’histoire, elle va au fur et à mesure rassembler les pièces du puzzle, se développer, s’affirmer, prendre en confiance et en maturité. À l’instar de leur petit chaperon rouge à elles.

« C’est une histoire d’initiation. La forêt dans plusieurs pays d’Afrique est considérée comme un lieu d’initiation. Je trouvais important d’avoir cette entité qui n’est contre personne. Et puis on se demande aussi ce que va devenir ce petit chaperon. Pour nous, c’est une guerrière. Aidée de la sororité, elle va mettre une tannée au loup mais ce n’est pas dans une vision du bien contre le mal, c’est plus complexe. », souligne Morgane qui fait germer le projet depuis plus d’une année à travers des recherches, des croquis, de la documentation, etc.
C’est sa méthode de travail à elle qui envisage toujours des pièces autour de la construction et du développement des filles et des femmes. Des pièces à jouer en intérieur comme en extérieur, un point auquel elle tient particulièrement, défendant fermement la place des femmes dans l’espace public et notamment l’importance de la danse en rue qui donne à montrer des corps en mouvement, des corps dynamiques, des corps actifs.
Si elle s’est tardivement définie féministe, elle a pourtant souvent dans sa carrière envoyé valdinguer les cadres et les normes. À ses débuts, dans son adaptation de Cendrillon, le prince est homo, le père effacé et la mère maltraitante. L’an dernier, son spectacle Femmes souriant à l’invisible – à (re)découvrir le 8 mars prochain le midi au parc du Thabor et l’après-midi au Blosne – explorait la figure de la sorcière contemporaine dans son origine première, soit son lien aux savoirs et aux connaissances de la Nature, sa puissance créatrice et son pouvoir de guérison.
Pas étonnant donc qu’ici elle fasse une croix sur les moralistes Perrault et Grimm pour revenir à l’essence même du conte et lui redonner une fraicheur écoféministe. Exit le côté cul-cul la praline et romanesque, la compagnie Erébé Kouliballets ajoute sa touche. Une touche bien plus réaliste et humaniste, qui ne mâche pas ses mots et ses propos mais bel et bien le loup et la grand-mère.
FÉMININ/MASCULIN, DOMINÉE/DOMINANT ?
« Quand je préparais le Petit chaperon rouge, j’ai fait un cercle de paroles au centre social du Blosne. Ça y allait ! C’était super, les nanas, avec leur tricot, qui se lâchaient, elles ont sorti des trucs, j’en revenais pas. Ça a beaucoup parlé du masculin et du féminin. J’adore ça. Qu’est-ce qu’un mec ? Qu’est-ce qu’une nana ? Comment je traduis ça avec mon corps ? Perso, je suis passionnée par le corps, c’est un espace qui me sert autant à moi qu’au collectif et dont je peux me servir pour travailler encore longtemps.»
Pour chaque mouvement, chercher d’où vient la puissance dans le corps, dans l’abstraction du squelette. Pouvoir puiser autant dans son énergie féminine que dans son énergie masculine. Dans ses cours comme dans sa pratique, elle travaille sur ces points-là, tout en cherchant à provoquer la discussion, le débat.
Autour de la signification pour les unes et les autres de la domination, de la soumission. Et propose de considérer ces concepts et sentiments différemment, par le biais de l’élément positif, celui de l’apprentissage et de la transmission.

« On peut imaginer le côté dominé sans le côté négatif. Le dominant a la maitrise. Le dominé peut être dans l’acceptation. C’est dur, hein, d’accepter ? Enlevez de votre tête l’idée d’oppression. On peut accepter la domination comme état transitoire. Quand on apprend quelque chose par exemple, on l’apprend de quelqu’un qui possède le savoir. Moi, j’ai été éduquée par des maitres en danse. À ce moment-là, on accepte la domination et on ne parle pas de soumission ou d’oppression. J’ai passé plusieurs mois avec les femmes maliennes sur la question de la domination et elles disent que nous les occidentales, on n’est pas honnêtes à ce sujet, en prétendant ne jamais être dominées. Il y a toujours des endroits où on est dominé-e-s. Moi, je suis dominée par la danse, il me faut ma piquouze toutes les semaines. », s’anime Morgane qui pourrait continuer des heures durant, alternant discours théorisé et concrétisation corporelle, le corps étant alors traversé par le souvenir de l’expérience et l’émotion.
Les systèmes de croyances dans lesquels chacun-e est éduqué-e influe nécessairement sur nos personnalités. Dans ces pièces, la compagnie Erébé Kouliballets interroge le passage au cours duquel la jeune fille va se construire femme et les éléments auxquels elle va s’allier et se confronter pour y parvenir et en ressortir plus mature et plus forte.
Dénuer son personnage de morale patriarcale apparaît ainsi comme fondamental pour entrevoir les capacités et les rouages de ce développement mais aussi pour voir éclore de manière limpide les entraves de la société actuelle à l’émancipation des jeunes femmes.
SE RÉAPPROPRIER LES CONTES : QUEL INTÉRÊT ?
De cette libération, tout le monde en profite. Le petit chaperon rouge, le loup et la grand-mère. « Les contes ont une raison d’être, ils font partis de notre patrimoine mais je pense que c’est important de se les réapproprier. Quand on raconte Le Petit chaperon rougeaux enfants, c’est pour leur faire peur. Il faut transformer cette peur. En tant qu’institutrice, je me pose la question parce qu’il y a des trucs qui me gênent : ce côté tout noir ou tout blanc, ce côté bon contre méchant. Ce n’est pas assez nuancé. Et très sexiste ! Je m’amuse à leur raconter de manière différente, en parlant du chaperon vert par exemple. Dans la pièce, ici, de la vision grand méchant loup et petit chaperon naïf, on passe à un conte initiatique. De la petite fille à la femme, avec un côté cannibale, comme un rite de passage. », commente Delphine Chilard, 38 ans.
Dans Loups, elle est la grand-mère. Une femme âgée et forte « qui peut dire ‘attention’, ‘j’en connais un paquet’ pour protéger sa petite fille mais qui va finalement lâcher en se disant que le petit chaperon n’agit pas forcément comme elle l’aurait fait mais qui accepte que les choses se passent différemment. »
Un personnage caractérisé par la transmission de son savoir et l’acceptation de la jeune génération à laquelle elle n’appartient plus. « Qui laisse la place et qui accepte la transformation », précise la danseuse.
Pour Pauline Gérard, qui à 24 ans enfile le costume du loup, ce dont il faut se méfier, c’est la manière dont on se transmet le conte. Comme une fable moralisatrice ou comme une simple histoire ?
« Ce n’est pas le même impact imaginaire. Personnellement, je n’ai pas trop été nourrie aux contes, ce ne sont pas mes repères, je ne peux donc pas dire s’il y a des conséquences. Mais en travaillant sur la création, je me suis replongée dans le conte et ça m’a bien confirmé le côté cliché dont je me souvenais avec le grand méchant loup et le petit chaperon rouge mis en garde du danger. », souligne-t-elle.
Pas facile dans ce contexte d’aller puiser à l’intérieur de soi pour faire vivre cet animal terrifiant : « Je tâtonne encore mais je commence à le percevoir ce loup, de notre version qui n’a pas de méchant. Tout est fait pour arriver à l’acceptation. Ce loup, il est un obstacle pour le petit chaperon mais pour lui-même aussi. Peut-être surtout pour lui-même. » Tout le monde doit apprendre de ses erreurs.
Que l’on soit rigide, en proie à ses pulsions ou naïve. Loups propose de mêler les expériences pour s’enrichir et s’épanouir dans une personnalité complexe, complète et affirmée. Liant sagesse, animalité, nature et désirs de faire ces expériences.

« Tout le monde va apprendre de tout le monde. On n’a pas encore le dénouement(au moment de l’interview, réalisée en amont du dossier, ndlr) mais on ne veut pas du côté moralisateur et binaire. On ne veut pas non plus dire comme Perrault : ‘petite fille ne sois pas trop naïve sinon ce sera ta faute’… », explique Juliette Guillevin qui se dit très proche de son personnage du petit chaperon rouge :
« Je me retrouve dans son côté un petit peu naïf, dans le côté ‘tout est beau, tout le monde est cool’, j’ai tendance à voir le positif dans les choses et dans les gens. Et j’ai eu des expériences qui m’ont fait grandir. Ce qui est marrant également, c’est que Pauline et moi, on se ressemble pas mal, tout en étant des opposées sur certains points et qu’au final, la ligne est fine entre le loup et le petit chaperon rouge. »
LA PEUR DU LOUP
Remettre les choses en perspective et en mouvement, pour bouleverser l’ordre établi. Chez Perrault, la morale est amorale dans la vision manichéenne dont il est d’usage dans les contes. Le mal triomphe sur le bien. La petite fille meurt. Et c’est toute la lignée des femmes que l’on place sur le banc des accusées.
La mère, pour avoir laissé son enfant courir le risque de sortir seule, la grand-mère, pour avoir été en incapacité de la protéger également, et évidemment, la petite fille qui a fait confiance à un inconnu. Pas n’importe quel inconnu. Le loup, l’allégorie sexuelle de l’homme. Celui qui séduit les filles avec de belles paroles, de beaux discours, pour les déflorer. Moralité : femmes, enseignez donc à vos filles à craindre l’extérieur et particulièrement les hommes.
 « La peur du loup » revient dans les entretiens avec Morgane, Delphine, Pauline et Juliette. Aucune des quatre en occulte l’image. Si le reste du conte ne retient pas particulièrement l’attention des petit-e-s devenu-e-s grand-e-s – mais qui pourtant s’inscrit bel et bien l’inconscient collectif – cette partie en revanche les marque au fer rouge.
« La peur du loup » revient dans les entretiens avec Morgane, Delphine, Pauline et Juliette. Aucune des quatre en occulte l’image. Si le reste du conte ne retient pas particulièrement l’attention des petit-e-s devenu-e-s grand-e-s – mais qui pourtant s’inscrit bel et bien l’inconscient collectif – cette partie en revanche les marque au fer rouge.
Dans Loups, pas question de présenter une forêt sombre et effrayante, une grand-mère passive, un loup méchant par nature et un petit chaperon rouge victime de sa condition.
« Oui, quand elle rencontre le loup, elle se jette dans sa gueule, elle tourne autour, elle veut y aller ! »
ajoute Juliette.
Le 26 janvier, c’est encore à l’espace Le Goffic de Pacé qu’on les retrouve. Dans une autre salle, en présence de Lucie – qui incarne la forêt – et en (recherche et essais de) costumes.
« Recommence, plus doucement, assume. Ce n’est pas parce que tu vas lentement qu’il n’y a pas de tension. Entre ton pubis et ton front, tout est en éveil, en tension. La première fois, c’est juvénile, enfantin. La deuxième fois, c’est carrément sexuel, intentionnellement. C’est la grand-mère qui remet de l’ordre là-dedans. Le loup profite du moment où elles sont à terre. Pauline, arrête de sourire, t’es le loup ! Faut d’ailleurs que j’arrête de t’appeler Pauline pour que tu te mettes dans le peau du loup… La grand-mère remonte le loup et le laisse se confronter au petit chaperon. Ne souris pas Juliette, ce sont les premiers moments qu’on fixe cellulairement, tu ne vas plus réussir à t’en défaire ! Hop, là, danse de séduction de malienne. Ok…Il faut que vous bloquiez le périnée quand vous sautez. Là, ça se voit que vous n’avez pas le périnée bloqué. », commente, en même temps que les filles dansent, Morgane Rey dont l’objectif est désormais de fixer le déroulé.
Les soli auxquels nous avions assisté fin octobre forment à présent un quatuor. Et si lors de la répétition, la chorégraphe leur conseille d’économiser leurs énergies, la trame et l’esprit de la pièce deviennent palpables. Et on finit par comprendre leur langage.
ENCOURAGER LES EXPÉRIENCES
Si on retrouve cette même dynamique volontaire et bienveillante, se dévoile ici toute la combattivité du propos. On s’éloigne définitivement de la version patriarcale pour se rapprocher « de celle qui est diffusée en Inde, au Maroc, dans les pays slovaques, où la jeune fille dévore la grand-mère et le loup. Investie du savoir de la grand-mère, elle domine et bat le loup et se sert du masculin et du féminin pour avancer. »
Aucune histoire de chasseur venu sauver la fillette et sa grand-mère. Aucune histoire non plus de prédateur sexuel et de viols. Seulement la menace que prolifère la société à ce sujet. Ici, peur, danger, violence, sexe, espace extérieur, ne sont pas des ennemis ou des armes d’éducation massive mais des réalités, des expériences, des sentiments investis sainement. Aucune épreuve amenant à la construction et au développement personnel ne se fait en douceur.
Considérant la forêt comme un lieu allié d’initiation, le petit chaperon découvre par elle-même, tout en puisant dans le savoir de son ainée, sa féminité et entraperçoit une partie de sa sexualité à laquelle elle se frotte consciemment, testant ainsi ses propres limites. Elle affronte sa peur et embrasse sa curiosité et ses désirs.
Personnage moderne qui questionne son rapport à la société, le petit chaperon s’affranchit des normes actuelles en choisissant de s’écouter et de se faire confiance. En acceptant sa position de dominée jusqu’à devenir dominante. « Dans nos contradictions et dans nos rencontres, c’est là qu’il se passe des trucs. », s’enthousiasme la chorégraphe.

Ça se ressent dès à présent dans le travail collectif du quatuor qui a commencé le matin même à répéter avec les percussionnistes et musiciens jazz – style choisi pour sa symbole de liberté et d’émancipation et sa grande potentialité en terme d’improvisation - Sébastien David, Briac Soury et ses élèves.
L’émotion nait de cette vision partagée d’une leçon de vie saine, libérée des assignations de genre et des injonctions constantes et intolérables qui placent les individus en situation de survie. Le discours change et au lieu de se crisper au son des mises en garde - « Ne parle pas aux inconnus » / « Ce n’est pas très prudent de sortir toute seule » / « Tu ne devrais peut-être pas t’habiller comme ça… Enfin, faudra pas te plaindre. » - on lit désormais dans les mouvements de leur corps et les intentions qu’elles y mettent un autre son de cloche.
Les filles, allez-y. Sortez. Explorez. Assumez votre curiosité, votre envie d’expérimenter. Ne culpabilisez pas face au loup. Ecouter son désir, le provoquer, jouer avec, l’assouvir n’a rien d’avilissant. Au contraire, il n’en sera que plus libérateur, tant qu’il est manié dans le respect et la bienveillance.
LES BIENFAITS D’UN APPRENTISSAGE FÉMINISTE

Une autre forme d’apprentissage est possible. Et il est résolument féministe. « On n’a pas eu besoin de formuler le côté féministe de la pièce, c’était assez inné. On partage ça dans nos vies respectives. Sans se le dire formellement, on partage le même combat, on remet en cause(l’ordre établi, ndlr). Ici, on n’a pas vu un petit chaperon qui subit mais qui provoque, sans que ce soit péjoratif. », analyse Pauline Gérard, rejointe par Delphine Chilard :
« On est toutes de fait dans le partage du féminisme et des droits des femmes et sur scène, ce que je vois, ce sont des femmes avec un sacré charisme ! »
L’évidence n’est pas contredite par Juliette Guillevin : « On est quatre femmes à faire la pièce et Morgane en est à l’initiative donc forcément c’est féministe ! C’est alternatif et contemporain comme Morgane sait le faire. On tire nos mouvements de nous. De qui on est, de nos émotions et de nos intentions. En ça, ça forme une pièce féministe. Humaniste. »
Elles n’ont pas les mêmes parcours et les mêmes expériences en matière de danse. Du classique à la danse africaine, en passant par le contemporain et surtout le hip hop, Pauline a atterrit dans les cours de Morgane Rey en effectuant un stage au Triangle, il y a plus d’un an. Appréciant le mélange de danse africaine et de danse contemporaine, la liberté d’y ajouter sa propre expérience, mais aussi le travail sur la respiration et la relaxation, elle décide de poursuivre son apprentissage.
Tout comme Delphine qui n’a pas quitté la chorégraphe depuis 10 ans. Avant, elle avait fait du flamenco, de la danse contact et de la danse bretonne : « J’avais pris un stage de danse africaine au Triangle avec une amie à elle. Elle est venue faire un partage et je l’ai suivie dès lors. J’aime son rapport à la danse, au partage, à la création, à sa manière de nous apprendre des choses avec rigueur pour qu’ensuite on les transforme. »
Juliette, elle, a quasiment toujours pratiqué du modern jazz. Mais a testé plusieurs styles, du hip hop au charleston, en passant par le contemporain et le classique, en intégrant une association vannetaise dont la mission est de créer des spectacles de danse dont les profits sont reversés aux Restos du cœur du Morbihan.
« Je voulais faire de la danse contemporaine quand je suis arrivée à Rennes l’an dernier. J’ai appelé le Triangle mais il n’y avait pas de place dans tous les cours. Je suis allée en danse africaine, le groupe m’a plu et la pédagogie de Morgane aussi. Et surtout, je n’avais jamais connu ça, ce rapport corps/esprit connecté en permanence. J’adore la danse parce que ça me permet d’exprimer des choses que j’ai en moi et Morgane met des mots dessus. J’ai compris des trucs que je n’avais jamais compris avant. Dans l’écoute de soi, l’écoute des autres. Dans la connexion du plexus solaire avec le sol qu’on amène vers le ciel en fonction des émotions, etc. Je ne peux pas donner d’exemple concret, ce sont des sensations que j’ai. Des choses qui m’apparaissent comme une évidence une fois qu’elle les a formulées. », décortique la danseuse de 25 ans.

LIBERTÉ ET ÉMANCIPATION
Il apparaît évident en les écoutant que la manière d’être et de travailler de Morgane Rey transparait dans le propos de la pièce et le processus de création. Que ce soit dans les cercles de paroles, dans les rencontres individuelles qu’elle a instauré avec chaque danseuse afin de créer un lien de confiance et approfondir chaque personnage indépendamment des autres, dans le soin qu’elle apporte à la création et à la tenue des carnets de bord, dans les discussions qu’elle provoque en cours ou dans son langage dessiné, les trois femmes en éprouvent un sentiment de liberté et d’investissement réel.
Si elles précisent être encore et toujours en apprentissage face aux feuilles que Morgane leur donne – sur lesquelles elle dessine le mouvement qu’elle a en tête – elles s’approprient la partition, chacune avec son style, son corps et sa danse.
« Je fonctionne beaucoup avec des photos, des textes et des peintures. Je suis vite allée vers le dessin pour retranscrire mes partitions chorégraphiques. C’était très enfantin au départ et puis j’ai affiné. J’ai vu qu’il y avait une bonne réception de cette méthode. En fait, je ne dessine pas réellement, je retranscris l’énergie du mouvement dans le trait. C’est une manière très minimaliste d’aborder la danse, qui est pratique, pas compliquée et qui laisse la liberté à chacun-e d’y mettre du sien. J’aime que les gens puissent investir ce que je leur propose. », explique Morgane Rey.
Pour Delphine Chilard, de nombreux effets positifs en émanent : « En fait, elle nous transmet des pas puis on s’en inspire et on en crée d’autres. Sans faire n’importe quoi bien sûr. Au niveau du corps, ça m’ancre au fur et à mesure. J’apprends à habiter mon corps, le connaître. Pas que dans le mouvement mais dans un tout. La danse africaine me donne conscience de tout un tas de choses dans mon corps. Et avec les feuilles en plus, on apprend à faire confiance à comment on va interpréter ce qu’elle dessine. C’est un fil conducteur puis il faut le sentir dans son corps. Tu explores, tu poses des questions, tu prends confiances au fur et à mesure. Je crois que c’est ça qui impacte mon quotidien de manière poussée. Parce que dans un groupe de confiance, on apprend à lâcher prise, on apprend à se fier à notre capacité à ressentir et à transformer. »
 Exit le manichéen et le binaire. Sous la forme d’un solo amateur (la conteuse), d’un duo professionnel (le petit chaperon rouge et Morgane dans les 3 rôles : forêt-grand-mère-loup) et d’un quatuor amateur, la compagnie Erébé Kouliballets aime explorer la complexité, la modernité, le mélange et le métissage, l’équilibre du féminin et du masculin. Pour tendre vers plus d’authenticité et de liberté. On admire la capacité à le faire sans lisser ou édulcorer la réalité.
Exit le manichéen et le binaire. Sous la forme d’un solo amateur (la conteuse), d’un duo professionnel (le petit chaperon rouge et Morgane dans les 3 rôles : forêt-grand-mère-loup) et d’un quatuor amateur, la compagnie Erébé Kouliballets aime explorer la complexité, la modernité, le mélange et le métissage, l’équilibre du féminin et du masculin. Pour tendre vers plus d’authenticité et de liberté. On admire la capacité à le faire sans lisser ou édulcorer la réalité.
Au contraire, on est soulagé-e-s de cette réappropriation libératrice d’un conte qui une fois envahi par la morale patriarcale devient toxique pour la construction des jeunes filles. Ici, le rouge qui domine la pièce n’est pas celui de la faute et de la culpabilité mais bel et bien celui qui coule dans nos veines et nos culottes, et teinte nos tentes, véritables espaces de paroles entre femmes, de partage, d’écoute et d’échanges.
Sans oublier la forme artistique qui vient dynamiser nos vécus, expériences et questionnements pour les mettre en relief et en mouvement :
« La danse, c’est l’indépendance du corps ! L’exercice de la liberté ! La danse est une façon de dire non aux injonctions, d’allers vers la résilience. »
Rendez-vous le 10 mai à l’Antichambre de Mordelles pour découvrir Lou(ps) et sur yeggmag.fr pour suivre les étapes en attendant la représentation.
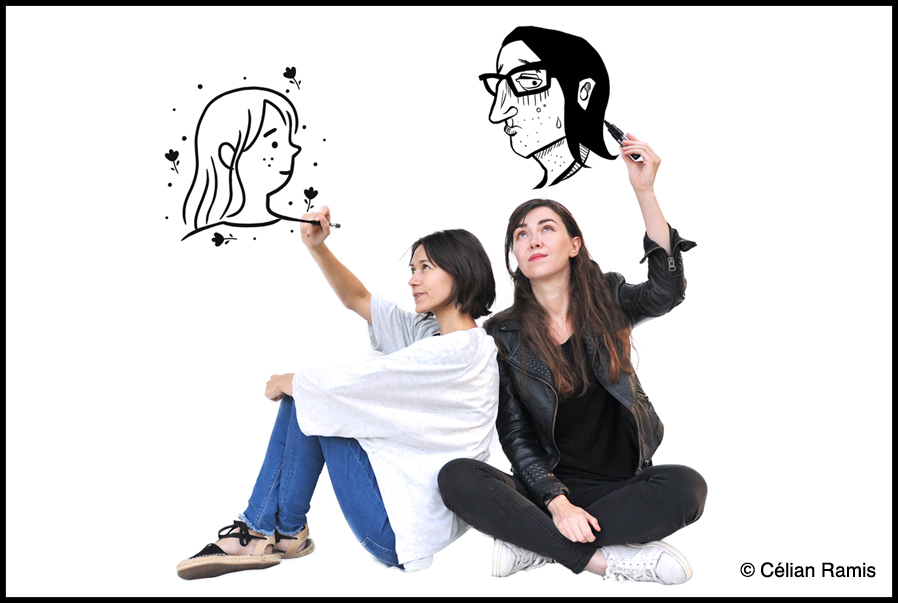
 « Ce projet parait évident. Et pourtant, ça a été un très gros travail. Il y a beaucoup de bédéistes à Rennes mais on n’en parle pas souvent. », indique WComics, autrice-dessinatrice qui a rapidement adhéré à l’ambition de l’équipe initiatrice - composée de Loïc Gosset, Maryse Berthelot, Lomig et Chloé Gwinner – qui donnait rendez-vous aux motivé-e-s, pros ou amateur-e-s tous les premiers mercredis du mois. Dans la revue, le premier rassemblement est malicieusement croqué par Lomig : la terrasse de l’Amarillys, tellement bondée de bédéistes qu’un personnage grimpe en haut d’un lampadaire.
« Ce projet parait évident. Et pourtant, ça a été un très gros travail. Il y a beaucoup de bédéistes à Rennes mais on n’en parle pas souvent. », indique WComics, autrice-dessinatrice qui a rapidement adhéré à l’ambition de l’équipe initiatrice - composée de Loïc Gosset, Maryse Berthelot, Lomig et Chloé Gwinner – qui donnait rendez-vous aux motivé-e-s, pros ou amateur-e-s tous les premiers mercredis du mois. Dans la revue, le premier rassemblement est malicieusement croqué par Lomig : la terrasse de l’Amarillys, tellement bondée de bédéistes qu’un personnage grimpe en haut d’un lampadaire.


 Petit à petit, l’enchainement des expressions permet de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes d’oppression et au fil du temps, et des investissements, de nous déconstruire nous-mêmes. Dangereuses lectrices participe grandement à cette exploration et analyse, aussi personnelle que collective.
Petit à petit, l’enchainement des expressions permet de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes d’oppression et au fil du temps, et des investissements, de nous déconstruire nous-mêmes. Dangereuses lectrices participe grandement à cette exploration et analyse, aussi personnelle que collective. 
 Toutes apportent un éclairage sur les différences entre les femmes et les hommes dans le milieu du football, en France comme à l’étranger. Et rien ne ramène les femmes à leur soi-disant état naturel. Au contraire, dans le livre de Lucie Brasseur, l’étau se resserre sur les enjeux et les conséquences des constructions sociales visant à opposer les sexes et les genres. Déjà convaincu-e-s par le postulat de départ, on se laisse transporter d’une interview à l’autre, d’une rencontre à la suivante, d’une thématique à l’autre.
Toutes apportent un éclairage sur les différences entre les femmes et les hommes dans le milieu du football, en France comme à l’étranger. Et rien ne ramène les femmes à leur soi-disant état naturel. Au contraire, dans le livre de Lucie Brasseur, l’étau se resserre sur les enjeux et les conséquences des constructions sociales visant à opposer les sexes et les genres. Déjà convaincu-e-s par le postulat de départ, on se laisse transporter d’une interview à l’autre, d’une rencontre à la suivante, d’une thématique à l’autre.







 Dans les pratiques, on observe d’un côté des sports pensés masculins et d’un autre des sports pensés féminins. Peu sont pensés comme mixtes. C’est ce qu’elle appelle le couloir de verre et qui se retrouve également dans la manière de penser les métiers. Sans oublier le plafond de verre, qui comprend les inégalités salariales mais aussi le constat – là aussi applicable aux métiers – que plus on grimpe dans les échelons, plus les femmes disparaissent, n’accédant que très rarement à des hauts postes à responsabilités.
Dans les pratiques, on observe d’un côté des sports pensés masculins et d’un autre des sports pensés féminins. Peu sont pensés comme mixtes. C’est ce qu’elle appelle le couloir de verre et qui se retrouve également dans la manière de penser les métiers. Sans oublier le plafond de verre, qui comprend les inégalités salariales mais aussi le constat – là aussi applicable aux métiers – que plus on grimpe dans les échelons, plus les femmes disparaissent, n’accédant que très rarement à des hauts postes à responsabilités.


 Chacune se concentre, déambule, tâtonne, effectue son mouvement en boucle jusqu’à saisir l’esprit de son personnage avant d’interpréter les solos en duo : « Allez on fait un duo petit chaperon – grand-mère. Dans ce duo, le petit chaperon doit dominer la grand-mère, on inversera après. »
Chacune se concentre, déambule, tâtonne, effectue son mouvement en boucle jusqu’à saisir l’esprit de son personnage avant d’interpréter les solos en duo : « Allez on fait un duo petit chaperon – grand-mère. Dans ce duo, le petit chaperon doit dominer la grand-mère, on inversera après. »


 « La peur du loup » revient dans les entretiens avec Morgane, Delphine, Pauline et Juliette. Aucune des quatre en occulte l’image. Si le reste du conte ne retient pas particulièrement l’attention des petit-e-s devenu-e-s grand-e-s – mais qui pourtant s’inscrit bel et bien l’inconscient collectif – cette partie en revanche les marque au fer rouge.
« La peur du loup » revient dans les entretiens avec Morgane, Delphine, Pauline et Juliette. Aucune des quatre en occulte l’image. Si le reste du conte ne retient pas particulièrement l’attention des petit-e-s devenu-e-s grand-e-s – mais qui pourtant s’inscrit bel et bien l’inconscient collectif – cette partie en revanche les marque au fer rouge.


 Exit le manichéen et le binaire. Sous la forme d’un solo amateur (la conteuse), d’un duo professionnel (le petit chaperon rouge et Morgane dans les 3 rôles : forêt-grand-mère-loup) et d’un quatuor amateur, la compagnie Erébé Kouliballets aime explorer la complexité, la modernité, le mélange et le métissage, l’équilibre du féminin et du masculin. Pour tendre vers plus d’authenticité et de liberté. On admire la capacité à le faire sans lisser ou édulcorer la réalité.
Exit le manichéen et le binaire. Sous la forme d’un solo amateur (la conteuse), d’un duo professionnel (le petit chaperon rouge et Morgane dans les 3 rôles : forêt-grand-mère-loup) et d’un quatuor amateur, la compagnie Erébé Kouliballets aime explorer la complexité, la modernité, le mélange et le métissage, l’équilibre du féminin et du masculin. Pour tendre vers plus d’authenticité et de liberté. On admire la capacité à le faire sans lisser ou édulcorer la réalité.