En 2019, la France accueillera la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, dont plusieurs matchs seront disputés dans la capitale bretonne. Un événement important pour la promotion des femmes dans le sport mais qui apparaît néanmoins comme incohérent, le Roazhon Park étant rarement foulé par les crampons féminins. Peinant à investir dans une section féminine, on peut alors se demander quel exemple renvoie le Stade Rennais ? L’occasion de s’intéresser à l’évolution du milieu du football, en terme d’égalité entre les hommes et les femmes.

« FOOTBALL – Une petite révolution. Petite, parce qu’il s’agit de la Norvège et que les prix des joueurs sont bien moins élevés que dans les grandes nations du football. Révolution tout de même, parce qu’il a fallu doubler le salaire des joueuses pour qu’il atteigne le niveau de leurs homologues masculins. Et aussi parce que c’est le second pays qui tente le coup, après les États-Unis. », peut-on lire sur le site du HuffingtonPost, le 9 octobre dernier.
Et de leur côté, les footballeurs norvégiens ont accepté de baisser leurs salaires. La bonne nouvelle est sidérante - preuve que l’on part de loin - bien que les pays d’Europe du nord soient réputés pour leur exemplarité en terme d’égalité entre les sexes. La suite de l’article est encore plus stupéfiante :
« Les footballeuses norvégiennes ont un palmarès conséquent avec notamment un titre de championnes du monde (1995), deux championnats d’Europe (1987 et 1993) et une médaille d’or olympique (2000). Les hommes, eux, n’ont jamais remporté aucune grande compétition internationale. Ils occupent actuellement la 73e place du classement de la Fifa tandis que les femmes sont 14e. »
De meilleures performances donc pour de moindres salaires. La preuve d’une inégalité profonde qui, si elle tend à disparaître en Norvège ou aux Etats-Unis (où les joueuses ont dû menacer de grève pour obtenir des conditions financières similaires à leurs homologues masculins), perdure dans la majorité des pays du monde. Et malheureusement, la France ne figure pas au tableau des exceptions.
DES INÉGALITÉS IMPORTANTES
Cet été, les équipes féminines de football jouaient pour l’Euro, aux Pays-Bas. Le site des Échos en profite alors pour s’intéresser aux chiffres. Des chiffres qui révèlent que dans le domaine du football, les femmes gagnent en moyenne 96% de moins que les hommes, là où dans la plupart des autres secteurs, l’écart est estimé à environ 23%.
« Selon la Fédération française de football, les footballeuses professionnelles évoluant dans les plus grands clubs (PSG, OM, OL, Montpellier…) touchent en moyenne 4000 euros par mois. Les autres, issues de clubs moins prestigieux, peuvent prétendre à un salaire allant de 1500 euros à 3000 euros mensuels. Une misère au regard des salaires des footballeurs de première ligue qui touchent en moyenne 75000 euros par mois. », indique le journal économique.

Deux mois plus tard, c’est au tour de l’association sportive et militante Les Dégommeuses d’établir un constat bien glaçant à travers la réalisation de la première étude concernant la place réservée aux footballeuses dans la presse écrite française : sur un mois d’enquête (permettant d’éplucher 188 journaux – presse spécialisée et Presse Quotidienne Régionale), 1327 pages ont été consacrées au foot dont 28 seulement dédiées aux sections féminines. Soit 2,1%.
Le collectif, luttant contre les discriminations notamment sexistes et les LGBTI-phobies, passe les écrits et les visuels à la loupe. Quand on parle du foot féminin dans les médias, ce sont les entraineurs, dirigeants de club et présidents de fédération qui sont valorisés, tandis que les joueuses sont montrées en second plan et souvent de dos. Un phénomène encore plus flagrant au moment où plusieurs villes françaises lancent la Coupe du Monde Féminine 2019.
ÉCARTER LES FEMMES DES TERRAINS
Alors que la plupart des clubs ayant créé des sections féminines voient le nombre de leurs licenciées augmenter, les mentalités ne semblent évoluer que trop lentement. La place des filles et des femmes ne serait pas sur le terrain ! Ni même sur le bord du terrain (preuve en est avec les nombreuses interviews et remarques sexistes à propos de la nouvelle sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre)…
Ni dans les gradins d’ailleurs puisque selon le bon vieux stéréotype, elles seraient plutôt sur la touche au moment des matchs, leurs hommes les délaissant cruellement pour le sport national le plus populaire qui soit. C’est sur ce cliché que s’est empressé de jouer le déodorant Axe en 2010 lors de la Coupe du Monde masculine. Trois affiches, trois femmes sexy et trois phrases d’accroche : « Mon portable n’a pas sonné depuis le 11 juin », « J’ai une bien meilleure façon de passer 90 minutes » et « Y a-t-il un mec célibataire qui ne regarde pas le foot ? ».
Une campagne déplorable basée sur le peu d’intérêt que la gent féminine accorderait au football. Pourtant, la pratique n’est pas réservée aux hommes et les femmes y jouent depuis la fin du XIXe siècle pour les pays britanniques et début du XXe siècle pour la France. Mais rapidement, les voix mâles vont s’élever, entrainant en 1941 l’interdiction aux femmes de jouer.
Parce qu’ils étaient (et sont toujours) nombreux les Messieurs à penser comme Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques, estimant que le rôle des femmes « devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. » Les argumentaires des médecins vont alors aller dans le sens des misogynes, déconseillant la pratique sportive à toutes celles qui possèdent le kit « vagin – utérus – ovaires » sous prétexte que celle-ci pourrait endommager l’appareil reproducteur.
Et là, difficile de se séparer d’une telle image, ancrée profondément dans les mentalités : biologiquement différent-e-s, hommes et femmes ne sont pas capables des mêmes choses. Comprendre ici : les mecs sont faits pour réaliser des prouesses, des performances spectaculaires, les nanas, non. Ce qui légitimerait donc les salaires mirobolants, pour ne pas dire indécents, et la bien plus forte médiatisation dont découlent ensuite les phénomènes de visibilisation et par conséquent d’identification.
À LEURS DÉBUTS
Heureusement, toutes les petites filles n’ont pas été irradiées par les rayons puissants des stéréotypes du genre et certaines rêvent, si ce n’est de devenir professionnelles, de jouer au football. « Je n’ai pas envisagé d’en faire mon métier parce que ça n’existait pas les professionnelles quand j’étais plus jeune. », souligne Lucile Nicolas, 28 ans, joueuse au Cercle Paul Bert Bréquigny.

Elle a 6 ans quand elle commence à jouer, à Quiberon. Avec les garçons d’abord, comme toutes celles qui commencent dès le plus âge (sans oublier que dans les années 90, rares sont les sections féminines qui existent), comme cela a été le cas pour ses coéquipières Maude Corfmat, 18 ans, et Marion Darcel, 21 ans, ou ses adversaires de l’ASPTT Rennes, Amandine Bézard, 24 ans, et Emelyne Fava, 22 ans.
« Mon père et mon frère jouaient et ma mère suivait tous les matchs. Je ne me suis jamais sentie à l’écart parce qu’ils étaient là aussi quand moi je jouais. Mais en grandissant, j’ai senti que ce n’était pas normal pour tout le monde. J’ai mis beaucoup de temps à trouver un établissement scolaire qui proposait sport-études pour les filles. J’ai commencé à Vannes puis je suis venue au lycée Bréquigny qui a un pôle Espoir. À Quiberon, quand j’étais plus jeune, je me souviens d’une fille qui jouait super bien mais elle a dû arrêter après ses 14 ans parce qu’elle ne pouvait plus jouer avec les gars et qu’il fallait qu’elle fasse 1h de route pour aller jouer à Lorient avec une équipe féminine. C’est vraiment dommage. Mais je pense qu’aujourd’hui, ça, ça n’existe quasiment plus, heureusement. », explique Lucile.
Pour Emelyne, les réflexions ont été compliquées à gérer au départ « parce qu’il y a le cliché du garçon manqué et encore aujourd’hui si les mentalités évoluent, ça reste encore stéréotypé, on pense que les filles jouent moins bien. » Sans éducation à l’égalité, les filles et les garçons intègrent dès la petite enfance les stéréotypes de genre. Dans le sport, notamment.
Et Nicole Abar, ancienne footballeuse professionnelle, aujourd’hui très investie dans la lutte contre le sexisme et le racisme (lire « 8 mars : Sur le terrain de l’égalité », daté du 6 mars 2017 sur yeggmag.fr) le confirme, constatant qu’avec les garçons, on lance le ballon avec le pied tandis qu’avec les filles, le lancé s’effectue avec les mains. Sans oublier que dans la cour de récré, l’espace sportif est encore principalement occupé par la gent masculine et ses jeux de ballons.
« Le foot, c’était le sport de la récré et je jouais avec les gars. J’ai souvent entendu que ce n’était pas un sport de filles, et encore aujourd’hui on fait ce genre de réflexion. Alors, on se vexe, on se met dans notre coin et personnellement, j’ai vraiment failli arrêter le foot quand il a fallu s’entrainer qu’avec les filles. », précise Amandine qui avoue qu’elle aurait aimé en faire sa carrière : « Maintenant, c’est trop tard, je suis trop vieille. »
Maude, elle, ne désespère pas d’être remarquée pour ses qualités sur le terrain. « Petite, on m’a dit que le foot, c’était pour les garçons et pas pour les chochottes. J’ai fait sport-études pendant 3 ans à Pontivy et j’ai pu prouver que j’étais capable ! J’aimerais vraiment évoluer à plus haut niveau et pour ça il faut soit passer des tests dans les clubs, soit être repérée par des dirigeants. Aujourd’hui, je ne suis pas dans l’échec, j’ai déjà eu des demandes mais pour jouer au même niveau. J’ai envie de prouver que je peux y arriver, de me donner à fond. N’écoutons pas les remarques et prouvons que les garçons ne sont pas les meilleurs ! », s’enthousiasme-t-elle.
PROFILS ET ENVIES DIFFÉRENT-E-S
Elle évolue, avec Lucile Nicolas et Marion Darcel, dans l’équipe A du CPB Bréquigny, réputé pour son niveau – l’équipe évolue en R1, plus haut niveau régional – et pour sa section féminine amateure, comptabilisant environ 150 licenciées, une des plus importantes de Bretagne.
Leur investissement est de taille : 3 entrainements par semaine et les matchs le dimanche. « J’aime la compétition, ça demande du dépassement de soi. Avec Bréquigny, j’ai envie d’aller en D2 – je n’étais pas encore dans le club quand elles y étaient – et de voir ce qu’on est capables de faire ensemble. On est une bonne équipe et j’aime vraiment ça. J’aimerais bien travailler dans le domaine du foot, comme community manager ou chargée d’une section féminine mais je n’ai aucune envie d’être footballeuse, parce qu’on ne peut pas en vivre et parce que je n’ai pas envie de faire autant de sacrifices. », explique Marion, diplômée d’une licence en management du sport.
 Même son de cloches du côté de Lucile, secrétaire comptable et ambulancière : « On n’a pas de vacances, pas de temps pour soi, avec un régime alimentaire drastique… Non, je crois que j’aime un peu trop la fête ! » Toutes jouent au foot depuis l’enfance quasiment. Toutes accrochent à l’esprit d’équipe et parlent d’un sport intelligent parce que tactique et stratégique. Toutes n’ont pas les mêmes profils, ni les mêmes envies.
Même son de cloches du côté de Lucile, secrétaire comptable et ambulancière : « On n’a pas de vacances, pas de temps pour soi, avec un régime alimentaire drastique… Non, je crois que j’aime un peu trop la fête ! » Toutes jouent au foot depuis l’enfance quasiment. Toutes accrochent à l’esprit d’équipe et parlent d’un sport intelligent parce que tactique et stratégique. Toutes n’ont pas les mêmes profils, ni les mêmes envies.
Emelyne Fava, professeure d’EPS, et Amandine Bézard, cariste, ont toutes les deux quitté le CPB Bréquigny pour l’ASPTT Rennes, qui compte nettement moins de licenciées, mais dont l’équipe A séniors évolue également en R1. Elles dénoncent du côté de Bréquigny une mauvaise ambiance et des rivalités entre joueuses, appréciant davantage la convivialité de l’APSTT.
« Je trouve qu’ici, c’est plus collectif, on ne se marchera pas dessus pour briller. Moi mon but n’est pas d’aller à plus haut niveau, l’investissement qu’il a fallu donner au CPB m’a énormément fatiguée. », déclare Emelyne, en accord avec sa coéquipière Amandine :
« Là-bas, créer sa place est compliqué. J’ai envie de jouer les hauts de tableau et les barrages mais pas comme ça. »
Des critiques que réfutent les joueuses du CPB Bréquigny : « Perso, l’an dernier, je ne m’entendais pas très très bien avec l’ancien coach et je n’ai pas beaucoup joué mais je ne le ressens pas comme ça. Je crois que c’est une question de choix, peut-être qu’elles n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu et ça leur a déplu. »
Quoi qu’il en soit, les deux équipes jouent à bon niveau et parlent chacune de vie « extra-entrainement », avant ou après les matchs du dimanche. Et se consacrent sur le terrain au jeu et à leur progression.
PAS TOUS CONVAINCUS…
Pour Richard Roc, entraineur de la section féminine de l’ASPTT Rennes, les conditions d’entrainements et le traitement en terme d’infrastructures diffèrent clairement de celles du CPB Bréquigny (lire l’encadré). En attendant la fin des travaux effectués sur leurs terrains, l’ASPTT se voit jouer à Cleunay (complexe Ferdinand Lesseps) qui semble en effet moins entretenu et dont les équipements type vestiaires, douches et sanitaires, sont un peu vétustes :
« Il a fallu batailler avec la Ville de Rennes pour qu’ils mettent des algecos parce qu’il n’y avait rien pour se changer et se laver. Ce n’est pas normal ! Les joueuses, elles sont incroyables parce qu’elles ne râlent pas tant que ça, elles se battent. »
Mais il déplore surtout le manque d’intérêt général pour le foot féminin, de la part du président du club, de certains de ses collègues entraineurs et des clubs :
« C’est une bataille permanente. Je me bats pour le foot féminin mais c’est loin d’être gagné. Quand j’entends, en formation, certains entraineurs me dirent « Tu dois être content d’entrainer les filles, surtout dans les vestiaires », c’est lamentable. Je me dis que tout le monde ne peut pas coacher les filles qui sont pourtant très fortes mentalement et qui aiment se surpasser ! Mais vous savez, pour la plupart des dirigeants, ce n’est pas rentable. Ça marcherait s’il y avait du pognon ! Enfin, dans la mesure où les filles ne dépassent pas les garçons. Parce que là, ce ne sera pas accepté du tout ! On tolère les footballeuses tant qu’elles ne font pas d’ombre aux hommes… »
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Et elles pourraient bien leur faire de l’ombre. Peut-être le font-elles déjà d’ailleurs. Et sans avoir les mêmes moyens que leurs homologues. « On dit que les filles sont plus lentes, c’est peut-être vrai, on est moins rapides. Mais on est beaucoup plus basées sur la technique. Je trouve que l’on se rapproche plus d’un foot des années Platini. », précise Lucile Nicolas. Moins sensationnel mais plus agréable, en somme.

Pour Mélissa Plaza, ancienne joueuse internationale – passée par Montpellier, Lyon, Guingamp, elle a fini sa carrière à Saint-Malo et s’est aujourd’hui installée à Rennes pour co-fonder une entreprise de conseils en matière d’égalité femmes-hommes (lire son interview, en fin de dossier) – la différence réside dans les moyens que l’on attribue aux femmes et aux hommes.
Parce que pour elle, les règles, la taille des terrains et des cages, les ballons, etc. sont identiques pour elles comme pour eux. Et s’agace d’ailleurs d’entendre parler de « foot féminin », comme s’il s’agissait d’une autre discipline. Rien ne devrait donc distinguer la pratique des hommes à celle des femmes. Sauf que ce sport, comme bien d’autres également, est encore pensé au masculin.
Plus d’argent, plus de visibilité, plus de médiatisation, plus de spectateurs-trices dans les tribunes et devant les écrans. Le match d’ailleurs qui opposa l’équipe de France à l’équipe de Grèce en juin 2016 au Roazhon Park reste gravé dans les mémoires, non pas pour les performances sportives mais pour le record d’affluence qu’il a généré. Que plus de 24 000 personnes se soient réunies pour supporter les footballeuses est encore de l’ordre de l’exceptionnel.
Même après 15 – 20 ans de développement des sections féminines, on sent toujours la réticence des mentalités. Et quand la Fédération Française de Football secoue ses troupes, nombreuses sont les voix qui protestent. Comme en Normandie, où Paul Hellouin râlait en 2015 :
« Si on a une équipe de filles, cela implique d’avoir des vestiaires dédiés, des frais liés aux déplacements, c’est tout un coût humain et matériel à mettre en place. »
TOUJOURS AU SECOND PLAN
Autre cas de figure avec le Stade Rennais, un des derniers clubs à très haut niveau à ne pas avoir constitué d’équipe féminine. Pourtant, l’Histoire a prouvé que c’était possible puisqu’entre les deux guerres puis à nouveau dans les années 70, les femmes jouaient sous les couleurs rouges et noires. L’absence de section à destination des joueuses laisse le milieu rennais dubitatif et provoque l’incompréhension.
« Je peux concevoir qu’on n’aime pas le foot en général mais pas qu’on n’engage pas d’équipe féminine. Et franchement, vu les résultats des gars, ce serait une bien plus belle vitrine pour le SRFC. Vraiment, ça attire pas mal de monde ! Je ne comprends pas… Comme Lorient qui a une section féminine mais n’en fait rien. », soulève Lucile, loin d’être la seule à le penser et à le dire.

Pour l’instant, rien n’est officiel mais depuis un an, le Stade Rennais a annoncé y réfléchir et avoir même un projet dans les cartons. Le rapprochement, scellé par un partenariat à l’heure actuelle avec le CPB Bréquigny, serait peut-être une manière de le concrétiser, c’est en tout cas ce que laisse entendre le quotidien 20 Minutes Rennes, dans un article daté du 26 septembre 2017. Aucune confirmation ne nous sera donnée par le club.
« C’est encore en négociation. Il n’y a rien de nouveau à déclarer depuis l’année dernière. La direction refusera de vous répondre à ce sujet. », va-t-on nous répéter par téléphone du côté du Stade Rennais.
Pour Maude Corfmat, c’est la preuve « que l’on croit moins en les filles. » Les inégalités infusent donc dans tous les secteurs de la société et doivent être brisés. Nécessairement par la formation des professionnel-le-s et l’éducation à l’égalité mais aussi par l’exemple et les volontés politiques des dirigeant-e-s.
« On se pose toujours la question de pourquoi on passe après. », confie Maude. Elle fait ici référence à un dysfonctionnement constaté lors de notre venue à l’entrainement. Un mardi soir, le terrain est occupé par les hommes qui n’ont pas terminé de disputer leur match. Il est presque 20h et l’entrainement des joueuses va commencer sur le bord du terrain.
C’est derrière les cages qu’elles passeront les 20 minutes d’échauffement avant de pouvoir poursuivre sur le terrain qu’elles partagent avec l’équipe B. Quelques jours plus tard, le dimanche 22 octobre précisément, l’équipe A a rendez-vous à 13h30 pour le coup d’envoi contre Brest. Dans la semaine, l’horaire change. Elles joueront à 12h30.
Cela pourrait rester banale et de l’ordre de l’anecdotique, mais la raison invoquée nous fait tiquer : « Les garçons jouent juste après et si on n’avance pas d’une heure, ils devront s’entrainer sur un terrain plus petit, c’est moins pratique. » Laisser les joueuses débuter sur le bord du terrain ne serait donc pas grave, en tout cas, pas autant que faire s’échauffer les joueurs sur un terrain pas à la taille standard ? On a du mal à comprendre.
Et encore plus de en observant que les stands et la musique sont installés seulement à partir de la deuxième mi-temps. Ou alors est-ce que parce qu’ils le sont simplement en vue du match des hommes ? Pour Marion Darcel, il n’y a pas lieu d’y voir là le signe d’une quelconque disparité. Pas convaincue, elle tente tout de même de nous expliquer :
« Je crois que c’est parce que c’était dans le cadre de la coupe de France, il faut un donc un minimum de temps et de conditions pour se préparer. Ça aurait l’inverse, ils auraient fait la même chose pour nous. Et puis, ça ne nous change rien de commencer une heure plus tôt. Sauf pour les filles de Brest qui ont dû partir une heure plus tôt… On peut toujours faire mieux mais à Bréquigny, on a quand même de la chance, au niveau communication, infrastructures, en visibilité en étant en ouverture des gars… »
On est moins optimistes qu’elle. Surement parce qu’on a du mal à sentir les encouragements de l’équipe masculine pour leurs homologues féminines. Du mal à sentir l’engouement du peu de public pour le jeu qui se déroule sous nos yeux, alors que le CPB Bréquigny se fait dominer lors de la première mi-temps et remonte peu à peu jusqu’à finir par s’imposer 1 – 0.
« Ce sont nos familles et ami-e-s principalement qui viennent nous voir et nous soutenir. Je pense que pour les garçons, on peut plus facilement aller voir le match sans connaître quelqu’un, tandis qu’on ne le fera pas pour les filles. »
pointe Lucile Nicolas.
SEXISME ORDINAIRE POUR LES FOOTBALLEUSES
 Moins médiatisées parce que soi-disant moins spectaculaires, elles sont donc moins visibilisées et moins reconnues pour leurs qualités et compétences de joueuses que les hommes. Pour les deux footballeuses à l’US Saint-Malo (équipe en D2), Arianna Criscione (ancienne joueuse internationale), 32 ans, et Romane Enguehard, 18 ans, le sexisme est omniprésent dans le milieu du ballon rond.
Moins médiatisées parce que soi-disant moins spectaculaires, elles sont donc moins visibilisées et moins reconnues pour leurs qualités et compétences de joueuses que les hommes. Pour les deux footballeuses à l’US Saint-Malo (équipe en D2), Arianna Criscione (ancienne joueuse internationale), 32 ans, et Romane Enguehard, 18 ans, le sexisme est omniprésent dans le milieu du ballon rond.
« Quand tu commences à jouer et que tu es une fille dans une équipe de garçons, tu as forcément la remarque des adversaires disant « ah il y a une fille en face, ça va être facile » ! Une fois sur le terrain, tu leur remets les idées en place ! », rigole Romane, non sans une pointe d’amertume. Et de fierté, aussi. Pour Arianna, ce qui la surprend à chaque fois, c’est cette façon qu’ont les hommes de vouloir sans cesse se mesurer aux femmes.
« Dès que tu dis que tu fais du foot, forcément, ils veulent jouer contre toi. Pour se rassurer et se dire qu’ils sont meilleurs, même quand ils ont un niveau déplorable. Tu te dis qu’ils ne feraient jamais ça avec un joueur du Stade Rennais ! En plus, comme je suis gardienne, ils veulent toujours faire le penalty contre moi. Je ne comprends pas ! », explique-t-elle, stupéfaite.
« C’est la culture dominante, c’est très long pour changer les mentalités. Il faut continuer à se battre et faire attention aux remarques, encore nombreuses, faites par les commentateurs à la télé sur le physique des footballeuses. », commente Camille Collet, animatrice sportive au Cercle Paul Bert. Si vers l’âge de 12 ans, elle commence le foot, elle se voit contrainte d’arrêter à cause d’une tendinite au genou.
« J’ai repris du côté de l’arbitrage, ça m’a énormément appris mais deux ans à côtoyer les terrains, ça m’a vraiment donné envie de m’y remettre. », sourit-elle. Plusieurs années durant, quatre exactement, elle joue auprès de l’équipe A du CPB Bréquigny mais l’investissement requis n’est finalement pas compatible avec le temps qu’elle a, effectuant à ce moment-là sa thèse sur le socio-sport en territoire rennais.
Ainsi, elle remarque que les équipements sportifs urbains ne sont pas adaptés aux femmes : « Qui dit foot, dit hommes et jeunes garçons. Les structures ne sont pas faites pour accueillir un public féminin. Encore moins du côté des adolescentes. Encore encore moins dans les quartiers. Il faut des équipements sportifs ouverts mais il faut réfléchir, comme c’est le cas me semble-t-il à Bordeaux, à les aménager autrement. Moi-même sur un stade où il y a 30 mecs, j’aurais du mal à y aller… »
ÉLOIGNÉES DE LA PRATIQUE SPORTIVE

Elle n’est pas la seule à constater que les jeunes femmes, à l’âge de l’adolescence, s’éloignent de la pratique sportive. Sans doute parce que la puberté intervient, faisant d’elles physiquement des femmes, par conséquent écartées de tout ce que l’on considère comme réservé aux hommes. Mais les femmes plus âgées sont nombreuses à préférer les sports individuels et à ne pas oser se lancer dans un sport collectif.
À plusieurs, entre amies, elles s’entrainent et se motivent, mais seules, les choses sont plus compliquées. Alors, avec quelques unes de ses coéquipières de Bréquigny, elles fondent le collectif Le Ballon aux Filles et organisent chaque année – le dernier week-end de mai 2018 célèbrera la 5e édition - un tournoi gratuit et réservé aux femmes, licenciées ou non, dans un quartier prioritaire de Rennes (Blosne, Maurepas, Cleunay, Bréquigny, Villejean).
L’idée étant de faire découvrir le football via cet événement qui propose certes une compétition mais surtout un moment de partage et de loisirs. Pour démocratiser et valoriser la pratique féminine, en cassant les stéréotypes sexués de la société.
« On organise des actions de sensibilisation en parallèle. La première année, on a travaillé avec Liberté Couleurs. On avait fait une initiation au foot pour les filles non licenciées et elles sont restées pour le débat ensuite qui leur a permis de parler des inégalités entre les filles et les garçons dans le sport et la société en général. On a eu envie de lancer ça parce que bien que Bréquigny soit une des plus grosses sections, il n’y avait pas tellement de tournois féminins. Mais on ne voulait pas d’un tournoi classique, on voulait aller plus loin dans la démarche, parce que certaines licenciées également étaient confrontées à des freins. », analyse Camille.
L’objectif est multiple : amener les filles et les femmes à chausser les crampons et prendre du plaisir d’avoir osé et d’avoir jouer ensemble. Et faire prendre conscience aux garçons et aux hommes – qui arbitrent les matchs afin de les impliquer - que le sexe féminin n’est en rien un obstacle à la pratique sportive.
Au fil des années, les joueuses de l’association ont développé des actions en amont du tournoi. Des actions qui favorisent la découverte du football, la création du lien social et la lutte contre les préjugés sexistes. Et étant conscientes que dans les quartiers prioritaires comme en zone rurale, les filles sont peu nombreuses à pratiquer un sport à l’instar de la répartition filles/garçons dans l’espace public, elles ont la volonté forte d’amener le sport jusqu’à elles.
Une initiative qui affiche un bilan positif avec l’inscription de 80 à 150 filles par an en club, le versement des recettes reversées au projet Amahoro – projet humanitaire et solidaire en direction de Madagascar – ainsi que l’engagement participatif d’une vingtaine de bénévoles sur chaque tournoi et l’investissement des garçons au coude-à-coude avec les filles qui foulent le terrain. Ainsi, elles investissent les pelouses mais aussi les espaces de débat et les établissements scolaires à Rennes.
« J’ai rejoint le collectif parce qu’il donne la parole aux femmes et qu’il organise un événement qui permet à tout le monde de se sentir concerné-e. Et c’est important aussi parce que le sport féminin manque vraiment de promotion. Au foot, on est davantage mises en avant que dans d’autres sports. On a la « chance » d’être plus médiatisées mais ce n’est pas suffisant. », insiste Marion Darcel.
QUELLES REPRÉSENTATIONS DES JOUEUSES ?
Pas suffisant, en effet. Et surtout, que montre la médiatisation ? Une image caricaturale de la femme sportive. Celle qui adopte tous les comportements masculins pour être acceptée. Phénomène nouveau, on assiste maintenant à l’ascension de la « sportive féminine ».

Celle qui répond sur le terrain aux injonctions de la société quant à l’idéal de beauté. En mars dernier, à l’occasion de son passage à Rennes, Catherine Louveau, sociologue et professeure en STAPS à l’université de Paris Sud, soulignait que depuis plusieurs années les membres de l’équipe de France apparaissaient sur le terrain, bien apprêtées, maquillées et coiffées. Comme obligées de justifier qu’elles sont des femmes.
« Parce qu’elles ont compris que c’était comme ça qu’elles allaient être médiatisées », déplore-t-elle. Les médias et commentateurs doivent également prendre part à l’évolution des mentalités. Par exemple, ne plus faire de distinction, en presse régionale, entre les hommes à qui l’on attribue les pages Sport (pour les journalistes et pour les sujets) et les femmes à qui on laisse un espace restreint dans les pages locales.
Hiérarchiser l’information selon les performances sportives et non selon le sexe de l’athlète. Ou encore arrêter de parler « de nos petites Françaises » lorsque l’on est payé-e-s à commenter un match. Et surtout, arrêter de mentionner leurs physiques à la place de leur manière de jouer.
Sans surprise, on manque de représentations réelles et réalistes. Et les femmes ne s’y retrouvent pas. C’est bien là le propos des Dégommeuses :
« D’une part, différents clichés et fantasmes ont encore cours sur les équipes de sport collectif féminin comme possible lieu de conversion à l’homosexualité. D’autre part, pour promouvoir le foot féminin, les clubs et fédérations ont tendance à axer leur communication sur une image univoque de la sportive conforme aux normes de genre (féminine, sexy, ayant forcément une vie de mère de famille en dehors du foot) et à dévaloriser toutes celles (lesbiennes, bi, trans mais aussi hétéro) qui ne se retrouvent pas dans ce modèle. La volonté de séduire et rassurer à tout prix les spectateurs et les parents des jeunes joueuses instaure en outre des formes d’injonction au silence pour les joueuses lesbiennes et de déni face aux comportements lesbophobes qui existent pourtant tout autant dans le foot féminin que masculin. D’où la nécessité de créer des espaces permettant de faire évoluer les représentations et d’engager un dialogue autour du respect de la diversité et des bienfaits de l’inclusivité. »
UNE AUTRE MANIÈRE D’ENVISAGER LE FOOT
Et la dernière phrase fait parfaitement écho aux actions du collectif Le Ballon aux Filles. Et à ce qui en découle. À savoir l’accès à toutes les filles et femmes, notamment dans les endroits où elles en sont le plus éloignées. Mais le tournoi a également donné lieu à la création d’un créneau loisirs de futsal dans le quartier du Blosne.
« Lors de la 2e édition, une femme de 38 ans est venue parce qu’elle avait envie de jouer. Depuis elle vient chaque année et c’est elle qui m’a parlé de développer le futsal ici. L’an dernier, il y avait 24 filles entre 15 et 40 ans et cette année, j’en ai 20. On n’est pas du tout sur de la compétition mais vraiment sur de la découverte, de l’initiation et du plaisir. Et ça brasse large ! Des mamans, des lycéennes, des étudiantes, des femmes qui travaillent ou non, des femmes voilées, des habitantes du quartier ou non. », souligne Camille Collet.
Cette femme de 38 ans - maintenant de 40 ans - c’est Aïcha El Aissaoui. Passionnée de foot depuis toujours, elle n’a jamais joué dans un club. « J’ai toujours été à fond. Petite, je dormais avec le ballon, je ne pensais qu’à ça. Et j’ai failli en faire, au collège, on m’avait remarquée. Mais pour ma mère, une fille, ça ne faisait pas de foot, ça faisait la cuisine, la couture, etc. Le mercredi après-midi, je baratinais pour aller aux rencontres sportives et mon frère me couvrait. », se souvient en rigolant l’aide auxiliaire puéricultrice.
Aujourd’hui, elle a transmis sa passion à son fils et à sa fille et encourage « toutes les jeunes femmes, de toutes les cultures, de toutes les religions à faire du foot. » Ici, pas de jugement, seulement des femmes qui s’éclatent 2h par semaine : « Ensemble, on va voir les matchs du Stade Rennais, on a été voir le match France – Grèce, c’est génial, c’est que du bonheur. C’est convivial, on joue pour le plaisir et pas pour la gagne. »
Même discours du côté de Soraya (prénom modifié à sa demande), 25 ans, mère au foyer :
« Au Maroc, je jouais avec tout le monde. Avec les filles, avec les garçons, on passait notre temps à ça après l’école ! J’aime jouer et entre femmes ici, c’est très bien aussi. »
SE SENTIR À L’AISE
Le futsal se pratique dans un gymnase, à l’abri des regards, et c’est ce qui a plu à Julie Shaban, 16 ans. Auparavant, elle a joué au CPB Blosne, dans une équipe mixte.

« Ma sœur est fan de foot et elle m’a transmis cette passion. Je suis plus à l’aise dans un gymnase, parce que je n’aime pas qu’on me regarde, et dans une équipe de filles, je préfère. J’ai eu quelques réactions de la part de mes parents qui m’ont dit « t’es une fille, comporte toi comme une fille », je les écoute, ce sont mes parents mais ça n’enlèvera pas le fait que c’est ma passion et que si je peux, ça me plairait bien d’être coach, comme Camille. Mais je ne pense pas en faire mon métier, elles ont des vies compliquées les footballeuses, j’aime que ça reste une passion. », explique la lycéenne en 1ère STMG, incapable de garder son sérieux dès lors qu’elle regarde sa copine, avec qui elle vient tous les vendredis soirs.
L’ambiance est légère et joyeuse. Entre exercices techniques, petits matchs par équipe de 3 sur moitié de terrain, puis matchs par équipe de 5 sur l’intégralité de la surface, elles ne chôment pas pour autant. Et c’est bien ce que recherche Claire Serres, 33 ans, qui n’avait jamais fait de foot avant le mois de septembre.
« J’ai eu deux enfants coup sur coup et je voulais un sport qui me défoule ! Et en effet, on sort de là lessivées. Même si peu de gens savent que les filles jouent au foot, et encore moins au futsal, pour moi, ça redore le blason des sports collectifs en général parce qu’il y a un très bon esprit. »
sourit cette assistante commerciale.
Et ce n’est pas Pauline Meyer, 29 ans, assistante d’éducation, ou Yasmine Degirmenci, 21 ans, étudiante en BTS assistante manager, qui la contrediront. Toutes les deux jouent ou s’intéressent au foot depuis qu’elles sont enfants. Et toutes les deux s’émerveillent de toutes les belles choses que l’on peut faire avec un ballon aux pieds.
« Je trouve ça vraiment bien qu’on soit de plus en plus nombreuses à faire du foot. C’est une bonne chose de le promouvoir et de dire que tout le monde peut le faire », s’exclame la première, rejointe par la seconde : « J’aime beaucoup regarder les footballeuses de l’équipe de France, j’aime leur esprit d’équipe, je trouve qu’il est plus flagrant que celui des hommes. Ça donne envie de jouer comme elles ! »
En quelques années, le football a évolué. Dans le sens où de nombreuses sections féminines sont apparues, offrant la possibilité aux filles, adolescentes, jeunes femmes et femmes de pratiquer ce sport à côté de chez elles. Dans un cadre de compétition, de haut niveau ou de loisirs, il est vecteur de lien social et d’émancipation.
Mais les représentations stéréotypées, gravées profondément dans l’inconscient collectif, pèsent encore trop lourd dans la balance. Subsistent encore de nombreuses inégalités, notamment en terme d’équipements sportifs, de matériel, de traitements ou financiers. Fruits d’un système encore dicté par les mécanismes du sexisme…
Enfant, son rêve était de devenir footballeuse professionnelle. Non seulement Mélissa Plaza l’a réalisé, en jouant le milieu de terrain avec le Montpellier Hérault Sport Club, l’Olympique Lyonnais, l’En Avant Guingamp ou encore l’équipe de France, mais elle a aussi obtenu sa thèse en parallèle, axée sur les stéréotypes sexués dans le sport. À 29 ans, cette docteure en psychologie sociale a co-fondé – en décembre 2016 – le cabinet de conseils sur l’égalité femmes-hommes Queo Improve, à Saint-Grégoire, pour lequel elle dispense formations, conférences et séminaires.
Enfant, on vous dit que footballeuse professionnelle, ça n’existe pas, mais faire du foot, ça, c’est possible…
Oui enfin il y avait quand même quelques réfractaires dans ma famille, ma mère ne voulait pas trop que je joue au foot. Comme mon beau-père aimait bien, c’est lui qui m’accompagnait et il était content que je joue.
À 8 ans quand vous commencez le foot, vous êtes dans une équipe mixte ?
J’avais une équipe de filles à côté de chez moi donc j’ai tout de suite joué avec elles. Mais c’est vrai qu’à l’époque, on avait souvent tendance à jouer avec les garçons car il y avait très peu d’équipes féminines. Par contre, on jouait dans un championnat de garçons, uniquement contre des garçons.
Y avait-il des réactions de leur part ?
Oui, il y avait le côté « ahhh, on joue contre des filles ». Mais en fait dès qu’on leur mettait une pâtée, ils se la bouclaient, ils avaient plutôt honte. C’était rigolo pour nous de leur mettre des branlées.
Vous avez longtemps vécu ce sexisme ambiant ?
C’est toujours d’actualité, c’est sociétal, ce n’est pas juste lié au foot. En réalité, dans le foot, toutes les inégalités sociales, tous les comportements discriminatoires que l’on peut observer en société, sont juste décuplés. Si on prend ce qui est sorti récemment sur les violences faites aux femmes, ces questions n’ont pas beaucoup été soulevées dans le contexte sportif. Les violences sexuelles, pas qu’aux femmes mais entre athlètes, les bizutages dont on ne parle jamais, ces traditions qui autorisent des dérives comportementales assez hallucinantes…
Qu’est-ce qui explique selon vous que l’on n’en parle encore moins ?
C’est un vase close. Et dans le contexte sportif, le corps est mis au service de la performance. J’ai du mal à expliquer ça mais je crois qu’on a longtemps fermé les yeux sur ces phénomènes là. C’est difficile dans certains sports, comme en gymnastique par exemple, de dire à quel moment l’entraineur dépasse la limite.
Parce qu’il peut se permettre de corriger le mouvement en touchant le bassin, en touchant les fesses, en modifiant la posture, etc. Alors à quel moment on peut dire qu’un coach, qui touche les fesses de ses joueurs ou de ses joueuses avant d’entrer sur le terrain, a quelque chose de malsain ou n’a pas d’intention derrière ? C’est assez difficile le rapport au corps que l’on peut avoir dans le domaine sportif en général. Les entraineurs ne sont pas formés à ça.
Et puis il y a des enjeux de pouvoir. Effectivement, quand on est gamins et qu’on a un entraineur qu’on adule, qu’on adore, parce qu’on veut performer et qu’on veut devenir le meilleur ou la meilleure, forcément ça peut mener à des dérives je pense. Si on fait #balancetonporc dans le contexte sportif, il y a au moins toutes les sportives qui ont vécu une situation comme ça, et les sportifs au moins une situation de bizutage. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de l’ordre du fait divers. C’est vraiment quelque chose de courant.
Toutes les sportives ont vécu ce type de situation, vous aussi par conséquent ?
Oui, je sais qu’avec certains de mes entraineurs, je pense qu’il y a des choses qui n’étaient pas claires, que des choses n’auraient pas du avoir lieu de cette manière-là. En particulier avec les histoires de poids, on peut vite mettre la pression outre mesure sur des jeunes filles, des jeunes femmes.
Dans le milieu du sport, il y a justement un contrôle important du corps féminin.
Oui, en effet. On est vraiment dans des injonctions paradoxales. On nous demande d’être performantes. Pour cela, il faut avoir des corps musclés, prêts à l’effort, prêts à l’impact, prêts à être rapides et endurants. Et on nous demande aussi, en tout cas la société nous demande, de correspondre aussi à l’idéal de beauté féminin, c’est-à-dire sveltes mais pas trop musclées, plutôt fines.
Ça crée beaucoup de conflit chez les athlètes. Surtout à l’adolescence. Autour de moi, j’ai connu beaucoup de filles qui ont eu des périodes d’anorexie ou de boulimie. Les troubles du comportement alimentaire, chez les garçons je ne sais pas, mais chez les athlètes femmes et particulièrement les footballeuses, j’en ai connu plein.
Concernant l’idéal de beauté féminin, Catherine Louveau – qui était venue à Rennes pour une conférence en mars sur ces fameuses injonctions paradoxales – expliquait qu’aujourd’hui on voit une équipe de France de foot féminin qui entre sur le terrain maquillée, coiffée, etc.
Dans les vestiaires, il y a beaucoup de filles qui se maquillent beaucoup avant le match, qui se lissent les cheveux avant le match alors qu’il pleut dehors et qu’elles vont probablement friser en 5 minutes. Ça pose question, oui, en effet ! On est en train de prendre tous les artifices de la féminité pour dire « ok on fait un sport masculin mais on reste des femmes ».
Comme si on avait besoin de se justifier ! Alors qu’en réalité, on peut pratiquer le sport qu’on a envie, de la manière dont on a envie, et se définir comme des femmes à part entière sans se justifier auprès de qui que ce soit. Mais je connaissais beaucoup de filles, oui, qui avant les matchs se maquillaient, se coiffaient…
À votre avis, est-ce inconscient ou se disent-elles qu’il faut absolument affirmer leur féminité ?
Parfois, c’est conscientisé, parfois pas. Je ne pense pas qu’elles maitrisent tous les mécanismes sous-jacents. Mais effectivement, il y a une volonté de répondre aux injonctions faites par la société.
Et inconsciemment, elles se rendent compte que plus elles vont correspondre à ce que l’on attend de la féminité, plus elles vont être médiatisées…
Aussi, oui, bien sûr. D’ailleurs, celles qui sont médiatisées sont souvent celles qui sont les plus jolies, les plus apprêtées. Il y a des filles qui mériteraient d’être beaucoup plus médiatisées qu’elles ne le sont. Parce qu’elles ne correspondent pas forcément à l’idéal de beauté féminin.
C’est un sujet qui préoccupe les joueuses ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu’il n’y a pas encore de prise de conscience. Pour l’instant, on est contentes d’être médiatisées. Peu importe la raison. Ça c’est dérangeant.
C’est quelque chose qui vous a souvent interrogé au fil de votre carrière ou c’est en abordant votre thèse que la prise de conscience a eu lieu ?
En faisant cette thèse, j’ai mis des mots et j’ai compris les mécanismes du sexisme et des discriminations liées au sexe, etc. Mais j’ai aussi fait des erreurs. Quand je repense à ma campagne pour le Montpellier Hérault quand j’avais 21 ans, j’ai fait une erreur parce que je ne pensais pas que poser à moitié nue sans savoir le slogan de la banderole (« Samedi soir marquer à la culotte ») pouvait être préjudiciable personnellement mais aussi à titre collectif.
Parce que finalement on n’allait pas parler de nos performances mais juste des trois nanas qui ont posé à poil, qui sont jolies et qu’on va aller voir jouer le dimanche. Ce sont des erreurs qu’on ne réalise pas sur le moment, on pense qu’enfin on s’intéresse à nous donc il faut saisir l’opportunité.
Mais quand ma photo a été affichée en 4x3 dans tous les abribus de Montpellier, ça m’a fait bizarre. J’ai commencé ma thèse à Montpellier et mon poster était affiché dans la cafétéria où je faisais ma thèse sur les stéréotypes sexués. Volontairement, j’ai laissé ça sur le net parce que je veux aussi me souvenir que c’est par ces erreurs-là aussi que j’avance.
J’étais gamine, et on l’impression qu’enfin on s’intéresse un peu à nous, c’était piégeur parce qu’en réalité, le but c’était de vendre des abonnements pour la Mosson (Stade de la Mosson). C’était pour aller voir les garçons, ils en avaient rien à carrer de nous en fait.
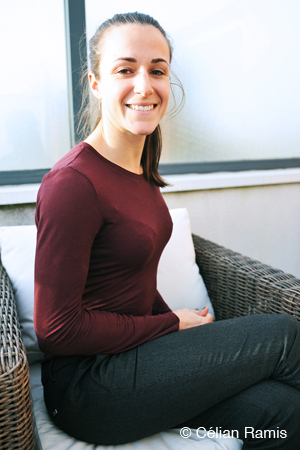 Est-ce que vous voyez une évolution depuis que vous avez commencé ?
Est-ce que vous voyez une évolution depuis que vous avez commencé ?
Il y a eu une évolution, c’est certain. Parce qu’il y a certains clubs professionnels, où les filles gagnent très bien leur vie. Il y a eu une évolution médiatique également mais on ne voit que les strass et les paillettes. On voit Paris, Montpellier, Lyon. Partout ailleurs la réalité est autre. Il y a des filles qui ne sont pas payées du tout, il y a des filles qui gagnent 200 euros brut par mois et qui font autant d’entrainements, qui font plus de déplacements parce qu’on n’a pas les moyens de leur payer le jet privé.
Au final, si on a avancé dans certains clubs, dans beaucoup d’autres ce n’est pas le cas. Aussi parce que comme toute situation pointée du doigt, elle doit être objectivée, avec des chiffres. Si on prend le championnat de France des garçons on est à peu près tous en mesure de dire en fonction du transfert ce que untel ou untel touche. Si on fait ça pour les filles, on ne trouve pas de salaires.
On sait à peu près, en moyenne, les salaires des filles de l’Olympique Lyonnais, mais cela ne correspond pas du tout à la réalité. Allons mettre sur la place publique un petit peu ce que ces filles touchent par mois. Il y a des filles qui ont 0 pour s’entrainer 6 à 8 fois par semaine et faire 30h de bus le week-end. Mettons un peu sur la place publique les salaires et comment sont traitées les filles parce que ce n’est pas seulement financier, c’est aussi en terme d’équipements.
Il y a des clubs qui filent 2 shorts et 2 maillots pour s’entrainer 2 fois par jour. Mais c’est bien connu les femmes aiment faire la lessive donc ce n’est pas grave, elles laveront leurs équipements ! Il y a aussi des clubs où les hommes ne veulent pas prendre le bus, donc ils prennent l’avion, mais comme il y a des sponsors, bon bah les filles elles vont prendre le bus, « c’est pas grave si vous faites 36h de bus dans le week-end, vous prendrez un jour de congé sur votre deuxième boulot qui vous permet d’atteindre péniblement les 800 euros net par mois ! ». C’est la réalité !
Et tant qu’on ne parlera pas de ce qui se passe ailleurs, effectivement on aura l’impression qu’on aura avancé. Et que de toute façon, dans notre devise c’est marqué égalité, alors on est naturellement égalitaires. Ce qui n’est pas du tout le cas ! On parle enfin des violences sexuelles faites aux femmes, des inégalités salariales, etc. Mais on en parle parce qu’on a enfin mis des chiffres et que ces chiffres sont enfin exposés et visibles.
A-t-on une idée d’où vient la responsabilité ?
Je pense que ce sont surtout des volontés politiques au sein des clubs. Il y a des dirigeants et des instances dirigeantes qui sont volontairement investi-e-s. Depuis une quinzaine d’années, voire une vingtaine, le président Aulas (président de l’OL) a choisi d’investir dans les féminines, au départ surement à perte, mais parce qu’il croyait en ces filles.
Aujourd’hui, c’est probablement la plus belle vitrine du club et il reçoit beaucoup en retour. Ça doit être des volontés politiques et pas seulement pour répondre à des quotas ou éviter de prendre des amendes. Parce qu’il y a aussi aujourd’hui encore des clubs qui préfèrent payer l’amende que d’avoir une section féminine.
On a le cas à Rennes avec le Stade Rennais.
Exactement ! Ce n’est pas un mythe, il y a encore des réfractaires, des gens qui vous disent ouvertement que les filles n’ont rien à faire sur un terrain de foot. En 2017, on entend encore ça ! C’est le quotidien.
Quand vous dites que vous avez été footballeuse professionnelle, est-ce que l’on avance dans les réactions, dans les mentalités ?
Vous savez, le problème de ces « femmes d’exception » comme on les appelle, c’est qu’elles viennent juste confirmer la règle. On les voit comme des extraterrestres finalement, on se dit que c’est un peu loin de nous tout ça et je pense que potentiellement, ça peut renforcer le stéréotype. Malheureusement.
Maintenant, c’est aussi des rencontres, des témoignages. Je sais que quand je parle de ce que j’ai vécu ou de ce que je peux vivre par moment, ça marque les gens. Certains en formation me disent « je ne pensais pas que ça pouvait être aussi violent ». Ça contribue à changer les mentalités mais ça va prendre du temps, ce n’est pas suffisant pour changer les comportements de façon durable.
C’est difficile de changer des siècles et des siècles de domination masculine. Où même les femmes peinent à reconnaître qu’elles sont dominées. C’est vraiment le combat de toutes et tous.
Ça rejoint ce que vous dites dans votre TED à propos de « garçon manqué »…
Oui, quand on me disait ça étant petite, je me disais que c’était un compliment. C’était valorisant d’être appelée comme ça alors qu’un garçon qu’on traitait de fille manquée ou d’homosexuel, parce que c’est ça qu’on dit, ce n’est pas le même statut. C’est plus tard que j’ai compris que finalement non, ce n’était pas un compliment mais une manière de rabaisser les femmes à leur rang d’inférieures et d’incapables.
La plupart des joueuses interviewées le disent encore qu’elles ont été ou sont des garçons manqués…
Et bien il faudra leur dire que ce sont des femmes réussies ! En fait, on a internalisé la domination masculine au fond de nous-même.
À propos du salaire, vous dites que vous avez commencé à 400 euros par mois…
Oui, 400 euros brut par mois. Mon premier salaire en tant que joueuse pro, à Montpellier.
Et à la fin de votre carrière ?
J’ai fini à 1500 euros net, à Guingamp. En faisant ma thèse en même temps. Une carrière qui permet de se mettre à l’abri, quoi. Qui permet de cotiser…
En tant que joueuse, que retenez-vous de votre carrière ?
Je retiens de choses positives quand même, des bons moments, des choses exceptionnelles que j’ai pu vivre, que d’aucun sur la terre pourrait vivre. Mais disons qu’il y a toujours des émotions qui sont diamétralement opposées, qui sont extrêmes. Des extrêmes déceptions, des extrêmes joies, des moments d’euphorie qu’on ne pourrait vivre dans aucun autre contexte.
Il n’y a que la victoire dans une compétition qui peut procurer autant de joie. Et en même temps, la retombée est rude. J’ai terminé ma carrière un peu contre mon gré et ça aura toujours un goût d’inachevé et d’injustice. Ce sont des émotions énormes. Je ne crois pas qu’un autre événement dans ma vie un jour puisse me procurer autant d’émotion que d’avoir gagné les jeux olympiques universitaires. Même la naissance d’un enfant sera moindre à côté.
Peut-être que je me trompe mais je pense que rien ne peut procurer autant d’émotion que le sport. La preuve en est que des gens vivent cette émotion par procuration. Ils ne vivent pas l’entrainement intense, la compétition, les efforts que ça demande mais arrivent à exulter au moment de la victoire. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans nos têtes. Enfin je ne sais pas si ça s’imagine…
Ça se voit en tout cas…
Oui, ça se voit. C’est juste dément. Et il n’y a rien qui puisse procurer ça ailleurs. Enfin, je ne pense pas.
Qu’est-ce que vous voulez dire aux jeunes filles, jeunes femmes, femmes qui n’osent pas ?
Je leur dirais de faire du sport en général parce que c’est important pour la santé et tant qu’on n’aura pas un égal accès au sport entre les femmes et les hommes, on n’aura pas un égal accès à la santé. C’est très important pour moi. La deuxième chose, c’est l’accès à la confiance en soi. Aujourd’hui, les filles et les femmes ont beaucoup moins confiance en elles que les garçons et les hommes.
Pour moi, le sport est un vecteur de confiance en soi, un vecteur d’émancipation et je pense que c’est un vecteur indispensable pour permettre aux femmes de se sentir épanouies et de ne pas avoir peur de faire des choses, de ne pas avoir peur de rebondir après un échec, etc. Je pense que le sport est une clé. On en parle souvent de manière générale pour les jeunes dans les quartiers mais on n’en parle pas assez pour les femmes.
Ça rejoint un peu le travail de Nicole Abar.
Tout à fait.
Quand avez-vous co-fondé votre entreprise Queo Improve ?
Fin décembre 2016. L’objectif, c’est de faire des conférences, des formations sur l’égalité, dans toutes les structures qui souhaitent s’améliorer sur ce plan là. Ou ce sont des entreprises qui sont contraintes législativement, ou des entreprises qui ont envie de s’investir dans le sujet, ou des collectivités territoriales, des collèges, des lycées…
Partout où il y a des gens qui ont la volonté de faire bouger les choses. Il y en a, tout comme il y en a qui ne réalisent pas l’importance de l’égalité et de la mixité au sein de leur structure et qui là en prennent conscience donc c’est bien. D’autres ne sont pas prêts à se faire ouvrir les chakras. Ça prendra du temps parce que toute la société évolue parallèlement.
Comment vous vous y prenez justement ? Par le démarchage ?
Oui, on démarche mais c’est aussi beaucoup par le bouche à bouche. A la suite d’une conférence, les gens se disent « Tiens j’ai déjà vu cette nana là, elle est super, elle aborde les choses différemment, tu devrais la voir ». Il y a du démarchage mais c’est beaucoup les gens qui viennent me chercher parce qu’ils ont vu mon TED, pour me faire intervenir sur l’égalité, sur la motivation, sur comment booster ces équipes, comment manager une équipe.
Vous avez des clients dans le milieu sportif ?
J’ai pas mal de collectivités qui veulent se lancer dans le sujet des violences dans le sport, la prévention des stéréotypes. À l’heure actuelle, je n’ai pas encore de clubs mais pour moi, ce qui m’apparaît essentiel, ce serait d’intégrer un module lié à l’égalité dans les diplômes d’état. Ce qui n’existe pas à l’heure actuelle.
Tant que l’on n’aura pas ça et que l’on n’aura pas des gens en mesure de donner ces formations, faire comprendre à ceux qui vont former et qui vont entrainer plus tard les gens que c’est incontournable, on n’avancera pas. On ne peut plus parler des filles comme on le faisait avant. Dire le « foot féminin », c’est faux. C’est du foot.
Le football au féminin n’est pas différent du football au masculin. Ce sont les mêmes règles, les mêmes buts, les mêmes ballons (des gens me demandent encore si on joue avec les mêmes ballons), les mêmes distances, la même longueur de but ! Informer les gens que, putain, c’est le même sport ! On part juste avec 50 – 60 ans de retard.
Donc oui aujourd’hui ça paraît plus lent mais pensez qu’aujourd’hui on a 40 caméras de moins, beaucoup plus de retard parce qu’on a commencé il y a moins longtemps, parce qu’on n’a pas d’école, pas d’entraineur, pas de staff compétent, pas d’équipement, faut penser à tout ça.
Donnons aux femmes et aux hommes les mêmes chances et ensuite on pourra éventuellement calculer par les différences biologiques les différences dans les performances. Faisons ça déjà !



 Elle est une artiste qui sans cesse repousse les limites de la musique. Parce qu’elle explore. Parce qu’elle expérimente. Parce qu’elle invente. Elle maitrise sa voix, sa gestuelle, ses instruments, son corps et son cerveau. Elle est complète, elle est entière. Elle vit l’instant, investit chaque sonorité et partage sans concession.
Elle est une artiste qui sans cesse repousse les limites de la musique. Parce qu’elle explore. Parce qu’elle expérimente. Parce qu’elle invente. Elle maitrise sa voix, sa gestuelle, ses instruments, son corps et son cerveau. Elle est complète, elle est entière. Elle vit l’instant, investit chaque sonorité et partage sans concession.
 Si les allitérations et assonances de « Sous le sable » et « Lasso » sont irrésistibles, Camille avance vers un contenu plus charnel et débridé. Plus déconstruit et libre.
Si les allitérations et assonances de « Sous le sable » et « Lasso » sont irrésistibles, Camille avance vers un contenu plus charnel et débridé. Plus déconstruit et libre.



 L’objectif des bénévoles est de faire découvrir ou redécouvrir les méthodes de contraceptions féminines et masculines à travers des quizz, des échanges, des jeux et même de la couture. “Toutes les salles, ou presque, ont été transformées en ateliers imaginés par l’équipe”, explique Anne-Claire Bouscal, directrice du planning familial rennais.
L’objectif des bénévoles est de faire découvrir ou redécouvrir les méthodes de contraceptions féminines et masculines à travers des quizz, des échanges, des jeux et même de la couture. “Toutes les salles, ou presque, ont été transformées en ateliers imaginés par l’équipe”, explique Anne-Claire Bouscal, directrice du planning familial rennais. Dans “l’atelier capote”, toutes les contraceptions hormonales ou naturelles - pilules, préservatifs, diaphragme, stérilets, implant et même digue buccale qui permet un sexe oral protégé des maladies sexuellement transmissibles - sont à portée de main.
Dans “l’atelier capote”, toutes les contraceptions hormonales ou naturelles - pilules, préservatifs, diaphragme, stérilets, implant et même digue buccale qui permet un sexe oral protégé des maladies sexuellement transmissibles - sont à portée de main. Et ce n’est pas la seule méthode à être occultée. L’injection hormonale hebdomadaire ou la vasectomie, légalisée en France seulement en 2001, sonnent encore comme des crimes contre la virilité. Pourtant, l’intervention qui consiste en la section des canaux déférents n’est pas une fatalité. André, présent au planning familial, a eu recours à la vasectomie à 24 ans, dans les années 70.
Et ce n’est pas la seule méthode à être occultée. L’injection hormonale hebdomadaire ou la vasectomie, légalisée en France seulement en 2001, sonnent encore comme des crimes contre la virilité. Pourtant, l’intervention qui consiste en la section des canaux déférents n’est pas une fatalité. André, présent au planning familial, a eu recours à la vasectomie à 24 ans, dans les années 70.
 On trouve alors la suédoise Hilma af Klint, pionnière de l’art abstrait, la chinoise Bow-Sim Mark, grande maitresse du kung-fu, l’américaine Bessie Coleman, première aviatrice afro-américaine à traverser l’Atlantique, l’indienne Lakshmi Bai, la légendaire reine guerrière, la mexicaine Petra Herrera, révolutionnaire, l’algérienne Kâhina, reine des Aurès et figure de la résistance berbère, la française Paulette Nardal, pionnière de la Négritude – mouvement d’émancipation et de réflexion sur la condition noire, ou encore les dominicaines Minerva, Patria et Maria Mirabal, militantes engagées contre la dictature, et la béninoise Hangbé, reine féministe et cheffe des troupes.
On trouve alors la suédoise Hilma af Klint, pionnière de l’art abstrait, la chinoise Bow-Sim Mark, grande maitresse du kung-fu, l’américaine Bessie Coleman, première aviatrice afro-américaine à traverser l’Atlantique, l’indienne Lakshmi Bai, la légendaire reine guerrière, la mexicaine Petra Herrera, révolutionnaire, l’algérienne Kâhina, reine des Aurès et figure de la résistance berbère, la française Paulette Nardal, pionnière de la Négritude – mouvement d’émancipation et de réflexion sur la condition noire, ou encore les dominicaines Minerva, Patria et Maria Mirabal, militantes engagées contre la dictature, et la béninoise Hangbé, reine féministe et cheffe des troupes.

 Et quand on a des témoignages de ça, en nombre, on se dit que le problème individuel est tellement partagé que ça doit vraiment être lié à nos modes d’éducation, à nos modes de représentation, à notre intégration nous-même des codes, de l’auto-censure. Quelque chose qui se joue là et qui n’est pas de l’ordre que de l’individuel. La bascule, elle est là.
Et quand on a des témoignages de ça, en nombre, on se dit que le problème individuel est tellement partagé que ça doit vraiment être lié à nos modes d’éducation, à nos modes de représentation, à notre intégration nous-même des codes, de l’auto-censure. Quelque chose qui se joue là et qui n’est pas de l’ordre que de l’individuel. La bascule, elle est là.




 Même son de cloches du côté de Lucile, secrétaire comptable et ambulancière : « On n’a pas de vacances, pas de temps pour soi, avec un régime alimentaire drastique… Non, je crois que j’aime un peu trop la fête ! » Toutes jouent au foot depuis l’enfance quasiment. Toutes accrochent à l’esprit d’équipe et parlent d’un sport intelligent parce que tactique et stratégique. Toutes n’ont pas les mêmes profils, ni les mêmes envies.
Même son de cloches du côté de Lucile, secrétaire comptable et ambulancière : « On n’a pas de vacances, pas de temps pour soi, avec un régime alimentaire drastique… Non, je crois que j’aime un peu trop la fête ! » Toutes jouent au foot depuis l’enfance quasiment. Toutes accrochent à l’esprit d’équipe et parlent d’un sport intelligent parce que tactique et stratégique. Toutes n’ont pas les mêmes profils, ni les mêmes envies.

 Moins médiatisées parce que soi-disant moins spectaculaires, elles sont donc moins visibilisées et moins reconnues pour leurs qualités et compétences de joueuses que les hommes. Pour les deux footballeuses à l’US Saint-Malo (équipe en D2), Arianna Criscione (ancienne joueuse internationale), 32 ans, et Romane Enguehard, 18 ans, le sexisme est omniprésent dans le milieu du ballon rond.
Moins médiatisées parce que soi-disant moins spectaculaires, elles sont donc moins visibilisées et moins reconnues pour leurs qualités et compétences de joueuses que les hommes. Pour les deux footballeuses à l’US Saint-Malo (équipe en D2), Arianna Criscione (ancienne joueuse internationale), 32 ans, et Romane Enguehard, 18 ans, le sexisme est omniprésent dans le milieu du ballon rond. 



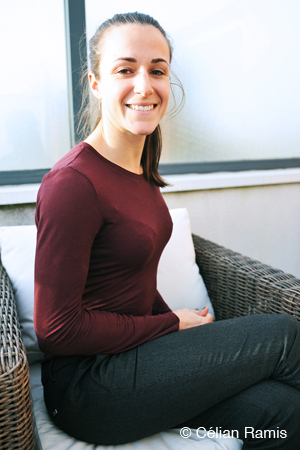 Est-ce que vous voyez une évolution depuis que vous avez commencé ?
Est-ce que vous voyez une évolution depuis que vous avez commencé ?

 Notre Candide interroge avec humour les convictions rebelles que les moins de vingt ans connaissent : changer le monde et le rendre meilleur. Qui de l'avocat en costume trois pièces ou du couple bobo en quête de vrai s'est le plus éloigné de sa candeur enorgueillie de justice ? Qui de l'Homme du 16ème ou du 21ème siècle est le plus moderne ?
Notre Candide interroge avec humour les convictions rebelles que les moins de vingt ans connaissent : changer le monde et le rendre meilleur. Qui de l'avocat en costume trois pièces ou du couple bobo en quête de vrai s'est le plus éloigné de sa candeur enorgueillie de justice ? Qui de l'Homme du 16ème ou du 21ème siècle est le plus moderne ? Les quatre protagonistes de Notre Candide exposent, dans leurs quêtes d'idéaux, ces schémas que nous répétons sans fin. Hier, Candide était enrôlé malgré lui dans une guerre entre Allemands et Bulgares dont il ne savait rien – et que Voltaire n’explicite pas volontairement.
Les quatre protagonistes de Notre Candide exposent, dans leurs quêtes d'idéaux, ces schémas que nous répétons sans fin. Hier, Candide était enrôlé malgré lui dans une guerre entre Allemands et Bulgares dont il ne savait rien – et que Voltaire n’explicite pas volontairement.