S’il est quasiment impossible de définir le nombre de femmes concernées par l’errance, deux sans domicile sur cinq seraient des femmes en France. Selon l’association catholique belge Vivre Ensemble Education – qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion - au niveau européen, elles représenteraient entre 8 à 25% des SDF. Une fourchette large…
« Ces femmes existent et il nous appartient d’en tenir compte. », déclare la structure bruxelloise. Elles sont par conséquent présentes dans l’espace public mais, pour de multiples raisons, sont invisibles.
Dans l’imagerie populaire, à quoi fait-on référence lorsque l’on parle de ‘SDF’ ? Les ‘sans domicile fixe’ sont-ils, par cette désignation, asexués ? Non. L’image première est celle d’un homme, pas particulièrement jeune, marqué par la rudesse de la « zone » - froid, stress, hygiène, violences potentielles – et souvent polyaddict à l’alcool et aux psychotropes.
 S’ajoute à cette représentation un fond de fainéantise, le sans-abri optant plus aisément pour la manche que pour la recherche d’un emploi, profitant ainsi du système au crochet de la société.
S’ajoute à cette représentation un fond de fainéantise, le sans-abri optant plus aisément pour la manche que pour la recherche d’un emploi, profitant ainsi du système au crochet de la société.
Une suspicion, voire une accusation, en tout cas un jugement négatif et réprobateur qui témoigne d’un malaise vis-à-vis d’une population que l’on ne connaît que très peu et à laquelle les individu-e-s craignent de se confronter.
Si elles sont identifiées par leur sexe, les femmes concernées, elles, vont bénéficier de la part des passant-e-s de plus de compassion, assortie d’un fort sentiment de pitié.
En effet, les représentations de genre amènent à envisager la femme comme un être plus fragile et vulnérable, tant sur le plan physique que psychologique, que l’homme. Ainsi, dans l’espace public, elle s’expose à des violences multiples.
À l’occasion d’une enquête réalisée par la Mipes (Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale) en 2009 auprès de 26 femmes SDF âgées de 50 ans, la sociologue Corinne Lanzarini explique : « Les violences auxquelles sont confrontées les femmes à la rue sont une extension de la violence générale à l’égard des femmes et plus particulièrement celle vécue par les femmes, en provenance des hommes. Les femmes à la rue doivent faire face à des craintes permanentes et elles se considèrent comme des proies au sein de l’espace public. »
Au quotidien, la gent féminine, en grande majorité, ressent un sentiment d’insécurité, craignant le harcèlement, les injures, les intimidations ainsi que les agressions physiques et/ou sexuelles. Elle développe pour y faire face des stratégies d’évitement : adopter un style vestimentaire sobre et « neutre », être accompagnée par des proches et en particulier par des hommes, éviter dans le cas échéant de fréquenter la rue à des heures tardives, etc. Et les femmes en errance ne font pas exception à cette logique de protection.
On dit alors qu’elles se masculinisent « Elles s’habillent dans les friperies de sorte qu’on ne les voit pas », déclare la réalisatrice canadienne Lise Bonenfant en préambule de son documentaire L’errance invisible, en 2008. La sociologue grenobloise Marie-Claire Vanneuville, approuve la théorie de l’invisibilité comme stratégie de survie.
Au début des années 2000, elle a mené une recherche-action de deux ans auprès de femmes en errance, débouchant sur la création dans la capitale des Alpes d’une association « Femmes SDF », connue, reconnue et prise en exemple pour ses réflexions et ses initiatives – notamment à travers la diffusion du documentaire de Denis Ramos réalisé en 2004, Malaimance, suivant 5 femmes en errance, SDF ou pas, dans leurs quotidiens et trajectoires de vie - dans le secteur social en France et à l’étranger, et la publication d’un ouvrage intitulé Femmes en errance : De la survie au mieux-être.
Ne pas se faire remarquer, « c’est une question de vie ou de mort face à la violence inimaginable qu’elles subissent. (…) C’est une attitude de défense mais aussi de culpabilité et de honte. »
La honte et la culpabilité dont elle fait mention, elle la développe en 2010 également dans un article de la revue de la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans abris, « Le sans-abrisme du point de vue du genre » (repris en contribution dans le magazine 50/50 en décembre 2010).
 Les femmes sans logement seraient en échec face à toutes les assignations de genre. Pourquoi ? Car elles ne répondraient pas à leur mission centrale : fonder un foyer à proprement parler et l’entretenir. L’espace privé étant le lieu par excellence de la femme. Dehors, le mode de vie ne correspond plus aux expectatives de la société.
Les femmes sans logement seraient en échec face à toutes les assignations de genre. Pourquoi ? Car elles ne répondraient pas à leur mission centrale : fonder un foyer à proprement parler et l’entretenir. L’espace privé étant le lieu par excellence de la femme. Dehors, le mode de vie ne correspond plus aux expectatives de la société.
Karine Boinot, psychologue clinicienne – qui est intervenue lors de la manifestation « Jeunes femmes en errance » en mars dernier à l’Hôtel Pasteur de Rennes – posait déjà la question en 2008 autour de la précarité asexuée et définissait alors :
« L’errance représente aussi la déviance par rapport à une norme ou un idéal. Elle renvoie à un certain désordre et donc à un danger potentiel. (…) La plus grande sévérité à l’égard des femmes peut s’expliquer en partie lorsque l’on sait que la prostitution est assimilée à l’époque (18e siècle, ndlr) au vagabondage. L’errance féminine est donc socialement et moralement suspecte car une honnête femme reste à la maison (du père ou du mari). Il y a ainsi transgression de l’apparent destin sociosexuel ou biologique, transgression qui se joue notamment par rapport à la sédentarité de l’univers domestique à laquelle les femmes sont vouées. »
Surtout dans un espace qui par essence est baigné de violences, comme constaté précédemment. « C’est pourquoi pour les femmes qui basculent dans la clochardisation, même si elles sont peu nombreuses, une cassure irréversible se fait au plus profond d’elles-mêmes, qui se traduit par une dégradation physique beaucoup plus marquée et rapide que chez les hommes. », précise Marie-Claire Vanneuville.
Il n’est pas rare également que pour se protéger, elles s’entourent et s’intègrent à des groupes de zonards. Une manière de se rassurer mais aussi de briser la solitude de l’errance. C’est le cas de Nadège, 26 ans, sans domicile depuis 2011. D’abord hébergée « à droite à gauche » du côté de Fougères, elle dort pendant un temps dans sa voiture puis, lorsque celle-ci tombe en panne, squatte chez un ami à Rennes.
Les choses tournent mal et en septembre 2013, la jeune femme atterrit dans la rue. C’est comme ça qu’elle va rencontrer, sur la dalle du Colombier, sa bande actuelle dans laquelle se trouve son amie Lina. « On s’aimait pas au début. J’aimais pas, elle jouait la racaille. Puis j’ai appris à la connaître, elle était mineure à l’époque alors je l’ai prise sous mon aile. Aujourd’hui, on a des liens de sœurs, c’est très important. Et c’est comme ça que j’ai rencontré son copain, qui vit aussi avec nous. », explique Nadège.
Ensemble, ils se sont installés dans une maison inoccupée, début mars, aux prairies Saint-Martin, à quelques mètres du Bon Accueil. Sinon ils vivent sous tentes, dehors ou dans des squats dont ils se font expulsés. Son entourage, c’est sa famille. Celle qui l’aide, la soutient, l’accompagne. Elle l’affirme et elle insiste :
« Lina, c’est ma sœur de cœur. On pourrait s’arracher le cœur l’une pour l’autre. C’est ce lien particulier qui nous a fait tenir. On se soutient dans la difficulté. Elle a arrêté les conneries – la violence, les vols de vélos… - sa mère me l’a bien dit, on arrive mieux à la canaliser maintenant. »
La solidarité, elle y tient. Victime, plus jeune d’une SDF qui profitait d’elle pour son argent, Nadège est à présent plus méfiante, sur ses gardes. Mais sa confiance envers ses trois compagnons de fortune est sincère.
« Ce sont de bonnes personnes. Je suis bien entourée. C’est grâce à eux que j’ai arrêté de boire et de fumer des bédos. Bon la clope, j’arrive pas à arrêter… Avant, je buvais en soirée, dehors tu bois des bières pour te réchauffer. T’es dans la galère, t’es sur les nerfs d’être dehors et de ne pas trouver d’endroit pour dormir alors bon… Aujourd’hui, je suis bien avec eux, à quoi ça sert alors de fumer et de boire ? Si je pète les plombs, ils sont là et ils me disent : ‘T’es une fille forte, t’es une battante’. », dit-elle en souriant.
RUPTURES ET FRACTURES
Néanmoins, elle ne nie pas la réalité. Au contraire, elle ne la connaît que trop. Agressée sexuellement à deux reprises, elle est consciente des dangers des soirées alcoolisées et de la rue, les premières violences ayant été subies dans un appartement, lorsqu’elle avait 17/18 ans.

Elle raconte : « Ils se sont mis à 2 sur moi, j’ai dit d’arrêter et que j’allais appeler au secours. J’ai eu un éclair de lucidité. Ils ont arrêté, j’ai eu de la chance. La plupart du temps, tu ne connais pas les noms de famille des personnes, alors tu ne portes pas plainte car contre X, tu sais que ça ne mènera nulle part. Surtout pour les zonardes, les flics vont pas faire une enquête. Mais le mec qui m’a agressée la 2e fois, lui, s’il revient à Rennes, il est mort, on fera justice nous-même. Rien à foutre. »
Les stratégies d’évitement ne peuvent être la seule réponse et défense des femmes en errance. Savoir se défendre est un atout incontestable quand on passe la majorité de son temps dans la rue. Elle a pratiqué le judo plus jeune, apprend, par un ami, quelques techniques de karaté et garde sur elle un couteau, en cas de besoin.
« Même si tu connais quelques trucs, quand tu te fais agresser, tu fais comme tu peux pour te sauver la vie. On essaye de se faire discrètes, de ne pas se faire voir, de ne pas rester tard dans la ville, on a les chiens avec nous – mais bon c’est pas dit que l’autre en face il ne plante pas ton chien ! – et on essaye d’être accompagnées par des hommes. », souligne-t-elle.
Les hommes avec lesquels elle a créé des liens étroits, elle les surnomme les grands frères, les tontons de rue, les papas de rue.
Pour Louise, à Rennes depuis 6 mois et en errance depuis plusieurs années, il est indéniable que les femmes doivent s’imposer, développer des caractères bien trempés et affirmés afin d’éviter au maximum les violences masculines.
« C’est clair que c’est difficile d’être une femme. Et une femme à la rue, c’est encore plus compliqué, avec toutes les violences. »
ajoute-t-elle.
 Les violences, elle les a subies au sein de son couple, pendant une dizaine d’années avant d’être aidée et soutenue par son compagnon actuel. À 37 ans, elle tente de se reconstruire et témoigne d’une grande réserve autour de sa vie privée que l’on décèle jalonnée de souffrances éparses.
Les violences, elle les a subies au sein de son couple, pendant une dizaine d’années avant d’être aidée et soutenue par son compagnon actuel. À 37 ans, elle tente de se reconstruire et témoigne d’une grande réserve autour de sa vie privée que l’on décèle jalonnée de souffrances éparses.
Depuis l’adolescence, Louise montre une envie de s’en sortir par ses propres moyens. Ses parents, issus du microcosme de l’audiovisuel et du cinéma, la poussent très jeune à travailler « mais le piston c’est pas trop mon truc, je n’ai pas envie d’être là parce que je suis fille de mais parce que j’ai des compétences. » Son père décède. Elle est alors âgée de 16 ans. Un passage par la radio Nova, quelques figurations dans des films… Les expériences lui plaisent mais sans plus.
Elle prend un chemin radicalement différent. « J’ai eu envie de liberté, envie de voyager, de rencontrer des gens différents. J’étais dans le sud, y avait du soleil mais des grandes gueules aussi, donc on a tracé vers le nord avec Raph’. On était vers Clermont, on y était depuis trop longtemps, ça nous cassait les couilles. Rennes, c’est une bonne ville, avec une bonne mentalité. On ne regrette pas du tout, on est bien ici. », explique-t-elle en finissant son thé, sur la terrasse de Malika par un après-midi ensoleillé.
Les premiers rayons de soleil printaniers se pointent et transforment les prairies Saint-Martin, inondées une semaine auparavant – obligeant plusieurs occupants des lieux à bouger leurs campements constitués principalement de tentes, matelas et bâches – en petit coin de campagne paisible et ressourçant.
Originaire de Charente, Malika débarque dans la capitale bretonne il y a 4 ans avec son camion. Ce mode de vie, elle l’a investi depuis 12 ans, à la suite d’une séparation amoureuse. Etre véhiculée, c’est la garantie de pouvoir bouger quand elle en a envie, de pouvoir aller là où elle a envie. « Mon beau-père est militaire, on a toujours bougé, je pense qu’il m’a transmis ça. », confie-t-elle.
Sans entrer dans les détails, elle livre une histoire familiale complexe. En rupture avec ses parents, elle est émancipée très jeune et lorsqu’elle prend la route, ne leur dit pas pendant 10 ans ses destinations et points d’ancrage : « J’ai revu ma mère il y a quelques années, j’ai été agréablement surprise. Elle voit que j’ai la tête sur les épaules, que j’ai mon camion, elle est rassurée. »
Nadège ne partage pas tout à fait la même expérience que Malika mais connaît des épisodes de fractures avec son père qui va être à la base de son errance. Clairement, il lui signifie de quitter le domicile familial. Mais elle reste en contact avec sa mère par sms ou par Facebook et lui a rendu visite l’an dernier. Un bref moment.
« Ça lui a fait mal de me voir partir la première fois. Je resterais toujours son bébé. Là, elle était contente de me voir mais triste que je reparte, car mon père ne voulait pas que je reste. Pour mon frère, ce n’est pas évident non plus. Il avait 11 ans quand j’ai quitté la maison. Il a manqué de quelque chose, comme un fils unique. Il est très timide, ne montre pas facilement ses émotions et je sais qu’il a pleuré plusieurs fois, je lui manquais. », dévoile Nadège.
 Les trois femmes démontrent la diversité des parcours et des facettes de l’errance. Des manières différentes de la vivre et de la concevoir. Choix ou non, elles cherchent toutefois à assumer leurs quotidiens, à le montrer sous un autre angle, à travers leurs réalités présentes et les forces qu’elles peuvent en retirer. Toutes les trois parlent avec pudeur du chemin qui les a menées là mais aucune question n’est taboue, aucune réponse n’est sans conviction.
Les trois femmes démontrent la diversité des parcours et des facettes de l’errance. Des manières différentes de la vivre et de la concevoir. Choix ou non, elles cherchent toutefois à assumer leurs quotidiens, à le montrer sous un autre angle, à travers leurs réalités présentes et les forces qu’elles peuvent en retirer. Toutes les trois parlent avec pudeur du chemin qui les a menées là mais aucune question n’est taboue, aucune réponse n’est sans conviction.
Déni ou vérité ? Les écrits universitaires et sociologiques affirment que personne ne choisit la rue. On cherche alors à justifier leur présence par des explications rationnelles et pragmatiques : la crise, l’augmentation de la précarité (qui souvent touche beaucoup plus les femmes que les hommes). Ainsi que par des images plus personnelles : la rupture familiale, la relation amoureuse d’une jeune fille avec un zonard, etc.
Et c’est là que se noue toute la complexité du regard porté par la société sur les femmes en errance. Envisager renoncer au confort du logement, au matérialisme rassurant, au cadre de la norme est source d’angoisses pour une grande partie de la population. La stigmatisation permet alors de se réconforter dans l’idée que cela n’arrive pas à tout le monde, au hasard d’un parcours cabossé. Nadège, Malika et Louise sont unanimes : mettre tout le monde dans le même panier sème la confusion et les amalgames sont réducteurs et contre-productifs.
« Y a des connards partout, des gens bien partout. Dans les zonards, y a des gens qui picolent, d’autres non, qui se droguent, d’autres non. Des violents, d’autres non. Mais c’est pareil chez les pompiers, les flics, etc. Il faut essayer de comprendre pourquoi les uns et les autres en arrivent là, il faut apprendre à connaître avant de juger. On a tous une histoire. On voit moins les femmes que les hommes mais tout le monde peut tomber dehors. », précise Nadège pour qui l’événement « Jeunes femmes en errance », organisé par Les Ceméa Bretagne, a été capital « pour faire ouvrir les yeux » au grand public, venu en nombre à la découverte de l’exposition et aux rencontres proposées (un peu moins lors des forums qui ont plus attiré les professionnel-le-s du secteur social).
Elle a fait partie, avec Lina, du comité de pilotage de la manifestation, et s’est beaucoup investie auprès des médias rennais pour changer les regards. Aborder tout aussi bien les difficultés, les galères, que les manières d’y survivre, sans détours.
L’invisibilité est donc une réalité de leur quotidien, de la situation des femmes en errance. Mais n’est pas tout ce qui les caractérise. Peut-être serait-il temps de s’interroger sur les raisons qui nous font ne pas les voir ? Car lorsque l’on s’y intéresse, les médiums d’information ne manquent pas. Documentaires, expositions, associations, articles de presse, ouvrages universitaires, publications sociologiques, émissions radio et TV… suffirait-il d’y porter attention et d’ouvrir les yeux en foulant les trottoirs de la ville ?
Dans un dessin de presse, l’illustrateur Pessin met le doigt sur l’image péjorative de l’errance féminine. Deux personnages discutent : « C’est le quoi le féminin de SDF ? », dit l’un. « C’est pire ! », répond l’autre. Une bribe de preuve que la société a du mal à faire face à ce phénomène social lié à un contexte de pauvreté mais aussi à une crise identitaire. Vulgarité, ignorance, hygiène douteuse… une représentation péjorative qui « met mal à l’aise, gêne quant au statut de la femme, elle en casse l’image », selon l’association Vivre Ensemble Education.
Pour la célèbre Mireille Darc, c’est avec le temps et l’habitude qu’elles sont devenues invisibles. « Invisibles parce que nous refusons de les voir, parce que cette réalité dérange », précise le synopsis du documentaire qu’elle signe pour l’émission de France 2, Infrarouge, diffusée le 15 décembre dernier et intitulé Elles sont des dizaines de milliers sans-abris.
SUBVENIR À LEURS BESOINS
Pour dégoter des couvertures, des matelas, des tapis de sol, des tentes ou encore des bâches, Nadège se tourne vers des associations comme le Samu social ou Si on se parlait. Pour se laver, la structure Le Puzzle propose des douches. Mais la jeune femme préfère se rendre à la piscine Saint-George qui pour 1 euro donne accès à des douches toujours très bien entretenues, bien mieux qu’au Puzzle précise-t-elle, et pour 2 euros à des bains. Pour la nourriture, la Croix-Rouge « dépanne ».
Mais avec ses ami-e-s, elle met en commun son RSA et les sous de la manche pour faire des courses et varier un peu les plaisirs. « On fait des pommes de terre, de la purée, des barbec’ en faisant du feu. Ce qu’on a en maraude, c’est bien mais on en a un peu marre des croissants et des sandwichs à force. On a besoin de chaud, de nourrissant. Sinon l’asso Le Fourneau sert des bons repas le midi aussi », signale Nadège. Elle est claire à ce sujet : ce n’est pas parce qu’elle vit dans la rue qu’elle n’aime pas s’entretenir. Sur le plan hygiénique et gastronomique, certes, les exigences sont réduites mais pas inexistantes :
« Si je pouvais, j’irais me laver 4 à 5 fois par semaine ! La rue, ça apprend à murir, à se débrouiller, à se nourrir, à se laver même quand les assos sont fermées. »
Pour Malika et Louise, même combat. En toute simplicité. Au bout de leur allée, une fontaine dont l’eau fait l’objet d’analyse chaque année afin de s’assurer de sa potabilité. À l’aide d’une brouette remplie de bidons, Malika va chercher de l’eau à la pompe. « On a ce qu’il faut ! On prend une bassine, on peut se doucher, faire une petite toilette de chat régulièrement. Ou prendre des lingettes. », explique-t-elle, naturellement.

Et pour les cabinets, des toilettes sèches faites de bric et de broc. « Mon coloc a posé des palettes, on installe une bassine et je ramène des copeaux. Il y a un endroit où je vide ça, tout simplement. », précise-t-elle.
Une fois cette image rompue, Nadège met pourtant le doigt sur une réalité qui augmente la vision d’une hygiène de vie peu enviable : les chiens. Ils dérangent, ils font peur. Aux prairies Saint-Martin, ils sont la cible de nombreux reproches de la part de certains riverains. Les trois femmes, chacune propriétaire d’un-e ou plusieurs chien-ne-s, en témoignent, c’est un espace qui résonne et quand les chiens aboient, l’écho amplifie les désagréments sonores.
Mais elles tiennent à rétablir la réalité quotidienne : oui les chiens aboient au cours de la journée quand un-e passant-e approche, mais non ils ne crient pas toute la nuit, dormant souvent avec leurs maitres et maitresses. Et rappellent également que les personnes en errance ne sont les seules à avoir des animaux domestiques. Derrière ces plaintes régulières se dissimule l’image stéréotypée des groupes de zonards qui veillent une partie de la nuit et font couler l’alcool à flots.
Elles ne s’en cachent pas, elles apprécient les moments de partage, les soirées, les apéros. Elles sont plutôt ‘couche-tard’ que ‘lève-tôt’. Louise reconnaît son addiction à l’alcool. Ce qui ne signifie pas que la fête bat son plein tous les soirs pour terminer au petit matin. « Souvent, on est couchés à la même heure que les poules !, rigole Nadège. Et de temps en temps, on fait la fête comme ça a été le cas la semaine dernière, ils m’ont organisé une fête pour mon anniversaire. Mais on va pas nous emmerder hein ?! On est censés déprimer tout le temps ? »
Elle revient sur la compagnie de son chien et de sa chienne. Elle veut faire comprendre l’importance de leur présence. Elle y tient. La relation qui se noue entre l’animal et la maitresse est primordiale pour elle : « Ce sont nos bébés, on les éduque, on les nourrit, on les soigne, on les emmène chez le véto, on dort avec eux, on s’attache à eux. » L’attachement dépasse souvent l’entendement, pourtant les liens affectifs sont bel et bien réels et très vite apparents dans des moments de complicité tout comme dans des moments de protection.
 « Si je suis en sécurité, ils vont aller jouer comme des gamins et vont s’éloigner. Sinon, ils vont rester autour de moi. Ou ils vont se mettre un devant et un derrière pour faire la garde. Ma chienne est très méfiante et quand elle ne connaît pas, elle ne laisse pas entrer, elle grogne. », souligne-t-elle.
« Si je suis en sécurité, ils vont aller jouer comme des gamins et vont s’éloigner. Sinon, ils vont rester autour de moi. Ou ils vont se mettre un devant et un derrière pour faire la garde. Ma chienne est très méfiante et quand elle ne connaît pas, elle ne laisse pas entrer, elle grogne. », souligne-t-elle.
Mais c’est aussi des instants émouvants comme quand la chienne met bas ou quand l’animal partage chaque ressenti du quotidien.
Ainsi, Nadège ne peut envisager de passer une journée sans ses deux compagnons à poils. « Il y a un lien très fort entre l’homme et le chien. Eux, c’est ma vie, ils sont toujours là pour moi, et inversement. On les aime, on se donne du confort. Ils nous comprennent, nous réchauffent, jouent avec nous ! On pourrait s’arracher un bras pour eux. J’ai 3 animaux préférés : le chien, le dauphin et le cheval. Leur point commun : la relation de confiance, l’attachement à l’homme, le tempérament joueur. Mais bon, le cheval en ville, c’est pas pratique… », plaisante-t-elle, tout en ne se détournant toutefois pas de son point principal : le chien a une place prépondérante dans son quotidien.
Et se les faire embarquer par la police, une fois les beaux jours venus sous prétexte d’une interdiction de regroupement de chiens, est une souffrance. Les animaux sont envoyés au chenil et les propriétaires, en plus de débourser la somme de 87 euros pour les faire sortir, doivent patienter une semaine réglementaire avant de pouvoir les récupérer.
« Ils font ça surtout au printemps et à l’été car il y a des touristes, alors ils essayent de nous éloigner. Mais Rennes, ce n’est pas qu’une jolie ville, on existe aussi. »
regrette-t-elle.
Les errant-e-s font tâche dans le paysage, ternissent la carte postale de la ville où il fait si bon vivre.
REMETTRE LES CHOSES À LEUR PLACE
Pour Marie-Claire Vanneuville, « L’errance n’est pas synonyme de « passage à la rue » (…) L’errance n’est pas le sans-abrisme (…) L’errance est profonde, psychologique, liée à une précarité matérielle dans la durée (…) L’errance est un parcours. » Pour Lise Bonenfant, il ne s’agit pas simplement de personnes mendiantes dormant sur les bancs publics. Et pour les concernées ? Comment se définissent-elles ? « Comme une femme normale », répond Nadège. Simplement.
Pas besoin d’aller chercher plus loin : « Je reste humaine. Je suis sans domicile fixe, je n’ai pas de logement. Je vadrouille dans la ville, je suis une zonarde. » Souvent installée avec sa bande et d’autres devant le Crédit Mutuel de Bretagne, place Sainte-Anne, elle fait la manche, en général les après-midis.
De temps à autre, elle participe à des activités et chantiers – de création et aménagement d’espaces verts par exemple, vers La Poterie et Beaulieu – organisés et proposés par la structure rennaise Le Relais, dont les éducateurs-trices de rue sont réparti-e-s sur plusieurs zones de la ville.
« Avec les éduc’ de rue, on peut parler de tout et de rien, rigoler, on peut aller avec eux en sortie kanoé, à la piscine ou en camp pour quelques jours aussi. Les chantiers, ça fait du bien aussi, ça donne envie de bosser, ça permet de pas rester dans la rue toute la journée et puis t’aimerait que ça dure toujours plus longtemps car tu noues des liens, des amitiés. », raconte Nadège qui devrait, avec Lina, prochainement accéder à une formation BAFA avec Les Ceméa. Ce qui lui permet d’envisager l’avenir autrement. Elle projette avec ses amis de trouver une colocation, à la campagne.
Louise et Nadège, elles, ne sont pas inactives non plus. Elles ne mettent pas forcément de catégorie sur leur mode de vie. Lors de notre rencontre, elles parlent de punks à chiens, de babos, de cas soc’ – en plaisantant à propos d’elles – mais ne collent pas l’étiquette sur ce qu’elles vivent et acceptent la désignation de femmes en errance, les deux femmes étant très attachées chacune à son camion, l’idée de bouger et de prendre la route leur tenant à cœur. Ne pas rester figées. Cela leur correspond.
Louise et son compagnon, hébergés actuellement chez un ami squattant une propriété en toute légalité, œuvrent depuis un mois à retaper leur véhicule, stationné devant la maison. Ensemble, ils aménagent leur intérieur avec un coin cuisine, une couchette, des espaces de rangement, etc. Un mélange d’intérieur bois et de mosaïques rétro, installés et fabriqués par eux-mêmes, avec du matériel acheté chez Brico-Dépôt et du système débrouille.
Un habitat fait de bric et de broc. C’est le leitmotiv de Malika qui, à 33 ans, se plait à profiter de ce qui l’environne. A contrario de Louise, qui parle ici de choix, elle ne fait pas la manche. Les prairies Saint-Martin, elle les a adoptées et les défend becs et ongles avec le collectif qu’elle a créé, Prairies libres ! Faire un potager, cueillir des noisettes, des châtaignes, en faire des cagettes, les mettre dans leur rue et les vendre à prix cassé, fabriquer des petits bijoux, voilà de quoi elle se satisfait en plus de son RSA, quand elle ne part pas en saison, dans le sud-ouest, pour travailler dans la restauration.
« Ici, on cherche des coins récup’ pour la bouffe, on fait des paniers pour le voisinage. On minimise, on vient avec le nécessaire, pas plus. »
déclare-t-elle.
Depuis plusieurs années, elle partage le terrain avec son colocataire, en squat légal, et vit dans son camion qu’elle entretient avec soin. Dans les fondations d’une ancienne maison aujourd’hui en ruines, ils aménagent un espace bureau, et devant, une petite terrasse.
Pour faire vivre les prairies, elle regorge d’idées. Créer un jardin d’enfants en milieu naturel, informer et sensibiliser toutes celles et ceux qui foulent les chemins de cet espace boisé avec des parcours rythmés de photos d’archives et d’explications, organiser des événements festifs et participatifs… des manifestations toujours basées sur le respect de l’environnement et des riverains. Pour un espace de vivre-ensemble.
Pour continuer à faire vivre cet esprit si particulier qui borde les prairies qui font l’objet d’un projet de réaménagement par la Ville de Rennes. Après avoir stoppé les jardins partagés, situés en zone inondable, il y a plusieurs années, la municipalité a commencé fin 2015 à abattre des arbres avant d’opérer les travaux de déconstruction du bâti existant et de reconstruction.
Un projet auquel Malika, et d’autres, s’opposent farouchement, souhaitant pouvoir conserver les prairies telles qu’ils les connaissent et les aiment :
« L’idée, c’est vraiment pas de faire une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes. Pas du tout. On ne veut pas avoir à faire avec les CRS, ce sont toujours les riverains qui mangent au bout du compte. Mais on peut vivre ensemble et faire des choses ensemble, entreprendre des projets sans tout aseptiser. Et en se souciant de l’environnement, pas comme la mairie de Rennes ! Il y a des gens qui vivent là depuis longtemps et ils vont être expropriés, c’est pas normal. On peut faire plein de choses, on aime les prairies et on veut les entretenir. Organiser des soirées à thème pour répondre aux interrogations des habitants, des expos-photos, des espaces naturels de jeux ou de répétition aussi pour les artistes, conserver l’esprit et l’histoire des prairies ! », répète Malika.
 Et en ce sens, elle entend aussi veiller au respect de la nature qu’elle souhaite préserver. Voir des déchets s’agglutiner sur les terrains sauvages l’exaspère. Tout comme les soirées trop arrosées de la « jeune génération des punks à chiens ». Elle a donc proposé au Relais d’organiser et animer des après-midis nettoyages des prairies avec les concerné-e-s pour les sensibiliser et les responsabiliser.
Et en ce sens, elle entend aussi veiller au respect de la nature qu’elle souhaite préserver. Voir des déchets s’agglutiner sur les terrains sauvages l’exaspère. Tout comme les soirées trop arrosées de la « jeune génération des punks à chiens ». Elle a donc proposé au Relais d’organiser et animer des après-midis nettoyages des prairies avec les concerné-e-s pour les sensibiliser et les responsabiliser.
La jeune femme restera cet été, a priori, dans la capitale bretonne. Elle souhaite se poser, et avoue avoir moins envie de partir en saison, d’ordinaire du côté de la région du Médoc. Elle entreprend sa propre démarche de reconversion dans le domaine du social, sans passer par un cursus universitaires : « Je n’ai pas besoin de ça pour comprendre les gens en difficultés. »
VERS LA RECONNAISSANCE
L’errance, incontestablement, s’accompagne d’une absence de confort matériel et généralement de souffrances dans les chemins des unes et des autres. Le quotidien est jalonné de galères et de débrouilles. Un quotidien qui amène à repenser, par protection ou autre, la norme imposée par la société qui renvoie alors aux femmes en errance un sentiment d’échec et de vie marginale.
Mais les facettes de celles qui côtoient, de manière satellite ou totale, la zone sont multiples, variées et complexes. Si leur invisibilité les protège de certains dangers indéniables de l’espace public et urbain, l’indifférence ou la pitié ne sont pas des réponses adaptées à leurs situations.
« Moi, je prends les devants. Mes chiennes font toujours la fête aux gens qu’elles croisent, alors j’en profite pour discuter avec eux. En général, ils sont ouverts et comprennent. En fait, les gens ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas. »
explique Louise.
Idem du côté de Nadège qui a appris, en faisant la manche, à vaincre sa timidité pour communiquer avec les passant-e-s. Mais bon nombre d’entre eux-elles les ignorent encore.
Peut-être serait-ce un début de solution. Un regard, une réponse, une parole. Sans tomber dans le pathos. Simplement un premier pas vers la reconnaissance et la sortie de l’invisibilité qui tend à effacer une partie de la personnalité et qui arrange une société trop frileuse pour se confronter à une réalité loin de s’améliorer dans les années à venir.


 Elles pourraient être des nymphes. Des divinités de la Nature. Autour d’une bûche qui pleure sa souffrance ou son angoisse, elles tentent d’apaiser la source de ses cris. Leur langage est animal, primitif. Leur danse est légère et virevoltante.
Elles pourraient être des nymphes. Des divinités de la Nature. Autour d’une bûche qui pleure sa souffrance ou son angoisse, elles tentent d’apaiser la source de ses cris. Leur langage est animal, primitif. Leur danse est légère et virevoltante. « Qu’est-ce que c’est le sauvage au féminin ? », s’interroge il y a 3 ans Sarah Crépin, chorégraphe et interprète pour La BaZooka. À cette époque, elle est intriguée par la relation entre le féminin et le sauvage, notion machinalement – et injustement - imaginée au masculin.
« Qu’est-ce que c’est le sauvage au féminin ? », s’interroge il y a 3 ans Sarah Crépin, chorégraphe et interprète pour La BaZooka. À cette époque, elle est intriguée par la relation entre le féminin et le sauvage, notion machinalement – et injustement - imaginée au masculin. Le metteur en scène la rejoint : « On ne veut pas figer les choses. On essaye d’agir de manière très libre. Par association d’idées, avec beaucoup d’improvisation et de l’évolution au fil des répétitions. C’est aussi un travail de transmission. On voit ce qui s’adapte aux corps des interprètes, ce qui se passe à travers la puissance du groupe et comment cela résiste au temps et à l’accueil des enfants selon les représentations. »
Le metteur en scène la rejoint : « On ne veut pas figer les choses. On essaye d’agir de manière très libre. Par association d’idées, avec beaucoup d’improvisation et de l’évolution au fil des répétitions. C’est aussi un travail de transmission. On voit ce qui s’adapte aux corps des interprètes, ce qui se passe à travers la puissance du groupe et comment cela résiste au temps et à l’accueil des enfants selon les représentations. »
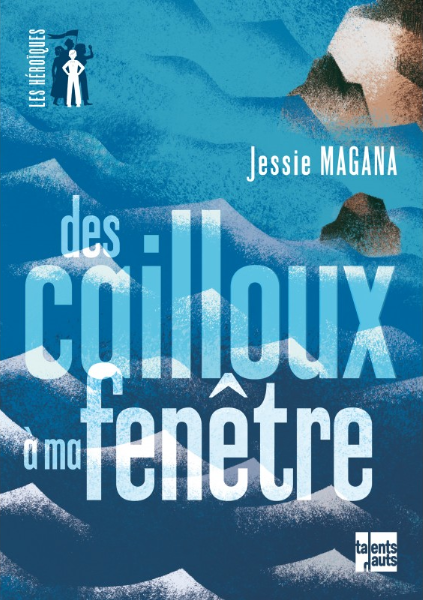 Albums, contes, romans, livres bilingues… la maison d’édition indépendante, fondée en 2005 par Laurence Faron, centralise son activité auprès du public jeunesse, de la petite enfance à l’adolescence. Et se distingue de ses congénères de sa par sa ligne humaniste forte, basée sur une éducation aux différences et une lutte contre les discriminations.
Albums, contes, romans, livres bilingues… la maison d’édition indépendante, fondée en 2005 par Laurence Faron, centralise son activité auprès du public jeunesse, de la petite enfance à l’adolescence. Et se distingue de ses congénères de sa par sa ligne humaniste forte, basée sur une éducation aux différences et une lutte contre les discriminations. Pour bâtir Les héroïques, pas question de passer commande. Les auteur-e-s ne sont pas missionné-e-s pour écrire une histoire répondant à des critères stricts. Mais pour qu’un ouvrage intègre la collection, il doit présenter un-e héro-ïne de l’ombre. Pas uniquement des femmes. Pas uniquement des blanc-he-s. Pas uniquement des problématiques extraordinaires. Au contraire, l’histoire doit rester proche des considérations actuelles.
Pour bâtir Les héroïques, pas question de passer commande. Les auteur-e-s ne sont pas missionné-e-s pour écrire une histoire répondant à des critères stricts. Mais pour qu’un ouvrage intègre la collection, il doit présenter un-e héro-ïne de l’ombre. Pas uniquement des femmes. Pas uniquement des blanc-he-s. Pas uniquement des problématiques extraordinaires. Au contraire, l’histoire doit rester proche des considérations actuelles.
 Elle croit en la responsabilité collective et la responsabilité individuelle, la prise de conscience. Éprise de liberté, elle joue des codes aussi bien cinématographiques que sexués. Elle ne croit pas qu’en le féminisme, mais globalement en l’humanisme.
Elle croit en la responsabilité collective et la responsabilité individuelle, la prise de conscience. Éprise de liberté, elle joue des codes aussi bien cinématographiques que sexués. Elle ne croit pas qu’en le féminisme, mais globalement en l’humanisme. Et aborde également la question du libre arbitre, de la responsabilité de nos actes, de la colère. La colère profonde, néfaste, dangereuse. Qui vient des entrailles et bouffe tout le reste autour.
Et aborde également la question du libre arbitre, de la responsabilité de nos actes, de la colère. La colère profonde, néfaste, dangereuse. Qui vient des entrailles et bouffe tout le reste autour.

 S’ajoute à cette représentation un fond de fainéantise, le sans-abri optant plus aisément pour la manche que pour la recherche d’un emploi, profitant ainsi du système au crochet de la société.
S’ajoute à cette représentation un fond de fainéantise, le sans-abri optant plus aisément pour la manche que pour la recherche d’un emploi, profitant ainsi du système au crochet de la société. Les femmes sans logement seraient en échec face à toutes les assignations de genre. Pourquoi ? Car elles ne répondraient pas à leur mission centrale : fonder un foyer à proprement parler et l’entretenir. L’espace privé étant le lieu par excellence de la femme. Dehors, le mode de vie ne correspond plus aux expectatives de la société.
Les femmes sans logement seraient en échec face à toutes les assignations de genre. Pourquoi ? Car elles ne répondraient pas à leur mission centrale : fonder un foyer à proprement parler et l’entretenir. L’espace privé étant le lieu par excellence de la femme. Dehors, le mode de vie ne correspond plus aux expectatives de la société.
 Les violences, elle les a subies au sein de son couple, pendant une dizaine d’années avant d’être aidée et soutenue par son compagnon actuel. À 37 ans, elle tente de se reconstruire et témoigne d’une grande réserve autour de sa vie privée que l’on décèle jalonnée de souffrances éparses.
Les violences, elle les a subies au sein de son couple, pendant une dizaine d’années avant d’être aidée et soutenue par son compagnon actuel. À 37 ans, elle tente de se reconstruire et témoigne d’une grande réserve autour de sa vie privée que l’on décèle jalonnée de souffrances éparses. Les trois femmes démontrent la diversité des parcours et des facettes de l’errance. Des manières différentes de la vivre et de la concevoir. Choix ou non, elles cherchent toutefois à assumer leurs quotidiens, à le montrer sous un autre angle, à travers leurs réalités présentes et les forces qu’elles peuvent en retirer. Toutes les trois parlent avec pudeur du chemin qui les a menées là mais aucune question n’est taboue, aucune réponse n’est sans conviction.
Les trois femmes démontrent la diversité des parcours et des facettes de l’errance. Des manières différentes de la vivre et de la concevoir. Choix ou non, elles cherchent toutefois à assumer leurs quotidiens, à le montrer sous un autre angle, à travers leurs réalités présentes et les forces qu’elles peuvent en retirer. Toutes les trois parlent avec pudeur du chemin qui les a menées là mais aucune question n’est taboue, aucune réponse n’est sans conviction.
 « Si je suis en sécurité, ils vont aller jouer comme des gamins et vont s’éloigner. Sinon, ils vont rester autour de moi. Ou ils vont se mettre un devant et un derrière pour faire la garde. Ma chienne est très méfiante et quand elle ne connaît pas, elle ne laisse pas entrer, elle grogne. », souligne-t-elle.
« Si je suis en sécurité, ils vont aller jouer comme des gamins et vont s’éloigner. Sinon, ils vont rester autour de moi. Ou ils vont se mettre un devant et un derrière pour faire la garde. Ma chienne est très méfiante et quand elle ne connaît pas, elle ne laisse pas entrer, elle grogne. », souligne-t-elle. Et en ce sens, elle entend aussi veiller au respect de la nature qu’elle souhaite préserver. Voir des déchets s’agglutiner sur les terrains sauvages l’exaspère. Tout comme les soirées trop arrosées de la « jeune génération des punks à chiens ». Elle a donc proposé au Relais d’organiser et animer des après-midis nettoyages des prairies avec les concerné-e-s pour les sensibiliser et les responsabiliser.
Et en ce sens, elle entend aussi veiller au respect de la nature qu’elle souhaite préserver. Voir des déchets s’agglutiner sur les terrains sauvages l’exaspère. Tout comme les soirées trop arrosées de la « jeune génération des punks à chiens ». Elle a donc proposé au Relais d’organiser et animer des après-midis nettoyages des prairies avec les concerné-e-s pour les sensibiliser et les responsabiliser.
 Née en 1940, la Normande qui grandit à Yvetot souhaite à 70 ans passés retrouver la fille qu’elle a été en 1958 et celle qu’elle a été avant l’été, celui de la colonie à S. dans l’Orne durant laquelle elle va croiser le chemin du moniteur chef qui l’invite à danser, éteint la lumière, l’embrasse, « et les choses s’enchainent, sans aller jusqu’au bout pour raisons techniques ou physiologiques. »
Née en 1940, la Normande qui grandit à Yvetot souhaite à 70 ans passés retrouver la fille qu’elle a été en 1958 et celle qu’elle a été avant l’été, celui de la colonie à S. dans l’Orne durant laquelle elle va croiser le chemin du moniteur chef qui l’invite à danser, éteint la lumière, l’embrasse, « et les choses s’enchainent, sans aller jusqu’au bout pour raisons techniques ou physiologiques. » Par l’écriture, elle transforme la honte et diminue celle de celles et ceux qui se reconnaissent dans le sentiment éprouvé. Lors de la rencontre à Rennes, elle parle de « devoir ». Et face à l’épaisse foule dispersée dans les rayons de la librairie venue l’écouter, elle montre sa grande humilité.
Par l’écriture, elle transforme la honte et diminue celle de celles et ceux qui se reconnaissent dans le sentiment éprouvé. Lors de la rencontre à Rennes, elle parle de « devoir ». Et face à l’épaisse foule dispersée dans les rayons de la librairie venue l’écouter, elle montre sa grande humilité.






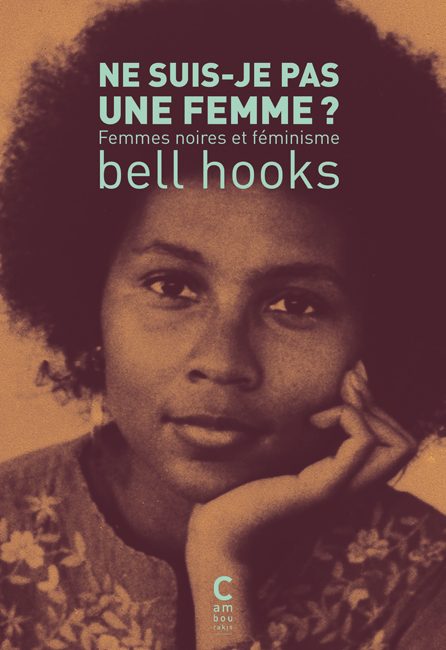 « On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.
« On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.