Célian Ramis
Femmes entrepreneures : Capables d'oser et de réussir


Parce qu’il faut des couilles pour diriger une boite, l’entrepreneuriat est clairement associé à une image masculine. Une représentation fausse mais très imprégnée dans les mentalités, tant des hommes que des femmes. Ces dernières ne représentent encore que 30% des entrepreneur-e-s en France.
En dépit de la progression de ce chiffre au cours de ces dernières années et des incitations gouvernementales – plan pour l’entrepreneuriat féminin lancé en 2013 – les difficultés persistent. Des réseaux de femmes entrepreneures se tissent alors pour y répondre, privilégiant l’entraide et le partage.
C’est sur ces valeurs que se lance le programme Caravelle, en octobre 2017, en Ile-de-France, en Aquitaine et en Bretagne, destinée aux femmes entreprenant dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire.
Depuis l’enfance, les petites filles entendent dire qu’elles doivent être douces, gentilles, maternantes, au service des autres et discrètes. En grandissant, elles intègrent que certains postes, comme ceux d’ingénieurs, de scientifiques ou encore de chefs d’entreprise, incombent aux hommes. Rares sont les modèles féminins à qui elles peuvent s’identifier.
Et quand on dresse le portrait de la femme d’affaires, l’image ne fait pas rêver : elle est stricte, froide, blanche, bourgeoise, peut-être fille de, centrée uniquement sur sa vie professionnelle, incapable de nouer des relations amicales avec les autres femmes. Pourquoi ? Parce qu’elle doit adopter les codes de la masculinité et redoubler d’effort pour prouver ses capacités et être acceptée.
Un tas de conneries parfaitement contre-productif qui part d’une base réelle, celle d’une société sexiste dans laquelle les femmes n’ont pas vraiment leur place. Pourtant, aujourd’hui, les choses bougent et une nouvelle génération émerge : celle qui choisit son émancipation.
 « Toute femme peut devenir une femme extraordinaire. Pour avoir votre part de chance, saisissez-là ! Il faut prendre la liberté d’entreprendre ! À vous d’organiser votre temps. La clé, c’est l’audace et la confiance en soi. Se sentir légitime, c’est important. On apprend en marchant. »
« Toute femme peut devenir une femme extraordinaire. Pour avoir votre part de chance, saisissez-là ! Il faut prendre la liberté d’entreprendre ! À vous d’organiser votre temps. La clé, c’est l’audace et la confiance en soi. Se sentir légitime, c’est important. On apprend en marchant. »
Ce sont les mots que la présidente d’Entreprendre ensemble, Daisy Dourdet, a adressé à l’assemblée présente lors du colloque « Réinventer le développement grâce à la diversité », qui se déroulait le 19 mai dernier, à l’École nationale supérieure de chimie de Rennes. Pour la table ronde « Entreprendre au féminin », elle était accompagnée de Céline Domino, créatrice du fait-main et membre du réseau Femmes de Bretagne, et de Michaela Langer, présidente de Triskem International.
Ensemble, elles ont pointé les difficultés auxquelles la majorité des femmes font face lorsque l’envie d’entreprendre les traverse et les ont aussitôt balayé du revers de la main. « Les réseaux féminins s’adressent particulièrement à celles qui se sentent menacées par les assignations de genre. Là, elles parlent entre elles de leurs vies personnelles et de leurs vies professionnelles qui s’entremêlent. », souligne Céline Domino, qui note également que « les femmes sont souvent sur l’idée de créer leur emploi. Beaucoup restent des porteuses de projet pendant très longtemps. Il y a parfois l’idée que quand on gère plusieurs salarié-e-s, on a moins de temps qualitatif avec ses enfants, sa famille. »
Pour Michaela Langer, c’est une question de choix et d’organisation : « J’ai un emploi du temps qui déborde. J’adore ce que je fais et je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Ils sont heureux parce que je suis heureuse et ça se voit quand on est ensemble. Mais j’ai aussi envie d’aller plus loin avec mon entreprise, de grandir avec et que mes collaborateurs-trices soient également épanoui-e-s. Il faut vraiment croire en ce que l’on fait, c’est vraiment essentiel, et oser. »
Un discours que cautionne totalement Daisy Dourdet qui soulève alors la problématique du rapport à l’argent : « Les femmes se sous-estiment. Encore une fois, il y a cette question du manque de confiance. On n’ose pas gagner d’argent. Pourquoi une femme aurait une petite entreprise ? Pourquoi n’aurait-elle pas d’ambition ? En entreprenant, on crée de la richesse, on fait vivre des salarié-e-s, il y a une redistribution des profits. Il ne faut pas avoir honte de gagner de l’argent, de vouloir gagner de l’argent et de créer de la richesse. »
Les trois entrepreneuses en viennent alors au fond du problème. Au-delà de l’éducation genrée que l’on reçoit dès la petite enfance – ne poussant pas les petites filles à oser – le manque de représentation féminine dans le monde des costards-cravates influe sur les individus, notamment les femmes qui ne se sentent alors pas légitimes à se lancer.
Pour la fondatrice d’Entreprendre ensemble, « il faut montrer des femmes qui ont commencé de zéro, qui sont parties de rien et qui ont tout construit. Et il faut arrêter de prendre en exemple le peu d’entreprises dirigées par des femmes au CAC 40 ». Ou faire les deux, puisque c’est dans la multiplicité des exemples et des parcours que les femmes pourront s’identifier.
Les problématiques relatées lors de la table ronde ne concernant pas uniquement le secteur de l’entrepreneuriat mais bel et bien l’ensemble des domaines encore principalement occupés par les hommes.
LA PARITÉ, ÇA RAPPORTE
Nathalie Mousselon est présidente du Comité Diversité de l’association Ingénieurs et scientifiques de France – à l’initiative du colloque organisé à Rennes – et le dit avec conviction : « L’étude MC KINSEY The power of parity estime la perte de richesse mondiale due aux inégalités entre les sexes à 28 milliards de dollars. Les femmes peuvent être la clé du redressement économique ! » (lire 3 questions à Nathalie Mousselon – YEGG#59 – Juin 2017).
Sans surprise, les femmes ont leur place à prendre dans l’économie mondiale, tous secteurs confondus et tous postes confondus. Dans un article daté du 1er octobre 2017, publié sur le site du Monde Afrique, Elisabeth Medou Badang, première femme Africaine à prendre la tête d’une multinationale au Cameroun (Orange), prône la parité femmes-hommes, dans le secteur privé.
 « Les femmes représentent 50% de la population et nous avons autant de capacités intellectuelles que les hommes. Pourquoi le monde, et l’Afrique, se priverait de la moitié de ses cerveaux ? (…) Des études ont démontré que si on donnait aux femmes autant d’opportunités qu’aux hommes, le monde pourrait accroitre ses richesses de plus de 20% ! », déclare celle qui s’est rendu au premier sommet « Women in Africa » du 25 au 27 septembre, organisé au Maroc.
« Les femmes représentent 50% de la population et nous avons autant de capacités intellectuelles que les hommes. Pourquoi le monde, et l’Afrique, se priverait de la moitié de ses cerveaux ? (…) Des études ont démontré que si on donnait aux femmes autant d’opportunités qu’aux hommes, le monde pourrait accroitre ses richesses de plus de 20% ! », déclare celle qui s’est rendu au premier sommet « Women in Africa » du 25 au 27 septembre, organisé au Maroc.
Pour partager son expérience aux côtés de plus de 300 entrepreneures venues échanger à Marrakech autour de la thématique « Investir pour une meilleure gouvernance avec les femmes africaines ». Un peu sur le même principe que le « Women’s forum », qui s’est déroulé l’an dernier en France, à Deauville (ce que montre la réalisatrice Tonie Marshall dans son nouveau film Numéro Une, au cinéma le 11 octobre – lire « Tonie Marshall contre le sexisme des hautes sphères du CAC 40, yeggmag.fr, 27 septembre 2017), et qui réunit chaque année depuis 12 ans des scientifiques, décideurs-euses et chef-fe-s d’entreprise, dans l’optique de renforcer la représentativité des femmes et inciter à la mixité femmes-hommes.
ÉDUCATION À LA PARITÉ ET NON À LA PRÉCARITÉ
Pour Elisabeth Medou Badang, il est primordial de casser les stéréotypes entre les filles et les garçons, dès l’enfance, à travers la cellule familiale et l’éducation, en laquelle elle croit profondément. Parce que les inégalités font partie intégrante de la culture mondiale. Isabelle Guegeun, cofondatrice de la SCOP bretonne Perfegal, constate qu’aujourd’hui encore la résistance des mentalités se confronte au cadre législatif.
« Des lois pour la parité dans les organisations, l’égalité salariale, les quotas en politique, etc. on en a. Mais il est compliqué de passer de la loi à la culture. Il est important de parler et de cultiver l’égalité hommes-femmes. »
souligne-t-elle.
L’Éducation Nationale ne fait pas exception : « Les enseignant-e-s sont assez réfractaires en général à se former. Alors les former à cette thématique… L’écriture inclusive va changer leurs habitudes donc ils ne trouvent pas ça bien. Mais attention, il y a des gens convaincus dans ce secteur et il ne faut pas tout leur mettre sur le dos. Dans notre travail, on essaye de démontrer par des chiffres et des exemples concrets plutôt que de culpabiliser. Mais je le redis, ce n’est pas que dans l’Education Nationale. On explique la même chose aux élu-e-s, il faut être pédagogique. C’est un ensemble qu’il faut faire évoluer ! » L’ensemble d’un système sexiste que l’on intègre dès la petite enfance.
La société bouge lentement et l’État peine à forcer l’évolution des mentalités, même s’il reconnaît aujourd’hui, à force de batailles féministes espérons-le, l’importance de l’intégration des femmes dans le monde économique. Pourtant, ces dernières, toujours les principales victimes des crises, sont les plus visées par la précarité, tandis qu’elles sont majoritairement plus diplômées que les hommes (72% des femmes sont de niveau Bac+5 à doctorat contre 62% des hommes, en moyenne).
En 2013, le ministère en charge des Droits des femmes, le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et le ministère délégué chargé des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique lancent le plan « Entreprendre au féminin », afin d’augmenter le nombre d’entreprises créées par les femmes. Trois ans plus tard, l’indice entrepreneurial – la part de Français-es étant ou ayant été dans une démarche entrepreneuriale – survole seulement les 27% pour les femmes.
L’ESS, TOUCHÉE PAR LES MÊMES DIFFICULTÉS ?
Et dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire, le rapport est proche. Un tiers des femmes sont entrepreneures et deux tiers sont salariées. « Il y a un vrai intérêt pour ce secteur mais les freins sont importants. Nous avons voulu comprendre ces freins avec l’étude Women’Act, pour pouvoir ensuite agir pour les résoudre. », explique Joséphine Py, chargée du programme Caravelle pour l’association Empow’her.
La structure, créée en 2011 par un groupe de jeunes constatant le contraste entre la précarité des activités entrepreneuriales des femmes rencontrées dans plusieurs pays du monde et le potentiel économique qu’elles représentent, se base sur des chiffres révélateurs de la problématique : 66% des employés du secteur sont des femmes, 45% sont à temps partiel et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’élève à 20%.
 Environ 30% seulement de femmes entrepreneures. Souvent dans des domaines plutôt genrés, comme les services sociaux et la santé. Ainsi, entre octobre 2016 et janvier 2017, Empow’her décide d’enquêter auprès de 100 entrepreneur-e-s sociaux intervenant sur le territoire français.
Environ 30% seulement de femmes entrepreneures. Souvent dans des domaines plutôt genrés, comme les services sociaux et la santé. Ainsi, entre octobre 2016 et janvier 2017, Empow’her décide d’enquêter auprès de 100 entrepreneur-e-s sociaux intervenant sur le territoire français.
Et le résultat n’a rien de surprenant : plus de la moitié des femmes interrogées considèrent qu’il est plus difficile d’entreprendre en étant une femme.
Et si les hommes font également face à des difficultés liées au financement des structures naissantes, les porteuses de projet mettent cependant plus de temps à se rémunérer (53% des hommes disent avoir mis moins d’un an contre 38% seulement de femmes).
Mais ce qui ressort fortement du côté de la gent féminine reste la difficulté à assumer une posture entrepreneuriale. Là encore, les chiffres sont criants de vérité : 58% des femmes indiquent manquer de confiance en elles, particulièrement lors de la phase de lancement, 53% indiquent que le manque de légitimité a un impact sur leur capacité à se projeter et 72% considèrent que des attitudes stéréotypées et dévalorisantes, de la part de leurs interlocuteurs comme de leurs entourages, participent à la difficulté à être une femme entrepreneure.
« Women’Act » révèle alors l’importance de l’accompagnement de ces femmes et de leur intérêt à se regrouper dans des réseaux.
CARAVELLE : ASSUMER SON LEADERSHIP
C’est bien ce qui sera donc proposé via le programme Caravelle, lancé en ce mois d’octobre avec la première promotion, composé de 25 créatrices – soit en cours de lancement, soit en activité depuis moins de deux ans - réparties sur trois régions : l’Ile de France, l’Aquitaine et la Bretagne.
« Ce sont trois zones dans lesquelles l’ESS est bien implantée. Il y a des besoins sociaux et environnementaux importants. Nous travaillons pour ce programme avec le Mouves qui était déjà bien intégré en Ile de France et en Aquitaine. Et pour la Bretagne, nous collaborons avec Entreprendre au féminin. Mais l’idée est de s’étendre et que Caravelle devienne un programme national en 2018. », explique Joséphine Py.
Sur 6 mois, dans un premier temps pour la première session, puis sur 10 mois pour les suivantes, les participantes bénéficieront de 3 séminaires de trois jours, où elles seront réunies et coachées par des expert-e-s en leadership, ainsi que d’un mentorat, grâce à un principe de marrainage.
« On voit bien que beaucoup de femmes ont des projets. Alors oui, elles sont de plus en plus nombreuses à s’installer, ça avance, heureusement, mais doucement. Et même quand elles ont réussi, le problème de la légitimité reste récurrent. L’idée est donc de leur proposer un accompagnement collectif afin de créer des synergies entre les femmes et de constituer une communauté qui s’entraide. Mais c’est aussi de leur proposer des rencontres inspirantes avec des femmes qui ont plusieurs années d’expérience et qui pourront témoigner de leurs parcours. Les marraines seront formées également au mentorat. », développe la chargée du programme.
Au-delà de l’empowerment de ces créatrices, l’objectif est aussi de constituer une « équipe » de figures modèles. La réflexion est logique : moins on voit des exemples féminins de réussite, moins le processus d’identification s’opère.
« Avec Caravelle, on veut mettre en place des outils de sensibilisation, comme une newsletter portée par les entrepreneures sociales ou des vidéos inspirantes. »
conclut Joséphine.
DES PARCOURS DIFFÉRENTS
Parce que l’image unique du modèle de réussite fait froid dans le dos. Froide, dure, carriériste aux dents longues, souvent issue d’un milieu bourgeois, peut-être même fille de ou femme de et dans tous les cas mauvaise mère… Cette représentation va à l’encontre d’une démarche encourageante.
La multiplicité des profils et des parcours a une importance capitale. Parce que toutes les femmes ne sont pas éduquées de la même manière, ne sont pas issues des mêmes milieux sociaux, n’ont pas les mêmes origines, les mêmes âges et les mêmes vécus et expériences.
 « J’ai toujours voulu lancer mon entreprise, le monde du salariat ne me convenant pas totalement. Mais je ne viens pas d’une famille d’entrepreneurs et forcément, c’est compliqué de vouloir plus grand. Tu te heurtes aux peurs des autres finalement. », confie Nathalie Le Merour, une des trois participantes brétilliennes du programme.
« J’ai toujours voulu lancer mon entreprise, le monde du salariat ne me convenant pas totalement. Mais je ne viens pas d’une famille d’entrepreneurs et forcément, c’est compliqué de vouloir plus grand. Tu te heurtes aux peurs des autres finalement. », confie Nathalie Le Merour, une des trois participantes brétilliennes du programme.
Après des études de langues en LEA, elle part en Erasmus pour 6 mois en Angleterre et reste en fin de compte 8 ans au sein d’une entreprise de formation. Elle revient en 2012 à Rennes et intègre une start-up, en qualité de cheffe de projet en communication digitale. À 35 ans, elle quitte son emploi et se lance dans la création de sa société, Bynath.
« À la base, je voulais faire des études de stylisme, et cette envie est restée. Mais être styliste sans cause derrière, je n’en trouve pas le sens. », souligne-t-elle. Ainsi, après avoir dessiné les croquis à la main, elle a réalisé sur logiciels une collection végane et éthique de tee-shirts et sweat-shirts.
Une partie des fonds récoltés permettront de financer des associations de protection des animaux et des minorités en général. La première campagne, qui devrait débuter très prochainement, passera par un financement participatif, dont une partie de l’argent sera reversée à La Ferme des Rescapés, située à Cassagnes dans le Lot (46).
Lorsqu’elle tombe sur le questionnaire de candidature de Caravelle, Nathalie n’hésite pas. Mais se dit qu’elle ne sera pas sélectionnée. Pourtant, elle est invitée à se présenter devant le jury : « J’ai été un peu secouée pendant l’entretien. Le jury me parlait de philanthropie, ça m’a fait réfléchir. Pourtant, je sais qu’un autre modèle économique est possible, ça marche en Belgique, en Suède ou aux USA où certaines structures reversent leurs bénéfices à autrui. »
De son côté, Emmanuelle Dubois engage à elle aussi une reconversion professionnelle, en lançant à 37 ans sa structure, Débrouillarts, après avoir étudié les arts plastiques à l’université, puis aux Beaux-Arts de Rennes, et travaillé comme assistante marketing et chargée de communication auprès de la Maison de la Consommation et de l’Environnement (lire focus « La seconde vie des déchets » - YEGG#60 – Juillet/Août 2017). « Aujourd’hui, je fais une activité qui me plait donc ce n’est pas très compliqué pour moi de m’y sentir à l’aise, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. », explique-t-elle.
ÊTRE PLUS À L’AISE
Ce qui l’intéresse principalement dans le programme, ce sont les rencontres et échanges avec les autres professionnelles. Le partage d’expériences, ça lui parle, même sur les sujets qui ne sont pas problématiques pour elle :
« Par exemple, c’est intéressant d’entendre les conseils sur la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Je ne veux pas dénigrer les hommes, loin de là, mais beaucoup de femmes doivent gérer les deux. Moi, j’ai la chance d’être dans un couple assez paritaire sur la répartition des tâches ménagères, sur l’éducation des enfants, qui en plus commencent à être grands, donc sont autonomes. Mais je trouve ça quand même important de voir comment ça se passe pour les autres et de pouvoir échanger des astuces pour gérer les choses sans se prendre la tête. »
 Sans se fixer d’objectifs précis au sein de Caravelle, Emmanuelle tend quand même à obtenir quelques clés vis-à-vis de la posture. La confiance en elle ne lui fait pas défaut mais elle constate encore quelques blocages.
Sans se fixer d’objectifs précis au sein de Caravelle, Emmanuelle tend quand même à obtenir quelques clés vis-à-vis de la posture. La confiance en elle ne lui fait pas défaut mais elle constate encore quelques blocages.
Face à celles et ceux qui ont un statut « plus élevé ». Les élu-e-s, par exemple. Même si elle n’a pas eu encore d’occasion de travailler avec elles/eux, elle a noté sa timidité à entrer en contact, simplement pour se présenter, se faire connaître.
« Lors de l’inauguration de La Belle Déchette, certains étaient présents. Mais je n’ose pas aller vers eux. Je débute dans l’entrepreneuriat et donc je n’ai pas assez d’expérience pour être suffisamment à l’aise. », précise-t-elle. Pourtant, lorsqu’elle travaillait dans le marketing, elle devait régulièrement faire des présentations devant un parterre de commerciaux. Elle se souvient d’un exercice stressant mais motivant :
« Les dirigeants étaient surpris parce que je n’étais pas obligée. Il faut reconnaître que les femmes sont moins écoutées et qu’elles sont plus souvent cantonnées au rôle d’assistantes que envisagées comme forces de proposition. Ça m’a donné envie de leur montrer que non, on n’est pas que des assistantes. »
Ce qu’elle attend, en quelques mots, c’est d’apprendre à montrer que l’on est sûre de soi. Parler clairement sans bégayer, ne pas chercher ses mots et avoir un discours clair. En gros, ne pas se laisser envahir, et ne pas laisser transparaitre, le stress et les sources de ce stress.
« C’est vrai que les hommes ont tendance à en imposer davantage. Je ne sais pas à quoi c’est dû… Une prestance naturelle, une voix qui impose. En tout cas, ils ont peut-être moins de freins. Là où nous, on a tendance à réfléchir 15 fois trop avant de se lancer. Les femmes, quand elles présentent leurs projets, on sent qu’elles dévoilent quelque chose d’important pour elles. Personnellement, dans ma carrière, je n’ai pas souffert de sexisme mais quand on voit qu’à Rennes, il y a beaucoup d’initiatives pour les femmes entrepreneures, on se dit que c’est parce qu’il existe réellement une inégalité quelque part. », ajoute Nathalie Le Merour, enthousiaste à l’idée de pouvoir se nourrir des conseils des unes et des autres.
TORDRE LE COU AUX CLICHÉS
Anne-Carole Tanguy, avocate d’affaires à Rennes, membre d’Entreprendre au féminin et dès à présent marraine dans le programme d’Empowher, le confirme : les inégalités entre les femmes et les hommes subsistent, même si une lente progression positive est à noter. Pour elle, Caravelle est symptomatique de l’évolution de la société.
« Aux commandes là haut, ils sont paumés et ils freinent des quatre fers alors que la génération suivante arrive. Les deux doivent être ensemble. Personnellement, je suis ravie d’avoir l’occasion de pouvoir rencontrer des jeunes femmes avec des profils différents, enrichissants, qui sont l’avenir et qui m’ouvrent sur le monde d’aujourd’hui et de demain, celui dans lequel ma fille grandit. », déclare-t-elle.
Et dans ce monde, c’est la diversité et la complémentarité qui doivent être brandies en priorité. Sur le papier, ça fonctionne mais dans la réalité, les mentalités n’avancent pas à vive allure, se butant aux éternels préjugés sexistes. Pour l’avocate, pas de secret :
« La posture ne se travaille pas consciemment, elle vient avec l’expérience. On remarque justement qu’au fil de l’expérience, on nous prend moins pour des petites secrétaires. Pour moi, la question est de se sentir vraiment légitime, c’est là dessus qu’il faut travailler. »
Si les clichés constituent des freins au lancement du projet, Isabelle Gueguen, marraine également dans le programme, identifie aussi les difficultés liées à des tabous qu’il est urgent de briser. Les femmes sont discriminées dans le monde du travail et l’image, aussi inconsciente soit-elle, de celles qui réussissent sont souvent connotées de manière négative.
« Il y a encore des témoignages choquants ! Je discutais avec une femme de 35 ans l’autre jour, cadre supérieur, avec un enfant. En entretien, on lui a demandé si elle comptait avoir un deuxième enfant. On est en 2017 ! Dans mon parcours, lorsque je me suis installée, cela a entrainé mon modification de mon environnement, qui a réagi à mon nouveau statut. Et ça s’est soldé par une séparation alors qu’il était lui aussi entrepreneur. Mais il aurait voulu me voir avec un statut plus pépère. », confie la cofondatrice de Perfegal.
Si, heureusement, tous les hommes ne réagissent pas de cette manière, il est certain que la question de l’équilibre, que l’on voudrait nous vendre comme naturel, se pose, parce qu’il touche à l’émancipation des femmes : « C’est un sujet qui ébranle la société parce qu’on parle là du partage du pouvoir ! Mais ce qui est bien, c’est que le sujet est investi par la politique, même si le monde politique reste encore bien machiste. Mais au moins, on en parle. »
En attendant l’évolution de la société en matière d’égalité femmes-hommes, Isabelle Gueguen préconise la libération de la parole et l’accompagnement de celles qui font le choix d’entreprendre. « Souvent, les personnes qui se lancent n’osent pas parler de leur projet parce qu’on répand l’idée qu’on pourrait se faire piquer ce projet. Mais je pense qu’au contraire, il ne faut pas avoir peur d’être dans le relationnel, de discuter de ses idées et de créer des réseaux. Il y a suffisamment de maillage sur le territoire et nous avons la chance en Bretagne d’avoir un réseau qui accompagne l’émergence des projets avec Entreprendre au féminin. Il faut savoir s’en saisir, se faire accompagner, ne pas avoir peur de gagner de l’argent, oser et assumer. », s’exclame-t-elle, en conclusion.
L’émancipation des femmes passe donc par la capacité à croire en elles, la notion d’empowerment est capitale et ne peut se faire qu’à travers une juste représentation des profils et des parcours. Montrer qu’ils sont pluriels, variés, teintés d’échecs peut-être avant de parvenir à des réussites et qu’il n’y a pas une voie unique.
Que chacune est libre de composer en fonction de ses codes, convictions, envies et besoins aussi bien sa vie personnelle que sa vie professionnelle. Comme elle l’entend, quand elle l’entend. Libre de faire ses choix. D’entreprendre ou pas.



 Ce soir-là, le look pin-up rock est troqué contre des parures plus chimériques, démoniaques et trash. Mais la sensualité et l’humour sont toujours de mise : « Celle qui arrive est une femme, enfin presque une femme, une chimère mignonne, gentille, pas dans les normes de la société. Vous imaginez bien que c’est difficile pour elle de trouver son crush sur Tinder. Elle cherche son mate, elle a un petit kiff pour les barbus. »
Ce soir-là, le look pin-up rock est troqué contre des parures plus chimériques, démoniaques et trash. Mais la sensualité et l’humour sont toujours de mise : « Celle qui arrive est une femme, enfin presque une femme, une chimère mignonne, gentille, pas dans les normes de la société. Vous imaginez bien que c’est difficile pour elle de trouver son crush sur Tinder. Elle cherche son mate, elle a un petit kiff pour les barbus. » Son apparence flippante détonne avec la dextérité et de l’agilité dont elle fait preuve dans un numéro axé sur la souplesse et les acrobaties, effectuées à l’aide d’un (puis de deux) hula hoop, sur un fond sonore électrico-angoissant qui nous rappelle quelques DJ set de la Greenroom des Transmusicales. C’est finalement l’effrayante gymnaste qui prendra ses jambes à son coup, s’enfuyant dans un cri strident dans les coulisses.
Son apparence flippante détonne avec la dextérité et de l’agilité dont elle fait preuve dans un numéro axé sur la souplesse et les acrobaties, effectuées à l’aide d’un (puis de deux) hula hoop, sur un fond sonore électrico-angoissant qui nous rappelle quelques DJ set de la Greenroom des Transmusicales. C’est finalement l’effrayante gymnaste qui prendra ses jambes à son coup, s’enfuyant dans un cri strident dans les coulisses.
 Ainsi, on connaît l’appétence d’Etienne Grandjean pour le new burlesque – rappelons qu’en 2015 il était le directeur artistique des soirées burlesque Les lapins voient rose, organisées au 1988 Live Club de Rennes – et on le rejoint dans ce domaine, sans chichis. La discipline mélange les propositions et rend les frontières des cases hétéro-normées de la société poreuses.
Ainsi, on connaît l’appétence d’Etienne Grandjean pour le new burlesque – rappelons qu’en 2015 il était le directeur artistique des soirées burlesque Les lapins voient rose, organisées au 1988 Live Club de Rennes – et on le rejoint dans ce domaine, sans chichis. La discipline mélange les propositions et rend les frontières des cases hétéro-normées de la société poreuses.

 Elle qui a longtemps cherché à ne pas se faire remarquer des hommes en tant que femme comprend vite que les barrières auxquelles elle se confronte sont celles d’une société patriarcale, régie par la « misogynie bienveillante, ordinaire, presque inconsciente ». Guidée par ses convictions professionnelles et son envie de faire bouger les lignes, elle va livrer un bras de fer fort et poignant.
Elle qui a longtemps cherché à ne pas se faire remarquer des hommes en tant que femme comprend vite que les barrières auxquelles elle se confronte sont celles d’une société patriarcale, régie par la « misogynie bienveillante, ordinaire, presque inconsciente ». Guidée par ses convictions professionnelles et son envie de faire bouger les lignes, elle va livrer un bras de fer fort et poignant.


 Le 28 juin dernier, au Jardin moderne, elle racontait la naissance du mouvement Riot Grrrls. Un récit qu’elle publie en avril 2016 dans son ouvrage Riot Grrrls, chronique d’une révolution punk-féministe. Newsletters, fanzines féministes, concerts, esprit DIY, la création est en pleine ébullition. Et prend d’autant plus d’ampleur quand la scène olympienne rencontre la scène washingtonienne, « plus politique, plus organisée ».
Le 28 juin dernier, au Jardin moderne, elle racontait la naissance du mouvement Riot Grrrls. Un récit qu’elle publie en avril 2016 dans son ouvrage Riot Grrrls, chronique d’une révolution punk-féministe. Newsletters, fanzines féministes, concerts, esprit DIY, la création est en pleine ébullition. Et prend d’autant plus d’ampleur quand la scène olympienne rencontre la scène washingtonienne, « plus politique, plus organisée ».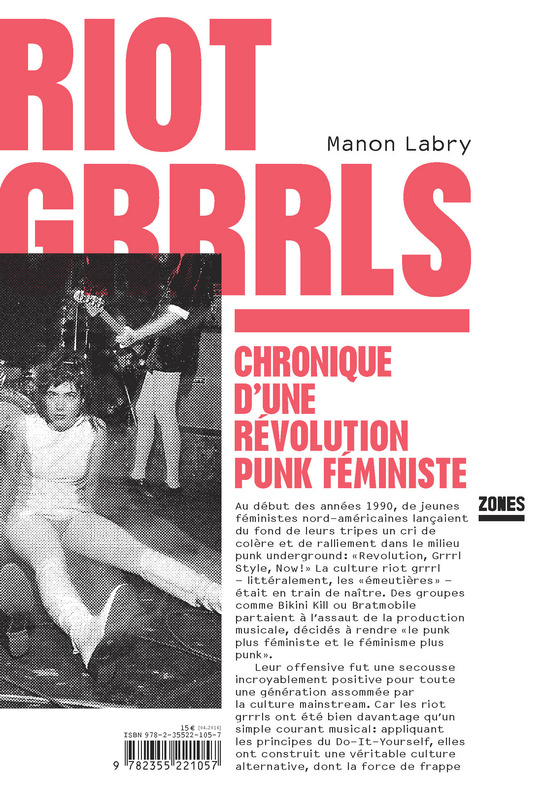 « À cette époque, on déchante un peu du punk qui se veut horizontal mais les scènes masculines sont majoritaires et les comportements machos sont pléthores. « Girls to the front » (réclamer que les femmes accèdent aux devants des scènes et faire reculer les hommes) est alors une stratégie, que Bikini Kill explique lors des concerts mais aussi sur des tracts, pour que l’espace ne soit pas dominé par des hommes. »
« À cette époque, on déchante un peu du punk qui se veut horizontal mais les scènes masculines sont majoritaires et les comportements machos sont pléthores. « Girls to the front » (réclamer que les femmes accèdent aux devants des scènes et faire reculer les hommes) est alors une stratégie, que Bikini Kill explique lors des concerts mais aussi sur des tracts, pour que l’espace ne soit pas dominé par des hommes. »
 Le déclic du scénario lui vient en lisant un article, au cours de l’été 2016, sur les Ovarian Psycos, une brigade féministe sillonnant à vélo les rues de l’Eastside Los Angeles pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une phrase de Simone de Beauvoir résonne dans son esprit :
Le déclic du scénario lui vient en lisant un article, au cours de l’été 2016, sur les Ovarian Psycos, une brigade féministe sillonnant à vélo les rues de l’Eastside Los Angeles pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une phrase de Simone de Beauvoir résonne dans son esprit :

 Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population.
Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population. « Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans.
« Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans. « Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans.
« Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans.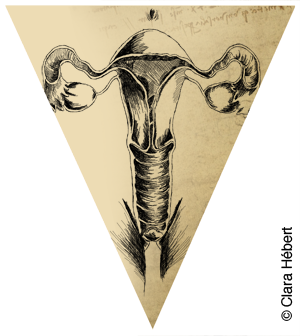 Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».
Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».
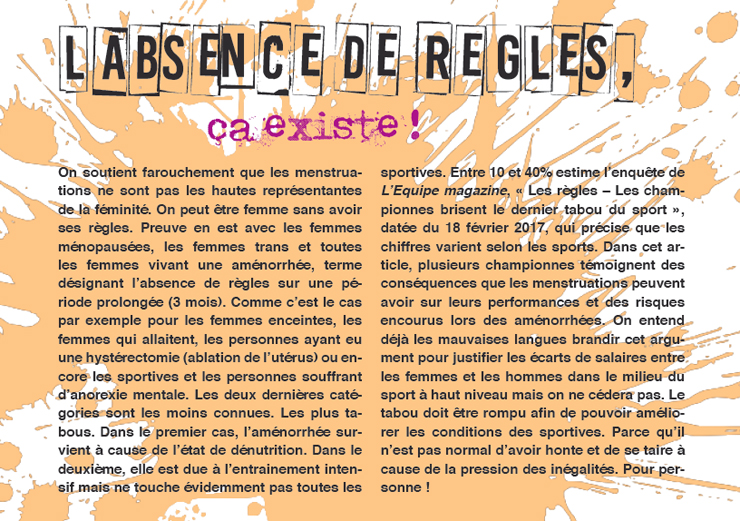
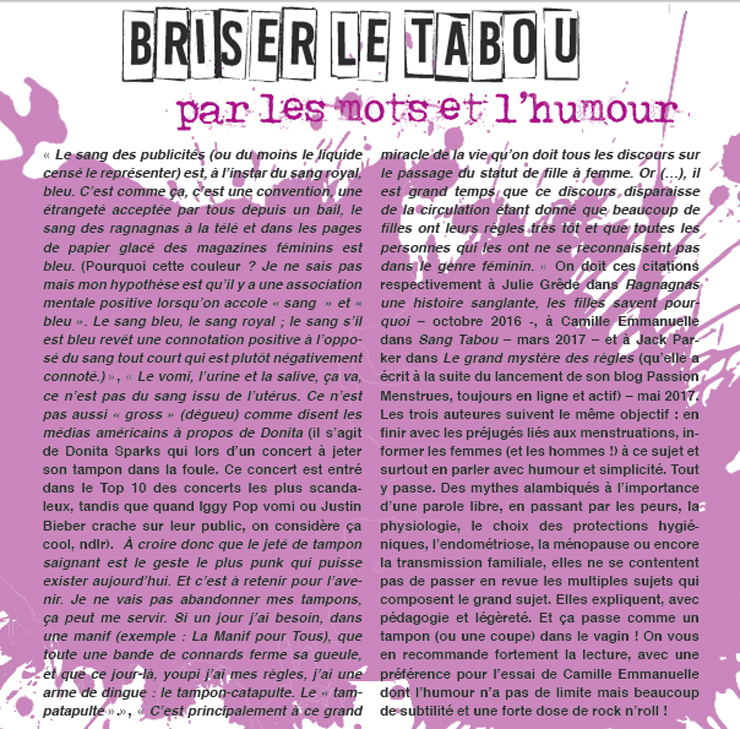


 « La vache ! Elles envoient les filles ! », « C’est incroyable ce qu’elles sont capables de faire ! », « Je suis bluffée par les nanas »… Dimanche 19 mars, les huit artistes de la compagnie Baro D’Evel viennent d’éblouir le public à l’occasion de la première des neuf représentations qu’ils donneront de Bestias lors du Temps fort Arts du cirque, organisé par ay-rOop.
« La vache ! Elles envoient les filles ! », « C’est incroyable ce qu’elles sont capables de faire ! », « Je suis bluffée par les nanas »… Dimanche 19 mars, les huit artistes de la compagnie Baro D’Evel viennent d’éblouir le public à l’occasion de la première des neuf représentations qu’ils donneront de Bestias lors du Temps fort Arts du cirque, organisé par ay-rOop. « Le mât est une discipline au départ réservée aux hommes. Quand je suis arrivée à Lille, le maitre chinois commençait à l’enseigner aux filles. Il n’y a pas de raison qu’elles ne puissent pas en faire. C’est physique mais c’est intéressant justement de l’appréhender d’une nouvelle manière, de voir comment on peut travailler dessus en adaptant à son corps. Pas simplement au corps d’une femme, mais comment l’adapter à tous les corps, selon son propre corps. »
« Le mât est une discipline au départ réservée aux hommes. Quand je suis arrivée à Lille, le maitre chinois commençait à l’enseigner aux filles. Il n’y a pas de raison qu’elles ne puissent pas en faire. C’est physique mais c’est intéressant justement de l’appréhender d’une nouvelle manière, de voir comment on peut travailler dessus en adaptant à son corps. Pas simplement au corps d’une femme, mais comment l’adapter à tous les corps, selon son propre corps. » « On a tou-te-s notre caravane, on est amené-e-s à être dehors pour aller à la douche par exemple. On croise tout le temps du monde. Il y a une énergie particulière, on vient tou-te-s d’horizons différents, mais il y a un grand respect de la vie de chacun-e, on a la possibilité d’être très indépendant-e-s et de faire des choses ensemble quand on en ressent l’envie. C’est une grande liberté. », s’enthousiasme Claire Lamothe, approuvée par sa co-équipière :
« On a tou-te-s notre caravane, on est amené-e-s à être dehors pour aller à la douche par exemple. On croise tout le temps du monde. Il y a une énergie particulière, on vient tou-te-s d’horizons différents, mais il y a un grand respect de la vie de chacun-e, on a la possibilité d’être très indépendant-e-s et de faire des choses ensemble quand on en ressent l’envie. C’est une grande liberté. », s’enthousiasme Claire Lamothe, approuvée par sa co-équipière : « C’est tellement vaste comme domaine ! À chaque fois que je travaille avec des compagnies ou sur des projets, on trouve un fil rouge qui te force à aller chercher de nouvelles choses pas évidentes. Dans All the fun, on tourne tout le temps la tête. Dans une autre proposition, l’idée était que la balle traverse à chaque fois un anneau. », se passionne-t-elle.
« C’est tellement vaste comme domaine ! À chaque fois que je travaille avec des compagnies ou sur des projets, on trouve un fil rouge qui te force à aller chercher de nouvelles choses pas évidentes. Dans All the fun, on tourne tout le temps la tête. Dans une autre proposition, l’idée était que la balle traverse à chaque fois un anneau. », se passionne-t-elle. Toujours être ramenée à la question de la féminité et du genre parce qu’elle s’amuse des hypercodes, parce qu’elle est femme, et surtout parce qu’elle est femme dans la catégorie « monstrueuse ». Monstrueuse dans le sens entendu par Anne Quentin dans son article « Les femmes dans le cirque contemporain », publié sur le site Territoires de cirque en mai 2010.
Toujours être ramenée à la question de la féminité et du genre parce qu’elle s’amuse des hypercodes, parce qu’elle est femme, et surtout parce qu’elle est femme dans la catégorie « monstrueuse ». Monstrueuse dans le sens entendu par Anne Quentin dans son article « Les femmes dans le cirque contemporain », publié sur le site Territoires de cirque en mai 2010. « Je voulais être acrobate, je voulais être circassienne. Et là-bas, on me disait que j’avais un truc clownesque à explorer. Mais je ne voulais pas assumer ça. J’ai été prise pour un cursus de 4 ans en Hollande, j’y suis allée mais cette histoire de clown ne résonnait dans la tête. Au bout d’un an de technique, je me suis remise en question. », se remémore-t-elle.
« Je voulais être acrobate, je voulais être circassienne. Et là-bas, on me disait que j’avais un truc clownesque à explorer. Mais je ne voulais pas assumer ça. J’ai été prise pour un cursus de 4 ans en Hollande, j’y suis allée mais cette histoire de clown ne résonnait dans la tête. Au bout d’un an de technique, je me suis remise en question. », se remémore-t-elle.


 Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique.
Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique. Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale.
Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale. Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.
Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.
