Célian Ramis
Visibiliser les silencié-e-s


Réduire la moitié de l’humanité au silence porte à conséquence. Effacer une partie de la société à travers les siècles porte à conséquence. Celle de croire en la légitimité de son invisibilité. Celle de penser que les personnes concernées n’ont ni histoires passées, ni récits à relater. Alors, elles prennent la parole, tendent le micro, montent sur scène, écrivent, transmettent et partagent. Pour rendre les femmes visibles et briser le schéma oppressif imposé par leur absence.
« Ce qu’il y a de plus redoutable dans l’invisibilisation des femmes, c’est qu’elle est invisible. », écrit la journaliste Lauren Bastide dans Présentes. Quelques pages et de nombreux chiffres plus loin, elle récapitule : « Les femmes sont invisibilisées partout où l’on produit de la connaissance, partout où l’on contribue à modeler l’inconscient collectif de la société. Et il ne peut pas y avoir de société juste si les représentations collectives se construisent en oubliant la moitié de l’humanité. » Ainsi, fin 2016, elle crée le célèbre podcast La Poudre pour faire entendre les voix, les discours, les réflexions, les engagements, les expertises, les revendications, les vécus, les analyses et les parcours des femmes.
« Je les ai interviewées, détail important, sans les interrompre, ni leur expliquer la vie, ce qui est reposant dans un espace médiatique où tout être féminin doit composer, en permanence, avec les aléas du manterrupting (dû à ces hommes qui interrompent systématiquement les femmes) et du mansplaining (dû à ces hommes qui expliquent la vie aux femmes). Ces femmes à qui j’ai donné la parole, je les ai choisies extraordinaires, guerrières, créatrices, inspirées. Je voulais graver dans le marbre leurs accomplissements actuels pour que personne ne puisse les effacer ensuite. »
MANQUE DE (RE)CONNAISSANCE
La question de la visibilité des femmes, à l’instar de la visibilité de toutes les personnes oppressées et marginalisées, constitue un enjeu majeur dans la lutte pour l’égalité entre les genres. L’Histoire est écrite par des hommes blancs hétéros cisgenres bourgeois valides, pour des hommes blancs hétéros cisgenres bourgeois valides. Elle exclut plus de la moitié de la population, la réduisant au silence, aux rôles secondaires, voire à la figuration. Les récits, qu’ils soient littéraires, cinématographiques ou encore médiatiques, sont articulés autour des hommes qui sont également experts sur les plateaux télévisés, dirigeants des grandes et moyennes entreprises, élus dans les lieux de décisions et de pouvoir…
L’incidence entre l’apprentissage d’une Histoire à laquelle les femmes ne participent pas ou peu, le manque de représentations féminines dans les instances politiques, la presse, les arts et la culture ou encore le sport et l’absence de parité dans les événements publics, les comités de direction, les scènes conventionnées, les médias ou encore dans l’hémicycle, n’est ni anecdotique ni pure coïncidence. Loin de là.
« Les femmes ne sont pas suffisamment visibles et ne se sentent pas suffisamment légitimes. Elles manquent parfois de rôles modèles. »
souligne Fanny Dufour, fondatrice des Nouvelles Oratrices, entreprise de formations dédiées à la prise de parole des femmes.
Et elles manquent souvent de reconnaissance. Si de nombreux films ne passent pas le test de Bechdel-Wallace (qui requiert d’avoir au moins 2 personnages féminins, nommés de la même manière que les personnages masculins, qui parlent entre elles d’un sujet autre que des hommes…), les articles de journaux sont des champions de cette invisibilisation. La spécialité : mentionner « Une femme », dans les titres, sans la nommer. L’outil de veille Meltwater révèle ainsi qu’en un mois – juin 2020 - 39 titres d’articles y ont eu recours. On lit par exemple que « Une femme (est) nommée à la Direction des missions d’exploration et d’opérations humaines à la Nasa », qu’il y a désormais « Une femme à la tête de l’École de l’air » et que « Pour la première fois de l’Histoire, le PDG le mieux payé du monde est une femme ».
Kathryn Lueders, Dominique Arbiol et Lisa Su ne sont pas des cas isolés du processus de minimisation et d’effacement. Une page Wikipédia parodique a été créée en l’honneur d’Une femme, décrite comme « journaliste, dirigeante d’entreprise, chimiste, diplomate, économiste, évêque, rabbin, imam, physicienne, sportive de haut niveau, directrice sportive, pilote de chasse, brasseuse, ouvrière, autrice de bande dessinée, footballeuse, handballeuse, cheffe d’orchestre, DJ, directrice de musée, astronaute et femme politique possédant au moins une vingtaine de nationalités. »
OÙ SONT LES FEMMES ?
Les hommes laissent leurs empreintes. Dans les exploits de guerre, la gouvernance des pays, la musique, la peinture, la littérature, les découvertes scientifiques, le cinéma. En couverture des médias, ils sont le monde d’après le Covid 19 (tout comme ils étaient le monde d’avant le Covid 19) et ils sont l’espoir de la Reconquête du cinéma français (tout comme ils étaient l’espoir de la Conquête du cinéma français). Ils représentent et symbolisent toute notre culture et nos références collectives. Ils sont le liant de toutes les civilisations passées et sociétés actuelles.
« Où sont les femmes ? », interroge la comédienne Catherine Bossard, en projetant les photos de classe post conseil des ministres, post G20, post comité de direction d’une entreprise du CAC40… Réponse : « Derrière, sur les côtés ou absentes ! » Dans la Halle de la Brasserie, sur le mail Louise Bourgeois à Rennes, elle donne le ton à la première édition de Visibles, l’événement organisé en 2022 par Les Nouvelles Oratrices qui en avril 2023 a renouvelé l’expérience et reviendra en avril 2024, à l’Antipode. Ici, elles ont des prénoms, des noms, des visages, des corps, des émotions, des choses à dire, à raconter, à partager. Ici, elles montent sur scène et prennent la parole.
 Pour parler d’elles, pour parler d’autres femmes. Pour créer la rencontre, provoquer les discussions et les échanges, favoriser la prise de conscience. « Avoir un plateau composé exclusivement de femmes, c’est possible. La non mixité, ça interroge les gens alors que quand il s’agit de plateaux composés uniquement d’hommes, on ne se pose pas la question… À un moment, il faut faire des efforts pour tendre vers une parité systématique dans les événements et ça passe par des événements comme Visibles. », analyse Fanny Dufour, faisant référence, entre autres, aux conférences TedX, qu’elle a présidé à Rennes pendant plusieurs années. Prendre la licence TedX Women, elle y a pensé.
Pour parler d’elles, pour parler d’autres femmes. Pour créer la rencontre, provoquer les discussions et les échanges, favoriser la prise de conscience. « Avoir un plateau composé exclusivement de femmes, c’est possible. La non mixité, ça interroge les gens alors que quand il s’agit de plateaux composés uniquement d’hommes, on ne se pose pas la question… À un moment, il faut faire des efforts pour tendre vers une parité systématique dans les événements et ça passe par des événements comme Visibles. », analyse Fanny Dufour, faisant référence, entre autres, aux conférences TedX, qu’elle a présidé à Rennes pendant plusieurs années. Prendre la licence TedX Women, elle y a pensé.
« C’est une marque puissante mais enfermante. Je voulais qu’on puisse bouger les formats. Qu’il y ait des prises de paroles en solo, des interviews, des duos, etc. Parce que l’idée, c’est qu’elles se sentent à l’aise sur scène, c’est ça qui servira au mieux leurs propos. On veut faire notre événement. Avec des femmes invisibilisées dans la société et des femmes qui œuvrent pour visibiliser les femmes. », souligne la directrice des Nouvelles Oratrices. Elle part de ses intérêts personnels et élargit ensuite le champ d’action :
« Pour montrer que les femmes sont partout. Ça concerne le monde de l’entreprise mais aussi de l’éducation, la politique, les médias, les réseaux sociaux, etc. Ce que j’espère, c’est que les gens repartent en ayant saisi ce qui a déclenché chez les unes et les autres l’envie de se rendre visible. Ou de rendre d’autres femmes visibles. C’est cette émulation-là que je veux. Et que l’on prenne conscience de la diversité des déclencheurs. Qu’est-ce qui fait franchir le pas à un moment donné ? Comment se sentir une femme forte et oser se lancer ? »
ÉNERGIE ET DÉTERMINATION
Dix femmes montent sur scène pour se raconter. La première, c’est Clothilde Penet, 34 ans, elle vit à Marseille et, depuis 2 ans, elle fait du krump, une danse qu’elle a choisie et pour laquelle elle a passé des mois et des mois à observer les danseurs. Elle relate son parcours, son obstination, sa persévérance. Le rituel de la cage, le regard des danseurs, la colère qui monte, le lâcher prise, la transcendance. Elle ressent l’énergie. Elle ne baissera jamais les bras. Elle intègre sa famille de krump. Les questions qu’elle pose résonnent en chacun-e :
« Comment tu es toi-même dans une discipline qui a déjà plein de codes ? Comment tu deviens visible alors que tu as peur jusqu’au bout des doigts ? »
Elle tape du pied, plie les genoux, fixe un point d’horizon, elle recommence, elle tape du pied, de l’autre pied, elle envoie un uppercut, elle percute nos viscères de sa volonté et détermination, elle répète les pas de bases. Sans cesse. Elle ajoute des mouvements de bras, elle active son corps avec maitrise. Elle teste, expérimente. Elle n’abandonne jamais. « Dans le krump, je peux être moche, monstrueuse, faire des grimaces. Ça change des endroits où il fallait être sage et fermer sa gueule. J’ai peur de ne pas être à la hauteur, j’ai peur de vos regards sur moi. J’ai peur de ma vulnérabilité comme de ma puissance, j’ai peur d’être essoufflée quand j’ai des choses à dire. » Silence.
Elle nous coupe le souffle, elle nous bouleverse. Son vécu, on le transpose. Son vécu, il résonne. Il diffère de celui d’Aicha et pourtant, il le croise. Algérienne âgée de 55 ans, elle se dit traversée par 3 choix essentiels dans sa vie : être autonome financièrement, divorcer, quitter son pays pour s’installer en France. Son bac S en poche, elle se marie à 18 ans pour satisfaire ses parents. Son époux refuse sa poursuite d’études, elle devient mère l’année suivante. Elle apprend la couture et en cachette, gagne de l’argent grâce à ça. Deux accouchements plus tard, elle ouvre son atelier et embauche des ouvrières. Elle divorce. Tant pis si c’est mal vu !
En 2017, elle rencontre son mari et l’année d’après, quitte l’Algérie. Aicha s’installe à son compte en 2020, juste avant le confinement. « J’ai un handicap, je marche avec une canne. En mars 2022, j’ai dû trouver un travail après une formation. J’ai choisi d’accompagner les personnes en situation de handicap dans la recherche d’un emploi. Ce qui m’a aidée, c’est mon ambition et le soutien de mes proches. Sans oublier les stages pratiques que j’ai fait en insertion. » Elle le dit, elle n’avait pas confiance en elle au départ mais avec le temps, la motivation et la formation, elle a développé et acquis les compétences nécessaires. « Je me suis reconvertie. Je me suis ouverte et intéressée aux autres. On a toutes des capacités à quitter, recommencer à zéro et choisir sa vie. »
RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE
Sur la scène, les intervenantes brisent le silence et les tabous. Brisent l’absence de pluralité des modèles et des trajectoires. C’est ainsi qu’Hélène Pouille, facilitatrice graphique depuis 9 ans, et Anne-Cécile Estève, photographe depuis 15 ans, partagent l’espace. La première a lancé un blog féministe. La seconde, une association nommée Diapositive, autour de la photographie thérapeutique. Elle réalise à travers l’exposition Mue – pour laquelle elle a photographié les corps de femmes atteintes du cancer du sein – que cela participe à leur réparation et contribue à changer leur regard sur leur propre corps.
Hélène Pouille aussi s’intéresse à une maladie qui touche principalement les femmes : le cancer du col de l’utérus. Son projet s’intitule Frottis chéri à la suite du diagnostic posé, en sortant d’un banal rendez-vous gynéco, du papillomavirus. « C’est un nom limite mignon. », rigole-t-elle. De l’humour et du dessin mais surtout beaucoup d’informations composent le fascicule illustré qu’elle a créé : « Parce que ce n’est pas naturel encore aujourd’hui de parler de ça et de rendre visible le fait qu’on a une IST… Et d’ailleurs, le prochain sujet que je veux traiter de cette manière-là, c’est la vie sexuelle et affective des personnes âgées. » Chacune trouve sa place au croisement de ses qualités professionnelles et de ses engagements. Et ça fait du bien. Beaucoup de bien.
« La légitimité, ça a été le problème de toute ma vie. J’ai mis beaucoup de temps à me sentir légitime. Déjà j’ai mis 20 ans à me sentir photographe. Je m’approprie enfin le terme d’artiste. Je suis tellement à ma place aujourd’hui ! », scande, soulagée, Anne-Cécile Estève. Fière et puissante.

ALTÉRITÉ ET RENCONTRE
Sans se connaître, des ponts se construisent. Quitterie et Myriam, elles, se côtoient depuis plusieurs années déjà et partagent ici leur rencontre. Celle de deux femmes qui n’ont a priori rien en commun. Myriam est de nationalité indéterminée, très probablement palestinienne. Elle vit dans un orphelinat jusqu’à ses 3 ans environ et a « la chance d’être adoptée par ses parents de cœur ». Quitterie est née en France « avec une cuillère en argent dans la bouche » et est adoptée elle aussi par des familles de cœur, au pluriel, car au total, elle compte 6 parents autour d’elle. Myriam subit le racisme à l’école puis les violences conjugales. Elle est une « femme violée et battue » mais surtout « pas abattue ». Quitterie n’a pas vécu ou subi les mêmes violences.
Être femmes les réunit. Chacune poursuit le récit de ce qui l’a amenée en résistance. « Je suis devenue une guerrière grâce aux paroles de Jacques Prévert et aux récits de ma mère. », signale Myriam. « Aimer une femme m’a sorti de la tyrannie de la norme. », poursuit Quitterie. Résist-tente est le nom de la pièce que joue Myriam, dans laquelle elle raconte sa vie dans la rue. Quitterie assiste à la représentation : « En la rencontrant, les préjugés que j’avais sont tombés. Les SDF sont soudain devenu-e-s visibles à mon regard. » Elles sont toutes les deux engagées dans l’action pour la dignité et le respect de tous les êtres humains. Elles sont toutes les deux engagées dans la lutte contre le patriarcat.
« Notre rencontre nous a transformées. L’altérité et la rencontre enrichissent la vie. », concluent-elles, avant que Sookie ne vienne secouer les corps légèrement ensuqués au contact des chaises. L’idée qu’elle met en pratique dans ses stages : danser comme dans les clips. Celui de Britney Spears, en l’occurrence. De quoi se sentir reine du dancefloor et des fantasmes.
Autant que Judith Duportail qui rêve d’une vie de glamour et de cocktails et qui télécharge Tinder, réfléchissant à sa phrase de présentation : « 5 étoiles sur Blablacar ». Elle annonce la couleur : « Je ne m’étais jamais sentie aussi désirable. Ça n’a pas duré. » Elle est journaliste et va mener une enquête très approfondie sur l’algorithme de l’application : « Nous avons tous une note secrète de désirabilité sur Tinder. J’ai décidé de partir en quête de ma note. » Elle accède ainsi à toutes les informations collectées à son sujet par le site de rencontre : 804 pages précisément. Ses données personnelles, toutes les conversations, les matchs, la manière de s’exprimer, les sujets évoqués… Tout contribue à ce que Tinder catégorise les participant-e-s, bien évidemment, en fonction du sexe et du genre.
« La communication de Tinder se base sur une prétendue libération des femmes alors que leurs algorithmes créent des couples où l’homme est toujours supérieur à la femme soit en matière d’âge, soit en matière de catégorie socio-professionnelle et donc supérieur financièrement… Exactement pareil que dans la société hétérosexuelle… », lâche Judith Duportail, hypnotisante de vitalité.
FAVORISER L’EXPRESSION DES FILLES ET DES FEMMES
Elle aussi citoyenne engagée, Marie Blandin plante le décor de son plaidoyer : « Imaginons un diner chez des amis, l’ambiance est excellente. Vous avez envie de partager une expérience personnelle… sur un cambriolage dont vous avez été victime. Tout le monde vous comprend. Imaginons le même diner mais vous avez envie de partager une expérience personnelle… sur un inceste dont vous avez été victime. Cela crée un malaise. » En tant qu’avocate, quand elle parle à son entourage d’une affaire de divorce, on raffole des détails. Mais quand il s’agit d’une affaire de violences à l’encontre d’une femme ou d’un enfant, on lui dit qu’elle plombe l’ambiance.
« En 2022, il y a encore des choses qu’on peut dire ou pas. »
constate Marie Blandin, avocate.
Pourtant, deux élèves par classe, en moyenne, sont victimes de violences. Le plus souvent, dans le cadre familial. « Difficile d’en parler, le fléau perdure ! », scande-t-elle, avant d’impulser son discours vers le collectif. Tout le monde peut agir en apprenant à un enfant que la politesse consiste à dire bonjour et non obligatoirement à faire un bisou ou un câlin, en apprenant à un enfant les mots exacts qui désignent les différentes parties de son corps et en apprenant à un enfant que son corps lui appartient, à lui et à lui seul.
Quasiment deux heures se sont écoulées et c’est à la marraine de Visibles de conclure. Najat Vallaud-Belkacem, ex ministre des Droits des femmes, de l’Education Nationale et actuelle directrice de l’ONG One, fait un tour d’horizon qui n’est pas sans rappeler celui de Catherine Bossard. Dans les conseils de défense, des hommes ! Sur les couvertures de magazines, des hommes ! Sur les plateaux télévisés et débats entre experts, des hommes ! Dans les métiers essentiels, des femmes ! Elle parle d’un « choc » de ne jamais leur donner la parole et dénonce « l’invisibilisation et l’absence des femmes dans les lieux de décisions. » Il n’y a pourtant « rien de mieux que de les mettre autour de la table pour les prendre en considération. » Néanmoins, elle pointe les conséquences sous-jacentes à la visibilité des femmes :
« Même quand les femmes prennent la parole et se rendent visibles, elles se prennent la violence des réseaux sociaux. Souvent, elles se retirent de la scène, de la visibilité et de l’oralité qu’elles avaient en étant sur la scène. Et ça, c’est particulièrement dangereux car les droits à l’expression des femmes reculent ! »
LA PUISSANCE DES PODCASTS
Faire entendre les voix des concernées devient un enjeu majeur dans l’égalité des sexes et des genres. Une urgence. Depuis plusieurs années, les podcasts se multiplient. Facilité d’accès, simplicité technique, gratuité de l’écoute… Les ingrédients sont réunis pour tendre le micro et diffuser massivement, à travers les réseaux sociaux, les témoignages des personnes sexisées et plus largement des personnes oppressées et minorées. Des outils dont se saisissent Aminata Bléas Sangaré et Suzanne Jolys qui le 1er octobre 2022 ont organisé la première édition du festival Haut Parleuses, à l’Hôtel Pasteur à Rennes, et se sont ensuite attelées à la construction d’une deuxième édition, à l’automne 2023.
 L’occasion de valoriser toutes celles qui l’ouvrent, toutes celles qui disent et toutes celles qui permettent de parler. Et c’est ainsi que dans l’espace Lauren Bastide a lieu la conférence réunissant Marine Beccarelli, historienne et co-créatrice de la série radiophonique Laisse parler les femmes, diffusée sur France Culture, et Aurélie Fontaine, journaliste et fondatrice du podcast Breton-nes et féministes. Toutes les deux expriment « l’aspect parisiano-centré » des médias. Et évoquent « le manque de parole de l’ordinaire. » Alors, Marine Beccarelli et 3 consœurs sont parties à travers la France, en milieu urbain comme en milieu rural, à la rencontre des femmes du quotidien :
L’occasion de valoriser toutes celles qui l’ouvrent, toutes celles qui disent et toutes celles qui permettent de parler. Et c’est ainsi que dans l’espace Lauren Bastide a lieu la conférence réunissant Marine Beccarelli, historienne et co-créatrice de la série radiophonique Laisse parler les femmes, diffusée sur France Culture, et Aurélie Fontaine, journaliste et fondatrice du podcast Breton-nes et féministes. Toutes les deux expriment « l’aspect parisiano-centré » des médias. Et évoquent « le manque de parole de l’ordinaire. » Alors, Marine Beccarelli et 3 consœurs sont parties à travers la France, en milieu urbain comme en milieu rural, à la rencontre des femmes du quotidien :
« Pour les 8 épisodes, on a décidé de ne pas choisir nos interlocutrices en amont. L’idée, c’était d’aller dans des lieux et de donner la parole à des femmes de milieux différents, d’âges différents, etc. »
Aurélie Fontaine acquiesce. De retour il y a quelques années dans le Finistère, elle souhaite explorer son territoire sous l’angle du féminisme et « laisser la parole et faire entendre des femmes qui n’ont pas forcément conscientisé ou intellectualisé le féminisme. » Croiser les voix, multiplier les regards, rendre compte de la diversité des profils, de la pluralité des parcours. Transmettre des vécus et des récits peu relatés dans la presse. « Il y a un problème au niveau de la formation des journalistes. Dans les rédactions, on manque de pluralisme social. Ce sont majoritairement des hommes blancs, hétéros, parisiens, de 40 – 50 ans… Ils ont des biais de genre, des visions et des formations élitistes. La formation en alternance permet d’amener des étudiant-e-s qui n’ont pas les moyens financiers pour les écoles de journalisme… », analyse Aurélie, rejointe par Marine :
« Dans les représentations, il y a peu de diversité. Dans l’animation des émissions, comme dans les invité-e-s. »
Alors, oui, la puissance des podcasts retentit du côté des personnes silenciées. Tout comme les réseaux sociaux offrent un medium immense de visibilité et de diffusion rapide et massive de cette visibilité. « Pouvoir rencontrer ces femmes, les écouter et les faire entendre à la radio, ça nous a bouleversées et émues. Cette expérience m’a transformée et a eu un impact fort dans ma vie et dans mon sentiment de légitimité. Les retours qu’on a eu nous donnent envie de continuer ! », s’enthousiasme Marine Beccarelli. La journaliste, Aurélie Fontaine, partage son émotion : « En fait, ça me procure des sensations opposées. Je ressens de la colère car on constate à quel point on est encore loin de l’égalité. Mais je ressens aussi beaucoup de joie de rendre visibles ces femmes, de donner de la représentativité à cette parole dans l’espace public. »
Pour parvenir à l’égalité, la société a besoin d’entendre les voix et les parcours de celles qu’on a intimé de taire, de celles que l’on a réduit au silence, de celles que l’on a enfermé dans l’espace privé, relégué à la maternité, conditionné à l’infériorité… « Le vent souffle dans les branches et toutes les feuilles de la forêt émettent des sons différents, des froissements soyeux, des crissements secs. Et si je tends l’oreille, il y a parmi les bruits du vent des histoires qui, un temps, ont été jamais-dites mais qui ont fini par venir à la parole. Parce que Toni Morrison. Parce que Maya Angelou, Monique Wittig. Parce que Maryse Condé, Sarah Kane, Virginie Despentes, Leonora Miano, Zoe Leonard, Rosa Montero, Zadie Smith, Anne Carson, Chimamanda Ngozi Adichie… Leurs noms et leurs voix, un peu partout au milieu des arbres, une assemblée de Guérillères, comme une autre forêt, mouvante, que je peux emporter avec moi sur le chemin du retour… jusqu’à la table où je me remets à écrire. », conclut Alice Zeniter dans son livre Je suis une fille sans histoire, adapté par l’autrice également sur les scènes des théâtres. Raconter, donner à entendre, visibiliser. Pour que toutes aient une histoire.

 Les chiffres sont effarants. Et cerise sur le gâteau, l’essayiste précise que son estimation est en deçà de la réalité. Elle parle « d’un gouffre statistique ». Les hommes représentent 83% des 2 millions d’auteurs d’infractions pénales traitées annuellement par les parquets, 90% des personnes condamnées par la Justice, 86% des mis en cause pour meurtre, 99% des auteurs de viols, 84% des auteurs présumés d’accidents routiers mortels, 95% des auteurs de vols avec violences, 97% des auteurs d’agressions sexuelles… « Tous les hommes ne sont pas des délinquants et des criminels mais majoritairement les délinquants et les criminels sont des hommes ! Et il y a là un point d’aveuglement car quand on étudie la violence, on ne prend pas ça en compte », souligne Lucile Peytavin qui prend l’exemple d’un soir de match de foot : jamais dans les médias, par exemple, on ne mettra en exergue le fait que dans 98% des affaires de violence sont commises par des hommes.
Les chiffres sont effarants. Et cerise sur le gâteau, l’essayiste précise que son estimation est en deçà de la réalité. Elle parle « d’un gouffre statistique ». Les hommes représentent 83% des 2 millions d’auteurs d’infractions pénales traitées annuellement par les parquets, 90% des personnes condamnées par la Justice, 86% des mis en cause pour meurtre, 99% des auteurs de viols, 84% des auteurs présumés d’accidents routiers mortels, 95% des auteurs de vols avec violences, 97% des auteurs d’agressions sexuelles… « Tous les hommes ne sont pas des délinquants et des criminels mais majoritairement les délinquants et les criminels sont des hommes ! Et il y a là un point d’aveuglement car quand on étudie la violence, on ne prend pas ça en compte », souligne Lucile Peytavin qui prend l’exemple d’un soir de match de foot : jamais dans les médias, par exemple, on ne mettra en exergue le fait que dans 98% des affaires de violence sont commises par des hommes.

 Tribunal d’Evry, mai 2021. Tran To Nga a 79 ans et cela fait 6 ans qu’elle attend l’ouverture de ce procès intenté à l’encontre de 14 multinationales, semeuses de souffrances et de morts et représentantes de l’impérialisme occidental. Des millions de corps exposés et contaminés à l’agent orange, destiné à détruire le maquis et stopper la guérilla communiste lors de la guerre du Vietnam.
Tribunal d’Evry, mai 2021. Tran To Nga a 79 ans et cela fait 6 ans qu’elle attend l’ouverture de ce procès intenté à l’encontre de 14 multinationales, semeuses de souffrances et de morts et représentantes de l’impérialisme occidental. Des millions de corps exposés et contaminés à l’agent orange, destiné à détruire le maquis et stopper la guérilla communiste lors de la guerre du Vietnam. C’est la période des guerres qu’Angelica Kiyomi Tisseyre Sékiné nous raconte minutieusement. Accompagnée d’images d’archives et de vidéo, elle décrit le paysage, l’engouement, la force et le courage, l’enthousiasme, la peur, le désarroi. Le climat de guerre, la tension mais aussi les joies, les liens qui se nouent, les vécus qui s’embrasent et s’entrelacent. Elle nous embarque avec elle dans les galeries souterraines, dans la forêt vietnamienne, on traverse le pays avec elle et ses compagnons d’unité, on vibre avec elle lorsqu’elle retrouve sa sœur, puis sa mère, on pleure la mort de son bébé, on craint les bombardements et puis on sent cette pluie gluante qu’elle reçoit sur les épaules et on sait que ce n’est pas un herbicide quelconque.
C’est la période des guerres qu’Angelica Kiyomi Tisseyre Sékiné nous raconte minutieusement. Accompagnée d’images d’archives et de vidéo, elle décrit le paysage, l’engouement, la force et le courage, l’enthousiasme, la peur, le désarroi. Le climat de guerre, la tension mais aussi les joies, les liens qui se nouent, les vécus qui s’embrasent et s’entrelacent. Elle nous embarque avec elle dans les galeries souterraines, dans la forêt vietnamienne, on traverse le pays avec elle et ses compagnons d’unité, on vibre avec elle lorsqu’elle retrouve sa sœur, puis sa mère, on pleure la mort de son bébé, on craint les bombardements et puis on sent cette pluie gluante qu’elle reçoit sur les épaules et on sait que ce n’est pas un herbicide quelconque.


 Deuil, maladies, accidents, grossesses extra-utérines, fausses couches, kyste enflammé, handicap dû à un traumatisme crânien non traité dans les temps, violences verbales, transition de genre, cicatrices, volonté de participer au projet… Nombreuses sont les raisons qui amènent les personnes à pousser la porte des Marie Rose. « Le tatouage est un acte qui permet de décider d’être maitre de son corps. Reprendre l’emprise sur son corps, ça revient quasiment à chaque fois dans les discussions. Car pour beaucoup, ils et elles ont subi des drames qui sont vécus comme imposés, puisque la personne n’a pas le contrôle dessus. On parle bien de subir des violences, subir la maladie, subir un accident. », commente la tatoueuse qui dans son quotidien rencontre tous les cas de figure. Pas de parcours type. Que des histoires de vie personnelles portées et ressenties de manière singulière. Qui donnent lieu à des dessins uniques, symbolisant ou non l’expérience de la personne. « Une femme malgache, adoptée à 14 mois, cherche à retrouver ses parents biologiques. Elle est venue pour se faire tatouer l’île de Madagascar. Une femme est venue pour une grossesse extra-utérine, elle a souhaité une étoile dans le bas du dos, au même niveau que l’utérus. Chaque personne est différente et chaque dessin aussi. », signale Marie. Elle le dit : il n’y a pas de règle dans le chemin de la reconstruction qui demeure propre à chacun-e. « Une femme a fait une fausse couche et est venue ici une semaine après. Une autre qui a eu un accident de cheval est venue des années après. Encore une autre est venue deux mois après le décès de son frère. Chacun-e fait son chemin différemment. », précise-t-elle.
Deuil, maladies, accidents, grossesses extra-utérines, fausses couches, kyste enflammé, handicap dû à un traumatisme crânien non traité dans les temps, violences verbales, transition de genre, cicatrices, volonté de participer au projet… Nombreuses sont les raisons qui amènent les personnes à pousser la porte des Marie Rose. « Le tatouage est un acte qui permet de décider d’être maitre de son corps. Reprendre l’emprise sur son corps, ça revient quasiment à chaque fois dans les discussions. Car pour beaucoup, ils et elles ont subi des drames qui sont vécus comme imposés, puisque la personne n’a pas le contrôle dessus. On parle bien de subir des violences, subir la maladie, subir un accident. », commente la tatoueuse qui dans son quotidien rencontre tous les cas de figure. Pas de parcours type. Que des histoires de vie personnelles portées et ressenties de manière singulière. Qui donnent lieu à des dessins uniques, symbolisant ou non l’expérience de la personne. « Une femme malgache, adoptée à 14 mois, cherche à retrouver ses parents biologiques. Elle est venue pour se faire tatouer l’île de Madagascar. Une femme est venue pour une grossesse extra-utérine, elle a souhaité une étoile dans le bas du dos, au même niveau que l’utérus. Chaque personne est différente et chaque dessin aussi. », signale Marie. Elle le dit : il n’y a pas de règle dans le chemin de la reconstruction qui demeure propre à chacun-e. « Une femme a fait une fausse couche et est venue ici une semaine après. Une autre qui a eu un accident de cheval est venue des années après. Encore une autre est venue deux mois après le décès de son frère. Chacun-e fait son chemin différemment. », précise-t-elle.

 Point de départ de l’histoire, le viol n’est pas directement au centre du spectacle qui s’attache, avec rage et panache, à valoriser la quête de Paillette vers la résilience. Pour cela, elle sera accompagnée de la resplendissante sirène, aux gros jambons, à l’allure décapante et aux airs de diva. Dans l’océan de larmes, le trou, le chemin qui pue, le pays magique… Paillette le dit : « Il ne faut pas mourir, je ne courberais pas l’échine. » Annihiler la souffrance. La faire disparaitre. La nier pour ne plus y penser. La colère, contre la culture du viol. L’ivresse, pour s’en échapper et ne plus étouffer. Mais même dans un pays enchanté, sans grues et sans mort-e-s, Paillette est hantée par les questions incessantes et culpabilisantes. Se justifier. Sans arrêt. Elle, la femme qui jouit sans honte et sans détour, la femme qui prend le mic’ face à un gang de mecs qui rappent, la femme qui n’a pas peur de se lancer à l’aventure, d’assouvir ses désirs et de l’ouvrir… Elle se perd. Ne sait plus ce qu’elle veut. Assaillie par la dureté des jugements, elle manque de souffle dans un univers qu’elle croyait bon mais qu’elle découvre nauséabond. Dès lors, une seule obsession : retrouver Cindy.
Point de départ de l’histoire, le viol n’est pas directement au centre du spectacle qui s’attache, avec rage et panache, à valoriser la quête de Paillette vers la résilience. Pour cela, elle sera accompagnée de la resplendissante sirène, aux gros jambons, à l’allure décapante et aux airs de diva. Dans l’océan de larmes, le trou, le chemin qui pue, le pays magique… Paillette le dit : « Il ne faut pas mourir, je ne courberais pas l’échine. » Annihiler la souffrance. La faire disparaitre. La nier pour ne plus y penser. La colère, contre la culture du viol. L’ivresse, pour s’en échapper et ne plus étouffer. Mais même dans un pays enchanté, sans grues et sans mort-e-s, Paillette est hantée par les questions incessantes et culpabilisantes. Se justifier. Sans arrêt. Elle, la femme qui jouit sans honte et sans détour, la femme qui prend le mic’ face à un gang de mecs qui rappent, la femme qui n’a pas peur de se lancer à l’aventure, d’assouvir ses désirs et de l’ouvrir… Elle se perd. Ne sait plus ce qu’elle veut. Assaillie par la dureté des jugements, elle manque de souffle dans un univers qu’elle croyait bon mais qu’elle découvre nauséabond. Dès lors, une seule obsession : retrouver Cindy. Paillette, protagoniste et artiste créatrice, s’affranchit des codes et des étiquettes. Elle convoque les émotions, les paroles, les styles, les notions et les concepts, les secoue et se les approprie. Ne pas déranger. Ne pas faire de bruit. Ne pas bouleverser l’ordre établi. Ne pas baigner dans la vulgarité. Ne pas déborder. Paillette et Sirène envoient tout péter. Elles prennent leur place et leur espace, elles vont trop loin, elles sombrent dans la caricature, elles crient, elles tapent des pieds, elles éclatent les carcans de leur condition de femmes, elles ne revendiquent pas un engagement en particulier. Elles disent, elles font, elles cherchent, elles questionnent, elles avancent, elles s’aident, elles expérimentent et ressentent, elles s’accompagnent, elles nous embarquent avec elles, dans leurs peurs, angoisses, combats, forces, singularités, univers artistiques, succès, etc. Et on plonge. On plonge avec elles dans le trou. On tombe dans le désarroi et la solitude et on comble le vide et le trauma. On remonte à la surface, avec la puissance de l’espoir et la force de la sororité. On se délecte de cette proposition sensible qui explore les recoins d’une âme en souffrance sur le chemin de la résilience. Avec son lot de doutes, de contradictions, de faiblesses, de déni mais aussi de forces, de capacités à rebondir, à s’adapter et à sublimer et à nuancer la noirceur de la réalité. Sans la renier. Ne pas juste survivre. Remonter à la surface, respirer et vivre.
Paillette, protagoniste et artiste créatrice, s’affranchit des codes et des étiquettes. Elle convoque les émotions, les paroles, les styles, les notions et les concepts, les secoue et se les approprie. Ne pas déranger. Ne pas faire de bruit. Ne pas bouleverser l’ordre établi. Ne pas baigner dans la vulgarité. Ne pas déborder. Paillette et Sirène envoient tout péter. Elles prennent leur place et leur espace, elles vont trop loin, elles sombrent dans la caricature, elles crient, elles tapent des pieds, elles éclatent les carcans de leur condition de femmes, elles ne revendiquent pas un engagement en particulier. Elles disent, elles font, elles cherchent, elles questionnent, elles avancent, elles s’aident, elles expérimentent et ressentent, elles s’accompagnent, elles nous embarquent avec elles, dans leurs peurs, angoisses, combats, forces, singularités, univers artistiques, succès, etc. Et on plonge. On plonge avec elles dans le trou. On tombe dans le désarroi et la solitude et on comble le vide et le trauma. On remonte à la surface, avec la puissance de l’espoir et la force de la sororité. On se délecte de cette proposition sensible qui explore les recoins d’une âme en souffrance sur le chemin de la résilience. Avec son lot de doutes, de contradictions, de faiblesses, de déni mais aussi de forces, de capacités à rebondir, à s’adapter et à sublimer et à nuancer la noirceur de la réalité. Sans la renier. Ne pas juste survivre. Remonter à la surface, respirer et vivre.


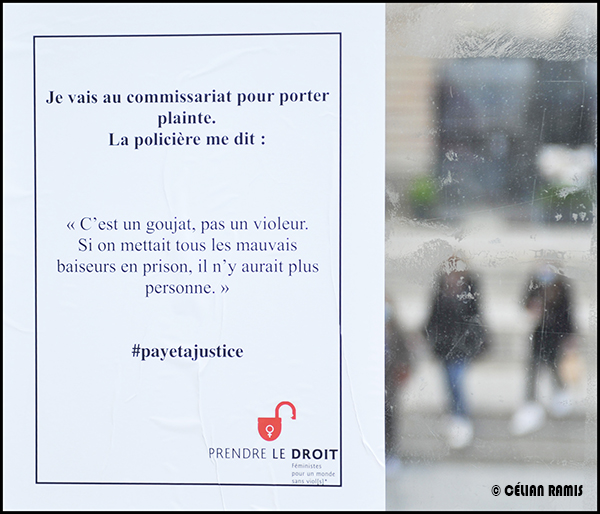 Et puis, dans certains cas, on défend l’accusé : « Vous savez, c’est sérieux, il risque la prison. Sa vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes sure de vouloir continuer ? » ou encore « Il va se marier dans deux mois. Vous voulez lui gâcher la vie ou quoi ? Vous avez une idée du prix du traiteur ? »
Et puis, dans certains cas, on défend l’accusé : « Vous savez, c’est sérieux, il risque la prison. Sa vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes sure de vouloir continuer ? » ou encore « Il va se marier dans deux mois. Vous voulez lui gâcher la vie ou quoi ? Vous avez une idée du prix du traiteur ? » 

 Ras-le-bol de faire semblant de s’intéresser à ce qui fondent les inégalités. Ras-le-bol des conneries des militantes féministes qui n’ont rien d’autre à foutre que de s’attaquer à la langue de Molière, à l’éducation de Jules Ferry, aux ambitions sportives de Pierre de Coubertin, au cinéma de Polanski et de Besson…
Ras-le-bol de faire semblant de s’intéresser à ce qui fondent les inégalités. Ras-le-bol des conneries des militantes féministes qui n’ont rien d’autre à foutre que de s’attaquer à la langue de Molière, à l’éducation de Jules Ferry, aux ambitions sportives de Pierre de Coubertin, au cinéma de Polanski et de Besson… Écouter et entendre. Sans renvoyer à l’autre l’état d’un jugement hâtif et basé sur des stéréotypes, sur de l’inconscient patriarcal et raciste (ne mentons pas, qui ne l’a pas intégré en vivant dans une société comme celle de la France ?). Voilà ce dont le gouvernement va à l’encontre.
Écouter et entendre. Sans renvoyer à l’autre l’état d’un jugement hâtif et basé sur des stéréotypes, sur de l’inconscient patriarcal et raciste (ne mentons pas, qui ne l’a pas intégré en vivant dans une société comme celle de la France ?). Voilà ce dont le gouvernement va à l’encontre. Nous non plus, on ne dit pas ça. Mais on dit que dans un système qui perpétue les inégalités et répand dans toutes les sphères de la société des stéréotypes genrés, tout le monde intègre cette construction sociale qui divise les individus et les hiérarchise en fonction de leur sexe, de leur genre, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur couleur de peau, de leur santé mentale et/ou physique, etc.
Nous non plus, on ne dit pas ça. Mais on dit que dans un système qui perpétue les inégalités et répand dans toutes les sphères de la société des stéréotypes genrés, tout le monde intègre cette construction sociale qui divise les individus et les hiérarchise en fonction de leur sexe, de leur genre, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur couleur de peau, de leur santé mentale et/ou physique, etc.

 Des témoins filment la scène, des passants réclament que les policiers arrêtent le plaquage et l’aident, George Floyd ne cesse de répéter qu’il ne peut plus respirer. Rien n’y fait, la pression à son cou est maintenue jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il décède. Les autopsies concluent à un homicide.
Des témoins filment la scène, des passants réclament que les policiers arrêtent le plaquage et l’aident, George Floyd ne cesse de répéter qu’il ne peut plus respirer. Rien n’y fait, la pression à son cou est maintenue jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il décède. Les autopsies concluent à un homicide. Elle précise que l’affaire n’avance pas. Qu’elle traine même. Alors la famille a choisi de délocaliser le procès à Rennes. A quelques mètres des prises de paroles, une pancarte flotte dans les airs : « Qui appelle-t-on quand la police tue ? » Une minute de silence suit les discours. « Laissez-Nous Respirer !», enchainent en chœur les manifestant-e-s, gravant cette lutte, ignorée jusqu’ici de la majorité des personnes blanches et du gouvernement.
Elle précise que l’affaire n’avance pas. Qu’elle traine même. Alors la famille a choisi de délocaliser le procès à Rennes. A quelques mètres des prises de paroles, une pancarte flotte dans les airs : « Qui appelle-t-on quand la police tue ? » Une minute de silence suit les discours. « Laissez-Nous Respirer !», enchainent en chœur les manifestant-e-s, gravant cette lutte, ignorée jusqu’ici de la majorité des personnes blanches et du gouvernement.
 Pour cette nouvelle édition, ce sera « Une génération », un thème qui lui plait et qu’iel partage avec une amie, Gabrielle Pichon comédienne et autrice pour l’écriture, qui s’effectue en deux jours, fin août. En septembre, le gouvernement lance son grenelle contre les violences conjugales et à cette occasion, ressort un micro-trottoir de 1979, qu’iel va donc reproduire dans son court-métrage. Iel lance un appel sur les réseaux sociaux et découvre avec joie que les réponses sont nombreuses :
Pour cette nouvelle édition, ce sera « Une génération », un thème qui lui plait et qu’iel partage avec une amie, Gabrielle Pichon comédienne et autrice pour l’écriture, qui s’effectue en deux jours, fin août. En septembre, le gouvernement lance son grenelle contre les violences conjugales et à cette occasion, ressort un micro-trottoir de 1979, qu’iel va donc reproduire dans son court-métrage. Iel lance un appel sur les réseaux sociaux et découvre avec joie que les réponses sont nombreuses :