Célian Ramis
Marine Turchi et Anne Bouillon : la parole des femmes dans les médias et la Justice


À l’invitation d’HF+ Bretagne, la journaliste de Mediapart spécialisée dans les affaires de violences sexistes et sexuelles, Marine Turchi, et l’avocate spécialisée en droits des femmes, Anne Bouillon, ont échangé le 14 mars dernier aux Ateliers du Vent, autour de la parole des femmes face aux médias et à la Justice.
D’un côté, elle enquête et révèle dans la presse les affaires de violences sexistes et sexuelles. De l’autre, elle défend et plaide en faveur des personnes ayant subi des faits de violences sexistes et sexuelles. Marine Turchi et Anne Bouillon ont toutes les deux été marquées par la prise de parole d’Adèle Haenel en 2019. Au micro de la journaliste de Mediapart cette année-là, l’actrice accuse publiquement le réalisateur Christophe Ruggia d’agressions sexuelles à son encontre alors qu’elle était âgée de 12 à 14 ans. En février 2025, le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement : le cinéaste est coupable et condamné à 4 ans de prison, dont deux ans ferme (aménageables sous bracelet électronique).
Six ans plus tôt, ce soir-là de 2019, la comédienne témoignait de son vécu et justifiait son choix, à l’époque, de ne pas avoir porté plainte : « La justice nous ignore. On ignore la justice. » Cette phrase reste marquée dans les esprits et résonne, depuis, avec le quotidien de centaines de milliers de victimes de VSS. Parce que leurs paroles sont encore minimisées, banalisées, déformées voire maltraitées lors du dépôt de plainte en commissariat ou gendarmerie. Parce que 86% des plaintes sont classées sans suite. Parce que les auteurs de violences sont peu condamnés, face au nombre de faits : chaque année, en France, on estime à 230 000 le nombre de femmes victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles (un viol ou une tentative de viols toutes les 2 ’30 minutes), à 271 000 le nombre de victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, entre 100 et 150 femmes tuées par leur partenaire ou ex-partenaire (un homme assassine sa conjointe ou ex-conjointe tous les 3 jours environ), et à 160 000 le nombre d’enfants victimes de violences sexuelles.
Entravées dans le processus de paroles, de reconnaissance des violences subies et parfois de reconstruction post-traumatique, elles éprouvent une méfiance envers l’institution judiciaire. Cette défiance, Anne Bouillon et Marine Turchi la ressentent et la constatent tous les jours sur le terrain. Chacune, dans sa fonction, son métier et sa déontologie, œuvre à la libération, l’écoute et la diffusion des récits pour faire émerger la prise de conscience dans la société et favoriser l’évolution des mentalités en faveur de l’égalité.
VIVRE EN ABSURDIE
 C’est l’affaire Denis Baupin, révélée par Mediapart grâce au travail de sa consœur Lénaïg Bredoux, qui va l’inviter à investiguer sur les violences sexistes et sexuelles. « On est en mai 2016 et c’est la première enquête de ce genre qui sort dans la presse sur le sujet. Durant les mois d’enquête – en partenariat avec France Inter, ce qui aide à diffuser plus largement – on a reçu énormément de témoignages de VSS, pas uniquement sur Denis Baupin. Il a fallu du renfort, je me suis portée volontaire », se remémore-t-elle. À cette époque, les VSS et les féminicides sont encore cantonnés et réduits aux pages faits divers dans les médias au lieu d’être traités comme « un phénomène systémique sur lequel il faut enquêter ». Un an plus tard, MeToo explose et la société écoute davantage les militantes féministes qui participent au changement de paradigme, imposant l’usage d’un terme désignant la spécificité de ces meurtres, en raison du genre des victimes et des criminels.
C’est l’affaire Denis Baupin, révélée par Mediapart grâce au travail de sa consœur Lénaïg Bredoux, qui va l’inviter à investiguer sur les violences sexistes et sexuelles. « On est en mai 2016 et c’est la première enquête de ce genre qui sort dans la presse sur le sujet. Durant les mois d’enquête – en partenariat avec France Inter, ce qui aide à diffuser plus largement – on a reçu énormément de témoignages de VSS, pas uniquement sur Denis Baupin. Il a fallu du renfort, je me suis portée volontaire », se remémore-t-elle. À cette époque, les VSS et les féminicides sont encore cantonnés et réduits aux pages faits divers dans les médias au lieu d’être traités comme « un phénomène systémique sur lequel il faut enquêter ». Un an plus tard, MeToo explose et la société écoute davantage les militantes féministes qui participent au changement de paradigme, imposant l’usage d’un terme désignant la spécificité de ces meurtres, en raison du genre des victimes et des criminels.
Pour Anne Bouillon, c’est Natacha – prénom modifié par l’avocate - qui a opéré ce rôle de bascule. Parce qu’elle lui a dépeint « un système absurde et une situation qui ressemblait à une prise d’otage ». Elle le dit : le mari obligeait sa cliente et leurs enfants « à vivre en absurdie », n’autorisant par exemple qu’un seul assaisonnement par repas ou contrôlant le nombre de verres d’eau de chacun-e à l’aide d’une installation vidéo dans la maison. Ce que l’on désigne aujourd’hui par le contrôle coercitif, abordé par Laurène Daycard dans son essai Nos absentes : à l’origine des féminicides, mais aussi Isild Le Besco dans le podcast Nos idées larges (épisodes « Sous contrôle coercitif ») d’Arte Radio : « Mais il y a 16 ans, on n’avait pas ce langage. » Sans compter la difficulté à le qualifier pénalement. Exfiltrée par ses parents, Natacha trouve une issue avec ses enfants. Lui, se suicide.
« Mais il aurait pu la tuer je pense. Cette situation-là est venue marquer des choses que j’ai beaucoup retrouvé ensuite dans les affaires de VSS et de violences intrafamiliales »
poursuit Anne Bouillon.
L’AVANT « ELLE LE QUITTE, IL LA TUE »
Longtemps, les violences exercées à l’encontre des femmes ont été reléguées, dans les médias, à des faits isolés plutôt que d’être analysées sous le prisme d’une problématique systémique. A propos des féminicides, les journalistes titraient et écrivaient sur des situations qualifiées de « drames passionnels », « crimes passionnels » et de « crimes d’amour », se faisant le relai des dires et manipulations des assassins, à l’instar de Jonathann Daval et de sa stratégie de culpabilité inversée. Une mécanique récurrente dans les affaires de féminicides. Si l’assassin finit par être condamné et emprisonné, la population entre en empathie avec celui-ci, étouffé et émasculé par sa campagne. L’esprit retient que quelque part, la victime l’avait peut-être cherché. En réponse, les féministes brandissent et martèlent le slogan : elle le quitte, il la tue. De quoi remettre les pendules à l’heure.
Dans les affaires de violences sexuelles, en revanche, les accusés sont souvent acquittés. Faute de preuves, comme s’intitule le livre de Marine Turchi, ou parce que les faits sont prescrits. Des signaux, entre autres, qui viennent renforcer les stéréotypes de genre et les idées reçues. Et surtout qui envoient un message fort aux victimes : parler a un coût, celui de ne pas être crédibles et crues, encore moins reconnues aux yeux de la société. La multiplicité des témoignages démontrant le mauvais accueil et traitement des plaintes par les forces de l’ordre s’ajoute à l’expérience collective et à la défiance envers une réponse judiciaire.
D’autres moyens existent pour poser et porter la parole des personnes ayant subi des violences. « Mais celles qui veulent prendre la parole devant la Justice doivent pouvoir le faire et doivent pouvoir trouver un espace secure et bienveillant pour le faire », souligne Anne Bouillon. Toutefois, « accueillir la parole qui vient gripper et dénoncer le système » a là aussi un prix : celui d’être « renvoyée face à sa propre responsabilité ». Une pirouette patriarcale que l’avocate estime « trop facile ». Il est donc important et essentiel de trouver des espaces avec des professionnel-les formé-es. Et d’être prêt-es pour une longue et parfois douloureuse procédure : « Personne n’est obligé de déposer plainte mais si on décide de saisir la justice pénale et de déposer plainte, ça se prépare. Il y a des associations, des assistantes sociales en commissariat et gendarmerie, des avocat-es qui le font en amont. À force d’expérience, on repère les interlocuteur-ices de qualité au sein des forces de l’ordre mais c’est encore très aléatoire et très disparate. »
OUVRIR LE DÉBAT ET AMÉLIORER LES PRATIQUES
 Aujourd’hui encore, l’accueil de la parole des victimes de VSS dépend des conditions de formation des agents de police (ou gendarmes) et des membres de la Justice. Si la voie de presse ne se substitue pas à cette dernière, elle apparait comme une alternative pour exprimer un vécu violent et mettre en évidence, par une enquête journalistique rigoureuse, la substance et les enjeux de la domination masculine. « À l’époque de l’enquête sur Denis Baupin, on a ouvert une boite mail dédiée aux témoignages de VSS et on a vu l’étendue du problème... Elle ne désemplit pas. C’est de l’ordre des milliers de messages », signale Marine Turchi, qui précise : « Il y a dans les mails, des personnes coincées dans des procédures interminables et espèrent que la voie médiatique leur permettra de sortir de cette impasse. Les personnes qui ne portent pas plainte, ça doit interroger la Justice… »
Aujourd’hui encore, l’accueil de la parole des victimes de VSS dépend des conditions de formation des agents de police (ou gendarmes) et des membres de la Justice. Si la voie de presse ne se substitue pas à cette dernière, elle apparait comme une alternative pour exprimer un vécu violent et mettre en évidence, par une enquête journalistique rigoureuse, la substance et les enjeux de la domination masculine. « À l’époque de l’enquête sur Denis Baupin, on a ouvert une boite mail dédiée aux témoignages de VSS et on a vu l’étendue du problème... Elle ne désemplit pas. C’est de l’ordre des milliers de messages », signale Marine Turchi, qui précise : « Il y a dans les mails, des personnes coincées dans des procédures interminables et espèrent que la voie médiatique leur permettra de sortir de cette impasse. Les personnes qui ne portent pas plainte, ça doit interroger la Justice… »
Dans ce qu’elle lit au quotidien, elle perçoit l’idée d’alerter l’opinion publique, qui vient contredire l’image de la femme vengeresse qui dénoncerait un innocent pour le faire tomber pour motif personnel. « C’est pas ce que je vois dans les mails qu’on reçoit. Beaucoup veulent alerter dans la presse pour que la personne citée s’arrête. Et pour ne pas porter la culpabilité de n’avoir rien dit », poursuit-elle. Parler a un impact fort, confirme la journaliste de Mediapart : « Baupin, Depardieu, Miller…. Il y a un afflux de témoignages qui continue d’arriver. Nous ne sommes pas auxiliaires de justice ni de police. Notre rôle, c’est l’information et nous estimons que les citoyen-nes ont le droit de savoir. Les VSS, c’est pas de la drague. Ce sont des crimes et des délits et c’est normal que la presse enquête. » Son travail : réaliser une investigation à la hauteur des paroles des victimes et témoins. La difficulté majeure : « On ne peut pas faire d’enquête pour tout le monde. Mais les affaires traitées agissent comme un révélateur dans la société parce qu’elles parlent à beaucoup de gens. »
Anne Bouillon acquiesce le rôle citoyen de cette parole. Elle reconnait ne pas avoir compris instantanément le propos d’Adèle Haenel ce soir-là de 2019, expliquant son choix de ne pas saisir la Justice. Elle lui écrit d’ailleurs une tribune dans la presse défendant l’importance du dépôt de plainte et de la procédure judiciaire. Puis prend la mesure de l’impact du discours de la comédienne. Après cela, « la justice s’est auto-saisie de cette situation. » Un procès accepté et assumé par Haenel non pour elle seule mais pour l’ensemble de la société. « Ça a mis la justice au défi. C’est un travail citoyen qui nous permet d’améliorer les pratiques judiciaires », confirme l’avocate. « Elle a ouvert la porte un peu fort, sourit Marine Turchi. Mais ce discours de la justice qui ignore les femmes victimes, les associations féministes l’entendent depuis très longtemps. Elle a permis de poser le débat. Elle a porté plainte pour continuer à porter ce débat. »
UN INTÉRÊT PUBLIC
L’évolution est lente mais évidente. Toutefois, des résistances se font entendre et des conflits se constatent. Lors de l’écriture de son livre Faute de preuves, Marine Turchi rencontrent et interrogent tou-tes les acteur-ices du chainon judiciaire. « J’étais interloquée que dès la première minute de certains entretiens, une partie des personnes me parle de tribunal médiatique. Je pose une question sur la Justice et on me répond ‘et vous, les médias ?’… », analyse-t-elle, rappelant que « sans la presse, pas d’affaire Ruggia, PPDA, Depardieu, etc. ». La multiplication des témoignages dans les médias ayant favorisé le recours à la justice : « La presse fait son travail et une partie du monde judiciaire ne le comprend pas. »
Elle parle d’intérêt public de relater que dans le cadre de son travail et de sa fonction de maire, Gérald Darmanin aide des femmes en situation de précarité en échange de relations sexuelles qu’il estime consenties, a contrario des concernées. Il est d’intérêt public d’informer les citoyen-nes que leur journaliste favori, ex-présentateur du JT de TF1 a fait défilé des filles mineures, souvent stagiaires, dans son bureau, usant de sa fonction ou les menaçant pour obtenir des relations sexuelles. « Ce sont des crimes de propriété et de domination. Pourquoi on mettrait ça sous le tapis ? », s’insurge-t-elle. « Il faut que la presse et la justice se parlent et se comprennent mieux. Nous avons des rôles différents dans lesquels chacun-e est à sa place », commente-t-elle.
Comme le souligne Anne Bouillon, « l’institution n’aime pas qu’on la renvoie à ces carences et ces défauts, et n’aime pas de ne pas avoir la primeur sur les investigations. » Nommer permet de faire exister. Parler de féminicides renvoie au caractère spécifique et systémique des meurtres de femmes parce qu’elles sont des femmes. Révéler au grand jour, dans la presse ou par le refus du huis clos comme l’a fait Gisèle Pelicot l’an dernier, c’est rompre le silence et briser les murs de l’intime que confinerait potentiellement et symboliquement l’enceinte du tribunal. Les violences exercées au sein d’un couple ne sont pas de l’ordre du privé. C’est politique, tout autant que la prise de paroles des femmes victimes.
UNE VOLONTÉ FORTE DE FAIRE TAIRE LES CONCERNÉ-ES
 Toutes les deux défendent la liberté de la presse et les principes fondamentaux de la Justice, parmi lesquels figurent le droit de la défense, le procès équitable ou encore la présomption d’innocence. Pourtant, ce dernier est souvent opposé aux journalistes et militant-es féministes qui dénoncent les auteurs de VSS. « On entend des voix judiciaires, relayées par certains médias, se demander si le tout victimaire n’aurait pas pris le dessus ? Comme si nous étions dans une société vengeresse qui voudrait immoler des hommes innocents… », plaisante, à demi-mots, Anne Bouillon. La résurgence massive des mouvements masculinistes et réactionnaires l’inquiète profondément. Elle y voit là une stratégie pour détourner le propos : « On doit repartir au combat ! Pour moi, ce backlash est fait pour déplacer la focale sur une question qui n’est pas notre sujet ! »
Toutes les deux défendent la liberté de la presse et les principes fondamentaux de la Justice, parmi lesquels figurent le droit de la défense, le procès équitable ou encore la présomption d’innocence. Pourtant, ce dernier est souvent opposé aux journalistes et militant-es féministes qui dénoncent les auteurs de VSS. « On entend des voix judiciaires, relayées par certains médias, se demander si le tout victimaire n’aurait pas pris le dessus ? Comme si nous étions dans une société vengeresse qui voudrait immoler des hommes innocents… », plaisante, à demi-mots, Anne Bouillon. La résurgence massive des mouvements masculinistes et réactionnaires l’inquiète profondément. Elle y voit là une stratégie pour détourner le propos : « On doit repartir au combat ! Pour moi, ce backlash est fait pour déplacer la focale sur une question qui n’est pas notre sujet ! »
La pédagogie apparait incontournable en réponse au discours persistant et large des opposant-es, visant à silencier les femmes et les personnes minorisées. « Il est important que les médias expliquent ce qu’est la présomption d’innocence, qui s’applique dans le cadre de la procédure pénale. Quand Adèle Haenel parle, il n’y a pas d’enquête pénale à ce moment-là. Ce qui n’annule pas le droit du contradictoire parce que nous avons un codé éthique et déontologique », précise Marine Turchi, précisant les jours et les semaines où elle s’est attelée à contacter Christophe Ruggia pour lui donner la parole. En vain. Elle évoque également les procédures bâillon que les accusés utilisent pour riposter : « Hulot, Darmanin et les autres, ils mettent une plainte contre la personne qui les accuse, qu’ils retirent discrètement ensuite. » Le but : faire croire publiquement à leur indignation, et donc innocence, vis-à-vis des faits qui leur sont acculés, et tenter de décourager la ou les femmes victimes de leurs délits et/ou crimes.
« C’est utilisé à toutes les sauces dans le cadre des violences sexistes et sexuelles et c’est pour dire ‘Taisez-vous'. C’est marrant parce que sur les fraudes fiscales, on n’oppose jamais la présomption d’innocence. Avec Cahuzac par exemple, la question ne s’est pas posée. C’est parlant… », insiste-t-elle. Son message : ne pas confondre présomption d’innocence et liberté d’expression.
« La parole est possible même quand une affaire est en cours. La présomption d’innocence n’empêche pas le contradictoire et le témoignage. Elle sert surtout à clore le débat public »
déplore-t-elle.
DANS LES ARTS ET LA CULTURE, UNE INTROSPECTION MOUVEMENTÉE…
La conversation poursuit son cours, jusqu’à aborder la question épineuse des VSS dans le secteur des arts et de la culture. Un sujet qui cristallise des tensions vives dans le milieu, comme dans la société, avec la fameuse réflexion autour de la séparation de l’homme et de l’artiste mais aussi de la cancelled culture. Là encore des stratégies de détournement pour ne pas creuser dans l’introspection et la remise en question, comme l’impose Adèle Haenel quand elle quitte la salle Pleyel et plus largement le cinéma, en criant « La honte », au même titre que Judith Godrèche quand elle prend la parole pour dénoncer les violences sexuelles et pédocriminelles des réalisateurs Jacques Doillon et Benoit Jacquot à son encontre. À son initiative d’ailleurs, une commission parlementaire relative aux « violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité » a été votée et mise en place par l’Assemblée nationale en 2024.
« Partout où les rapports de domination s’exercent, il y a un risque d’en abuser. L’art étant un secteur dans lequel il est essentiel et permanent de repousser les limites pour pouvoir créer… Les conditions sont réunies ! Sous couvert de la puissance créatrice, toutes les limites s’affaissent », signale Anne Bouillon. Réflexion que l’on retrouve également chez l’humoriste Hannah Gadsby dans son spectacle Nanetteautour de la figure de l’artiste comme Picasso ou Gauguin, et que l’on peut transposer à nos contemporains, à l’instar de Polanski ou Depardieu, soutenus par la société – jusqu’au chef de l’État – pour leur « génie créateur et créatif ». Une carte privilégiée pour justifier l’impunité. « C’est un concentré pur de ce que le patriarcat peut produire. Leur position dominante légitime leurs abus de pouvoir. Ce sont les mêmes rapports que dans les familles patriarcales où la figure du père prend le dessus. C’est encadré et institutionnalisé comme tel, et donc admis par la société », poursuit l’avocate.
Si les mouvements MeToo bouleversent le cinéma et le théâtre, entre autres, ce n’est pas un hasard, selon Marine Turchi : « Ça raconte quelque chose. Ce sont des affaires impactantes parce que le cinéma, par exemple, produit des images et s’installe dans les foyers. Il y a dans ces secteurs l’alibi artistique. Si on dénonce, on nous répond que ce ne sont pas des violences mais de l’art. La puissance du réalisateur, l’idée du génie créateur, etc. sont encore à l’œuvre. D’où le besoin d’ouvrir à la parité et à la diversité. Pour que la parole circule. Heureusement, ça évolue. »
L’année 2017 – année de l’affaire Weinstein – marque un tournant mondial dans la prise de conscience de l’ampleur et des mécanismes des violences sexistes et sexuelles. Huit ans plus tard, le mouvement MeToo – lancé bien plus tôt, en 2007 par l’afroaméricaine Tarana Burke – remue tous les secteurs et toutes les sphères de la société, dont le milieu des arts et de la culture, longtemps pensé comme hors du monde, n’est pas exempt. Les voix s’élèvent et les discours et actions féministes gagnent du terrain, et comme le dit Marine Turchi essaiment partout. En démontre les multiples accusations contre Gérard Depardieu, Nicolas Bedos, Franck Gastambide, Gérard Darmon, Ary Abittan et bien d’autres - par plusieurs femmes à chaque fois - mettant en lumière non seulement le caractère systémique de celles-ci mais aussi l’influence et l’impact de l’impunité qui protège les artistes (en général, hommes, blancs, valides, reconnus et soutenus par leurs pairs et une grande partie de la population…).
 De par la médiatisation de ces affaires, venant étayer les propos des victimes et des militantes, les représentations évoluent, exigeant des prises de position et de responsabilités claires et précises. Ainsi, l’an dernier, la sortie du film CE2, réalisé par Jacques Doillon, a été reportée à un mois dans sa diffusion en salles et le cinéaste a même été décommandé par le festival Viva II Cinéma, à Tours, en raison de l’ouverture d’une enquête pénale pour viols sur mineur-es. Cette année, c’est la sortie de Je le jure qui met l’industrie du cinéma dans l’embarras. En effet, le réalisateur Samuel Theis est accusé de viol par un technicien du film, tourné en 2023, et une enquête est en cours. La production, inquiète face aux enjeux financiers et sociétaux que l’affaire soulève, a opté pour un protocole de confinement jusqu’à la fin du tournage (absent du plateau pour « prendre acte d’une souffrance », le réalisateur a dirigé les scènes à distance) et la sortie du film est accompagnée d’un dispositif de « non mise en lumière du réalisateur » qui ne donne pas d’interview et ne participe à aucune avant-première. Des précautions, et des motivations, peut-être discutables mais qui ont le mérite d’interroger les alternatives possibles dans les situations d’accusations de VSS et de mettre en lumière que tout reste désormais à inventer. Un défi qui s’applique à tous les pans de la société.
De par la médiatisation de ces affaires, venant étayer les propos des victimes et des militantes, les représentations évoluent, exigeant des prises de position et de responsabilités claires et précises. Ainsi, l’an dernier, la sortie du film CE2, réalisé par Jacques Doillon, a été reportée à un mois dans sa diffusion en salles et le cinéaste a même été décommandé par le festival Viva II Cinéma, à Tours, en raison de l’ouverture d’une enquête pénale pour viols sur mineur-es. Cette année, c’est la sortie de Je le jure qui met l’industrie du cinéma dans l’embarras. En effet, le réalisateur Samuel Theis est accusé de viol par un technicien du film, tourné en 2023, et une enquête est en cours. La production, inquiète face aux enjeux financiers et sociétaux que l’affaire soulève, a opté pour un protocole de confinement jusqu’à la fin du tournage (absent du plateau pour « prendre acte d’une souffrance », le réalisateur a dirigé les scènes à distance) et la sortie du film est accompagnée d’un dispositif de « non mise en lumière du réalisateur » qui ne donne pas d’interview et ne participe à aucune avant-première. Des précautions, et des motivations, peut-être discutables mais qui ont le mérite d’interroger les alternatives possibles dans les situations d’accusations de VSS et de mettre en lumière que tout reste désormais à inventer. Un défi qui s’applique à tous les pans de la société.
BACKLASH : L’EXTRÊME-DROITE ET LES MASCULINISTES SE FONT ENTENDRE
L’accumulation de témoignages reçue par la rédaction, la révélation d’un grand nombre d’affaires de VSS dans la presse, l’évolution du langage permettant de nommer et affirmer la spécificité des féminicides, quittant alors la rubrique des faits divers pour caractériser la dimension systémique de ceux-ci… constituent des avancées majeures au cours des dernières années pour les droits des femmes et la lutte pour l’égalité. Ombre non négligeable au tableau : le retour de bâton « dans un paysage gangréné par l’extrême-droite et les masculinistes. » Poursuivre le travail de pédagogie, par l’information et sa large diffusion, est essentiel pour la journaliste de Mediapart qui démontre l’importance des enquêtes et révélations médiatiques :
« Quand on sort le papier sur Depardieu, ça essaime dans la société. Pareil pour PPDA. Le récit d’une femme dans l’émission a été un détonateur pour plein d’autres femmes. »
Déminer et déconstruire les stéréotypes, décrypter la mécanique sexiste, interroger la posture de la victime pour anéantir la vision manichéenne de la société. Pour que les femmes se sentent légitimes de parler, de raconter leurs vécus même si celui-ci ne correspond pas aux représentations et fantasmes que l’on se fait autour des VSS. « Elles ont souvent honte et culpabilisent. Dans l’affaire PPDA, on a reçu des messages de femmes qui pensaient qu’elles ne pouvaient venir témoigner dans notre émission parce qu’elles l’avaient suivi dans sa chambre d’hôtel », précise Marine Turchi. S’il n’est pas simple de déboulonner les idées reçues en matière d’égalité femmes-hommes, la journaliste souhaite rester optimiste et croire en l’évolution positive des mentalités.
Une vision à laquelle Anne Bouillon aimerait adhérer. Pourtant, elle affirme son pessimisme. Sans nier les changements : « Je ne fais pas le même métier qu’avant MeToo. Ça a provoqué une bascule et donné une attention accrue aux VSS. C’était tellement difficile avant en fait ! » Face aux juges quotidiennement, elle constate qu’aujourd’hui les femmes ont davantage voix au chapitre dans l’enceinte des tribunaux. Et constate également le nombre d’affaires pour viols, le nombre d’affaires pour féminicides et le nombre d’affaires pour inceste... La souffrance et la peur habitent toujours le quotidien d’un grand nombre de femmes violentées et persécutées, sans oublier les mineur-es, victimes directes et indirectes des violences intrafamiliales :
« La violence n’en finit pas. La violence, c’est ce qui ne change pas. Les corps des femmes et des enfants sont toujours des réceptacles des violences »
Anne Bouillon appelle à la mobilisation massive et générale. Plus que ça. À la révolution féministe. « Les forces obscures se profilent à l’horizon et la culture réelle de l’égalité ne vient toujours pas. N’oublions pas que face à une crise, la cause des femmes passe à l’as en premier ! Il ne faut rien lâcher ! Gardons notre vigilance et envie de combats intactes parce qu’il va falloir s’en servir ! », insiste-t-elle, largement applaudie par le public conquis par cette rencontre croisée qui met l’accent sur des difficultés réelles et des enjeux majeurs de la société actuelle : l’information, la qualité de son traitement, sa diffusion et son accessibilité, que ce soit pour la presse ou la Justice. En ayant toujours à l’esprit la lutte pour les droits des femmes, des personnes sexisées et minorisées, et plus largement l’égalité entre les individus, en portant avec respect et sororité la parole des concerné-es.
Dans le cadre des événements proposés par la Ville de Rennes à l'occasion du 8 mars.
- Pour découvrir le travail de l'association, HF+ Bretagne, dédiée à l'égalité réelle entre les genres dans les arts et la culture, c'est par ici : HF+ Bretagne


 D’un bout à l’autre de la manifestation, se font entendre le bruit et le vacarme de la colère et de la révolte. Sur les pancartes trônent des messages engagés et solidaires: « Soyez écolos, plantez des riches », « Nous sommes les voix de celles qui n’en ont pas – Free Palestine », « Viva la vulva », « Pas de fachos dans nos quartiers – pas de quartier pour les fachos », « Contre l’utilisation raciste de nos luttes féministes », « Justice pour les incesté-es » ou encore « Mon corps mon choix », « On te croit », « Un silence n’est pas un oui – Un viol n’est jamais un accident » et « Destruction totale et irrévocable du patriarcat – BADABOUM ». Les mines sont enjouées, les poings levés, les corps dansent et les percussions vibrent et résonnent dans un espace public animé par les luttes féministes.
D’un bout à l’autre de la manifestation, se font entendre le bruit et le vacarme de la colère et de la révolte. Sur les pancartes trônent des messages engagés et solidaires: « Soyez écolos, plantez des riches », « Nous sommes les voix de celles qui n’en ont pas – Free Palestine », « Viva la vulva », « Pas de fachos dans nos quartiers – pas de quartier pour les fachos », « Contre l’utilisation raciste de nos luttes féministes », « Justice pour les incesté-es » ou encore « Mon corps mon choix », « On te croit », « Un silence n’est pas un oui – Un viol n’est jamais un accident » et « Destruction totale et irrévocable du patriarcat – BADABOUM ». Les mines sont enjouées, les poings levés, les corps dansent et les percussions vibrent et résonnent dans un espace public animé par les luttes féministes. Intitulé L’art de la joie en femmage à l’œuvre littéraire de Goliarda Sapienza, le projet est aujourd’hui porté par la Brave Compagnie « mais il est parti d’une initiative collective et amicale », précise Johanna Rocard, co-fondatrice de la structure, aux côtés d’Estelle Chaigne et Amandine Braud. « En 2023, on s’est retrouvées à plusieurs dans la manif du 8 mars. Il y avait moins de mobilisation cette année-là, ce qui s’explique par la guerre en Ukraine et les actus qui se priorisent… On n’était pas très fières de notre engagement, on était un peu à la va vite », poursuit-elle.
Intitulé L’art de la joie en femmage à l’œuvre littéraire de Goliarda Sapienza, le projet est aujourd’hui porté par la Brave Compagnie « mais il est parti d’une initiative collective et amicale », précise Johanna Rocard, co-fondatrice de la structure, aux côtés d’Estelle Chaigne et Amandine Braud. « En 2023, on s’est retrouvées à plusieurs dans la manif du 8 mars. Il y avait moins de mobilisation cette année-là, ce qui s’explique par la guerre en Ukraine et les actus qui se priorisent… On n’était pas très fières de notre engagement, on était un peu à la va vite », poursuit-elle. Au cours des deux semaines, l’événement a proposé des journées en accès libre et des temps d’aide à la couture, des ateliers cagoules ou chorales et des créneaux pour accueillir des structures partenaires comme le GPAS et les enfants de Maurepas. « Ce sont des publics qu’on ne toucherait pas sans ce lieu dédié. Il y a par exemple des femmes d’un certain âge qui sont venues à un atelier et sont revenues ensuite. On aurait aimé aussi faire quelque chose avec les femmes de la prison de Rennes, qu’elles puissent porter leurs voix et manifester avec nous mais c’est tombé à l’eau », souligne Cassandre, plasticienne investie dans L’art de la joie.
Au cours des deux semaines, l’événement a proposé des journées en accès libre et des temps d’aide à la couture, des ateliers cagoules ou chorales et des créneaux pour accueillir des structures partenaires comme le GPAS et les enfants de Maurepas. « Ce sont des publics qu’on ne toucherait pas sans ce lieu dédié. Il y a par exemple des femmes d’un certain âge qui sont venues à un atelier et sont revenues ensuite. On aurait aimé aussi faire quelque chose avec les femmes de la prison de Rennes, qu’elles puissent porter leurs voix et manifester avec nous mais c’est tombé à l’eau », souligne Cassandre, plasticienne investie dans L’art de la joie. UN LIEU VIVANT ET JOYEUX
UN LIEU VIVANT ET JOYEUX Cassandre, ce jour-là, s’affaire à la couture pour terminer sa bannière : « J’avais un slogan en tête mais je ne savais pas comment le mettre en forme. Sans compter qu’on ne se rend pas compte le temps que ça prend, c’est très long ! » Sur un tissu orange, elle inscrit et ajuste le message, lettre bleue par lettre bleue : « Aux violeurs de Gisèle et aux autres nous n’oublierons jamais vos visages ni vos noms ni vos actions » Pour elle, ce lieu est important : « Si on ne l’avait pas, il n’existerait pas ! » Cet endroit, c’est un espace de rencontres et de partages. De mutualisation du matériel et des compétences. D’engagement et de militantisme.
Cassandre, ce jour-là, s’affaire à la couture pour terminer sa bannière : « J’avais un slogan en tête mais je ne savais pas comment le mettre en forme. Sans compter qu’on ne se rend pas compte le temps que ça prend, c’est très long ! » Sur un tissu orange, elle inscrit et ajuste le message, lettre bleue par lettre bleue : « Aux violeurs de Gisèle et aux autres nous n’oublierons jamais vos visages ni vos noms ni vos actions » Pour elle, ce lieu est important : « Si on ne l’avait pas, il n’existerait pas ! » Cet endroit, c’est un espace de rencontres et de partages. De mutualisation du matériel et des compétences. D’engagement et de militantisme.  Ensemble, elles investissent un espace résolument engagé, un militantisme féministe « au croisement très clair des luttes décoloniales, queer et migrantes », au service et en soutien du mouvement collectif. Elle le dit : « On ne théorise pas plus que ça dans ce lieu de création. On ne fait pas le travail de NousToutes 35, du Cridev et des autres associations qui à l’année font un travail de fond que l’on vient ici soutenir et rendre visible. » Elle aborde le contexte actuel, l’importance et l’impact des images, le besoin et l’intérêt de créer des visuels joyeux. Proposer un cortège flamboyant et lumineux pour affirmer les éléments positifs existants dans la société. Valoriser les savoir-faire et les joies partagées : « Il y a des choses qui vont mal mais il n’y a pas que ça. Face à l’effet de sidération que nous apporte l’actualité, c’est important de visibiliser toutes les personnes qui font des choses incroyables, dans ce travail de la forme et de la création. »
Ensemble, elles investissent un espace résolument engagé, un militantisme féministe « au croisement très clair des luttes décoloniales, queer et migrantes », au service et en soutien du mouvement collectif. Elle le dit : « On ne théorise pas plus que ça dans ce lieu de création. On ne fait pas le travail de NousToutes 35, du Cridev et des autres associations qui à l’année font un travail de fond que l’on vient ici soutenir et rendre visible. » Elle aborde le contexte actuel, l’importance et l’impact des images, le besoin et l’intérêt de créer des visuels joyeux. Proposer un cortège flamboyant et lumineux pour affirmer les éléments positifs existants dans la société. Valoriser les savoir-faire et les joies partagées : « Il y a des choses qui vont mal mais il n’y a pas que ça. Face à l’effet de sidération que nous apporte l’actualité, c’est important de visibiliser toutes les personnes qui font des choses incroyables, dans ce travail de la forme et de la création. » Si l’événement s’empare des codes et valeurs de la tradition carnavalesque et de sa manière de se costumer pour dénoncer et critiquer les systèmes de domination, les participant-es s’approprient l’expérience. « J’ai longtemps été dans le collectif Mardi Gras et pour moi, ce que l’on fait là est un peu différent. Au Carnaval, on renverse les situations et on s’autorise à être qui on n’est pas. Ici, je me sens très moi-même au contraire ! La symbolique est différente et je ne porte pas de la même manière le costume au carnaval qu’au 8 mars », analyse Sophie. C’est une forme d’exutoire qui lui donne accès à son identité et sa personnalité, hors des injonctions sociales et patriarcales : « J’ai l’impression d’être moi-même, d’être une version de moi-même que je ne peux pas incarner tous les jours parce qu’elle est trop intense cette version ! » Bas les masques, désactivés les filtres du quotidien. Pour Sophie, c’est un sentiment de grand soulagement. En enfilant le costume, elle a la sensation de révéler qui elle est :
Si l’événement s’empare des codes et valeurs de la tradition carnavalesque et de sa manière de se costumer pour dénoncer et critiquer les systèmes de domination, les participant-es s’approprient l’expérience. « J’ai longtemps été dans le collectif Mardi Gras et pour moi, ce que l’on fait là est un peu différent. Au Carnaval, on renverse les situations et on s’autorise à être qui on n’est pas. Ici, je me sens très moi-même au contraire ! La symbolique est différente et je ne porte pas de la même manière le costume au carnaval qu’au 8 mars », analyse Sophie. C’est une forme d’exutoire qui lui donne accès à son identité et sa personnalité, hors des injonctions sociales et patriarcales : « J’ai l’impression d’être moi-même, d’être une version de moi-même que je ne peux pas incarner tous les jours parce qu’elle est trop intense cette version ! » Bas les masques, désactivés les filtres du quotidien. Pour Sophie, c’est un sentiment de grand soulagement. En enfilant le costume, elle a la sensation de révéler qui elle est :
 Fougue et énergie rock sur la scène des Transmusicales, le 4 décembre 2021, grâce aux artistes musiciennes d’Ottis Cœur ! Elles se sont rencontrées en formation, ne sont pas appréciées tout de suite et puis, elles ont fini par se confiner toutes les deux, en mars 2020. Sans intention professionnelle au départ, elles ont composé, expérimenté et chanté ensemble. Ça a matché et de là est née la créativité rugissante montrée à l’Étage du Liberté. Elles prônent l’identité DIY, le rock et le féminisme. Et on se régale autant en visionnant le clip de « Je marche derrière toi » qu’en l’écoutant en live. À la différence que là, on savoure leur panache et leur dynamisme électrisants ! Ça sent bon le garage, le rock alternatif, les influences pop rock et la colère débordante au service d’une créativité rythmique et explosive. Leurs voix s’unissent, les harmonies renforcent leur proposition musicale et accentuent leur discours, scandé en français, dénonçant les violences sexistes et masculines. Leur ras-le-bol des histoires fumeuses, des mecs qui ne pensent qu’à leur gueule – oubliant le plaisir et l’orgasme des femmes - du mensplaining et on en passe, elles l’expriment avec hargne, saisissant et brandissant leurs émotions catapultées sous la forme de forces libératrices et empouvoirantes. Elles bondissent, guitare électrique, basse et batterie saturent et vrombissent, et l’énergie envahit très vite la salle. L’enthousiasme gagne la foule, convaincue par ce mélange de calme, d’amertume et de fureur. Les tripes sur le plateau, laissant entrevoir également leur jovialité, légèreté et humour entre les morceaux, Camille et Margaux signent un set puissant, qui retient notre attention et surtout alimente notre curiosité pour Ottis Cœur, qu’il faudra suivre, c’est certain, dans les prochaines années. Ce sont là les prémices d’un duo bien décidé à chanter fort sans s’excuser.
Fougue et énergie rock sur la scène des Transmusicales, le 4 décembre 2021, grâce aux artistes musiciennes d’Ottis Cœur ! Elles se sont rencontrées en formation, ne sont pas appréciées tout de suite et puis, elles ont fini par se confiner toutes les deux, en mars 2020. Sans intention professionnelle au départ, elles ont composé, expérimenté et chanté ensemble. Ça a matché et de là est née la créativité rugissante montrée à l’Étage du Liberté. Elles prônent l’identité DIY, le rock et le féminisme. Et on se régale autant en visionnant le clip de « Je marche derrière toi » qu’en l’écoutant en live. À la différence que là, on savoure leur panache et leur dynamisme électrisants ! Ça sent bon le garage, le rock alternatif, les influences pop rock et la colère débordante au service d’une créativité rythmique et explosive. Leurs voix s’unissent, les harmonies renforcent leur proposition musicale et accentuent leur discours, scandé en français, dénonçant les violences sexistes et masculines. Leur ras-le-bol des histoires fumeuses, des mecs qui ne pensent qu’à leur gueule – oubliant le plaisir et l’orgasme des femmes - du mensplaining et on en passe, elles l’expriment avec hargne, saisissant et brandissant leurs émotions catapultées sous la forme de forces libératrices et empouvoirantes. Elles bondissent, guitare électrique, basse et batterie saturent et vrombissent, et l’énergie envahit très vite la salle. L’enthousiasme gagne la foule, convaincue par ce mélange de calme, d’amertume et de fureur. Les tripes sur le plateau, laissant entrevoir également leur jovialité, légèreté et humour entre les morceaux, Camille et Margaux signent un set puissant, qui retient notre attention et surtout alimente notre curiosité pour Ottis Cœur, qu’il faudra suivre, c’est certain, dans les prochaines années. Ce sont là les prémices d’un duo bien décidé à chanter fort sans s’excuser.  Le premier confinement arrive, elles s’installent à la campagne dans sa maison familiale et se mettent à composer et à enregistrer ensemble. Isolées, elles vont s’affranchir du regard masculin qui peut mener à l’hésitation ou l’auto-censure et lever les freins éventuels qui pourraient s’interposer avec leur création. « Sans le confinement, on aurait peut-être fait mais plus tard. Être là toutes les deux, préservées des remarques et des doutes, c’était sans barrières. On n’avait jamais joué de batterie avant, on a testé. On avait l’étincelle de l’expérimentation ! », soulignent les membres d’Ottis Cœur. Et pour Margaux, cela marque un tournant décisif dans sa manière d’agir : « Camille m’a inspirée. Avant, je n’aurais jamais osé faire un solo de guitare sur scène. Elle m’a aidée à prendre confiance en moi, à me sentir légitime dans le travail. On discutait beaucoup et c’est important, car un mot positif de quelqu’un-e que tu estimes beaucoup peut tout changer ! » Même son de cloche du côté de sa co-musicienne : « Je n’osais pas sortir de moi-même pour exprimer ma parole et ma voix. J’avais du mal à m’exprimer et à me faire entendre. Margaux m’a permis de libérer plein de trucs ! On trouve des idées à deux, en rebondissant sur ce que dit l’autre… C’est vachement bien ! »
Le premier confinement arrive, elles s’installent à la campagne dans sa maison familiale et se mettent à composer et à enregistrer ensemble. Isolées, elles vont s’affranchir du regard masculin qui peut mener à l’hésitation ou l’auto-censure et lever les freins éventuels qui pourraient s’interposer avec leur création. « Sans le confinement, on aurait peut-être fait mais plus tard. Être là toutes les deux, préservées des remarques et des doutes, c’était sans barrières. On n’avait jamais joué de batterie avant, on a testé. On avait l’étincelle de l’expérimentation ! », soulignent les membres d’Ottis Cœur. Et pour Margaux, cela marque un tournant décisif dans sa manière d’agir : « Camille m’a inspirée. Avant, je n’aurais jamais osé faire un solo de guitare sur scène. Elle m’a aidée à prendre confiance en moi, à me sentir légitime dans le travail. On discutait beaucoup et c’est important, car un mot positif de quelqu’un-e que tu estimes beaucoup peut tout changer ! » Même son de cloche du côté de sa co-musicienne : « Je n’osais pas sortir de moi-même pour exprimer ma parole et ma voix. J’avais du mal à m’exprimer et à me faire entendre. Margaux m’a permis de libérer plein de trucs ! On trouve des idées à deux, en rebondissant sur ce que dit l’autre… C’est vachement bien ! » Le 11 février, en fin d’après-midi, elles sont prêtes. Elles osent, elles montent sur scène, divisées en deux groupes. Snakes 4, tout d’abord. Main Towanda, ensuite. Timides au départ, on sent rapidement que le stress se dissipe pour faire place au plaisir d’être sur scène. Elles prennent des postures rock, s’affranchissent d’une part de leurs appréhensions et saisissent l’instant pour emporter le public dans l’aventure vécue. Et pour finir, c’est ensemble qu’elles entament a cappella une chanson d’amour que Sam déclame en algérien à sa copine, installée au premier rang. Elle a 17 ans et a décidé de s’inscrire au Girls Rock Camp « par goût de la musique ». La faible présence des femmes dans le milieu musical, elle en avait déjà conscience avant de venir. « C’est clair que ça doit changer ! », poursuit-elle. À ses côtés, Jeanne, 17 ans, a été séduite par le côté « être entre meufs dans un groupe » et Pome, 13 ans, est convaincue que cela a permis « de se mieux se lâcher, s’exprimer et se rendre compte qu’on peut se libérer ! J’aurais beaucoup moins osé avec des hommes autour, c’est certain. » Ce qu’elles retiennent de leur stage, c’est l’ambiance et la sororité, la confiance que cela procure. « Il y en avait une qui avait une idée, la disait, on rebondissait. On était ensemble. On a fait ensemble. On a écouté, testé, beaucoup testé… Là, on voyait du soutien partout, on s’encourageait. On n’était pas en rivalité comme on nous fait croire que les femmes sont. On s’est bien entendues et c’est là, quand tu te sens libre que tu sors ton talent à 100% ! », signale Sam.
Le 11 février, en fin d’après-midi, elles sont prêtes. Elles osent, elles montent sur scène, divisées en deux groupes. Snakes 4, tout d’abord. Main Towanda, ensuite. Timides au départ, on sent rapidement que le stress se dissipe pour faire place au plaisir d’être sur scène. Elles prennent des postures rock, s’affranchissent d’une part de leurs appréhensions et saisissent l’instant pour emporter le public dans l’aventure vécue. Et pour finir, c’est ensemble qu’elles entament a cappella une chanson d’amour que Sam déclame en algérien à sa copine, installée au premier rang. Elle a 17 ans et a décidé de s’inscrire au Girls Rock Camp « par goût de la musique ». La faible présence des femmes dans le milieu musical, elle en avait déjà conscience avant de venir. « C’est clair que ça doit changer ! », poursuit-elle. À ses côtés, Jeanne, 17 ans, a été séduite par le côté « être entre meufs dans un groupe » et Pome, 13 ans, est convaincue que cela a permis « de se mieux se lâcher, s’exprimer et se rendre compte qu’on peut se libérer ! J’aurais beaucoup moins osé avec des hommes autour, c’est certain. » Ce qu’elles retiennent de leur stage, c’est l’ambiance et la sororité, la confiance que cela procure. « Il y en avait une qui avait une idée, la disait, on rebondissait. On était ensemble. On a fait ensemble. On a écouté, testé, beaucoup testé… Là, on voyait du soutien partout, on s’encourageait. On n’était pas en rivalité comme on nous fait croire que les femmes sont. On s’est bien entendues et c’est là, quand tu te sens libre que tu sors ton talent à 100% ! », signale Sam.

 Point de départ de l’histoire, le viol n’est pas directement au centre du spectacle qui s’attache, avec rage et panache, à valoriser la quête de Paillette vers la résilience. Pour cela, elle sera accompagnée de la resplendissante sirène, aux gros jambons, à l’allure décapante et aux airs de diva. Dans l’océan de larmes, le trou, le chemin qui pue, le pays magique… Paillette le dit : « Il ne faut pas mourir, je ne courberais pas l’échine. » Annihiler la souffrance. La faire disparaitre. La nier pour ne plus y penser. La colère, contre la culture du viol. L’ivresse, pour s’en échapper et ne plus étouffer. Mais même dans un pays enchanté, sans grues et sans mort-e-s, Paillette est hantée par les questions incessantes et culpabilisantes. Se justifier. Sans arrêt. Elle, la femme qui jouit sans honte et sans détour, la femme qui prend le mic’ face à un gang de mecs qui rappent, la femme qui n’a pas peur de se lancer à l’aventure, d’assouvir ses désirs et de l’ouvrir… Elle se perd. Ne sait plus ce qu’elle veut. Assaillie par la dureté des jugements, elle manque de souffle dans un univers qu’elle croyait bon mais qu’elle découvre nauséabond. Dès lors, une seule obsession : retrouver Cindy.
Point de départ de l’histoire, le viol n’est pas directement au centre du spectacle qui s’attache, avec rage et panache, à valoriser la quête de Paillette vers la résilience. Pour cela, elle sera accompagnée de la resplendissante sirène, aux gros jambons, à l’allure décapante et aux airs de diva. Dans l’océan de larmes, le trou, le chemin qui pue, le pays magique… Paillette le dit : « Il ne faut pas mourir, je ne courberais pas l’échine. » Annihiler la souffrance. La faire disparaitre. La nier pour ne plus y penser. La colère, contre la culture du viol. L’ivresse, pour s’en échapper et ne plus étouffer. Mais même dans un pays enchanté, sans grues et sans mort-e-s, Paillette est hantée par les questions incessantes et culpabilisantes. Se justifier. Sans arrêt. Elle, la femme qui jouit sans honte et sans détour, la femme qui prend le mic’ face à un gang de mecs qui rappent, la femme qui n’a pas peur de se lancer à l’aventure, d’assouvir ses désirs et de l’ouvrir… Elle se perd. Ne sait plus ce qu’elle veut. Assaillie par la dureté des jugements, elle manque de souffle dans un univers qu’elle croyait bon mais qu’elle découvre nauséabond. Dès lors, une seule obsession : retrouver Cindy. Paillette, protagoniste et artiste créatrice, s’affranchit des codes et des étiquettes. Elle convoque les émotions, les paroles, les styles, les notions et les concepts, les secoue et se les approprie. Ne pas déranger. Ne pas faire de bruit. Ne pas bouleverser l’ordre établi. Ne pas baigner dans la vulgarité. Ne pas déborder. Paillette et Sirène envoient tout péter. Elles prennent leur place et leur espace, elles vont trop loin, elles sombrent dans la caricature, elles crient, elles tapent des pieds, elles éclatent les carcans de leur condition de femmes, elles ne revendiquent pas un engagement en particulier. Elles disent, elles font, elles cherchent, elles questionnent, elles avancent, elles s’aident, elles expérimentent et ressentent, elles s’accompagnent, elles nous embarquent avec elles, dans leurs peurs, angoisses, combats, forces, singularités, univers artistiques, succès, etc. Et on plonge. On plonge avec elles dans le trou. On tombe dans le désarroi et la solitude et on comble le vide et le trauma. On remonte à la surface, avec la puissance de l’espoir et la force de la sororité. On se délecte de cette proposition sensible qui explore les recoins d’une âme en souffrance sur le chemin de la résilience. Avec son lot de doutes, de contradictions, de faiblesses, de déni mais aussi de forces, de capacités à rebondir, à s’adapter et à sublimer et à nuancer la noirceur de la réalité. Sans la renier. Ne pas juste survivre. Remonter à la surface, respirer et vivre.
Paillette, protagoniste et artiste créatrice, s’affranchit des codes et des étiquettes. Elle convoque les émotions, les paroles, les styles, les notions et les concepts, les secoue et se les approprie. Ne pas déranger. Ne pas faire de bruit. Ne pas bouleverser l’ordre établi. Ne pas baigner dans la vulgarité. Ne pas déborder. Paillette et Sirène envoient tout péter. Elles prennent leur place et leur espace, elles vont trop loin, elles sombrent dans la caricature, elles crient, elles tapent des pieds, elles éclatent les carcans de leur condition de femmes, elles ne revendiquent pas un engagement en particulier. Elles disent, elles font, elles cherchent, elles questionnent, elles avancent, elles s’aident, elles expérimentent et ressentent, elles s’accompagnent, elles nous embarquent avec elles, dans leurs peurs, angoisses, combats, forces, singularités, univers artistiques, succès, etc. Et on plonge. On plonge avec elles dans le trou. On tombe dans le désarroi et la solitude et on comble le vide et le trauma. On remonte à la surface, avec la puissance de l’espoir et la force de la sororité. On se délecte de cette proposition sensible qui explore les recoins d’une âme en souffrance sur le chemin de la résilience. Avec son lot de doutes, de contradictions, de faiblesses, de déni mais aussi de forces, de capacités à rebondir, à s’adapter et à sublimer et à nuancer la noirceur de la réalité. Sans la renier. Ne pas juste survivre. Remonter à la surface, respirer et vivre.

 Or, les femmes, de tous temps et de toutes origines, ont créé elles aussi le monde d’hier et d’aujourd’hui et pensé le monde de demain. On ne les retient pas ? Parce que l’Histoire est écrite par les hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc. pour les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc.
Or, les femmes, de tous temps et de toutes origines, ont créé elles aussi le monde d’hier et d’aujourd’hui et pensé le monde de demain. On ne les retient pas ? Parce que l’Histoire est écrite par les hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc. pour les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc. Il comble le vide, rétablit l’équilibre et chasse l’absence de ces figures féminines dont les témoignages, passant par le théâtre documentaire ou la fiction, ou le mélange des deux, délivrent un message puissant. La transmission opère et interroge alors l’impact des représentations sur l’ensemble des sociétés et leur vision des filles et des femmes.
Il comble le vide, rétablit l’équilibre et chasse l’absence de ces figures féminines dont les témoignages, passant par le théâtre documentaire ou la fiction, ou le mélange des deux, délivrent un message puissant. La transmission opère et interroge alors l’impact des représentations sur l’ensemble des sociétés et leur vision des filles et des femmes. Pareil du côté de Caroline Alaoui : « Au départ, on pensait adapter des œuvres autour du matrimoine et puis en se mettant à l’écriture, on a fini par écrire nos textes et à en faire une création à proprement parler. La question de la légitimité est toujours centrale. En tant que jeunes autrices, il faut toujours se convaincre que nos mots sont à la hauteur. Les temps de recherches étaient très nourrissants, empouvoirants. De ce travail est née l’envie de mettre en parallèle ces femmes et ce qui résonnait en nous (pas dans l’immédiat mais ce sera certainement pour une suite). Et ça nous a posé la question de la place des femmes dans le milieu théâtral. Et nous a poussé à avoir une réflexion sur comment on estimait la valeur de notre travail en tant que créatrices. S’autoriser à rêver grand. À rêver normal, en fait. Au contact de toutes ces femmes, dont on parle et avec qui on travaille, on a pris confiance en nous. »
Pareil du côté de Caroline Alaoui : « Au départ, on pensait adapter des œuvres autour du matrimoine et puis en se mettant à l’écriture, on a fini par écrire nos textes et à en faire une création à proprement parler. La question de la légitimité est toujours centrale. En tant que jeunes autrices, il faut toujours se convaincre que nos mots sont à la hauteur. Les temps de recherches étaient très nourrissants, empouvoirants. De ce travail est née l’envie de mettre en parallèle ces femmes et ce qui résonnait en nous (pas dans l’immédiat mais ce sera certainement pour une suite). Et ça nous a posé la question de la place des femmes dans le milieu théâtral. Et nous a poussé à avoir une réflexion sur comment on estimait la valeur de notre travail en tant que créatrices. S’autoriser à rêver grand. À rêver normal, en fait. Au contact de toutes ces femmes, dont on parle et avec qui on travaille, on a pris confiance en nous. » Ne pas oublier celles qui œuvrent à rendre le matrimoine tout aussi vivant que les spectacles qu’elles écrivent, créent et mettent en scène. Et profiter de l’éclairage qui lui ait fait actuellement.
Ne pas oublier celles qui œuvrent à rendre le matrimoine tout aussi vivant que les spectacles qu’elles écrivent, créent et mettent en scène. Et profiter de l’éclairage qui lui ait fait actuellement.

 Dans les musiques actuelles et les musiques traditionnelles, on retrouve les plus grosses inégalités avec des chiffres choquants : sur 562 concerts étudiés, 3 se sont déroulés sans aucun homme et 71 sans aucune femme. Soit 12,5% des concerts sans femmes.
Dans les musiques actuelles et les musiques traditionnelles, on retrouve les plus grosses inégalités avec des chiffres choquants : sur 562 concerts étudiés, 3 se sont déroulés sans aucun homme et 71 sans aucune femme. Soit 12,5% des concerts sans femmes.


 Pareil pour Amélie Grosselin, qui parle aussi d’un gain de confiance en elle, et pour Astrid Radigue, qui constate une écoute différente, où l’égo prend moins le pas sur la création et le temps accordé à se comprendre et évoluer ensemble. Claire Grupallo ne partage pas ces ressentis.
Pareil pour Amélie Grosselin, qui parle aussi d’un gain de confiance en elle, et pour Astrid Radigue, qui constate une écoute différente, où l’égo prend moins le pas sur la création et le temps accordé à se comprendre et évoluer ensemble. Claire Grupallo ne partage pas ces ressentis.

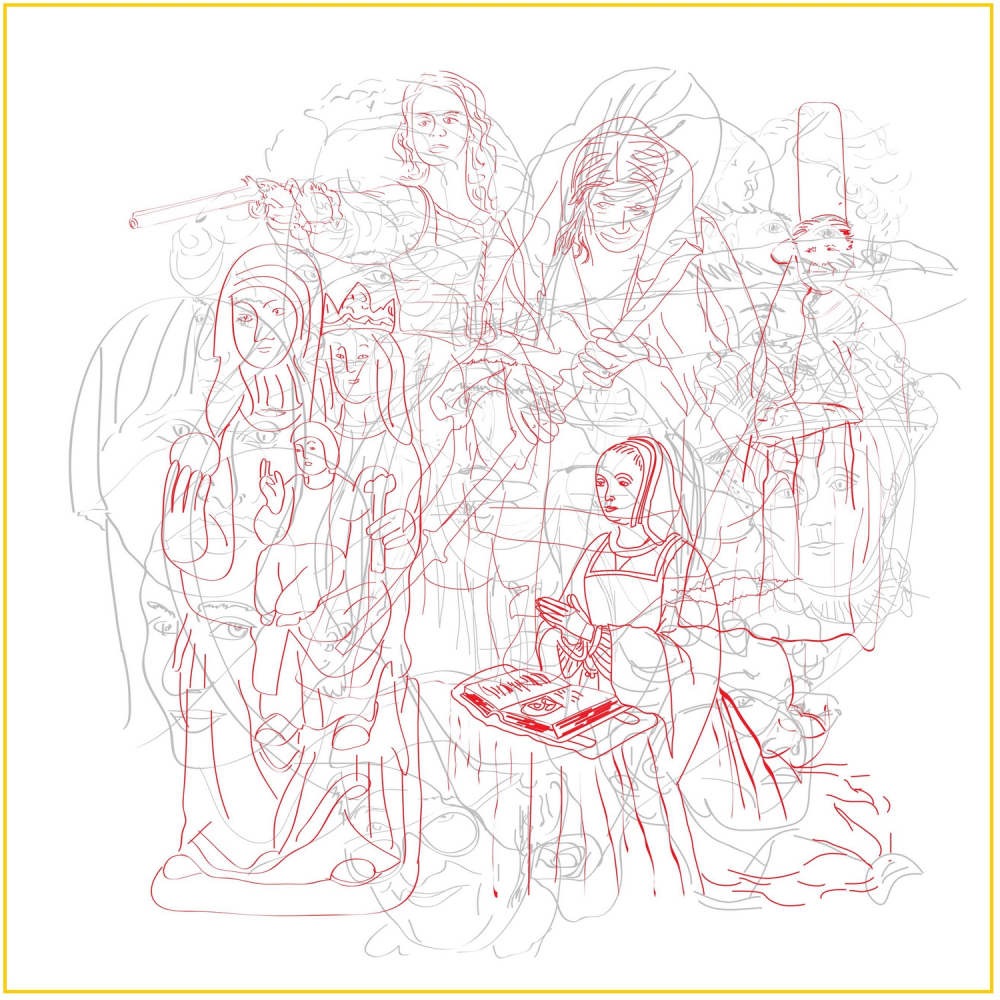 Elles partagent néanmoins cette volonté de mettre en lumière toutes les artistes qui ont participé à la vie culturelle et sociale de la région mais qui ont été oubliées, ignorées, méprisées. Parce qu’elles sont femmes et que l’Histoire est écrite par et pour les hommes.
Elles partagent néanmoins cette volonté de mettre en lumière toutes les artistes qui ont participé à la vie culturelle et sociale de la région mais qui ont été oubliées, ignorées, méprisées. Parce qu’elles sont femmes et que l’Histoire est écrite par et pour les hommes.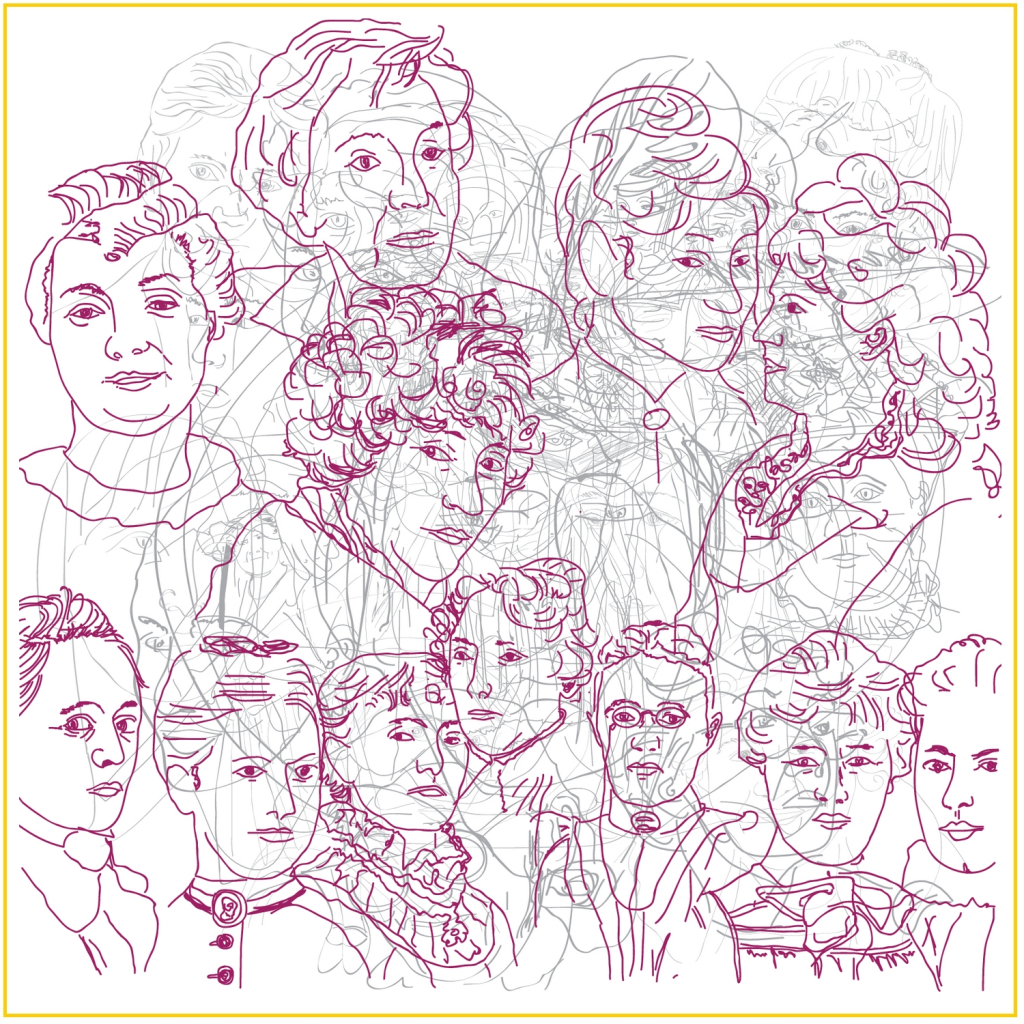 Le podcast s’attache à décrypter ce processus d’invisibilisation subi par les femmes et qui s’étend tout autant aux personnes LGBTIQ+ et aux personnes racisées. Mais il s’attache aussi à mettre en exergue des initiatives actuelles comme le mentorat mis en place par la Fedelima dans le secteur des musiques actuelles, formant des binômes sur des fonctions encore très genrées comme les postes de direction, de technique, etc. Ou encore les actions régulières de l'association Histoire du féminisme à Rennes.
Le podcast s’attache à décrypter ce processus d’invisibilisation subi par les femmes et qui s’étend tout autant aux personnes LGBTIQ+ et aux personnes racisées. Mais il s’attache aussi à mettre en exergue des initiatives actuelles comme le mentorat mis en place par la Fedelima dans le secteur des musiques actuelles, formant des binômes sur des fonctions encore très genrées comme les postes de direction, de technique, etc. Ou encore les actions régulières de l'association Histoire du féminisme à Rennes. Tirer le fil de cette histoire permet de créer un choc. Une prise de conscience. C’est d’ailleurs là le reflet de tout le travail mené par HF Bretagne qui compte et établit un diagnostic chiffré tous les deux ans sur la place des femmes dans les arts et la culture en Bretagne.
Tirer le fil de cette histoire permet de créer un choc. Une prise de conscience. C’est d’ailleurs là le reflet de tout le travail mené par HF Bretagne qui compte et établit un diagnostic chiffré tous les deux ans sur la place des femmes dans les arts et la culture en Bretagne.