Aujourd’hui, les femmes comptent. Elles comptent leurs mortes, assassinées par leur compagnon ou ex compagnon. Elles comptent leurs mortes, tuées ou poussées au suicide parce qu’elles sont trans. Elles comptent le nombre de personnes sexisées victimes de harcèlement de rue, harcèlement sexuel, harcèlement moral, d’agression-s sexuelle-s, viol-s, de violences conjugales.
Elles comptent les écarts de salaire. Elles comptent la répartition sexuée des métiers et des fonctions, dans les institutions, les lieux de pouvoir et de décision, dans les lieux de représentation. Elle compte le nombre de personnes noires dans la salle lors de la cérémonie des César (mais ça, en France, on n’aime pas du tout, sauf si c’est une personne blanche ou un homme racisé - et encore - qui le fait). L’heure est à la prise en compte. De tou-te-s. Malgré les résistances, on avance.
Cette révolution, elle est colossale. Parce que oui, il s’agit bien d’une révolution. Pas de suspens. Au début de cette enquête, une interrogation : vivons-nous actuellement une révolution féministe ? Autour de nous, dans les manifestations, sur les réseaux sociaux, les mots associés au féminisme se multiplient et se croisent.
Riposte, vague, révolution… Les termes claquent. Ils sont forts et puissants et ils s’embrasent ainsi alliés à la détermination des militant-e-s, toujours plus nombreux-euses dans leurs actions. Ils interpellent, également.
RIPOSTE ET VAGUES FÉMINISTES
Le 6 juillet 2020, Gérald Darmanin est nommé ministre de l’Intérieur et Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justice. Le duo renforce l’affront : le gouvernement nie clairement et explicitement les droits des femmes en nommant grand manitou de la police un homme accusé de viols et garde des sots, un antiféministe notoire.
 Quelques jours plus tard, des mobilisations féministes occupent l’espace public pour dénoncer l’hypocrisie du président Macron et de sa (fausse) grande cause du quinquennat. Les militantes brandissent des pancartes, prônant « la riposte féministe », expression largement reprise lors des manifestations autour du 25 novembre, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles à l’encontre des personnes sexisées.
Quelques jours plus tard, des mobilisations féministes occupent l’espace public pour dénoncer l’hypocrisie du président Macron et de sa (fausse) grande cause du quinquennat. Les militantes brandissent des pancartes, prônant « la riposte féministe », expression largement reprise lors des manifestations autour du 25 novembre, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles à l’encontre des personnes sexisées.
Au-delà du débat que cela génère sur la présomption d’innocence – quid de celle des victimes que l’on positionne d’office en vilaines menteuses ? – on se questionne sur le terme « riposte ». La définition nous indiquant qu’il s’agit d’une action vigoureuse de défense, une réponse instantanée faite à un interlocuteur agressif, son usage dans un tel contexte nous apparaît très à propos.
C’est un volet de l’histoire du féminisme. Une histoire que l’on décompose en « vagues ». Un terme qui provoque un malaise chez Mathilde Larrère, historienne, spécialisée dans les mouvements révolutionnaires du XIXe siècle. Ainsi, en introduction de son ouvrage Rage against the machisme, elle décortique cette notion de vague, partant du postulat que nous en sommes, dans le monde entier, à la troisième avec des mobilisations et manifestations importantes dans le monde pour le droit à l’IVG (Irlande, Argentine, Pologne…) et contre les violences sexistes et sexuelles et leur impunité, avec #NiUnaMenos, repris dans de nombreuses langues. On fait de l’hymne des Chiliennes « Un violador en tu camino » un chant contestataire international.
« « Troisième vague », donc… La « seconde » étant celle des années 1970, et la « première », celle des Suffragettes de la fin du XIXe siècle. Mais avant ? Il n’y aurait rien ? Pas de vague ? Calme plat ? Toutes ces femmes qui ont lutté pour leurs droits avant la fin du XIXe siècle, on les oublie ? Voilà bien ce qui me gêne dans cette terminologie : l’effacement de décennies de combats et de bataillons de combattantes. », analyse-t-elle.
Elle poursuit un peu plus loin : « L’autre défaut de cette image des vagues est de tendre à associer une vague à une lutte – le droit de vote pour la première, l’IVG pour la seconde, et la bataille du corps et de l’intime pour la troisième. Une lecture qui, déjà, ne laisse pas de place aux combats féministes pour le travail, pour le droit au travail, pour les droits des travailleuses ; lesquels s’inscrivent pleinement sur la longue durée et suivant un calendrier qui leur est propre.
Donc une lecture qui évacue le prisme de la classe et de la lutte des classes, pourtant menée aussi au féminin, et parfois même contre le mouvement ouvrier. Les ouvrières ne sont pas les seules invisibilisées par cette lecture : les femmes racisées, les homosexuelles, peinent aussi à trouver place dans le roman national féministe. Qui plus est, à trop associer une vague à une lutte, on en oublierait que tout au long de l’histoire des luttes des femmes, presque toutes les revendications ont été portées ensemble. (…)
Les luttes se croisent, se répondent et tendent donc la main dans le temps. Finalement, la discontinuité des luttes féministes est plus à chercher dans l’écoute sélective des revendications des femmes, et la mémoire plus sélective encore qu’on en a, que dans le contenu de leurs revendications. »
UNE RÉVOLUTION LENTE ET PROGRESSIVE
Si on schématise rapidement, il y a des moments de fortes mobilisations donnant lieu à des avancées, toujours accompagnées de leur retour de bâton, le fameuxbacklashdont parle Susan Faludi dans son livre éponyme paru au début des années 90, et des moments de creux, durant lesquels on pense le féminisme en sommeil.
C’est alors penser que les personnes oppressées peuvent s’octroyer le loisir de stopper leurs luttes pour leurs droits et leur dignité. Néanmoins, il y a bel et bien des périodes plus fédératrices que d’autres. Ainsi, Mathilde Larrère explique :
« Les vagues ne correspondent finalement pas à des moments où des femmes prennent la parole (ce qu’elles tentent toujours de faire) mais plutôt aux rares moments où l’on daigne les écouter, les entendre – pour assez vite tenter de les faire taire et les renvoyer aux fourneaux. Les femmes profitent souvent des séquences révolutionnaires qui, généralement, permettent à d’autres voix que celles des dominants de s’exprimer. C’est vrai tout au long du XIXe siècle mais aussi après 1968. »
De là nait notre interrogation initiale : qu’est-ce qui caractérise précisément ce mouvement global de luttes ? La révolution ? Pas celle de 1789, non, même si l’historienne la place en point de départ des luttes des femmes, qu’elle différencie des luttes de femmes qui avaient déjà lieu en amont :
« Parce que la Révolution accouche de la citoyenneté, de l’espace public, des libertés publiques, parce que des femmes commencent en tant que femmes, entre femmes, un processus d’organisation, d’association dans leur lutte, et, ce faisant, deviennent un mouvement. »
Une révolution féministe de longue haleine a bel et bien lieu. Avec des hauts et des bas. Avec des victoires et des échecs. Une révolution qui comme le disait la poétesse afro-féministe Pat Parker en 1980 n’est « ni propre, ni jolie, ni rapide ». Lors d’une conférence à Oakland, elle déclarait :
« Je suis féministe révolutionnaire parce que je veux être libre. Et il est absolument crucial que, vous qui êtes ici présentes, vous vous impliquiez dans la révolution en partant du principe que c’est pour vous que vous faites la révolution. »
Cette révolution, elle est culturelle, nous précise Mathilde Larrère, dans le sens où les féminismes influent sur les changements profonds des mentalités.
Dans nos imaginaires et dans les dictionnaires, l’association révolution et violences opère instantanément. La spécialiste nous indique que c’est là une idée reçue :
« Elle est construite par le discours anti-révolutionnaire justement. La violence n’est pas systématique. Si on prend la révolution des Œillets, ce n’est pas violent. Dans une révolution, il y a renversement d’un ordre établi. Dans les luttes féministes, il s’agit par exemple non pas de renverser l’ordre des sexes mais de l’équilibrer. La violence qui peut survenir émane de l’ordre qui se défend. Si l’ordre se laisse renverser, il n’y a pas de violence. Il faut faire attention : on pense violences et révolution comme un couple alors qu’on n’associe pas colonisation et violences… »
Parfois galvaudé, parfois remis en cause, parfois admis parce que tombé dans le langage commun, il y a des indicateurs auxquels se fier pour pouvoir qualifier un mouvement de révolutionnaire. La masse en est un, l’impression de soulèvement « parce qu’on ne fait pas une révolution à 10. » La fusion est essentielle également :
« Des groupes qui ne sont pas forcément d’accord en général s’allient pour renverser l’ordre. Ça on le retrouve dans les féminismes, le côté polyvoque, à plusieurs voix. Tout comme la nécessité d’une masse interclassiste : dans une révolution, il n’y a jamais que les bourgeois-es ou que les prolétaires… C’est le cas aussi des révolutions féministes. »
Et puis l’objectif de renverser un ordre, en l’occurrence ici l’ordre patriarcal afin d’équilibrer les rapports entre les femmes et les hommes.
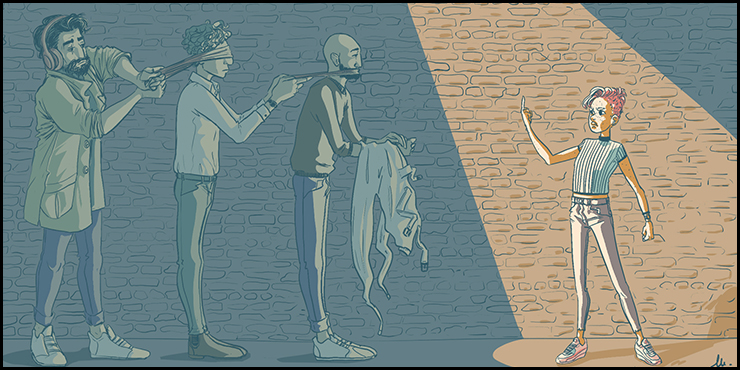
AFFRONTER L’ORDRE PATRIARCAL
C’est un ordre terriblement enraciné. Dans toutes les sphères de la société. Des siècles de domination masculine ont entravé les droits des femmes. Les combats pour rétablir l’équilibre sont nombreux. Ils sont même gigantesques et exigent une volonté et une détermination solides, minutieuses, de tous les instants. Fatiguant. Être sur tous les fronts. Impossible.
Les luttes des femmes s’inscrivent dans une (r)évolution progressive et se heurtent à la fois à l’obscurantisme religieux, à la force du capitalisme – qui aime à faire penser qu’il œuvre pour le confort et l’émancipation des femmes – ainsi qu’aux sceptiques, aux privilégié-e-s qui résistent et aux faux semblants d’un monde qui grâce à son siècle des Lumières, aux progrès scientifiques et à l’industrialisation des territoires se réclame moderne et revendique fièrement « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Voilà, Fraternité. Droits de l’Homme. Patrimoine. Vous l’entendez, là, l’invisibilisation des femmes ? Vous la sentez venir l’uniformisation du langage vers un neutre parfaitement inexistant dans la langue (binaire) française ? On connaît bien la chanson : ces termes englobent autant le masculin que le féminin mais on ajoute une nuance pas du tout anodine : le masculin l’emporte sur le féminin.
C’est ce qu’on nous a appris à l’école. Tout comme le fait que ce sont les hommes qui ont marqué l’Histoire. Des hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, bien placés dans l’échelle sociale. Ainsi, la norme est instaurée. Si vous en êtes exclu-e-s, sortez les rames, vous allez galérer à trouver votre place dans la société !
Engagée en faveur des droits civils et politiques des femmes et l’abolition de l’esclavage, Olympe de Gouges s’offusque de ce processus en 1791 et rédige la désormais célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle s’indigne que les femmes aient été écartées de la rédaction de la Constitution et appelle celles-ci à s’unir et faire corps avec la société.
Ainsi, elle pointe l’isolement de la gent féminine et cela rejoint le propos de Mathilde Larrère : à la suite de la Révolution, les femmes constatant qu’elles ne sont ni écoutées, ni entendues, ni prises en compte, vont s’organiser en non mixité. La bande dessinée Histoire(s) de femmes – 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits, réalisée par Marta Breen et Jenny Jordahl, prend comme point de départ - sur un plan international - le congrès antiesclavagiste qui a lieu en Angleterre en 1840.
Dans la délégation américaine, des femmes sont présentes, embarrassant fortement les hommes qui les autorisent, grands seigneurs, à assister au rassemblement. Cachées derrière un rideau... Scandalisées par cette injustice, plusieurs femmes rédigent elles aussi une déclaration sur l’égalité des sexes sur le modèle de la déclaration d’indépendance américaine, qui fut présentée à la convention abolitionniste de Seneca Falls, état de New York, en 1848.
« Ce rassemblement est considéré comme l’acte fondateur du mouvement féministe », nous indique la BD qui enchaine la page suivante sur la lutte des femmes contre l’esclavage.
FAIRE CORPS AVEC (UNE PARTIE DE) LA SOCIÉTÉ
Elles y ont participé, notamment avec Harriet Tubman, qui s’est libérée de sa condition d’esclave et a aidé de nombreux-euses autres à s’enfuir. À la fin de la guerre civile en 1865, les noirs obtiennent le droit de vote. Les femmes, non. Harriet Tubman prend part à la première association américaine pour le droit de vote des femmes, l’ancienne esclave Sojourner Truth prononce un discours dans lequel elle pointe les inégalités entre les droits des hommes et les femmes de couleur, et pourtant ce que l’on retient et que l’on montre de cette période historique outre-Atlantique mais aussi européenne, notamment en Angleterre avec le mouvement des Suffragettes, est entièrement blanche.

Si antiesclavagisme et antisexisme se sont côtoyés dans cette moitié du XIXe siècle, distinction est ensuite faite entre les femmes non blanches, laissées sur le bas côté, et les femmes blanches. Ces dernières accèdent à l’éducation, réduite certes et principalement destinée à les préparer aux assignations de genre et aux métiers manuels précaires, à la pénibilité incontestablement néfaste.
Elles militent pour l’obtention de droits sociaux et l’accès à la citoyenneté, et cela passe par le droit de s’exprimer et donc par le droit de voter. Faiblement écoutées, voire inconsidérées dans leur demande, elles passent à l’action, se forment pour certaines à l’auto-défense, comme le montre notamment la BD Jujitsuffragettes de Clément Xavier et Lisa Lugrin, et prennent les armes.
Explosions, incendies, manifestations, grève de la faim… les militantes finiront, non sans polémique, par se faire entendre et obtenir gain de cause. Victoire marquante. Les dates diffèrent d’un pays à l’autre : en France, c’est 1944. Pour autant, elles sont loin d’être libres puisqu’elles sont encore sous la tutelle des pères, des maris ou des frères.
Mais les travailleuses, et notamment les ouvrières, prennent petit à petit part au mouvement et œuvrent pour des revalorisations salariales et des conditions décentes de travail. En Bretagne, l’histoire régionale est marquée par les mouvements des Penn Sardin, par exemple. Elles ne seront pas les seules.
CHOISIR OU SUBIR ?
Elles ont fourni l’effort de guerre, démontré leurs capacités à gérer de front travail et gestion du foyer, maintenant elles veulent choisir. Dans la deuxième partie du XXe siècle, c’est la sexualité et la maternité qui sont visées. « Un enfant, si je veux, quand je veux ! »
Le slogan retentit dans les années 70. Les femmes veulent maitriser leur contraception. Depuis 1920, la publicité anticonceptionnelle est interdite, tout comme il est interdit aux médecins de divulguer des informations à ce sujet à l’égard de leurs patientes.
En 1942, le gouvernement de Pétain, définit l’avortement comme un crime à l’encontre de l’Etat. Il est passible de la peine de mort. Ce n’est qu’en 1967 que la loi Neuwirth sur la contraception est adoptée mais il faudra attendre encore 5 ans avant qu’elle ne soit remboursée par la Sécurité sociale, ce qui obligatoirement crée des inégalités entre les femmes.
Tout comme la loi Veil de 1975 autorisant l’IVG d’abord pour 5 ans, puis reconduite définitivement en 1979 – et depuis elle est constamment menacée. Il faudra attendre la loi Roudy de 1988 pour que l’avortement soit remboursé par la Sécurité sociale.
Ce sont là des droits conquis, des droits arrachés. Par des longues luttes acharnées. À la sueur du front. De très nombreuses femmes sont mortes à la suite d’avortements clandestins, d’autres sont mortes condamnées parce qu’elles avaient aidé des consœurs à interrompre leur grossesse, à l’instar de Marie-Louise Giraud, faiseuse d’anges dénoncée par son mari et guillotinée en 1943, incarnée par Isabelle Huppert dans le film Une affaire de femmes, de Claude Chabrol.
Depuis les militantes ne cessent de défendre ce droit, particulièrement menacé aujourd’hui encore et terriblement inégal selon les pays qui décident des conditions dans lesquelles une femme peut y accéder (danger pour la santé ou la vie de la mère, grossesse après un viol, nombre de semaines légales d’aménorrhées…).
Sans parler de la double clause de conscience, spécifiquement inscrite dans la loi d’une part et celle accordée aux médecins d’autre part. Intrinsèque à ce droit, c’est la liberté du corps que les féministes défendent. Le droit de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Le droit de choisir. L’histoire des luttes des femmes ne s’arrête pas là, évidemment.
En parallèle, les combats pour l’émancipation se poursuivent. Pouvoir travailler sans autorisation du mari, posséder un chéquier sans autorisation du mari, obtenir à travail égal un salaire égal… L’autonomie est le maitre mot de cet énorme coup de pied dans la fourmilière.
Le capitalisme l’entend et se fait un plaisir de répondre aux besoins des femmes en leur concevant des appareils électroménagers sur mesure, taillés pour leur confort. Merci Moulinex ! Le leurre est de courte durée mais participe à faire accepter la double journée des femmes, désormais présentées comme des Super Femmes, capables d’entreprendre travail, courses, ménage, éducation des enfants, repas, tout ça en n’oubliant pas de répondre aux injonctions à la beauté parce qu’avec tout ça, il ne s’agirait pas de « se laisser aller »...
Parce que oui, la femme parfaite et unique, est mince, hétéro, cisgenre, blanche, mère accomplie, épouse comblée, travailleuse épanouie et amie fidèle. Ça y est, l’égalité est là, elle est acquise. Celles qui poursuivent le combat sont des hystériques, rabat joie, surement lesbiennes parce que mal baisées. Waw, pause. Interruption des programmes. La réalité proposée est un écran de fumée. Nocive. Réductrice et oppressante.
UN RÉCIT PARTIEL
A force d’être bercé-e-s à l’ambiance Disney et aux rayons bleus pour les garçons et roses pour les filles, on se serait laissé-e-s berner ? Pas tout le monde. Pas tout le temps. Il existe des périodes durant lesquelles les causes féministes mobilisent moins, voire beaucoup moins. Le terme est carrément diabolisé, rejeté.
 Cependant, il y a toujours des militantes pour rompre l’ordre patriarcal. Pour dénoncer les travers capitalistes, sexistes et racistes. Pourtant, des années 70, on ne retient qu’un récit partiel. L’avortement est illégal et on se bat pour le rendre légal. En métropole. Parce qu’au même moment, à La Réunion, des milliers d’avortements et de stérilisations sont pratiqué-e-s par des médecins blancs sans le consentement des femmes, stigmatisées en raison de leur couleur de peau comme l’analyse Françoise Vergès dans Le ventre des femmes – Capitalisme, racialisation, féminisme.
Cependant, il y a toujours des militantes pour rompre l’ordre patriarcal. Pour dénoncer les travers capitalistes, sexistes et racistes. Pourtant, des années 70, on ne retient qu’un récit partiel. L’avortement est illégal et on se bat pour le rendre légal. En métropole. Parce qu’au même moment, à La Réunion, des milliers d’avortements et de stérilisations sont pratiqué-e-s par des médecins blancs sans le consentement des femmes, stigmatisées en raison de leur couleur de peau comme l’analyse Françoise Vergès dans Le ventre des femmes – Capitalisme, racialisation, féminisme.
Et puis, on a oublié les réflexions sur l’hétéronormativité. Dans les années 60-70, l’identité lesbienne devient une identité collective, portée politiquement, signale Mathilde Larrère dans Rage against the machisme :
« On leur doit alors une grande partie de la production théorique et pratique. Les lesbiennes ne s’en sont pas moins retrouvées marginalisées, à l’intérieur du mouvement LGBT, qui reproduisait la domination masculine des gays, et à l’intérieur du mouvement féministe, les obligeant à construire des espaces d’autonomie entre les deux. C’est ainsi que nait, en avril 1971, le mouvement des Gouines rouges autour, notamment, de Marie-Jo Bonnet, Christine Delphy et Monique Wittig. Ce sont elles qui ont permis de comprendre à quel point la domination masculine repose sur l’hétérosexualité obligatoire et sur les contraintes qui pèsent sur le corps et la sexualité des femmes. »
On a aussi sans doute oublié que le célèbre procès survenu dans les années 70 à l’issue duquel le viol deviendra enfin un crime, on le doit à la lutte acharnée d’Anne Tonglet et Araceli Castellano pour que les viols qu’elles ont subi près de Marseille ne soient pas correctionnalisés mais bel et bien jugés devant une cour d’assise. Le couple lesbien sera défendu par l’avocate féministe franco-tunisienne Gisèle Halimi.
Les chemins semblent séparés, divisés. Impossibles à réconcilier ? Rien n’est moins sûr. Le renouveau déboule et accrochez-vous, ça va souffler fort. Le mouvement ne ronronne pas, il hurle ! S’il y a parfois incompréhension entre les générations, ce sont bel et bien les combats de nos ainées que l’on poursuit.
Malgré les dissensions et les tentatives pour éteindre le feu, le flambeau est passé. Le féminisme est appelé à se renouveler et à ne plus s’écrire et se retenir au singulier. Cette histoire est plurielle, tout autant que les militantes sont plurielles. Les femmes ne sont pas une masse homogène. Et ça, il va falloir en tenir compte.
Parce que des femmes aiment des femmes, parce que des femmes naissent assignées hommes, parce que des personnes ne se reconnaissent pas dans la binarité du genre, parce que des femmes sont handicapées, parce que des femmes sont non blanches, parce que des femmes sont mutilées à la naissance pour être définies comme femmes, parce que des femmes vivent des oppressions multiples, parce que des femmes sont voilées, parce que des femmes ne veulent pas d’enfant, etc.
Refuser les injonctions. Accepter les paradoxes. Écouter les personnes concernées. S’affranchir des normes. Sortir de la domination. Penser d’autres rapports sociaux. S’approprier son corps. Le revendiquer. Voilà les enjeux des féminismes actuels. Un idéal aujourd’hui accessible pour demain parce que les luttes d’hier ont eu lieu. Mais bien souvent, on les oublie, en partie. Et l’histoire des luttes féministes n’est pas enseignée à l’école. Ne ferait-elle pas partie de l’Histoire ?
S’il y a des féminismes, c’est parce que comme le dit Priscilla Zamord, « il n’y a pas un féminisme qui prend en compte toutes les formes d’oppression. » Vice-présidente en charge des Solidarités, de l’Égalité et de la Politique de la ville au sein de Rennes Métropole et conseillère municipale à la ville de Rennes, elle figurait dans le binôme tête de liste des écologistes lors de la campagne électorale en 2020.
Engagée dans l’économie sociale et solidaire, elle a notamment co-fondé l’association d’insertion par la culture La Distillerie, à Fort-de-France en Martinique, et la ressourcerie La Belle Déchette à Rennes. Priscilla Zamord se présente comme bretonne d’outre mer, militante écologiste, anticapitaliste, antiraciste et féministe.
« C’est important de pouvoir se situer. Ces engagements, nourris par mon expérience personnelle et les vécus des femmes, je les rassemble sous la grande bannière de l’écologie politique. J’ai vécu des discriminations en tant que femme métisse perçue comme noire qui se revendique queer. C’est une identité hybride et je n’ai pas envie de choisir mon identité selon le jour de la semaine, ni ma lettre LGBTI… »
explique-t-elle.
Ses propos rejoignent ceux d’Aurélia Décordé Gonzalez, fondatrice et directrice de déCONSTRUIRE, association rennaise d’éducation populaire travaillant sur l’articulation des rapports de domination raciste et sexiste. Elle ne peut pas choisir le lundi d’être noire, le mardi d’être femme, le mercredi directrice, etc.
Elle est un tout et ne peut scinder son identité en fragments. L’absence d’imbrication des luttes, et plus particulièrement l’absence de prise en compte des oppressions au croisement des questions raciales et du genre, c’est ce qu’elle a non seulement ressenti mais surtout constaté en s’investissant dans des associations féministes puis des associations antiracistes.
Ainsi, poursuit Priscilla Zamord : « Il est nécessaire de déconstruire ces oppressions qui sont liées. Tout est lié ! »
TOUT EST LIÉ
 Si des mobilisations et événements militant-e-s ont lieu toute l’année, il y a tout de même deux dates qui s’inscrivent depuis longtemps dans le calendrier : le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La première provient des luttes ouvrières et suffragistes.
Si des mobilisations et événements militant-e-s ont lieu toute l’année, il y a tout de même deux dates qui s’inscrivent depuis longtemps dans le calendrier : le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La première provient des luttes ouvrières et suffragistes.
Dans ce contexte, Clara Zetkin propose la création d’une journée internationale des femmes, en 1910 lors de la conférence des femmes socialistes. En 1917, la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg ancre le 8 mars comme la date traditionnelle reconnue officiellement par l’ONU en 1977 et instaurée en France en 1982. La seconde provient de l’assassinat - commandité par le dictateur Rafael Trujillo – des militantes politiques dominicaines Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal, le 25 novembre 1960.
Ainsi, la République Dominicaine propose en leur honneur une journée de lutte contre les violences faites aux femmes. En décembre 1999, l’assemblée générale de l’ONU reconnaît officiellement cette date comme la Journée internationale pour l’élimination des violences contre les femmes.
Elles sont emblématiques ces dates et marquent désormais les nombreuses luttes contre les violences sexistes et sexuelles à l’égard des personnes sexisées. Une évolution qui prône l’inclusion des personnes trans, intersexes et non binaires dans le combat global. En quelques décennies, les manifestations organisées par les associations et structures militantes ont vu les rangs se grossir. Drastiquement même ces dernières années.
C’est l’ère des mouvements #MeToo avec en France, la naissance du collectif Nous Toutes et l’appel à la politisation et l’inclusion - lors de la marche du 24 novembre 2018 - de plusieurs autres regroupés sous l’intitulé Nous Aussi, soulignant le caractère collectif de l’oppression patriarcale.
L’IMPACT DE METOO
#MeToo, c’est une explosion. Une déferlante. Les réseaux sociaux éclatent magistralement les murs invisibles qui empêchent les femmes du monde entier de démontrer que certains de leurs vécus sont communs. Là où avant, on pouvait se réfugier derrière une parole isolée et la stigmatiser, on est désormais obligé-e-s de reconnaître l’existence d’une problématique globale. 2017 marque un tournant vertigineux dans la grande histoire des féminismes.
A moins qu’on ait encore négligé une partie de cette histoire… ? Il suffit de taper « mouvement metoo » sur un moteur de recherche pour découvrir qu’il a été lancé 10 ans auparavant. Par Tarana Burke. Travailleuse sociale afro-américaine, elle se définit comme survivante d’une agression sexuelle et crée en 2007 le « Me Too Movement » en soutien aux victimes d’agressions sexuelles dans les quartiers défavorisés.
L’actrice Alyssa Milano, le 15 octobre 2017, soit quelques jours après les révélations édifiantes visant le producteur Harvey Weinstein – condamné en mars 2020 à 23 ans de réclusion pour viols et agressions sexuelles – écrit sur Twitter : « Si vous avez été harcelé-e-s ou agressé-e-s sexuellement, écrivez « me too » en réponse à ce tweet. » Un cataclysme planétaire s’en suit, inondant les réseaux sociaux et l’actualité médiatique.
Des millions de messages, en moins de 24h, témoignent du caractère systémique et genré des violences sexuelles. Le lendemain, Alyssa Milano tweete à nouveau : elle vient de découvrir un précédent mouvement #MeToo et partage alors le combat de Tarana Burke. Pourtant, on retiendra que c’est l’actrice qui en est à l’initiative. Nouvelle invisibilisation des femmes racisées.
Le mouvement poursuit sa route et essuie de nombreuses polémiques. En France, le lancement du #BalanceTonPorc par la journaliste Sandra Muller crée un débat virulent et touche un enjeu central : on tolère que les femmes témoignent des faits subis mais on s’insurge si elles dénoncent publiquement et nommément leurs agresseurs.
Rage et panique se lisent dans les discours de celleux qui argumentent « que cela nuirait à la vie de ceux qui sont visés » par des accusations systématiquement prônées comme mensongères. Servant simplement à assouvir une vengeance personnelle. Un discours que l’on retrouve du côté des forces de l’ordre quand une personne sexisée tente de porter plainte.
Si le hashtag MeToo est davantage usité, car beaucoup plus politiquement correct et sans lien avec les animaux et donc une quelconque volonté spéciste (oui, critique est faite aussi sur cet aspect), les militantes font front. Elles ne lâcheront pas, elles ne lâcheront rien.
 On brandit la présomption d’innocence à chaque fois qu’un homme – de pouvoir – est visé ? Elles brandissent la présomption de sincérité des victimes. Elles hurlent leurs colères et combattent d’une main le mythe de la virilité et de l’autre le mythe du prédateur. La masculinité toxique et hégémonique doit être déconstruite en parallèle des réflexions sur la féminité unique, instituées par le patriarcat et le capitalisme.
On brandit la présomption d’innocence à chaque fois qu’un homme – de pouvoir – est visé ? Elles brandissent la présomption de sincérité des victimes. Elles hurlent leurs colères et combattent d’une main le mythe de la virilité et de l’autre le mythe du prédateur. La masculinité toxique et hégémonique doit être déconstruite en parallèle des réflexions sur la féminité unique, instituées par le patriarcat et le capitalisme.
Rien de vraiment nouveau dans les rangs militants. C’est du côté de l’opinion publique que les choses commencent à bouger. Doucement. Très doucement. Et pourtant, il s’agit là de la grande cause du quinquennat ! Emmanuel Macron s’engage pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
De la réduction du ministère des Droits des Femmes, transformé en secrétariat d’État, à la nomination de Gérald Darmanin comme ministre de l’Intérieur, alors qu’il est accusé et visé par une enquête judiciaire pour viols et harcèlement sexuel, en passant par la volonté de mettre en concurrence le 3919, service dédié à l’aide et l’écoute des victimes de violences sexistes, il ne cesse de prouver ses engagements en la matière…
DÉCONSTRUCTION DES MYTHES ET DU LANGAGE
Heureusement, des actions concrètes sont mises en place et elles sont nombreuses sur le territoire. Fruits d’une course de fond entamée avant le coup d’accélérateur MeToo. Harcèlement de rue, extension de la PMA pour tou-te-s, taxe rose, question de la parité (et du sexisme) en politique, lutte contre les violences…
À chaque fois, les militantes procèdent à un travail de pédagogie, souvent fixé à tort par la population comme une injonction, tentant d’expliquer les causes profondes de ces conséquences. Soit une société patriarcale dans laquelle on grandit tou-te-s en s’imprégnant des stéréotypes et assignations de genre, produits de constructions sociales qui perdurent au fil des générations. On essentialise le féminin et le masculin.
Le premier se rapportant à tout ce qui attrait aux soins, à la douceur et la maternité. Le second à tout ce qui est en lien avec la force, le courage, la réflexion, la stratégie… Bref tout le reste, en somme, excepté le domaine du sensible. En parallèle, travail est fait sur le langage comme vecteur des inégalités : il y a certes la question de la neutralité, et par là même de l’invisibilisation de toutes les personnes qui se genrent au féminin, mais aussi des images véhiculées quand la presse parle de « drames passionnels » ou de « femmes battues ».
Ces images, on les intègre. On réduit les assassinats de centaines de femmes par an en France à une dispute qui aurait mal tourné. On réduit les milliers de femmes par an qui subissent coups et blessures certes mais aussi insultes, crachats, pressions économiques, affectives, intimidations, menaces, agressions sexuelles et/ou viols de la part de leur partenaire.
On répand l’idée que l’espace public, principalement de nuit, est dangereux pour les femmes qui ne devraient pas rentrer seules chez elles car là, tapis dans l’ombre d’une ruelle mal éclairée ou d’un parking délabré, attend un prédateur. Alors que dans plus de 80% d’agressions sexuelles et viols, les victimes connaissent leur agresseur. On exclut les personnes trans du sujet du cycle utérin lorsqu’on le relie uniquement aux femmes et non aux personnes sexisées.
Les militantes œuvrent donc pour l’emploi de termes précis : menstruations ou règles, protections périodiques plutôt qu’hygiéniques, vulve, vagin, clitoris, féminicides, violences conjugales, harcèlement sexuel, agressions sexuelles, viols plutôt que rapports non désirés, consentement.
Dans les manifestations féministes, on remplace petit à petit certains passages de « L’hymne des femmes » des années 70 - « Nous sommes le continent noir » et « Levons-nous femmes esclaves » - jusqu’à ne plus le chanter du tout. À la place, on préférera entonner en chœur « Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère ! » et danser sur « Un violador en tu camino » du collectif féministe chilien Las Tesis.
On nomme les actes et on nomme les agresseurs présumés ou reconnus coupables. Gérald Darmanin, Luc Besson, Roman Polanski, Gérard Depardieu, Patrick Poivre d’Arvor, Alain Duhamel, Georges Tron, Richard Berry, François Asselineau, Denis Baupin, Dominique Strauss-Kahn, Dominique Boutonnat, Christophe Ruggia, David Hamilton, Gabriel Matzneff et bien d’autres sont visés par des accusations de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles, de viols, d’abus de pouvoir et d’autorité, sur des enfants et/ou sur des adultes.
Ils ont en commun d’être des hommes blancs, de pouvoir, bénéficiant majoritairement d’une impunité totale. On est là bien loin de l’image stéréotypée du prédateur qui dans le mythe décrit l’agresseur type comme étant racisé, pauvre, migrant, peu éduqué, à la dérive, livré à ses pulsions bestiales…
Au gratin, en revanche, on trouvera des excuses et on retournera la culpabilité directement sur la victime. On pourra toujours prétendre à la vénalité de la femme vengeresse ou inventer des formules toutes faites, comme (au hasard) : « Séparer l’homme de l’artiste ». Une bien belle phrase qui nous fait perdre du temps de cerveau pendant que ces Messieurs profitent de leur liberté…
Petit à petit, le mur s’effrite et on déconstruit progressivement les profils type des agresseurs mais aussi des victimes. La mauvaise victime, celle qui avait peut-être bu ou pris de la drogue, celle qui était en mini jupe, celle qui a dragué le mec, a accepté d’aller chez lui puis a dit non, celle qui ne se souvient plus précisément des faits, celle qui poursuit sa vie sans traumatisme apparent, celle qui ne s’est pas débattue face à l’agresseur, celle qui vient porter plainte dix ans plus tard, celle qui ne pleure pas durant sa déposition.
La bonne victime, celle qui a subi un viol dans le parking ou la ruelle sombres, a identifié son agresseur, établi malgré les pleurs en continu une plainte aux forces de l’ordre qui n’ont qu’à cueillir le pauvre mec qui avec un peu de chance est déjà fiché, celle qui ensuite n’arrivera plus à trouver goût à la vie.
Celle qui est blanche, celle qui est cisgenre, celle qui est hétérosexuelle. Celle qui est valide. Alors que selon Mémoire Traumatique et Victimologie, les enfants en situation de handicap ont près de 3 fois plus de risques d’être victimes de violences sexuelles que les enfants dans leur ensemble et que selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 35% des femmes handicapées subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% des femmes dites valides.
LES HANDIFÉMINISTES DÉBOULONNENT LE VALIDISME
Pourtant, lors de la première marche organisée par Nous Toutes, Céline Extenso scrute les images de la manifestation : la question du handicap et du genre échappe aux revendications. Nous sommes en 2019, l’actrice Adèle Haenel brise le tabou des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma.
 Elle témoigne de son vécu dans Médiapart et accuse le réalisateur Christophe Ruggia d’attouchements et de harcèlement sexuel. Elle était alors âgée de 12 à 15 ans. Elle fait état de la honte qu’elle a ressenti, puis de la colère qui s’est installée, jusqu’à ce qu’elle rompe le silence comme un acte viscéral.
Elle témoigne de son vécu dans Médiapart et accuse le réalisateur Christophe Ruggia d’attouchements et de harcèlement sexuel. Elle était alors âgée de 12 à 15 ans. Elle fait état de la honte qu’elle a ressenti, puis de la colère qui s’est installée, jusqu’à ce qu’elle rompe le silence comme un acte viscéral.
Si #MeToo peinait au démarrage en France, Adèle Haenel vient de l’ancrer dans l’hexagone et d’ouvrir la voie, grâce à sa voix, à de nombreuses autres femmes qui vont à leur tour dénoncer les violences subies et les agresseurs l’année suivante, à l’instar de la patineuse Sarah Abitol qui un an plus tard sort du silence quant aux violences commises par son entraineur Gilles Beyer, accusé également par Hélène Godard, ou encore de l’actrice Nadège Beausson-Diagne, violée à plusieurs reprises à l’âge de 9 ans par un ami de la famille.
À l’époque, en 2019, les propos d’Adèle Haenel secouent les mentalités et quelques semaines plus tard, le 23 novembre, elles sont des dizaines de milliers à envahir et occuper l’espace public dans une manifestation historique. Toutefois, Céline Extenso constate la sous représentation des femmes handicapées dans la rue, sur les pancartes ou dans les slogans, comme dans la presse.
« C’est un énorme problème puisqu’au contraire, les femmes handicapées sont beaucoup plus victimes de violences que les valides, mais notre absence connaît sans doute plusieurs raisons. Il y a d’abord les freins concrets à la présence des personnes handicapées dans les milieux militants (ce manque d’inclusivité n’est évidemment pas spécifique au féminisme). Le manque d’accessibilité physique des rassemblements, les entraves communicationnelles, la fatigue chronique et le manque de disponibilité générale consécutifs à nos handicaps compliquent énormément notre activité militante. », analyse-t-elle.
Elle poursuit : « En France, le discours sur le handicap a historiquement été capté par les grosses associations gestionnaires. Elles sont principalement portées par des personnes valides et véhiculent donc de lourds relents validistes, empreints de médicalisation et d’institutionnalisation dans des établissements spécialisés. Après un mouvement handi radical mais trop éphémère dans les années 70 (le Comité de Lutte des Handicapés, auteur entre autres du journal Les handicapés méchants) une voix militante a peiné à se faire entendre. Timidement d’abord dans les années 2000, mais principalement depuis environ 5 ans. Il est évident que l’avènement des réseaux sociaux a été un formidable outil facilitateur pour nous rassembler malgré nos handicaps et leurs contraintes ! »
Et c’est justement sur Twitter qu’elle lance un appel pour rassembler les motivées et ensemble déboulonner le validisme. Un an plus tard, né le collectif handiféministe Les Dévalideuses, reconnu depuis mars 2021 association officielle. Le but : donner de la visibilité aux femmes handicapées dans le féminisme.
« Je suis tétraplégique, myopathe, mais nous tenons à la diversité de notre collectif. Les Dévalideuses vivent tous types de handicap, physiques, sensoriels, cognitifs, psys, maladies chroniques, visibles ou invisibles, de naissance ou acquis sur le tard… Chacun implique une expérience différente, parfois très différente, mais nous faisons front contre un ennemi commun : le validisme. »
explique Céline Extenso.
Le validisme, comme elle nous l’explique précisément, c’est l’oppression que subissent spécifiquement les personnes handicapées et qui repose sur l’idée que leur vie vaut moins que celle des personnes valides, parce que l’on se figure qu’elles possèdent moins de capacités.
« Le validisme peut pendre la forme d’un rejet franc, mais peut aussi se cacher sous la forme d’un « validisme gentil », entre pitié, héroïsation et infantilisation, qui fait malheureusement tout autant de dégâts. La psychophobie ou la grossophobie sont des formes de validisme. », précise-t-elle.
Dans un communiqué récent, les Dévalideuses soulignent que leur objectif est triple : informer le grand public autour du validisme pour lui faire comprendre de quoi il s’agit mais aussi quels sont les vécus des femmes handicapées, bousculer les institutions pour créer un impact politique concret et durable sur la société et aussi visibiliser les femmes handicapées, valoriser l’histoire de la communauté handie et revendiquer la fierté de cette identité.
Entre féminisme et anti-validisme, les points communs sont clairs et nombreux : « décrédibilisation, infantilisation (le validsplaining vaut bien le mansplaining), contrôle de nos corps, de nos sexualités, injonction ou au contraire pour nous interdiction de procréer, difficulté d’accéder à une indépendance financière, violences sexistes et sexuelles exacerbées pour les femmes handicapées… On se rejoint sur un besoin d’émancipation, d’autonomie, d’auto-détermination, contre une classe qui voudrait nous contrôler. »
Mais aussi dans le syndrome de l’imposteur, note-t-elle plus tard. Construire des ponts avec d’autres luttes, cela apparaît évident : il faut croiser les thématiques du handicap avec le féminisme mais aussi les questions de « racisme, des LGBTIphobies, de la grossophobie, putophobie ou encore du capitalisme. »
Ce dernier évaluant « les êtres selon leur utilité, leur capacité à produire de la richesse, dans une course toujours plus standardisée, où nos spécificités et nos lenteurs ne trouvent pas leur place. Et sur l’autre versant du capitalisme, puisqu’on n’est pas jugés assez rentables, nous ne sommes même pas considérés comme des consommateurs à part entière. »
Il est urgent de questionner la place des personnes handicapées dans la société tout comme la place des femmes handicapées au sein des luttes féministes. « Ne reléguez plus le validisme en fin de liste… dans le meilleur des cas. », signale Céline Extenso qui appelle les milieux militants à être des alliés « à la hauteur ».
Elle établit deux façons complémentaires de les aider sur le terrain. D’une part, en rendant les lieux de rendez-vous accessibles aux personnes en fauteuil mais en réfléchissant également à des dispositifs pour les personnes ayant des difficultés de communication, de compréhension, de fatigue ou de douleurs diverses.
Et d’autre part, en allant à leur rencontre quand cela ne leur est pas possible de se mobiliser physiquement, en amplifiant leurs voix et leurs actions, comme cela a par exemple été le cas à plusieurs reprises dans les manifestations 25 novembre et 8 mars à Rennes, où leurs témoignages ont pu être enregistrés à distance et diffusés lors de la mobilisation.
« Oui, c’est exigeant, bien sûr ça demande pas mal d’anticipation et de réflexion, mais il est impensable qu’un mouvement se dise inclusif sans penser systématiquement à tout ça, en amont de ses événements publics ou même réunions internes.»
affirme-t-elle.
RENDRE VISIBLES LES COMBATS
La militante handiféministe le dit : la lutte contre le validisme devient de plus en plus connue dans les milieux militants mais est encore loin d’être bien ancrée dans les mentalités : « Nous n’avons plus le temps d’attendre qu’on nous fasse une place. Les réseaux sociaux nous permettent une meilleure inclusion, mais en même temps, les militants handis sont régulièrement critiqués : militer en ligne serait tout juste du spectacle, pas du « vrai activisme ». »
Et pourtant, aujourd’hui, les réseaux sociaux détiennent un pouvoir faramineux. Aussi dangereux qu’utiles, ils permettent la prise de parole de toutes les personnes n’ayant pas accès aux médias et peuvent transformer cette expression individuelle en mouvement collectif. Ils donnent à voir et à entendre et permettent également de bouleverser les représentations.

De montrer une population bien plus variée et plurielle que celle que l’on réduit trop souvent dans les médias mais aussi les arts et la culture à un noyau d’élite de gens extraordinaires érigés en modèles pas tellement accessibles au commun des mortel-le-s. Non ou trop peu représentatifs de ce qui se joue là, au quotidien, dans les foyers, les entreprises, l’environnement, en somme dans les vies de celles et ceux qui vivent la réalité et avec elle, les inégalités et discriminations.
« Il y a encore beaucoup de travail pour faire comprendre la nécessité de rendre visibles et légitimes les spécificités des un-e-s et des autres. Il y a des spécificités de la part des minorités qui subissent des discriminations et il y a des mécanismes globaux : on connaît les mécanismes de la stigmatisation, de la marginalisation, des stéréotypes, de l’invisibilisation… Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le pot commun. On ne vit pas tous et toutes la même chose et le combat est spécifique en fonction de sa situation. », analyse la sociologue des médias, Marie-France Malonga.
Les femmes noires ne vivent pas toutes les mêmes sexisme et racisme, en fonction de la carnation de leur peau mais aussi en fonction de leur orientation sexuelle, identité de genre, handicap, tout comme les femmes blanches ne vivent pas le même sexisme entre elles et avec les femmes racisées.
Une femme noire à la peau foncée ne vit pas le même racisme et sexisme qu’une femme perçue comme asiatique. Une femme perçue comme arabe ne vit pas le même racisme et sexisme qu’une femme voilée perçue comme arabe. Le podcast Kiffe ta race, produit et animé par Rokhaya Diallo et Grace Ly en fait état à travers des discussions, questionnements et analyses basé-e-s sur une approche et une histoire intersectionnelles.
« C’est très très long de changer les représentations médiatiques. C’est plus simple de changer le quantitatif que le qualitatif. », nous dit Marie-France Malonga. Elle a fait sa thèse en Science de l’information et de la communication sur les liens entre public et télévision à travers la question de la place des minorités ethniques – et particulièrement noires – à l’antenne.
Avant cela, lors de son master, elle a été à l’initiative et a dirigé l’étude historique qui a ouvert le Baromètre de la diversité au sein du Conseil Supérieur Audivisuel. Plus de 800 programmes analysés, soit plus de 250 heures de visionnage des propositions diffusées sur TF1, France 2, France 3, Canal + et M6 durant une semaine du mois d’octobre 1999. Elle constate, sans surprise, une sous représentation nette des populations non blanches.
« Elles sont peu représentées aux postes de premier plan. Ça ne voulait pas dire qu’elles n’existaient pas mais elles étaient marginalisées, invisibilisées. Parmi les minorités, les plus représentées étaient les populations noires, surtout du fait des productions américaines, dans la fiction notamment. On voyait très peu de magrébins, d’arabes, encore moins d’asiatiques ! »
souligne-t-elle.
Même si elle ne plait pas à tout le monde, cette étude, que certains journalistes vont qualifier de profilage raciste, crée une première prise de conscience de la part des chaines publiques mais aussi privées qui commencent alors à modifier leurs cahiers des charges. En 2009, l’étude est systématisée, elle devient un Baromètre de la diversité, aux critères élargis prenant désormais en compte les catégories socioprofessionnelles, le handicap, le sexe, l’âge, l’origine perçue ou encore les territoires (ruraux, urbains, banlieues, etc.).
En janvier 2020, le CSA a lancé l’Observatoire de l’égalité, de l’éducation et de la cohésion sociale en adéquation avec sa volonté de s’intéresser aux questions intersectionnelles, qui jusque là n’étaient pas mesurées. « Ce sont dans les intentions d’amélioration de l’institution mais c’est encore très confidentiel. », précise Marie-France Malonga.
Lier féminisme et questions raciales, c’est une évidence pour la professionnelle : « Les médias ont un rôle à jouer pour sortir les femmes et les minorités de l’essentialisation. C’est très long et complexe de lutter contre les visions stéréotypées dans les médias. Parce qu’il n’y a pas toujours la conscience de ce qu’est un stéréotype. On reproduit certaines choses inconsciemment. Il y a des avancées de la part de l’institution mais ça reste très compliqué. Avec la représentation des femmes issues des minorités non blanches, on est dans une impasse car il n’y a pas de statistiques ethniques. Pas d’outils pour lutter contre les stéréotypes diffusés. »
Et pour que les minorités elles-mêmes puissent proposer des solutions, encore faut-il qu’elles puissent s’exprimer ! Dans des mouvements collectifs, ajoute Marie-France Malonga. Dans le milieu du petit écran, les années 90 et 2000 marquent une époque durant laquelle émerge la parole individuelle des anonymes qui peuvent témoigner dans des émissions type « Ça se discute », « Vie privée vie publique » ou encore « C’est mon choix ».
On entre dans l’intimité des gens et à travers la télévision, cette intimité entre dans les foyers des français-es. Avec l’émergence des réseaux sociaux, cette parole est amplifiée et facilitée dans le processus collectif, la rendant légitime et visible partout dans le monde.
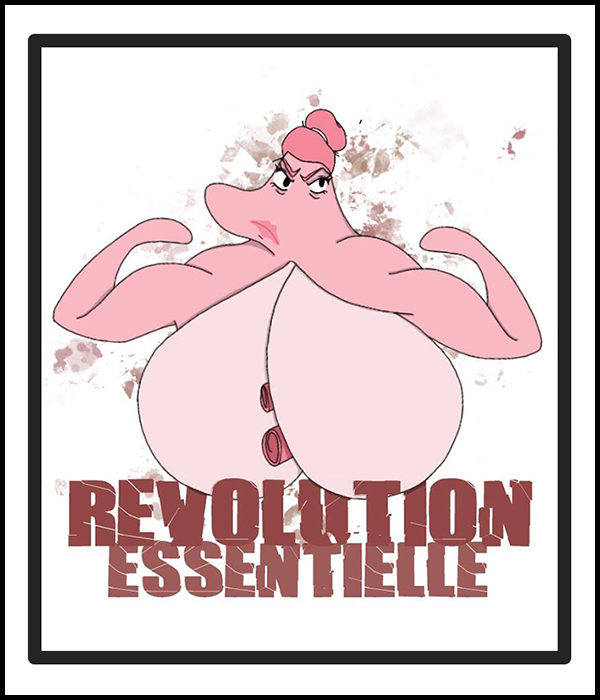 « C’est très intéressant je trouve ce qui se passe dans cette façon de se mobiliser collectivement. Ça va en parallèle avec le mouvement MeToo. On décrie les réseaux sociaux, avec ses dérives de haine en ligne et de déshumanisation de la société, mais en terme de visibilité donnée aux personnes qui n’arrivent pas à avoir des représentations médiatiques, c’est très important. Ils rendent la mobilisation plus grande, plus rapide et connectent des individus qui peuvent se regrouper et se rendre visibles.
« C’est très intéressant je trouve ce qui se passe dans cette façon de se mobiliser collectivement. Ça va en parallèle avec le mouvement MeToo. On décrie les réseaux sociaux, avec ses dérives de haine en ligne et de déshumanisation de la société, mais en terme de visibilité donnée aux personnes qui n’arrivent pas à avoir des représentations médiatiques, c’est très important. Ils rendent la mobilisation plus grande, plus rapide et connectent des individus qui peuvent se regrouper et se rendre visibles.
On voit aussi émerger des médias alternatifs qui apportent un éclairage particulier sur ces questions d’égalité. Ils cohabitent avec les médias mainstream, ce qui ne veut pas dire que les médias mainstream doivent se dédouaner de ces thématiques. Les deux peuvent cohabiter, ce n’est pas contradictoire. Il y a de la place pour tout le monde et ce qui est important c’est de montrer un autre type de paroles ! », s’enthousiasme la sociologue.
UNE SOCIÉTÉ À DEUX, TROIS, QUATRE VITESSES…
Cantonnées à leur rôle reproducteur et sexuel, les femmes sont rarement présentées comme des expertes. Quand les femmes sont racisées, la société ajoutent sur elles des stéréotypes liées à leur couleur de peau, leurs origines réelles ou supposées et leur sexe.
Les clichés peuvent changer également selon l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, la classe sociale. Nombreuses sont les voix qui s’élèvent pour dénoncer ces oppressions et leurs spécificités. En 2018, par exemple, paraît Noire n’est pas mon métier, un ouvrage collectif initié par l’actrice Aïssa Maïga. Seize professionnelles du cinéma témoignent et analysent les vécus communs et conjoints du sexisme et du racisme.
Ensemble, elles dénoncent le manque de personnes noires dans les films et la représentation stéréotypée qui s’en dégage les rares fois où elles apparaissent à l’écran. Mamas africaines, prostituées ou mères célibataires dépassées, les rôles ne proposent pas de choix, n’offrent pas une palette réaliste, ne cassent pas les stéréotypes, au contraire, ils les renforcent.
« Il y a eu une visibilité assez grande autour de ce livre et de ces artistes qui ont pu exprimer le problème de la représentation des femmes noires. Il y a eu beaucoup de retombées médiatiques, ça a eu un impact mondial (elles marquent les esprits également lors de la montée collective des marches du festival de Cannes, la même année, ndlr) ! Mais quand on voit les réactions face au discours d’Aïssa Maïga à la cérémonie des César, on voit bien que le problème n’est pas réglé du tout. », commente Marie-France Malonga.
Nous sommes le 28 février 2020 et la question des droits des femmes est au centre de la cérémonie à l’issue de laquelle Roman Polanski se verra décerner le prix du meilleur réalisateur et Adèle Haenel, criant « La honte », partira avec Céline Sciamma... Avant cela, dans la salle Pleyel, tout le monde se marre à chaque vanne de Florence Foresti, et tout à coup, tout le monde regarde ses pieds.
Ambiance pesante. Aïssa Maïga est en train de prononcer son discours. Face à la grande famille du cinéma, elle n’hésite pas à partager un geste qu’elle exécute depuis deux décennies : « Compter lors des réunions du métier. » Et c’est sur les doigts d’une main généralement qu’elle compte le nombre de personnes non blanches présentes. Les mots sont puissants et ce soir-là, comme à de nombreuses reprises, l’actrice sait s’en servir pour briser le silence et les tabous.
« On a survécu au whitewashing, au blackface, aux tonnes de rôles de dealers, de femmes de ménages à l’accent bwana, on a survécu aux rôles de terroristes, à tous les rôles de filles hypersexualisées… Et en fait, on voudrait vous dire, on ne va pas laisser le cinéma français tranquille. (…) On est une famille, on se dit tout non ? Vous tous qui n’êtes pas impactés par les questions liées à l’invisibilité, aux stéréotypes ou à la question de la couleur de peau… la bonne nouvelle, c’est que ça ne va pas se faire sans vous. Pensez inclusion. Ce qui se joue dans le cinéma français ne concerne pas que notre milieu hyper privilégié, cela concerne toute la société, n’est-ce pas monsieur qui est sur votre téléphone portable là ? », clame-t-elle.
Un discours d’une telle force, c’est intense et hypnotisant. Galvanisant en même temps. Ce n’est pas une autre parole qui doit être portée, diffusée, entendue. Ce sont toutes les paroles reléguées à la marge - parce que comme elles viennent chatouiller nos privilèges de personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, valides, elles dérangent - qu’il faut écouter et prendre en compte. Véritablement.
Égaliser la réception des paroles. Pas simplement s’en servir de levier à l’occasion avant de les replacer dans les oubliettes de l’Histoire.
« On ne laissera rien passer ! Fini d’aller au casse-pipe pour être récupérées ! On ne peut pas être juste des défricheuses puis ensuite être mises sur le côté. C’est de la marge que viennent de nombreuses avancées politiques. C’est vrai avec les personnes racisées comme avec le mouvement queer. C’est le même mécanisme. Le mouvement a été récupéré, vidé de son sens avec des étapes ultra violentes de rejet total ! »
s’indigne l’élue écologiste Priscilla Zamord.
RECONQUÉRIR LA PRISE DE PAROLE
En mars 2019, Arrêt sur images analyse l’opposition féministes universalistes contre féministes intersectionnelles dans un article qui révèle que les premières se sentent lésées dans les médias là où les deuxièmes y sont en vérité moins invitées. Le média amène la preuve scientifique par un comptage, processus qui encore une fois permet de mieux rendre compte de la réalité et de prendre conscience que certaines voix sont souvent laissées en marge du débat public.
Nadiya Lazzouni est journaliste, productrice et fondatrice de Speak up channel, média sur YouTube dans lequel elle pense, crée et développe des contenus et des concepts d’émission comme actuellement « The Nadiya Lazzouni Show » ou prochainement « Droit de cité ».
 L’objectif : reconquérir la prise de parole. Elle prend la parole mais aussi, elle la donne. À celles et ceux qui trop souvent sont invisibilisé-e-s. Juriste de formation en droit des affaires, elle a par la suite repris ses études pour travailler dans des ONG en sciences politiques.
L’objectif : reconquérir la prise de parole. Elle prend la parole mais aussi, elle la donne. À celles et ceux qui trop souvent sont invisibilisé-e-s. Juriste de formation en droit des affaires, elle a par la suite repris ses études pour travailler dans des ONG en sciences politiques.
« Entre temps, j’ai porté le hijab, ce qui réduit le champ des possibles… En 2012, j’ai 27 ans quand je décide de le porter. C’est l’aboutissement pour moi d’un cheminement et d’une réflexion spirituelle. Je mène mes choix et j’essaye d’aller au bout. Pas question de renoncer à une de mes identités ! Ce n’est pas le voile qui m’a fermé les portes mais les racistes. J’ai galéré à trouver un job. », explique-t-elle.
Elle a des spécificités et pour ces spécificités, elle est discriminée. C’est pour cela que des années plus tard, elle crée son propre média. Même combat pour Priscilla Zamord : « Au fil de l’eau, j’ai trouvé des leviers pour m’émanciper. Très jeune, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué au niveau de l’emploi. Comme je suis une machine à projets, j’ai décidé de créer mes activités. »
Enfant, la normande Nadiya Lazzouni réalise qu’au travers de la télévision, elle n’existe pas. Elle n’est pas représentée en tant que française musulmane racisée. Ce qui lui donne le sentiment d’être exclue de la société.
« Pour une ado, c’est hyper compliqué pour construire un être apaisé. Pour être apaisé-e, on a besoin de reconnaissance. Et cette société, elle ne nous montre pas de manière reluisante. Je me suis lancée le défi de reconquérir cet espace dont on est absents sans s’enfermer dans un ghetto intellectuel visant à dire que quand on est musulmanes, on doit parler de ça et pas d’autre chose. Dans « The Nadiya Lazzouni Show », les questions sont beaucoup plus inclusives. Pour inviter tout le monde à s’intéresser aux expertes et aux experts. »
Elle place au cœur de sa pratique journalistique bienveillance, reconnaissance et représentations plurielles :
« C’est important de pouvoir s’identifier physiquement à une femme musulmane, voilée, qui porte un message bienveillant et inclusif. Ça casse l’image de la femme soumise, aliénée, analphabète que l’on fait porter à la femme musulmane. Alors notre présence dérange mais elle a le mérite de déconstruire les idées reçues. On peut alors se rendre compte que les musulmans que l’on dit séparatistes ne s’inscrivent pas dans un mouvement communautariste. C’est un leurre, un mensonge. »
La journaliste dénonce l’hypocrisie d’une société qui prône la singularité des êtres et qui cultive l’idée qu’il est important de se distinguer mais qui ne tolère pas que la masse soit polymorphe. Marie-France Malonga approuve :
« Il y a une forme de diabolisation des mouvements des minorités. On a peur d’individus qui ont des petites armes, beaucoup plus infimes que les armes des dominants. On accuse les minorités de diviser le corps social alors que non. Elles n’ont pas de volonté d’exclusion mais au contraire, elles ont une volonté d’inclusion. Il faut s’organiser, se rassembler, nommer. Comment faire du féminisme si on ne parle pas des femmes ? »
Entre temps, le projet de loi « Séparatisme » se durcit – parce qu’apparemment, c’est toujours possible de faire pire - au Sénat début avril.
Au cœur du texte, l’interdiction du port du voile pour les accompagnatrices de sortie scolaire et les mineures dans l’espace public, ainsi que la volonté de dissoudre les associations « qui interdisent à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de participer à une réunion. »
Les réunions en non mixité rassemblant uniquement des hommes sont donc à l’abri. Pareil pour les réunions en non mixité rassemblant uniquement les femmes.
« Au lieu de s’offusquer sur les réunions non mixtes, on devrait s’offusquer de l’absence de diversité et de mélange sur l’ensemble des sphères de la société depuis très longtemps ! Ce serait beaucoup plus intéressant. Même chose avec « la discrimination positive » (je n’aime pas ce terme, je préfère parler d’action positive ou volontariste). On s’en offusque alors que la discrimination négative, non, là, tout va bien ! C’est un déni face à la question des inégalités que vivent certaines citoyennes et certains citoyens de notre société ! », réagit la sociologue des médias.
Ainsi, on nie les spécificités de certains groupes à qui on confisque la parole. Le parallèle est établi avec le féminisme universaliste brandi en France et qui prône une voix universelle – et par là unique - de l’émancipation des femmes à travers le monde entier.
« On ne se reconnaît pas dans ce féminisme, qui est un féminisme occidental et ethnocentré. Il est important de redéfinir le féminisme et établir un rapport égalitaire entre toutes les femmes. Parce que là, la lutte est commune tant qu’on remet en question l’ordre établi du patriarcat mais quand on remet en question les privilèges des personnes blanches, là, on assiste à la reproduction des travers qu’on reproche au système. »
analyse Nadiya Lazzouni.
Elle l’exprime clairement : aujourd’hui, la parole se libère et des réseaux sociaux émergent des voix singulières et différentes. Nait aussi la solidarité entre les féminismes minoritaires : LGBTI, afroféministes, féministes musulmanes, féministes décoloniales. « Pour s’organiser vers un féminisme plus inclusif et bienveillant. », précise-t-elle.
Elle poursuit : « On devient de plus en plus des sujets, on nous invite un peu plus qu’avant, on nous permet d’amener de la nuance. Et c’est important que l’on soit représenté-e-s car la France du quotidien n’a rien à voir avec l’image qu’on nous donne à voir. On est beaucoup à vouloir créer une société plus inclusive mais la télévision a un pouvoir sacré, elle s’impose chez nous. »
Les médias sont pour elle des lieux privilégiés pour changer les mentalités. Elle croit en l’impact de la visibilisation des minorités dans les lieux de reconnaissance. Et elle a raison d’y croire. Le 18 septembre 2020, la ville de Caen a inauguré la rue Nadiya Lazzouni : « Une reconnaissance personnelle et familiale ! Une première en France ! Je ne peux que rester positive ! »
REDONNER DU POUVOIR
 Partir du vécu. En juin 2019, le site Reporterre publie un entretient avec Fatima Ouassak. Elle est politologue, co-fondatrice de Front de mères, premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, présidente du réseau Classe/Genre/Race et autrice du livre La puissance des mères.
Partir du vécu. En juin 2019, le site Reporterre publie un entretient avec Fatima Ouassak. Elle est politologue, co-fondatrice de Front de mères, premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, présidente du réseau Classe/Genre/Race et autrice du livre La puissance des mères.
Elle explique : « Je ne lutte jamais sur des questions idéologiques en fait. Par exemple, je n’ai jamais milité sur la Palestine, même si je suis profondément pro-palestinienne. Il faut que cela parte d’un vécu. »
Elle défend depuis longtemps la lutte locale, notamment au sein des quartiers. Elle découvre, à travers sa fille, qu’un-e enfant de deux ans et demi peut subir du racisme. Elle co-écrit avec Diaratou Kebe le texte « l’école, c’est la guerre ». Elle raconte alors à Reporterre :
« Il est très très dur, très antiraciste. Politiquement, le texte se tient. Mais après quand on conduit sa fille à l’école, on se retrouve face aux enseignantes qu’on a démontées dans le texte. Stratégiquement, on ne peut pas faire cela, cela ne mène à rien sinon à pourrir sa vie quotidienne. Par ailleurs, tenir un discours politique localement est plus compliqué pour les habitants des quartiers populaires.
Dans une ville comme Bagnolet, qui ne compte que 30 000 habitants, une grande partie de la population est ce que l’on appelle « municipalisée » : il y a toujours dans la famille ou parmi les amis quelqu’un qui travaille à la mairie ou qui a une demande de logement social en cours. Quand vous voulez mobiliser les gens des quartiers populaires, c’est difficile, non pas parce qu’ils ne sont pas courageux mais parce qu’ils se disent que s’ils vont trop loin, leur mère, leur frère ou leur sœur va perdre son boulot, que la demande de logement ne va pas aboutir. Cela limite largement la politisation du discours. »
Partir du vécu. Elle l’applique dans le syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires qu’elle a créé, Front de mères. Elle se positionne en tant que mère :
« J’ai eu cette impression d’avoir été dépossédée de l’accouchement, de mon rôle de mère en fait. Le mouvement féministe a tendance – ce que je comprends – à dire qu’il faut arrêter de renvoyer systématiquement les femmes à leur rôle de reproductrices. Mais est-ce que cela ne nous a pas dépossédées du pouvoir que l’on a sur l’éducation et la reproduction ? Le Front de mères sert à voir comment on se réapproprie notre pouvoir de mère, pas en tant que mère au foyer mais en tant que mère comme sujet politique qui gère l’éducation, la transmission, la parole publique. Réinvestir cette question peut révolutionner l’ensemble des questions politiques. »
Elle est une militante inspirante pour de nombreuses personnes, dont Priscilla Zamord qui adhère non seulement à l’idée d’alliances dans les luttes comme celle d’Assa Traoré et d’Alternatiba mais aussi au syndicat Front de mères.
« La politisation des mères dans les quartiers prioritaires est un mouvement impensé, voire malmené dans les questions de féminismes et de politique. On voit « les mamans des cités » comme bonnes à faire des gâteaux mais pas à débattre. Là, il y a un espace safe où on peut être soi. Sans compartimenter son identité.
Les femmes sont un vrai sujet politique, que ce soit dans les questions de parentalité heureuse, dans l’égalité des traitements, les questions de violences sexuelles sur les adultes comme sur les enfants et sur l’histoire et la transmission. L’expérience de la marge doit être prise en compte. Je me souviens quand j’étais enfant, j’allais aux Antilles l’été et cette expérience de la mobilité n’a jamais été valorisée dans ma scolarité. », souligne l’élue pour qui il est nécessaire de regarder la vérité en face dans le cadre de la lutte contre les discriminations.
Cela passe, en local, par l’Observatoire métropolitain de lutte contre les discriminations mais aussi l’élaboration d’un vrai plan sur l’égalité femmes-hommes, à l’instar de celui qui est mis en place déjà sur la ville de Rennes, pour embarquer les 43 communes de Rennes Métropole dans ce combat.
Partir du vécu. Pour faire jaillir des sujets et des enjeux parfois oubliés ou négligés par les militant-e-s. Autre exemple de politisation de la maternité : le compte instagram Matergouinité, lancé par Elsa et Lisa, deux femmes lesbiennes en colocation à Bagnolet, visant à mettre en valeur des maternités, comme l’homoparentalité, la monoparentalité ou la transparentalité, trop peu visibles dans les médias.
L’objectif : déconstruire le regard marginalisé que l’on se figure à ce sujet. Rendre visibles ces familles et les rendre légitimes. Parce que leur invisibilisation crée des stéréotypes et du tabou avec lesquels il est pourtant urgent de rompre, l’extension de la PMA pour tou-te-s se heurtant trop souvent à des idéologies conservatrices et dangereuses.
Régulièrement, à Rennes, les militant-e-s féministes et LGBTIQ+ sont invité-e-s à contre-manifester contre les mobilisations revendiquant encore et toujours « Un papa, une maman, un enfant »… On remet en question la capacité des femmes lesbiennes, célibataires et des personnes trans à investir la fonction parentale et dénie complètement leur droit au choix de fonder ou non une famille.
On met un mouchoir sur le sujet tout comme sur toutes les questions également d’accompagnement et de reconnaissance de toutes les personnes ayant des difficultés à concevoir, ayant vécu fausse-s couche-s ou perte-s d’un enfant à la naissance, post partum, etc.
LES HOMMES NE SONT PAS LA NORME
Alice Coffin est journaliste, activiste féministe et LGBTIQ+, co-fondatrice de la Conférence lesbienne* européenne (* : pour les femmes qui aiment au moins les femmes, inclusif de la transidentité, de la non binarité et de la bisexualité), co-fondatrice de l’Association des Journalistes LGBT, élue écologiste au conseil de Paris et autrice de l’ouvrage Le génie lesbien. Elle y explique qu’elle est parfois invitée sur les plateaux télé des chaines d’info en continu :
« Pour parler féminisme. Ou de la PMA. Ce sont rarement des sollicitations directes. Souvent, c’est une copine féministe hétéro, initialement conviée, qui fait savoir à la chaine qu’il serait préférable, pour aborder un sujet concernant les lesbiennes, de faire appel à une lesbienne. Il m’est arrivé de patienter dans une loge, avant d’entrer en studio, en compagnie de plusieurs hommes. Je suis alors dans cette pièce la seule femme, la seule lesbienne, la seule à plancher, jour après jour, depuis des années, sur la PMA. Je suis aussi, pendant ce temps d’attente, la seule à bosser, à réviser mes chiffres, à préparer des notes. Certains, parmi les hommes invités, n’y connaissent rien mais cela ne les affole pas. Ils devisent, balancent une idiotie sexiste. »

Plusieurs pages plus tard, elle explique qu’elle a à plusieurs reprises été bâillonnée en tant que journaliste féministe et lesbienne. Alors qu’elle travaille pour 20 Minutes, elle doit faire un article sur la manière dont vivent et travaillent les journalistes depuis le 7 janvier 2015. Elle interviewe des reporters de BFMTV, de L’Express, de France 4, de France 3 Picardie, de La voix du nord, de La Provenceet Isabelle Germain, la rédactrice en chef des Nouvelles News, site d’info féministe.
Celle-ci souligne à juste titre qu’après les attentats survenus à la rédaction de Charlie Hebdo, les hommes étaient encore plus nombreux à être invités sur les plateaux télé. « La solliciter m’avait été reproché par ma hiérarchie. Elle y percevait un signe de mon « militantisme féministe et pro-LGBT ». Attester qu’en temps d’attentats ou de coronavirus les hommes saturent l’espace médiatique relève pourtant de l’information. », écrit-elle.
Tout comme Nadiya Lazzouni en a témoigné, Alice Coffin a elle aussi subi le manque de représentation, la coupant d’une partie de son identité. « Je suis passée à côté de dix ans de ma vie parce que je n’avais pas d’exemples de lesbiennes auxquels m’identifier. À cause de ceux qui confinent l’homosexualité à la sphère privée. Un quart des ados LGBT a déjà fait une tentative de suicide. L’absence de personnalités out en France a un lien direct avec l’écho donné à la haine de la Manif pour tous, le suicide des adolescents LGBT, le report systématique du vote de la PMA, les discriminations qui visent l’ensemble des minorités françaises et pas juste les homosexuels. « Familiarity breeds acceptance », disent les Américains. La familiarité engendre l’acceptation. Quand des politiques ont pour collègue un député gay, quand des journalistes ont pour consœur une reporter lesbienne, quand des sportifs ont un coéquipier homo, ils, elles hésitent avant de balancer une insulte homophobe. », analyse la journaliste.
Aujourd’hui, la question des représentations est essentielle. Et ça, les productions télévisées l’ont (plutôt) bien compris, proposant des contenus qui valorisent la pluralité et la complexité de chaque identité et qui tendent à distribuer les paroles restées jusque là sous les radars, à l’instar par exemple de francetv.slash, alors qu’elles soulignent et symbolisent les préoccupations et les enjeux actuels.
Pas uniquement de la nouvelle génération, même si forcément le renouveau militant impacte davantage la jeunesse. Qui s’en saisit comme le signalent Mathilde Larrère et Marie-France Malonga qui voient leur cours sur leur matière au prisme du genre se remplir au fil des années, surtout depuis MeToo. Toutes les deux le disent, le féminisme est de moins en moins perçu comme un gros mot, au contraire, aujourd’hui, il devient revendiqué par de nombreuses personnes.
Toutefois, la sociologue des médias le rappelle : « Militer ne doit pas être une injonction ! » À chacun-e son féminisme. Tout comme la femme guerrière et combattive ne doit pas être une injonction. À chacun-e ses forces et ses failles. Ne pas tomber dans une autre image unique. Il n’y a pas non plus de profil type de la militante féministe. Ça n’existe pas.
LES LIEUX DE POUVOIR ET DE DÉCISION, ENCORE DES BASTIONS MASCULINS
Du côté des pouvoirs politiques, ça rame encore cependant. Parce que la politique ainsi que le reste des lieux de pouvoir sont toujours pensé-e-s comme étant des mondes d’hommes, blancs, hétéros, cisgenres. Souvenons-nous la Une du Parisienlors du premier confinement, s’interrogeant sur le monde d’après, avec en photo 4 hommes blancs et vieux.
Ce n’est pas le seul exemple, malheureusement. Et ça, Alice Coffin en parle merveilleusement bien. Au début de son livre Le génie lesbien, elle raconte :
« « À poil ! » Ils sont députés, directeurs de théâtre ou de journal, ministres, grands intellectuels, grands artistes, grands savants, chefs d’entreprise, présidents de fédération. « Salopes ! » Dans les augustes salles de l’Assemblée nationale, du palais Brongniart, de la Maison de la Chimie, sous la coupole des Académies, ils déambulent, se tapent dans le dos, « Salut mon vieux, ça va mon vieux ? ». « Connasses ! » Les imprécations qu’ils lancent lorsque nous interrompons leurs tables rondes, leurs conférences, les racontent. « On veut voir vos seins ! » Ils hurlent, ils éructent. Ils sont furieux, hors d’eux. Ils ne sont plus entre eux. »
Cela fait maintenant 11 ans qu’elle a rejoint le collectif La Barbe, un groupe d’activistes déboulant dans les lieux de pouvoir où les hommes se réunissent en non-mixité, sans que personne n’y voit aucun mal, sans que personne ne hurle au communautarisme.
« Pendant nos interventions, nous posons, face au public, comme les hommes politiques des débuts de la IIIe République. Le regard fier, la barbe frémissante, avec, à la main, des écriteaux ornés des mots « Splendide », « Épatant » ou « Merveilleux », et un tract de félicitations dont le titre, très ironique, varie selon les circonstances. « Les substantifiques mâles » pour congratuler ces messieurs de la gastronomie, « Je veux que l’on soit homme », emprunté au Misanthrope, pour célébrer les quatorze auteurs et quatorze metteurs en scène au programme du théâtre de l’Odéon, « Citizen Ken » pour encenser les dirigeants de la presse quotidienne régionale. », poursuit la militante qui témoigne également des brutalités dont elles font parfois l’objet lors de leurs actions.
Malgré des avancées, les personnes sexisées ne sont pas encore prises en considération dans leur entièreté. Oui, la nomination de Kamala Harris en tant que vice-présidente des Etats-Unis est une heureuse nouvelle. Tout comme la réélection de Jacinda Ardem au poste de Première ministre de la Nouvelle-Zélande. Pareil pour Rose Christiane Ossouka au Gabon (premier mandat) et bien d’autres, à l’instar des pays nordiques par exemple. Ce sont là des exemples démontrant qu’elles peuvent accéder aux sphères de décision. Mais pour l’instant, elles restent minoritaires.
TEMPÊTE DE MACHOS
En 1981, Yvette Roudy devient la première ministre des Droits des Femmes. On lui doit entre autre le remboursement de l’IVG et des lois concernant l’égalité professionnelle. Dans son livre Lutter toujours, elle explique « qu’un ciel de machos lui est tombé sur la tête ».
 Elle se souvient : « Sans doute, dans l’ivresse heureuse des débuts de mon mandat, ai-je oublié un moment la puissance du machisme que nous affrontions. Une nouvelle loi, mon dernier grand chantier, allait pourtant me le rappeler. Et faire basculer notre ministère dans la partie la plus sombre de son histoire. (…)
Elle se souvient : « Sans doute, dans l’ivresse heureuse des débuts de mon mandat, ai-je oublié un moment la puissance du machisme que nous affrontions. Une nouvelle loi, mon dernier grand chantier, allait pourtant me le rappeler. Et faire basculer notre ministère dans la partie la plus sombre de son histoire. (…)
La loi antisexiste devait permettre aux associations féministes de déposer plainte lorsqu’elles jugeaient qu’une publicité affichée sur la voie publique portait atteinte à la dignité de la femme. Raconter la vague de haine qui s’est abattue sur moi ne servirait à rien, mais il convient d’en prendre la mesure. Si tous, soutiens et opposants à la loi, étaient d’accord pour reconnaître l’image dégradante de la femme dans la publicité, sous couvert d’humour et de désir, le droit de réponse et les répressions qui pourraient s’ensuivre ont provoqué une levée de boucliers et de violences que je n’avais pas anticipée. »
Aujourd’hui, le combat du corps se poursuit et rejoint celui qu’Yvette Roudy avait commencé : « Je proposais d’arrêter d’utiliser le corps des femmes pour vendre des produits qui n’avaient rien à voir avec lui, et on me traitait de tyran qui menaçait la liberté d’expression, de puritaine réactionnaire. Et tout cela principalement depuis mes propres rangs idéologiques. (…)
Et le gouvernement qui me soutenait au départ m’a lâchée quand son électorat masculin s’est dressé vent debout contre moi. Il fallait abandonner la loi. Simone de Beauvoir m’a soutenue, les femmes de mon ministère aussi. Mais le Parti socialiste, à l’heure qu’il est, n’a toujours pas fait son mea culpa. »
Un regret pour celle qui croit en l’association féminisme et socialisme de Clara Zetkin. Priscilla Zamord le dit sans détour, rares sont les élu-e-s qui s’assument et s’affirment féministes, encore moins antiracistes. Sans doute de peur d’être étiqueté-e-s, jugé-e-s, réduit-e-s à leur militantisme. Ou aussi parce que : « On pense que c’est censé être inné quand on est de gauche. Mais non, en fait. »
Pour l’ancienne ministre des Droits des Femmes, « il faut repartir de la base, repenser la politique autrement, dès ses fondements. Pour cela, je conseille aux jeunes générations non pas de faire du féminisme avec les outils traditionnels, pensés et créés par des hommes, mais plutôt de créer leurs propres outils. Le premier et le plus fondamental : un parti politique. » Une piste peut-être pour une révolution politique qui a pour le moment encore un peu de mal à décoller.
« La plupart des révolutions sont ratées. Ce n’est pas grave. Il y a des choses qui restent mais il faut remettre des couches pour ne plus retourner en arrière. Peut-être qu’en politique, ça n’a pas encore fonctionné mais au niveau des mentalités, ça bouge. Les jeunes générations bénéficient d’une plus grande conscientisation féministe (et écologiste, ndlr). La brèche est ouverte. Autour de la bataille de l’intime, de l’égalité salariale, de la réflexion intersectionnelle… MeToo est devenu révolutionnaire.
Pas juste autour des violences sexistes et sexuelles, même si cela engage une réflexion profonde autour des problématiques salariales notamment (si on a autant de patronnes que de patrons, il y aura beaucoup moins de harcèlement, etc.), on prend conscience que les inégalités sont sociales et économiques. Durant la loi retraite, les femmes ont montré que cette loi serait plus catastrophique pour elles. Toutes les mesures ont des conséquences en terme de genre. C’est net. », analyse l’historienne, spécialiste des mouvements révolutionnaires, Mathilde Larrère.
Pour autant, les choses bougent. En novembre 2019, 250 acteur-ice-s du monde politique, associatif, artistique et militant appelaient à l’occasion des élections municipales un #MeToo des territoires. Sous cette appellation transparait la volonté de dénoncer les violences sexistes et sexuelles qui sévissent dans les sphères de pouvoir. Au sein des partis politiques, l’omerta subsiste.
En mars 2021, 150 élu-e-s, militant-e-s, collaborateur-ice-s, candidat-e-s aux élections régionales, parlementaires, responsables d’association et artistes ont à nouveau signé un manifeste sur le sujet, demandant la mise à l’écart des candidats accusés de violences à l’encontre des personnes sexisées.
L’INTIME EST POLITIQUE
Si les lieux de décision et de pouvoir restent, aujourd’hui encore, des bastions de la virilité masculine, les féminismes sont éminemment politiques. Depuis plusieurs décennies, les militantes le disent : l’intime est politique. Le passage du privé au public, c’est ça qui brise les tabous, qui délie les langues, qui transforme l’expérience individuelle en vécu collectif.
Et celui des femmes, et plus largement des personnes sexisées, il se vit dans la chair. Dans le corps. Que ce soit à cause de la précarité et la pénibilité du travail, professionnel et domestique, et/ou que ce soit à cause des violences sexistes et sexuelles. On a relégué les femmes à la sphère privée et le corps, à l’intimité.
Non dans une volonté de pudeur, certainement pas. Il s’agit plutôt de dissimuler, cacher, taire tout ce qui attrait au corps. Le sang des menstruations, c’est dégoutant ! Les poils sous les aisselles et sur les jambes des femmes, c’est répugnant ! L’accouchement, gerbant ! Les tétons qui pointent sous le tee-shirt, provoquant ! Les vergetures sur les seins, les hanches et les cuisses ou encore la cellulite, c’est ragoutant !
Le corps des femmes est contrôlé. Épié. Scruté. Jugé. En permanence. Soumis au regard masculin qui soit le sexualise, soit le réduit à sa capacité reproductive. Et ce regard masculin est intégré aussi bien par les hommes que par les femmes, qui sont dépossédées de leur corps et de leurs connaissances à propos de celui-ci.
Se le réapproprier, ou se l’approprier tout court, est une bataille de longue haleine qui nécessite de déconstruire les injonctions qui pèsent lourdement sur nos épaules, nos bourrelets et nos capitons graisseux.
Ne pas porter de soutien-gorge. Tous les jours, de temps en temps ou dans certaines situations spécifiques. Ne pas s’épiler. Ne pas se maquiller. Ou ne pas se lisser les cheveux. Ou ne jamais mettre de jupe et de robe. Ne pas cacher son tampon dans sa main ou sa poche quand on va changer de protection périodique. O
ser dire « J’ai mes règles ». Exiger des professionnel-le-s de la santé des explications sur chaque examen effectué. Dire que non, ce n’est pas normal d’avoir mal avant ou pendant les menstruations. Explorer son corps et son sexe. Les caresser, les regarder dans un miroir (accompagné d’une lampe torche pour observer l’intérieur du vagin), tester, expérimenter. Pour savoir ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas. Nommer les différentes parties de notre sexe. Connaître nos cycles.
Ce sont là des exemples d’actions qui paraissent aujourd’hui plus abordables parce que les militantes féministes portent publiquement ces sujets-là depuis plusieurs décennies, incitant à réfléchir autour des taches assignées par le combot patriarcat-capitalisme et les moyens de nous en affranchir.
Cela ne veut pas dire que toutes les personnes sexisées doivent arrêter de s’épiler, de porter un soutien-gorge, se masturber, jouir, aimer le sexe, parler de leurs règles à table, ne pas désirer d’enfant, etc. Cela veut dire qu’en partageant, à travers les témoignages, les actions collectives, les débats, les expériences de cette féminité normative mais aussi les vécus et ressentis de féminités alternatives, les un-e-s et les autres peuvent s’en saisir pour rompre l’isolement, constater la pluralité des possibilités et s’émanciper de ces oppressions, si on le souhaite et de la manière dont on le souhaite.

L’espace privé et l’intimité sont des sujets politiques. Qui permettent de briser les tabous et de réfléchir individuellement et collectivement aux tenants et aboutissants des silences placés sur ces thématiques. Chacun-e peut s’en saisir. À son rythme. Mais il est important qu’on accède aux informations, que les paroles puissent circuler librement et que le choix soit donné et respecté.
Avoir la possibilité d’exprimer ce que l’on vit dans son corps (et dans sa tête) qu’il s’agisse des bouleversements du temps, des cycles menstruels, de l’endométriose, du cancer du sein, des conséquences et traumatismes de violences sexuelles, de fausses couches, de stress à l’idée que le fœtus ne soit pas viable, de la grossesse, dans les rapports sexuels, la ménopause, etc.
Ne pas se dire que sans soutien-gorge et avec mini-jupe un soir en ville, on prend des risques. Ne pas penser que parce qu’on ne veut pas d’enfant, parce qu’on n’allaite pas un enfant, parce qu’on ne prend pas de plaisir en faisant l’amour, parce qu’on n’a jamais joui, etc. on n’est pas normales…
Nos corps nous appartiennent mais un contrôle social a été imposé dessus. Nos désirs font désordre et court-circuitent parfois les assignations de genre. Aucune femme ne doit se sentir obligée de témoigner de son vécu. Aucune personne transgenre ne doit se justifier du sexe qu’elle a entre les jambes. Personne ne doit être entravée dans son corps et sa manière de vivre dedans et avec. L’intime est politique.
REPENSER LE MILITANTISME FÉMINISTE
Le renouveau féministe, Aurore Koechlin en fait état dans le livre La révolution féministe. Elle milite dans des collectifs depuis les années 2010, a effectué un master en Etudes de genre à Paris 8 puis en sociologie du genre et fait une thèse sur la gynécologie. Elle commence par intégrer un syndicat étudiant avant de se tourner vers des collectifs non mixtes.
Ce qui au départ devait être un article sur son parcours militant et autour de l’émergence d’une réflexion liant les questions de genre à celles de classe, de race, d’orientation sexuelle, et d’identité de genre est devenu un livre qui dresse un panorama politique et sociologique des années 70 à aujourd’hui, dans une dimension internationale et le contexte MeToo.
« C’est un ouvrage dans lequel j’interroge les stratégies à mettre en place pour ce mouvement naissant. C’est quoi le féminisme ? Pourquoi on se bat ? Et comment on se bat ? La difficulté, c’est que le féminisme s’est construit comme un mouvement très unifié dans lequel l’axe « Femme » était le plus important. Plus important que la classe, la race, etc. Aujourd’hui, il faut imposer ces questions dans l’agenda féministe. Il faut qu’on ait ce débat, qu’on pose ces questions. C’est important, notamment face à une loi comme celle sur le séparatisme. On ne doit pas laisser le féminisme être instrumentalisé. Féminisme et antiracisme sont au centre de ce débat. », nous explique-t-elle.
Dans le fait que le gouvernement s’approprie ce mouvement, elle y voit la puissance contestatrice : « C’est une façon de le pacifier que de l’intégrer au sommet de l’Etat. Après, pour obtenir concrètement l’application de certaines revendications, on ne peut pas totalement se détourner de lui. C’est là où pour moi il faut faire émerger clairement les revendications militantes. Le mouvement est actuellement très fort, c’est une lame de fond qui bouscule tout et qui pour cela est attaqué de toute part. Il est important de continuer ce mouvement et de le faire converger avec d’autres mouvements comme l’antiracisme, l’antivalidisme, etc. et les mouvements sociaux. »
Ce qu’elle défend, c’est de repenser notamment le travail reproductif et d’imaginer d’autres manières de s’organiser. Par les cantines collectives, les crèches collectives, par exemple. Pour faire sortir le travail domestique de son cadre genré et privé. Là aussi, les militantes le disent et le répètent : le privé est politique.
Parce que dans la sphère privée, on enferme les femmes, laissant penser que leur rôle consiste à faire et éduquer les enfants et à entretenir le foyer. Dans cette sphère-là, on tait les violences conjugales et familiales. Le privé est politique : on dénonce de plus en plus les blessures, les insultes, les viols, les menaces au sein du couple et dans les familles mais aussi l’enfermement domestique et maternel.
Toutefois, comme expliqué précédemment, chaque personne a le droit de souhaiter rester à la maison pour s’occuper des enfants, de la vaisselle, du ménage, etc. Le problème pointé dans le débat résidant dans le fait que cette personne est majoritairement et depuis longtemps de sexe et de genre féminin.
« Le premier confinement a démontré que le travail reproductif (domestique, éducatif, soins, etc.) est extrêmement dévalorisé dans la sphère privée comme dans le cadre du service public. Il est relégué au bas de l’échelle… Et là, il est apparu comme essentiel. C’est-à-dire comme un travail qui ne peut pas être confiné, qui ne peut pas être mis en pause.
On a pu constater que ce travail essentiel, il est majoritairement occupé par des femmes, racisées. Mais ça n’a duré que quelques semaines. Depuis, il n’y a pas eu de changement dans notre organisation sociale, pas de revalorisation malgré les promesses gouvernementales. Mais on ne repart pas de 0. Je crois malgré tout qu’il va en rester des traces. »
Et encore une fois, il est nécessaire d’investir les espaces de pouvoir. Sinon, on le voit, ces questions sont établies comme non prioritaires et c’est encore aux militantes de redoubler d’acharnement. Pour que la PMA soit enfin ouverte à tou-te-s sans laisser sur le côté les lesbiennes, les personnes trans, les femmes célibataires. Pour que le congé paternité soit une vraie mesure satisfaisante et appliquée et pas uniquement sur 7 jours obligatoires.
Pour que le délai légal d’avortement soit allongé de 12 à 14 semaines de grossesse. Pour que l’on fixe un âge décent au consentement sexuel. Pour que l’allocation aux adultes handicapés soit individualisée. Pour que les réunions en non mixité soient reconnues comme utiles aux personnes concernées. Pour l’autodétermination des personnes trans. Pour la gratuité des protections périodiques. Pour la dignité et le respect de toutes les personnes.
UN POINT DE BASCULEMENT
Si Aurore Koechlin n’envisage pas que la révolution féministe soit encore advenue, elle précise néanmoins : « On pourra dire qu’il y a révolution, quand les bases plus profondes seront réorganisées. Les féminismes ont un aspect profondément révolutionnaire car ils touchent à tous les aspects de nos vies que ce soit vies privées ou vies publiques. Parler de ce que vivent les femmes, des minorités de genre, du système hétéro, de la masculinité hégémonique, etc. C’est là le pouvoir créateur du féminisme : développer d’autres possibles. On le voit par exemple dans la littérature SF (science fiction, ndlr)que les femmes investissent. Ça nous pousse à penser un autre monde ! »
Un monde dans lequel le « male gaze » n’est pas au centre… Pour Céline Extenso qui nous répond avec une note d’humour, pareil, nous sommes aux portes d’une révolution à venir :
« Je crois qu’elle n’a jamais été aussi proche. Nous sommes de plus en plus nombreuses à la rêver, avec la ferme intention de ne pas nous complaire dans le seul « rêve ». J’ai l’impression qu’on s’organise, qu’on s’entraide, qu’on fourbit nos armes comme jamais. Évidemment, on ne peut pas dévoiler tous les détails du plan maintenant, il faut garder un peu de surprise ! »
On parle là d’une révolution plus globale. Parce que la révolution féministe a bel et bien déjà commencé. Depuis plus de 150 ans, elle progresse et participe au changement des mentalités. Avec des flux et des reflux comme on l’a vu. Avec des périodes d’ébullition, des retours de bâton, des phases d’écoute, des phases de rejet. La société a affronté des crises qui ont à chaque fois impacté les droits des femmes.
Toujours le féminisme a rebondi et a permis des mobilisations aux ampleurs toujours plus grandes. Le mouvement avance et s’il demande une prise en compte des femmes à part entière, il doit aussi entendre la critique qui parvient des militantes racisées, handicapées, LGBTIQ+, etc. Pour que les spécificités des un-e-s et des autres ne soient plus vécues comme marginales et hors-normes et ne soient pas victimes de la reproduction des mécanismes de domination que le féminisme combat.
Dans une interview accordée au magazine Antidote en octobre 2020, Lauren Bastide, journaliste féministe, créatrice et animatrice du podcast La poudre explique :
« Je pense que non seulement une révolution féministe va avoir lieu, mais aussi une révolution écologique, antiraciste, anticapitaliste et une révolution du genre, tout est intrinsèquement lié. J’ai l’impression que toute cette prise de conscience est en train d’avoir lieu.
Je pense qu’il y a de plus en plus de personnes qui comprennent que le combat d’Assa Traoré contre les violences policières rejoint le combat des féministes contre les violences faites aux femmes et contre le viol, rejoint le combat anticapitaliste contre la mainmise de 1% des êtres humains sur 99% des ressources mondiales, rejoint le combat écologique de Greta Thunberg. Tout ça, c’est la même histoire, une histoire d’oppression d’un tout petit nombre de dominant-e-s sur un nombre écrasant de dominé-e-s. Pour moi, si la révolution féministe a lieu demain, elle se fera par cette convergence-là. »
TROUVER NOS POINTS D’ALLIANCE
Combattre ce qui nous divise. Cela ne veut pas dire que nous devons penser tou-te-s de la même manière. Ou même ressentir de la même manière. Le rapport au corps diffère, tout comme la pression face aux injonctions diverge également. On ne place pas tou-te-s le curseur de la liberté au même endroit et ne vivons pas la même urgence à s’affranchir et s’émanciper de telle ou telle assignation.
En revanche, nous devons nous accorder pour fonder une société basée sur la dignité et le respect des êtres humains, autant que sur l’environnement. On a beau parler de solidarité féminine, la sororité est loin d’être innée chez les personnes sexisées. Tout simplement, parce qu’on ne l’a pas appris.
On nous a peut-être même bien inculqué le contraire. Les filles aiment les commérages et les coups dans le dos. Elles se jalousent et se critiquent. Meilleures rivales pour la vie. Un tas de conneries difficiles à contrer malgré tout. C’est sans doute là un enjeu crucial des féminismes. Briser les injonctions. Sans les remplacer par d’autres injonctions.
Briser le cercle de victimisation dans lequel on nous enferme régulièrement. Sans nier les inégalités, discriminations et violences que nous vivons spécifiquement. Briser la hiérarchisation des souffrances. Sans prendre la place et la parole de celles qui vivent des expériences différentes des nôtres.
C’est inspirant tout ce qui se passe actuellement au sein des féminismes. Fatiguant parfois mais surtout stimulant et enrichissant. Le 8 mars dernier, Rachida du Collectif Sans Papiers de Rennes rappelait :
« Nous migrantes, réfugiées, sans papiers, demandeuses d’asile, nous les femmes et les personnes lesbiennes, gays, bis, trans, nous sommes parmi vous à l’appel international pour une grève féministe. Nous avons l’interdiction formelle de travailler pour survivre et pourtant nous sommes ici avec vous. »
Son discours est puissant. Elle démontre l’importance de l’inclusion de tou-te-s dans les luttes féministes. Parce que nombreuses sont celles qui ont été oubliées, négligées, méprisées. Rachida demande aux militantes de les soutenir et d’être à leurs côtés dans leurs combats :
« Il ne nous suffit pas d’avoir une place parmi vous sur vos estrades militantes. Nous féministes prolétaires que notre courage de survivre a amené ici pour trouver refuge, nous nous sommes échappées des guerres produites par le patriarcat et le capitalisme de nos pays. Nos pays maintenus dans la misère. Nous venons chercher parmi vous solidarité et refuge. Quelque soit les barrières qui nous opposent, il est en notre pouvoir de les affranchir. (…) Tant que l’imbrication de la violence patriarcale et raciste ne sera pas vaincue, nous ne pourrons pas triompher ensemble.
Tant que la liberté des migrantes n’est pas prise de partout comme un combat général, nous ne pourrons pas être ensemble sur la place mais resterons divisées dans les maisons, les villes, les lieux de travail. C’est pourquoi le 8 mars nous nous joignons à vous, à la lutte des femmes, contre les violences, l’exploitation patriarcale, c’est pourquoi le 8 mars, nous demandons un permis de séjour illimité et sans conditions. Nous appelons tout le monde à soutenir cette demande. Faire du 8 mars un point de départ pour continuer cette lutte ensemble. De la force transnationale et la grève un instrument général ! Soutenez-nous, nous avons besoin de vous. »
Se soutenir. Avancer ensemble. Construire réflexions et stratégies à partir des récits et expériences des personnes concernées. Sans prendre leur place. Sans parler à leur place. Doris, travailleuse du sexe et trésorière du STRASS dont elle est la référente en Bretagne, et créatrice des Pétrolettes, association de développement communautaire, le formule parfaitement :
« Nous vous donnons rendez-vous pour poursuivre ensemble la réflexion et les luttes et trouver ensemble des solutions à notre émancipation. La libération des travailleuses du sexe sera l’œuvre des travailleuses du sexe elles-mêmes. »
Son discours analyse les rapports de domination hommes – femmes depuis le système féodal jusqu’à aujourd’hui. Le contrôle des femmes par les hommes. La protection offerte par les hommes aux femmes qui en échange offriront du travail gratuitement. Le viol comme arme de guerre pour détruire la crédibilité du protecteur. Le couple hétérosexuel et la famille comme seule garante de la sécurité des femmes, « alors même que la famille et le couple sont une des plus dangereuses (structures, ndlr) pour elles. »
SOMMES-NOUS DE MAUVAISES FÉMINISTES ?
Au quotidien, à chaque étape de la rédaction de ce dossier, à chaque point de vue controversé que l’on retransmet et diffuse, à chaque critique que l’on établit dans une réflexion globale de comment avancer ensemble, on se demande si nous sommes de mauvaises féministes. Pas que dans le cadre professionnel, d’ailleurs.
On se pose la question régulièrement dans nos vies privées. On ne sent pas toujours légitimes, on ne sent pas assez féministes. Et puis, un jour, Roxane Gay écrit et publie Bad feminist. Ça nous interpelle, on le lit et on respire.
« Le féminisme est imparfait, mais quand il est au meilleur de sa forme, il donne les moyens de naviguer dans les remous du changement de climat culturel. Le féminisme m’a certainement aidée à trouver ma propre voix. Le féminisme m’a aidée à me convaincre que ma voix avait de l’importance, même dans un monde où tant d’autres voix exigent qu’on les entende. Comment réconcilier les imperfections du féminisme avec tout le bien qu’il peut faire ?
À la vérité, ce mouvement est imparfait parce qu’il est dirigé par des gens, et que les gens sont imparfaits par nature. Pour une raison quelconque, en matière de féminisme, nous plaçons la barre à une hauteur déraisonnable, nous voulons qu’il remplisse toutes nos exigences et qu’il fasse toujours les meilleurs choix. », analyse-t-elle.
Elle poursuit un peu plus loin : « Le féminisme m’a apporté la paix. Le féminisme m’a donné des principes qui me guident dans mon écriture, mais je sais aussi que ce n’est pas dramatique quand je ne suis pas à la hauteur de la féministe idéale qui est en moi. Les femmes de couleur, les femmes queer et les femmes transgenres devraient être mieux intégrées dans le projet féministe. Les femmes de ces groupes ont été honteusement abandonnées par le Féminisme avec un grand F, et à de nombreuses reprises. C’est une vérité crue, et douloureuse. (…)
Mais on ne répare par une injustice par une autre. Les erreurs du féminisme n’impliquent pas que l’on doive le rejeter totalement. Nous ne sommes pas tous obligés de croire au même féminisme. Le mouvement peut être pluriel, à condition que nous respections les différents féminismes que nous portons en nous, à condition que nous nous en souciions assez pour tenter de réduire les fractures qui nous séparent. »
Et ce n’est là que l’introduction d’un ouvrage authentique, construit et libérateur. Comme il y en a plein, à l’instar des ouvrages de Mona Chollet et notamment Sorcières – la puissance invaincue des femmes mais aussi de la littérature féministe qui émerge dénonçant la charge mentale comme l’a si bien fait Emma ainsi que les violences gynécologiques et obstétricales, entre autres, et de nombreuses autres thématiques indispensables à l’évolution des mentalités. Et c’est pourquoi le travail sur le matrimoine et la valorisation des œuvres réalisées par des personnes sexisées, racisées, handicapées, trans, etc. est fondamental.
La thématique de l’éducation à l’égalité n’est pas un détail. Depuis les années 90, le marketing genré a envahit les rayons des magasins mais aussi les esprits. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. On a beau lutter, les stéréotypes résistent. Dans Éduquer sans préjugés, Manuela Spinelli et Amandine Hancewicz, co-autrices et co-fondatrices de Parents & Féministes, décryptent les différences de traitement des filles et des garçons dans une société encore largement imprégnée de croyances et de constructions sociales patriarcales.
Dès la naissance, les pleurs des bébés sont analysés à l’aune du sexe de l’enfant, auquel on attribue toute une série d’assignations et d’attentes qui vont de pair. L’influence de ces injonctions est connue : elles entrainent des choix que ce soit dans les activités artistiques, sportives, dans les loisirs, dans la manière de s’habiller, d’interagir avec son environnement mais aussi dans le cursus scolaire et l’orientation professionnelle.
DES EXISTENCES EFFACÉES, NÉGLIGÉES
Sans oublier qu’en occultant plus de la moitié de l’humanité de l’Histoire, on l’invisibilise. Quelle place dans la société peut-on s’octroyer quand dès les premières années de construction personnelle, on ne se voit pas à la télévision, dans les émissions d’actu et de débat mais aussi dans les films et les séries, dans les récits littéraires, les BD, les peintures exposées dans les musées, etc. ?
Quelle histoire nous est donnée à voir et à entendre lorsque l’on aborde les périodes de colonisation ? De quels points de vue situe-t-on ces récits, notamment en matière de décolonisation ? Dans les manuels scolaires, aucune place n’est attribuée aux groupes oppressés.
Depuis 2001, une loi oblige les établissements scolaires à dispenser des cours autour de la vie sexuelle et affective dans sa globalité, et sa pluralité, chaque année. Pourtant, ils sont majoritaires à ne pas le faire. Depuis 2017 seulement, on représente dans son anatomie complète le clitoris pour les classes de seconde.
Dans un seul manuel de SVT. Deux ans plus tard, cinq manuels sur sept le représentent. Entre temps, en 2018, Mme de Lafayette devient la première femme de lettres, décrite comme « la première plume féminine » dans certains médias, à être étudiée au programme de Terminale L en vue des épreuves du baccalauréat.
Dans les livres d’histoire, on parle rapidement d’Olympe de Gouges et de Simone Veil. Qu’en est-il de toutes les autres ? De toutes celles qui ont marqué les arts et la culture, les sports, la politique, les sciences, etc. ? N’ont-elles pas mérité d’être étudiées ?
Depuis plusieurs années, des livres entiers s’écrivent sur toutes ces femmes et elles sont nombreuses. Elles sont citoyennes, avocates, chirurgiennes, navigatrices, pilotes, footballeuses, étudiantes, militantes, lesbiennes, transgenres, intersexes, atteintes d’endométriose, grosses, minces, maigres, anorexiques, boulimiques, handicapées mentales, en fauteuil roulant, au chômage, mères de famille, juives, musulmanes, catholiques, athées, criminelles, violentes, cuisinières, artistes, journalistes, scientifiques, noires, arabes, asiatiques, non binaires, apatrides, orphelines, bourgeoises, prolétaires, ouvrières, femmes de ménage, caissières, diplomates, élues, ministres, polyamoureuses, dessinatrices, travailleuses du sexe, enseignantes… Elles sont plurielles.
Elles ont des parcours atypiques, des parcours dits classiques et linéaires. Elles ont fait des découvertes scientifiques, dont elles ont été dépossédées, elles n’ont pas voulu d’enfant, elles ont subi des violences, elles ont combattu les discriminations, elles ont été incarcérées pour des crimes qu’elles ont commis, elles n’ont jamais obtenu justice, elles ont fait de leur corps une arme de déconstruction, elles ont des tatouages, iels ne se reconnaissent pas dans le pronom féminin, iels veulent un langage plus inclusif, iels exigent un enseignement incluant des modèles variés et réalistes, mêlant les origines, les couleurs de peau, les points de vue, les handicaps, les orientations sexuelles, les identités de genre, les possibles.
Parce qu’il s’agit là de l’histoire d’une évolution. D’une évolution des mentalités face à des personnes qui ont toujours existé mais n’ont pas toujours eu l’espace nécessaire pour parler en toute sécurité et encore moins l’écoute adéquate.
Il y a le besoin de s’identifier mais aussi le besoin de découvrir. Dans un cadre sécurisé et bienveillant. Pas dans un contexte où on exclut les personnes handicapées du cursus dit classique, où les enfants découvrent qu’ils/elles sont noir-e-s parce que les autres se moquent et les insultent, où les mères qui portent le voile n’ont pas le droit d’accompagner les sorties scolaires, où on interdit aux filles l’accès à l’établissement parce que leurs tenues sont considérées comme « non républicaines » et où une fille transgenre a peur de porter des robes parce que l’école ne la reconnaît pas dans son genre.
C’est le cas de Sasha, 7 ans, dont le combat qu’elle porte avec sa famille a été filmé dans le documentaire Petite fille, de Sébastien Lifshitz. Elle est bouleversante, cette enfant qui doit vivre le déni de l’institution face à sa transidentité et le rejet du conservatoire qui refuse qu’elle s’habille comme les autres petites filles.
Accompagnée et soutenue par ses parents et ses frères, ainsi que la pédopsychiatre, Sasha fait bouger les lignes et heureusement, obtient des avancées. De cette diffusion - sur Arte en début d’année et désormais sur Netflix – émerge une nouvelle prise de conscience.
Petite fille constitue un témoignage, une lutte familiale qui mérite d’être portée par le collectif. C’est une partie du récit concernant la transidentité. Car là encore, les parcours diffèrent et les difficultés montrées dans le film ne sont pas exhaustives et ne sont pas les mêmes d’un-e individu à l’autre.
L’histoire racontée dans la BD Appelez-moi Nathan, signée Catherine Castro et Quentin Zuttion, n’est pas la même que celle relatée dans Je suis Sofia, de Céline Gandner et Maël Nahon. L’éducation à l’égalité est fondamentale pour favoriser l’inclusion sans effacer les différences. Pour que chacun-e trouve sa voix et sa place. Son chemin d’émancipation.
Et pour cela, l’information - et son accès, surtout - est un enjeu capital dans la transmission. On peut par exemple suivre le compte instagram de la militante Lexie, agressively_trans, dont le livre Une histoire de genres – Guide pour comprendre et défendre les transidentités a été publié en février dernier.
NE PAS HIÉRARCHISER LES VÉCUS ET LES COMBATS
Nous ne portons pas tou-te-s les mêmes combats au sein de la lutte contre les inégalités et les discriminations. Les féminismes ne sont pas une exception. À l’intérieur de ce mouvement polymorphe, il est important de s’écouter et de se respecter. Sans hiérarchiser.
Comme le disent Mathilde Larrère et Aurore Koechlin, il est plutôt sain que les différents sujets portés soient débattus, rabattant parfois les cartes des luttes et des stratégies à mener. Tant que les critiques sont constructives et qu’elles amènent à faire évoluer les réflexions. On aime le discours d’Alice Coffin à ce sujet.
Dans une interview accordée à National Geographic, elle répond à la question « Quel est le plus grand défi pour les femmes aujourd’hui ? » :
« Se Soutenir. Faire bloc face à l’adversité. Cela requiert de se battre pour les femmes de minorités particulièrement opprimées. Les femmes migrantes, racisées, lesbiennes, précaires, toutes celles qui, en plus du sexisme structurel et quotidien, affrontent d’autres violences et discriminations. Mais cela implique, aussi, d’éviter toute critique publique envers d’autres femmes en position de pouvoir. C’est un exercice difficile, car certaines n’agissent pas en féministes, mais il me semble indispensable, si nous ne voulons pas entretenir la misogynie. Concentrons, en public, nos attaques contre les hommes. »
On sait, on voit déjà de nombreuses personnes grimacer à la lecture de cette dernière phrase. « #NotAllMen », peut-on souvent lire en commentaire des articles ou post qui parlent des féminismes. Elles sont perçues comme radicales celles qui parlent des hommes et des violences masculines. Tout comme les militant-e-s antiracistes qui brandissent #BlackMatterLives et qui se voient rétorquer que TOUTES les vies comptent. Encore une fois, on nie le côté systémique des violences sexistes et sexuelles et des violences racistes.
 Les féminismes regorgent de force, de détermination, font place à des cheminements individuels et collectifs, amènent à repenser ce que nous voulons pour nous et celles et ceux qui nous entourent. Les féminismes mènent des révolutions multiples qui ne concernent pas uniquement les femmes mais globalement le monde dans lequel on vit.
Les féminismes regorgent de force, de détermination, font place à des cheminements individuels et collectifs, amènent à repenser ce que nous voulons pour nous et celles et ceux qui nous entourent. Les féminismes mènent des révolutions multiples qui ne concernent pas uniquement les femmes mais globalement le monde dans lequel on vit.
Les rapports sociaux, environnementaux, économiques, politiques, et la manière dont ils sont traités dans toutes les sphères de la société. À présent, le mouvement même se renouvelle à travers les critiques qui lui sont faites dans la façon de prendre en considération les voix et les points de vues des groupes dits minoritaires. Une révolution dans la révolution.
Se libérer de l’universalisme est un enjeu féministe du XXIe siècle. Ecouter, prendre en compte, agir ensemble mais sans prendre la place des concernées. Sororité avec les femmes sans papiers, les femmes sans domicile, les femmes travailleuses du sexe, les femmes racisées, les femmes voilées, les femmes détenues, les femmes handicapées, les personnes non binaires, les personnes trans, les lesbiennes, les personnes intersexes, les femmes qui ne veulent pas d’enfant…
Il reste encore de nombreux sujets qui cristallisent encore les divisions et les impensés au sein du mouvement féministe. Poser des questions, interroger la famille traditionnelle, repenser les rapports au corps et leur monétisation, mettre au travail la question des privilèges, oui, des discussions peuvent avoir lieu, des débats sont nécessaires.
Mais ce qui est inenvisageable, c’est de laisser ces personnes sur le côté sous prétexte qu’elles ne conviennent pas à nos modes de pensée, à nos idéologies militantes. Sinon, on reproduit les mécanismes de domination que le patriarcat a instauré, tout comme le capitalisme, le racisme, etc.
On peut ne pas être d’accord mais on doit s’unir dans l’adversité malgré les dissensions, sans se juger et se lyncher. Le 8 mars dernier, l’association déCONSTRUIRE partageait sur sa page Facebook un extrait de La parole aux négresses, écrit par Awa Thiam en 1978 et qui résonne encore aujourd’hui :
« La solution aux problèmes des femmes sera collective et internationale. Le changement de leur statut sera à ce prix ou ne sera pas. Que l’on veuille bien jeter un coup d’œil sur l’histoire de la condition féminine. Parcourue ou illustrée de luttes, elle n’a guère cessé d’évoluer, mais à une allure telle qu’il apparaît que les femmes qui luttent pour leur libération et corrélativement pour celle de leurs sociétés entreprennent une lutte de longe haleine. En d’autres termes, nous dirons qu’il s’agit non d’une course de vitesse mais d’une course de fond. Que les femmes s’arment en conséquence pour la mener à bien. »
NOUS SOMMES FORTES, NOUS SOMMES FIÈRES…
La révolution féministe a lieu depuis longtemps. Elle est plurielle. Il nous faut reconnecter les histoires du passé aux luttes actuelles. Comprendre l’impact de ces histoires erronées, partielles. Parce qu’elles ont été écrites par les hommes pour les hommes, nous avons besoin de les explorer pour savoir d’où nous venons et d’où viennent les autres. Nous avons besoin d’entendre les voix des groupes oppressés pour pouvoir davantage appréhender leurs vécus et leurs ressentis.
Et prendre en compte les besoins. Considérer les personnes sexisées dans toute leur complexité. Parce que les assignations nous divisent, nous opposent et nous blessent. Les féminismes sont des outils individuels et collectifs pour construire un projet de société affranchi des systèmes de domination. Une utopie ? Peut-être ! Pas tant que ça…
Quand on voit les avancées sur quelques dizaines d’années, à l’échelle de l’humanité, c’est un tour de force magistrale. Ce sont des personnes sexisées et racisées que toutes ces victoires sont survenues. Avec les réseaux sociaux, on assiste à une explosion des initiatives, comptes, chaines proposant d’autres discours, d’autres façons de penser, d’autres modèles.
Les militantes prennent leur place et prennent la parole, à travers les podcasts notamment, outil incontournable de la reconquête de l’espace médiatique et de la déconstruction des codes et des normes. De plus en plus, elles occupent l’espace public, et elles sont de plus en plus nombreuses.
Elles appellent à combattre les féminicides mais aussi les violences policières et les lois rétrogrades. Les mots résonnent dans le mégaphone mais pas seulement. Ils sont aussi pochés sur les trottoirs, tagués sur les ponts, collés sur les murs des villes. Impossible de passer à côté.
On peut toujours détourner le regard, tourner la tête, nos yeux ont balayé les mots du regard et ils ne sont pas faciles à effacer. Et tandis que l’on rentre chez nous, à la lumière déclinante du jour, les ombres du patriarcat surgissent sous nos pas nous murmurant de raser les murs et de presser nos foulées. Alors, dans la tête, on entonne une ritournelle qui nous accompagne et nous donne le sourire :
« Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère… Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère… NOUS SOMMES FORTES, NOUS SOMMES FIÈRES, ET FÉMINISTES ET RADICALES ET EN COLÈRE… Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère… »
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on fait ce qu’on peut. Ça veut dire qu’on fait ce qu’on veut. Et que allié-e-s à nos adelphes d’hier, d’aujourd’hui et de demain, à travers le monde entier, nous allons compter ! Nous comptons déjà !


 D’un bout à l’autre de la manifestation, se font entendre le bruit et le vacarme de la colère et de la révolte. Sur les pancartes trônent des messages engagés et solidaires: « Soyez écolos, plantez des riches », « Nous sommes les voix de celles qui n’en ont pas – Free Palestine », « Viva la vulva », « Pas de fachos dans nos quartiers – pas de quartier pour les fachos », « Contre l’utilisation raciste de nos luttes féministes », « Justice pour les incesté-es » ou encore « Mon corps mon choix », « On te croit », « Un silence n’est pas un oui – Un viol n’est jamais un accident » et « Destruction totale et irrévocable du patriarcat – BADABOUM ». Les mines sont enjouées, les poings levés, les corps dansent et les percussions vibrent et résonnent dans un espace public animé par les luttes féministes.
D’un bout à l’autre de la manifestation, se font entendre le bruit et le vacarme de la colère et de la révolte. Sur les pancartes trônent des messages engagés et solidaires: « Soyez écolos, plantez des riches », « Nous sommes les voix de celles qui n’en ont pas – Free Palestine », « Viva la vulva », « Pas de fachos dans nos quartiers – pas de quartier pour les fachos », « Contre l’utilisation raciste de nos luttes féministes », « Justice pour les incesté-es » ou encore « Mon corps mon choix », « On te croit », « Un silence n’est pas un oui – Un viol n’est jamais un accident » et « Destruction totale et irrévocable du patriarcat – BADABOUM ». Les mines sont enjouées, les poings levés, les corps dansent et les percussions vibrent et résonnent dans un espace public animé par les luttes féministes. Intitulé L’art de la joie en femmage à l’œuvre littéraire de Goliarda Sapienza, le projet est aujourd’hui porté par la Brave Compagnie « mais il est parti d’une initiative collective et amicale », précise Johanna Rocard, co-fondatrice de la structure, aux côtés d’Estelle Chaigne et Amandine Braud. « En 2023, on s’est retrouvées à plusieurs dans la manif du 8 mars. Il y avait moins de mobilisation cette année-là, ce qui s’explique par la guerre en Ukraine et les actus qui se priorisent… On n’était pas très fières de notre engagement, on était un peu à la va vite », poursuit-elle.
Intitulé L’art de la joie en femmage à l’œuvre littéraire de Goliarda Sapienza, le projet est aujourd’hui porté par la Brave Compagnie « mais il est parti d’une initiative collective et amicale », précise Johanna Rocard, co-fondatrice de la structure, aux côtés d’Estelle Chaigne et Amandine Braud. « En 2023, on s’est retrouvées à plusieurs dans la manif du 8 mars. Il y avait moins de mobilisation cette année-là, ce qui s’explique par la guerre en Ukraine et les actus qui se priorisent… On n’était pas très fières de notre engagement, on était un peu à la va vite », poursuit-elle. Au cours des deux semaines, l’événement a proposé des journées en accès libre et des temps d’aide à la couture, des ateliers cagoules ou chorales et des créneaux pour accueillir des structures partenaires comme le GPAS et les enfants de Maurepas. « Ce sont des publics qu’on ne toucherait pas sans ce lieu dédié. Il y a par exemple des femmes d’un certain âge qui sont venues à un atelier et sont revenues ensuite. On aurait aimé aussi faire quelque chose avec les femmes de la prison de Rennes, qu’elles puissent porter leurs voix et manifester avec nous mais c’est tombé à l’eau », souligne Cassandre, plasticienne investie dans L’art de la joie.
Au cours des deux semaines, l’événement a proposé des journées en accès libre et des temps d’aide à la couture, des ateliers cagoules ou chorales et des créneaux pour accueillir des structures partenaires comme le GPAS et les enfants de Maurepas. « Ce sont des publics qu’on ne toucherait pas sans ce lieu dédié. Il y a par exemple des femmes d’un certain âge qui sont venues à un atelier et sont revenues ensuite. On aurait aimé aussi faire quelque chose avec les femmes de la prison de Rennes, qu’elles puissent porter leurs voix et manifester avec nous mais c’est tombé à l’eau », souligne Cassandre, plasticienne investie dans L’art de la joie. UN LIEU VIVANT ET JOYEUX
UN LIEU VIVANT ET JOYEUX Cassandre, ce jour-là, s’affaire à la couture pour terminer sa bannière : « J’avais un slogan en tête mais je ne savais pas comment le mettre en forme. Sans compter qu’on ne se rend pas compte le temps que ça prend, c’est très long ! » Sur un tissu orange, elle inscrit et ajuste le message, lettre bleue par lettre bleue : « Aux violeurs de Gisèle et aux autres nous n’oublierons jamais vos visages ni vos noms ni vos actions » Pour elle, ce lieu est important : « Si on ne l’avait pas, il n’existerait pas ! » Cet endroit, c’est un espace de rencontres et de partages. De mutualisation du matériel et des compétences. D’engagement et de militantisme.
Cassandre, ce jour-là, s’affaire à la couture pour terminer sa bannière : « J’avais un slogan en tête mais je ne savais pas comment le mettre en forme. Sans compter qu’on ne se rend pas compte le temps que ça prend, c’est très long ! » Sur un tissu orange, elle inscrit et ajuste le message, lettre bleue par lettre bleue : « Aux violeurs de Gisèle et aux autres nous n’oublierons jamais vos visages ni vos noms ni vos actions » Pour elle, ce lieu est important : « Si on ne l’avait pas, il n’existerait pas ! » Cet endroit, c’est un espace de rencontres et de partages. De mutualisation du matériel et des compétences. D’engagement et de militantisme.  Ensemble, elles investissent un espace résolument engagé, un militantisme féministe « au croisement très clair des luttes décoloniales, queer et migrantes », au service et en soutien du mouvement collectif. Elle le dit : « On ne théorise pas plus que ça dans ce lieu de création. On ne fait pas le travail de NousToutes 35, du Cridev et des autres associations qui à l’année font un travail de fond que l’on vient ici soutenir et rendre visible. » Elle aborde le contexte actuel, l’importance et l’impact des images, le besoin et l’intérêt de créer des visuels joyeux. Proposer un cortège flamboyant et lumineux pour affirmer les éléments positifs existants dans la société. Valoriser les savoir-faire et les joies partagées : « Il y a des choses qui vont mal mais il n’y a pas que ça. Face à l’effet de sidération que nous apporte l’actualité, c’est important de visibiliser toutes les personnes qui font des choses incroyables, dans ce travail de la forme et de la création. »
Ensemble, elles investissent un espace résolument engagé, un militantisme féministe « au croisement très clair des luttes décoloniales, queer et migrantes », au service et en soutien du mouvement collectif. Elle le dit : « On ne théorise pas plus que ça dans ce lieu de création. On ne fait pas le travail de NousToutes 35, du Cridev et des autres associations qui à l’année font un travail de fond que l’on vient ici soutenir et rendre visible. » Elle aborde le contexte actuel, l’importance et l’impact des images, le besoin et l’intérêt de créer des visuels joyeux. Proposer un cortège flamboyant et lumineux pour affirmer les éléments positifs existants dans la société. Valoriser les savoir-faire et les joies partagées : « Il y a des choses qui vont mal mais il n’y a pas que ça. Face à l’effet de sidération que nous apporte l’actualité, c’est important de visibiliser toutes les personnes qui font des choses incroyables, dans ce travail de la forme et de la création. » Si l’événement s’empare des codes et valeurs de la tradition carnavalesque et de sa manière de se costumer pour dénoncer et critiquer les systèmes de domination, les participant-es s’approprient l’expérience. « J’ai longtemps été dans le collectif Mardi Gras et pour moi, ce que l’on fait là est un peu différent. Au Carnaval, on renverse les situations et on s’autorise à être qui on n’est pas. Ici, je me sens très moi-même au contraire ! La symbolique est différente et je ne porte pas de la même manière le costume au carnaval qu’au 8 mars », analyse Sophie. C’est une forme d’exutoire qui lui donne accès à son identité et sa personnalité, hors des injonctions sociales et patriarcales : « J’ai l’impression d’être moi-même, d’être une version de moi-même que je ne peux pas incarner tous les jours parce qu’elle est trop intense cette version ! » Bas les masques, désactivés les filtres du quotidien. Pour Sophie, c’est un sentiment de grand soulagement. En enfilant le costume, elle a la sensation de révéler qui elle est :
Si l’événement s’empare des codes et valeurs de la tradition carnavalesque et de sa manière de se costumer pour dénoncer et critiquer les systèmes de domination, les participant-es s’approprient l’expérience. « J’ai longtemps été dans le collectif Mardi Gras et pour moi, ce que l’on fait là est un peu différent. Au Carnaval, on renverse les situations et on s’autorise à être qui on n’est pas. Ici, je me sens très moi-même au contraire ! La symbolique est différente et je ne porte pas de la même manière le costume au carnaval qu’au 8 mars », analyse Sophie. C’est une forme d’exutoire qui lui donne accès à son identité et sa personnalité, hors des injonctions sociales et patriarcales : « J’ai l’impression d’être moi-même, d’être une version de moi-même que je ne peux pas incarner tous les jours parce qu’elle est trop intense cette version ! » Bas les masques, désactivés les filtres du quotidien. Pour Sophie, c’est un sentiment de grand soulagement. En enfilant le costume, elle a la sensation de révéler qui elle est :
 « Face aux violences, notre silence les arrange, notre colère les dérange » Le ton est donné face à cette grande banderole qui trône en tête de cortège, en étendard et symbole du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences à l’encontre des personnes sexisées. Samedi 23 novembre, elles étaient des milliers, personnes concernées et allié-es, à se rassembler partout en France, pour faire entendre leurs voix et leurs colères et ensemble dénoncer les violences sexistes et sexuelles.
« Face aux violences, notre silence les arrange, notre colère les dérange » Le ton est donné face à cette grande banderole qui trône en tête de cortège, en étendard et symbole du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences à l’encontre des personnes sexisées. Samedi 23 novembre, elles étaient des milliers, personnes concernées et allié-es, à se rassembler partout en France, pour faire entendre leurs voix et leurs colères et ensemble dénoncer les violences sexistes et sexuelles. « Contre le patriarcat, riposte féministe ! », « Réarmement féministe », « Not all men – 95% », « Pour le sang et la douleur on a déjà nos règles » ou encore « J’avais 10 ans et 17 ans » Elles sont nombreuses les pancartes ce jour-là, à côtoyer les chants, les percussions et les vibrations du sol, au rythme d’une marche placée sous le signe de la combattivité, de la rage, de la joie militante et de l’espoir. Parmi les slogans emblématiques, « la honte doit changer de camp » revient comme un fil rouge, en écho à l’actualité brûlante du procès des viols de Mazan. Mais aussi des affaires et scandales qui se multiplient à vitesse historique (Bedos, Depardieu, Plaza, Doillon, Jacquot, Nekfeu, Naps, Abbé Pierre…)
« Contre le patriarcat, riposte féministe ! », « Réarmement féministe », « Not all men – 95% », « Pour le sang et la douleur on a déjà nos règles » ou encore « J’avais 10 ans et 17 ans » Elles sont nombreuses les pancartes ce jour-là, à côtoyer les chants, les percussions et les vibrations du sol, au rythme d’une marche placée sous le signe de la combattivité, de la rage, de la joie militante et de l’espoir. Parmi les slogans emblématiques, « la honte doit changer de camp » revient comme un fil rouge, en écho à l’actualité brûlante du procès des viols de Mazan. Mais aussi des affaires et scandales qui se multiplient à vitesse historique (Bedos, Depardieu, Plaza, Doillon, Jacquot, Nekfeu, Naps, Abbé Pierre…)  Sans oublier qu’une femme est tuée tous les 2 à 3 jours par son partenaire ou ex-partenaire, que 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol par an en France ou encore que plus de 270 000 personnes subissent des violences conjugales. Elle poursuit : « Des millions de femmes, ici et partout dans le monde, souffrent en silence. Les violences brisent des vies et défigurent des sociétés. »
Sans oublier qu’une femme est tuée tous les 2 à 3 jours par son partenaire ou ex-partenaire, que 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol par an en France ou encore que plus de 270 000 personnes subissent des violences conjugales. Elle poursuit : « Des millions de femmes, ici et partout dans le monde, souffrent en silence. Les violences brisent des vies et défigurent des sociétés. »  « Nous devons regarder vers l’avenir. Qu’allons-nous laisser ? Une société où les violences sexistes et sexuelles continueront de se répandre ou un monde où l’égalité, la dignité et le respect régneront pour toutes les femmes et les filles ? Le chemin reste semé d’embuches mais il est essentiel que nous poursuivions le combat. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour toutes celles qui, par peur ou honte, n’osent pas encore parler. »
« Nous devons regarder vers l’avenir. Qu’allons-nous laisser ? Une société où les violences sexistes et sexuelles continueront de se répandre ou un monde où l’égalité, la dignité et le respect régneront pour toutes les femmes et les filles ? Le chemin reste semé d’embuches mais il est essentiel que nous poursuivions le combat. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour toutes celles qui, par peur ou honte, n’osent pas encore parler. »

 C’est une histoire d’alliances. Toujours. Mais c’est aussi une histoire d’invisibilisation. Toujours. Les lesbiennes ont sans cesse lutté pour les droits des femmes, pour la dignité et le respect des individus, pour la défense des biens communs et sociaux. Pour tou-te-s. Et pourtant, elles ont toujours été écartées de l’Histoire. Silenciées, méprisées, infériorisées, stéréotypées, stigmatisées… Elles sont souvent réduites à une série de clichés, quand elles ne sont pas ignorées par la société et ses représentations médiatiques, militantes, culturelles, artistiques ou encore sportives.
C’est une histoire d’alliances. Toujours. Mais c’est aussi une histoire d’invisibilisation. Toujours. Les lesbiennes ont sans cesse lutté pour les droits des femmes, pour la dignité et le respect des individus, pour la défense des biens communs et sociaux. Pour tou-te-s. Et pourtant, elles ont toujours été écartées de l’Histoire. Silenciées, méprisées, infériorisées, stéréotypées, stigmatisées… Elles sont souvent réduites à une série de clichés, quand elles ne sont pas ignorées par la société et ses représentations médiatiques, militantes, culturelles, artistiques ou encore sportives.  Quand on pense homosexualité, on pense au masculin. Et dans les rares cas où on l’envisage au féminin, notre regard est biaisé par les clichés sexualisants et pornographiques. Par le fantasme de deux femmes hétéros se donnant du plaisir pour satisfaire les désirs des hommes. Et si elles affirment leur lesbianisme hors des codes hétéropatriarcaux, alors on les insulte en les traitant de mal baisées, d’aigries et on les réduit à l’image unique du « garçon manqué », d’une femme tentant de correspondre aux caractéristiques de la virilité hégémonique… Ces stéréotypes sexistes et lesbophobes encore très ancrés dans les mentalités accompagnent et participent significativement aux mécanismes d’invisibilisation des lesbiennes, de leur pluralité, de leur culture, de leurs trajectoires vécues, des difficultés subies, de leur histoire militante… Alors même qu’elles ont toujours été impliquées dans les mouvements féministes et LGBTIQ+, profitant à l’ensemble de la société.
Quand on pense homosexualité, on pense au masculin. Et dans les rares cas où on l’envisage au féminin, notre regard est biaisé par les clichés sexualisants et pornographiques. Par le fantasme de deux femmes hétéros se donnant du plaisir pour satisfaire les désirs des hommes. Et si elles affirment leur lesbianisme hors des codes hétéropatriarcaux, alors on les insulte en les traitant de mal baisées, d’aigries et on les réduit à l’image unique du « garçon manqué », d’une femme tentant de correspondre aux caractéristiques de la virilité hégémonique… Ces stéréotypes sexistes et lesbophobes encore très ancrés dans les mentalités accompagnent et participent significativement aux mécanismes d’invisibilisation des lesbiennes, de leur pluralité, de leur culture, de leurs trajectoires vécues, des difficultés subies, de leur histoire militante… Alors même qu’elles ont toujours été impliquées dans les mouvements féministes et LGBTIQ+, profitant à l’ensemble de la société.  Et même lorsque la thématique lesbienne est abordée dans le film d’animation En avant, les articles ne mentionnent jamais le terme… On parle alors « du premier personnage homosexuel », tout comme on parle d’un « passage gay » censuré dans Buzz l’éclair, et on explique que le film est interdit de diffusion dans les pays du Moyen Orient en raison de ce « personnage homosexuel » qui explique « son homosexualité ». Ce personnage, c’est une policière. Si on ne le sait pas, on se figure une relation homosexuelle entre deux hommes. Parce que la lesbophobie s’exprime au croisement de l’homophobie et du sexisme.
Et même lorsque la thématique lesbienne est abordée dans le film d’animation En avant, les articles ne mentionnent jamais le terme… On parle alors « du premier personnage homosexuel », tout comme on parle d’un « passage gay » censuré dans Buzz l’éclair, et on explique que le film est interdit de diffusion dans les pays du Moyen Orient en raison de ce « personnage homosexuel » qui explique « son homosexualité ». Ce personnage, c’est une policière. Si on ne le sait pas, on se figure une relation homosexuelle entre deux hommes. Parce que la lesbophobie s’exprime au croisement de l’homophobie et du sexisme.  C’est là que le militantisme lesbien et le militantisme féministe se rejoignent, à Rennes. Au début des années 80. L’association Femmes Entre Elles met en place des stages de wendo, une pratique d’auto-défense féministe adaptant les techniques des arts martiaux et de la self défense aux vécus spécifiques des femmes. Ces dernières « prennent collectivement conscience des violences qu’elles ont vécues » et partagent « un moment où elles acquièrent confiance en elles. » Se protéger lors d’une agression, apprivoiser sa peur dans une situation de tension pour ne pas céder à la panique, découvrir et valoriser sa force et sa puissance, voilà ce que le wendo propose.
C’est là que le militantisme lesbien et le militantisme féministe se rejoignent, à Rennes. Au début des années 80. L’association Femmes Entre Elles met en place des stages de wendo, une pratique d’auto-défense féministe adaptant les techniques des arts martiaux et de la self défense aux vécus spécifiques des femmes. Ces dernières « prennent collectivement conscience des violences qu’elles ont vécues » et partagent « un moment où elles acquièrent confiance en elles. » Se protéger lors d’une agression, apprivoiser sa peur dans une situation de tension pour ne pas céder à la panique, découvrir et valoriser sa force et sa puissance, voilà ce que le wendo propose. Puisqu’elles ne couchent pas avec les représentants du patriarcat et de son sbire, le système hétéro, les lesbiennes sont-elles les seules véritables féministes ? La question bouscule et a le mérite d’entrer en profondeur dans le vif du sujet. Le féminisme serait la théorie et le lesbianisme, la pratique, selon Ti-Grace Atkinson, grande figure du féminisme radical et du militantisme lesbien. Dans les travaux présentés par FEERIE, on retrouve à Rennes ce climat de tensions, cette peur au sein de la Cité d’Elles « d’être définies comme moins féministes si on n’a pas de vécus lesbiens », indique un compte rendu de réunion. Un sentiment « que le lesbianisme peut être ressenti comme un jugement de valeur envers les femmes qui ne le sont pas. » Les points de vue divergent et toutes les militantes, féministes comme lesbiennes, ne s’identifient pas dans ce courant de pensée.
Puisqu’elles ne couchent pas avec les représentants du patriarcat et de son sbire, le système hétéro, les lesbiennes sont-elles les seules véritables féministes ? La question bouscule et a le mérite d’entrer en profondeur dans le vif du sujet. Le féminisme serait la théorie et le lesbianisme, la pratique, selon Ti-Grace Atkinson, grande figure du féminisme radical et du militantisme lesbien. Dans les travaux présentés par FEERIE, on retrouve à Rennes ce climat de tensions, cette peur au sein de la Cité d’Elles « d’être définies comme moins féministes si on n’a pas de vécus lesbiens », indique un compte rendu de réunion. Un sentiment « que le lesbianisme peut être ressenti comme un jugement de valeur envers les femmes qui ne le sont pas. » Les points de vue divergent et toutes les militantes, féministes comme lesbiennes, ne s’identifient pas dans ce courant de pensée.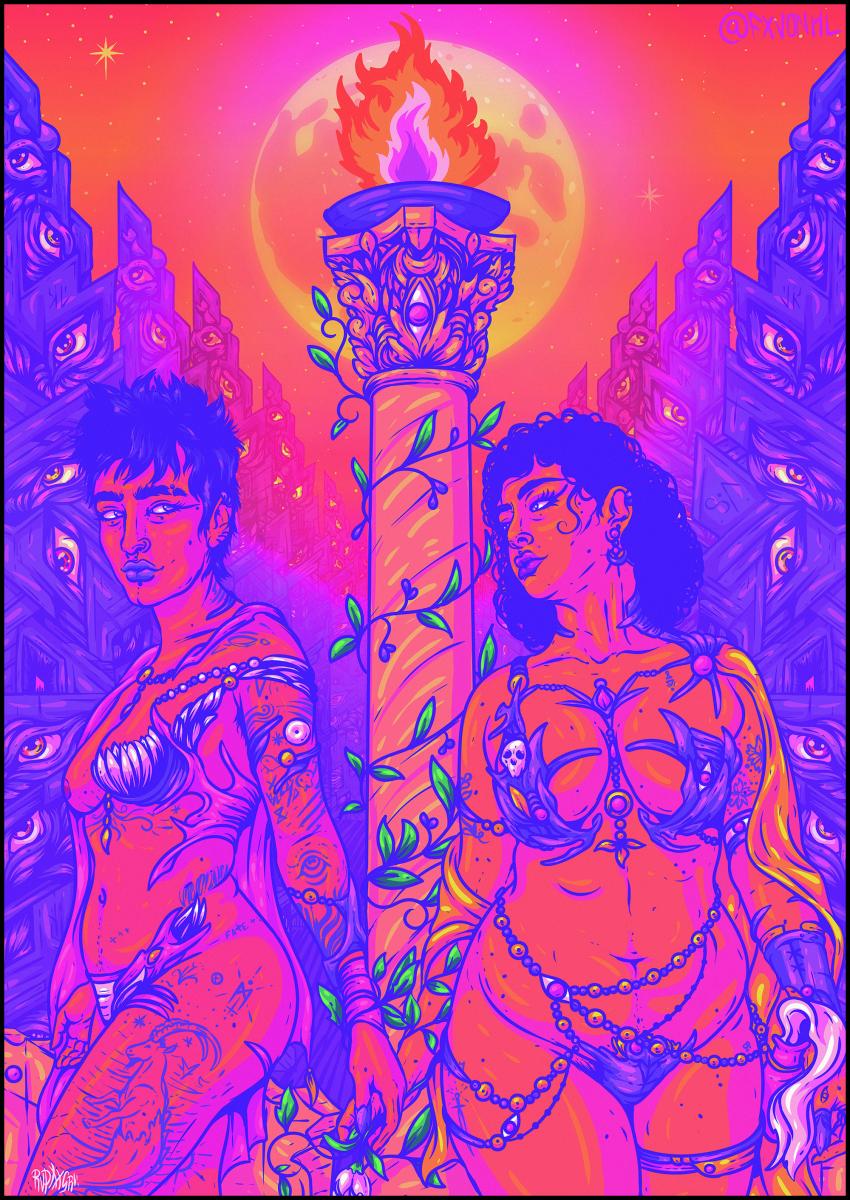 Elles initient une équipe de handball, des soirées FEEstives dans lesquelles les arts et la culture sont à l’honneur, instaurent de nouveaux ateliers, font perdurer certains anciens, se mettent aux réseaux sociaux, refont leur site internet, continuent les permanences à la MJC La Paillette et protestent contre les anti-Mariage pour tous, recevant au passage haine et injures des militant-e-s de la Manif pour tous… Elles maintiennent les liens étroits et partenariaux avec la Marche des Fiertés, le 8 mars à Rennes, les associations de santé des femmes à l’instar du Planning Familial, déménagent à Villejean, organisent des conférences, mettent en place des apéros zoom et une ligne téléphonique solidaire durant le confinement et éditent en 2021 le livre Paroles des FEES confinées avant de se concentrer sur l’organisation des 40 ans de l’association.
Elles initient une équipe de handball, des soirées FEEstives dans lesquelles les arts et la culture sont à l’honneur, instaurent de nouveaux ateliers, font perdurer certains anciens, se mettent aux réseaux sociaux, refont leur site internet, continuent les permanences à la MJC La Paillette et protestent contre les anti-Mariage pour tous, recevant au passage haine et injures des militant-e-s de la Manif pour tous… Elles maintiennent les liens étroits et partenariaux avec la Marche des Fiertés, le 8 mars à Rennes, les associations de santé des femmes à l’instar du Planning Familial, déménagent à Villejean, organisent des conférences, mettent en place des apéros zoom et une ligne téléphonique solidaire durant le confinement et éditent en 2021 le livre Paroles des FEES confinées avant de se concentrer sur l’organisation des 40 ans de l’association. Ne pas visibiliser l’Histoire des lesbiennes, ne pas visibiliser la pluralité des orientations sexuelles et affectives dans les lieux de travail, les médias, les publicités, les espaces de socialisation, les sports, etc. participe aux violences qui s’exercent contre les concernées dans l’espace privé comme public, comme le démontre le rapport 2022 sur les LGBTIphobies, réalisé par SOS Homophobie. « Constat alarmant en 2021 : les lesbiennes qui subissent des violences et discriminations sont de plus en plus jeunes. Pas moins d’une sur quatre est mineure (contre une sur cinq en 2020) et près de la moitié a moins de 24 ans. », peut-on lire dans l’enquête. Insultes, menaces, rejets, séquestrations… Les violences ont principalement lieu dans la sphère familiale, premier contexte de lesbophobie, avant le cadre professionnel. Autre source de violence en augmentation : l’outing.
Ne pas visibiliser l’Histoire des lesbiennes, ne pas visibiliser la pluralité des orientations sexuelles et affectives dans les lieux de travail, les médias, les publicités, les espaces de socialisation, les sports, etc. participe aux violences qui s’exercent contre les concernées dans l’espace privé comme public, comme le démontre le rapport 2022 sur les LGBTIphobies, réalisé par SOS Homophobie. « Constat alarmant en 2021 : les lesbiennes qui subissent des violences et discriminations sont de plus en plus jeunes. Pas moins d’une sur quatre est mineure (contre une sur cinq en 2020) et près de la moitié a moins de 24 ans. », peut-on lire dans l’enquête. Insultes, menaces, rejets, séquestrations… Les violences ont principalement lieu dans la sphère familiale, premier contexte de lesbophobie, avant le cadre professionnel. Autre source de violence en augmentation : l’outing. Pas question pour elles de rajouter de la pression à l’injonction d’avoir des enfants. Il s’agit là de visibiliser une réalité, de repenser les représentations autour de la maternité, de questionner les schémas de la famille nucléaire, de s’interroger sur le militantisme quand on est mère, etc. Pour Lisa, « il y a une injonction très forte de dire que les femmes doivent être mères. Le féminisme a voulu rompre avec ça à l’époque. Aujourd’hui, c’est important de politiser la maternité en pensant les modes de garde et les manières de s’organiser pour continuer à militer. » Elsa prend la suite, posant la question : « Comment concilier la vie de mère gouine militante ? Nos lieux de sociabilité sont tournés vers les manifs et la fête. Qui ne sont pas forcément pour les enfants. Des choses se jouent à ce niveau-là. Il y a une super alternative grâce à La Bulle, à Rennes. C’est très concret puisque l’association propose de garder les enfants pendant les événements festifs et militants. C’est en train de se monter en ce moment à Paris. »
Pas question pour elles de rajouter de la pression à l’injonction d’avoir des enfants. Il s’agit là de visibiliser une réalité, de repenser les représentations autour de la maternité, de questionner les schémas de la famille nucléaire, de s’interroger sur le militantisme quand on est mère, etc. Pour Lisa, « il y a une injonction très forte de dire que les femmes doivent être mères. Le féminisme a voulu rompre avec ça à l’époque. Aujourd’hui, c’est important de politiser la maternité en pensant les modes de garde et les manières de s’organiser pour continuer à militer. » Elsa prend la suite, posant la question : « Comment concilier la vie de mère gouine militante ? Nos lieux de sociabilité sont tournés vers les manifs et la fête. Qui ne sont pas forcément pour les enfants. Des choses se jouent à ce niveau-là. Il y a une super alternative grâce à La Bulle, à Rennes. C’est très concret puisque l’association propose de garder les enfants pendant les événements festifs et militants. C’est en train de se monter en ce moment à Paris. » Cette enquête VOILAT (visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail), que l’on doit à l’association LGBTIQ+, L’Autre Cercle, et à l’Ifop, révèle que 53% des personnes interrogées a subi au moins une discrimination ou une agression au cours de sa carrière professionnelle. Conséquences lourdes et directes sur la santé émotionnelle et mentale : elles sont 34% à avoir quitté leur travail et 45% à avoir eu des pensées suicidaires. Le rapport souligne également que 41% des répondantes ont vécu des moqueries ou des propos désobligeants qui leur étaient personnellement adressé-e-s et 62% ont été témoins de termes lesbophobes sans qu’ils leur soient personnellement adressés.
Cette enquête VOILAT (visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail), que l’on doit à l’association LGBTIQ+, L’Autre Cercle, et à l’Ifop, révèle que 53% des personnes interrogées a subi au moins une discrimination ou une agression au cours de sa carrière professionnelle. Conséquences lourdes et directes sur la santé émotionnelle et mentale : elles sont 34% à avoir quitté leur travail et 45% à avoir eu des pensées suicidaires. Le rapport souligne également que 41% des répondantes ont vécu des moqueries ou des propos désobligeants qui leur étaient personnellement adressé-e-s et 62% ont été témoins de termes lesbophobes sans qu’ils leur soient personnellement adressés. Elle pointe l’absence de modèles. L’absence de représentations. Et rejoint alors le propos d’Alice Coffin à ce sujet : « Eh bien, moi, cela me regarde. Je suis passée à côté de dix ans de ma vie parce que je n’avais pas d’exemples de lesbiennes auxquels m’identifier. À cause de ceux qui confinent l’homosexualité à la sphère privée. Un quart des ados LGBT a déjà fait une tentative de suicide. L’absence de personnalités out en France a un lien direct avec l’écho donné à la haine de la Manif pour tous, le suicide des adolescents LGBT, le report systématique du vote de la PMA (elle explique d’ailleurs dans une autre partie du livre comment le débat s’est déroulé sans les lesbiennes, ndlr), les discriminations qui visent l’ensemble des minorités françaises et pas juste les homosexuels. La familiarité entraine l’acceptation. Quand des politiques ont pour collègue un député gay, quand des journalistes ont pour consœur une reporter lesbienne, quand des sportifs ont un coéquipier homo, ils, elles hésitent avant de balancer une insulte homophobe. »
Elle pointe l’absence de modèles. L’absence de représentations. Et rejoint alors le propos d’Alice Coffin à ce sujet : « Eh bien, moi, cela me regarde. Je suis passée à côté de dix ans de ma vie parce que je n’avais pas d’exemples de lesbiennes auxquels m’identifier. À cause de ceux qui confinent l’homosexualité à la sphère privée. Un quart des ados LGBT a déjà fait une tentative de suicide. L’absence de personnalités out en France a un lien direct avec l’écho donné à la haine de la Manif pour tous, le suicide des adolescents LGBT, le report systématique du vote de la PMA (elle explique d’ailleurs dans une autre partie du livre comment le débat s’est déroulé sans les lesbiennes, ndlr), les discriminations qui visent l’ensemble des minorités françaises et pas juste les homosexuels. La familiarité entraine l’acceptation. Quand des politiques ont pour collègue un député gay, quand des journalistes ont pour consœur une reporter lesbienne, quand des sportifs ont un coéquipier homo, ils, elles hésitent avant de balancer une insulte homophobe. »  Un bonheur qui participe à la construction de l’identité de femme, de lesbienne. « Et si on est plus fortes collectivement et qu’on acquiert de la visibilité collective, on devient plus fortes individuellement, dans nos vies, auprès de nos familles, nos entourages, nos boulots, etc. Ce qui n’est pas nommé n’existe pas. Alors, au sein de FEE, on s’est nommées lesbiennes dans les statuts et on s’est rendues visibles au monde. Puis on est allées vers la mairie pour obtenir des subventions. On a obtenu la première en 1994, je peux vous dire que ça a fait grand bruit ! Il y avait même un tract du FN qui disait que les impôts locaux étaient gaspillés en nous donnant de l’argent… On a fait ajouter le terme Lesbian à la Gay pride parce qu’il n’y était pas alors que les femmes participaient à la Marche ! Et puis, on a eu un stand comme les autres à l’occasion du 8 mars plus tard. On voyait bien qu’on dénotait. Que tout le monde n’était pas habitué à rencontrer des lesbiennes… On a continué encore et encore à se rendre visibles. », scande la militante.
Un bonheur qui participe à la construction de l’identité de femme, de lesbienne. « Et si on est plus fortes collectivement et qu’on acquiert de la visibilité collective, on devient plus fortes individuellement, dans nos vies, auprès de nos familles, nos entourages, nos boulots, etc. Ce qui n’est pas nommé n’existe pas. Alors, au sein de FEE, on s’est nommées lesbiennes dans les statuts et on s’est rendues visibles au monde. Puis on est allées vers la mairie pour obtenir des subventions. On a obtenu la première en 1994, je peux vous dire que ça a fait grand bruit ! Il y avait même un tract du FN qui disait que les impôts locaux étaient gaspillés en nous donnant de l’argent… On a fait ajouter le terme Lesbian à la Gay pride parce qu’il n’y était pas alors que les femmes participaient à la Marche ! Et puis, on a eu un stand comme les autres à l’occasion du 8 mars plus tard. On voyait bien qu’on dénotait. Que tout le monde n’était pas habitué à rencontrer des lesbiennes… On a continué encore et encore à se rendre visibles. », scande la militante. « C’est un mot que seules les lesbiennes, les queer peuvent utiliser. Ce serait super gênant que les hétéros le disent. C’est une dimension très politique pour nous. On est fières d’être gouines. C’est au cœur de ce qu’on est nous, de ce qui nous fait penser le monde. C’est hyper fort de se dire gouines ! Ça veut dire qu’on ne s’excuse pas d’être nous ! Et puis, le terme apporte la dimension queer incluant les trans les gouines et les pédés, un groupe dans lequel on se retrouve. Le mot lesbienne est chargé aussi et c’est important d’utiliser ces deux termes politiques. », analysent-elles.
« C’est un mot que seules les lesbiennes, les queer peuvent utiliser. Ce serait super gênant que les hétéros le disent. C’est une dimension très politique pour nous. On est fières d’être gouines. C’est au cœur de ce qu’on est nous, de ce qui nous fait penser le monde. C’est hyper fort de se dire gouines ! Ça veut dire qu’on ne s’excuse pas d’être nous ! Et puis, le terme apporte la dimension queer incluant les trans les gouines et les pédés, un groupe dans lequel on se retrouve. Le mot lesbienne est chargé aussi et c’est important d’utiliser ces deux termes politiques. », analysent-elles. « En effet, d’une part, différents clichés et fantasmes ont encore cours sur les équipes de sport collectif comme possible lieux de « conversion » à l’homosexualité féminine. D’autres part, pour promouvoir le foot féminin, les clubs et fédérations ont tendance à mettre en avant dans leur communication uniquement des sportives adoptant un look et des attitudes conformes aux normes de genre (féminines, sexy, en couple hétéro, mères de famille…) et à dévaloriser toutes les autres (lesbiennes, bi, trans, mais aussi femmes hétéros ne correspondant pas au modèle traditionnel de la féminité). », peut-on lire sur leur site.
« En effet, d’une part, différents clichés et fantasmes ont encore cours sur les équipes de sport collectif comme possible lieux de « conversion » à l’homosexualité féminine. D’autres part, pour promouvoir le foot féminin, les clubs et fédérations ont tendance à mettre en avant dans leur communication uniquement des sportives adoptant un look et des attitudes conformes aux normes de genre (féminines, sexy, en couple hétéro, mères de famille…) et à dévaloriser toutes les autres (lesbiennes, bi, trans, mais aussi femmes hétéros ne correspondant pas au modèle traditionnel de la féminité). », peut-on lire sur leur site. S’allier autour des spécificités communes et des luttes militantes partagées, c’est renforcer le collectif, renforcer la minorité oppressée pour en faire jaillir sa puissance. Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer des personnes dans leurs individualités sans la crainte du jugement, sans la peur de la mise à l’écart, sans la menace d’être à nouveau invisibilisée. Pour autant, elles en témoignent quasi toutes, la communauté lesbienne n’est pas exempte de préjugés et stéréotypes discriminatoires. Une remise en question des privilèges blancs, cisgenres et valides notamment est à faire ou à poursuivre pour assumer un mouvement plus inclusif encore. Pour une réelle prise en considération des croisements qui s’opèrent de manière exponentielle à mesure que l’on s’éloigne de la norme établie.
S’allier autour des spécificités communes et des luttes militantes partagées, c’est renforcer le collectif, renforcer la minorité oppressée pour en faire jaillir sa puissance. Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer des personnes dans leurs individualités sans la crainte du jugement, sans la peur de la mise à l’écart, sans la menace d’être à nouveau invisibilisée. Pour autant, elles en témoignent quasi toutes, la communauté lesbienne n’est pas exempte de préjugés et stéréotypes discriminatoires. Une remise en question des privilèges blancs, cisgenres et valides notamment est à faire ou à poursuivre pour assumer un mouvement plus inclusif encore. Pour une réelle prise en considération des croisements qui s’opèrent de manière exponentielle à mesure que l’on s’éloigne de la norme établie. Le lesbianisme radical, dit aussi lesbianisme politique, met les pieds dans le plat depuis longtemps et secoue la marmite. Le fond du discours n’a pourtant rien de choquant. Une refonte en profondeur du système patriarcal s’impose pour libérer les consciences. Les lesbiennes affirment leurs existences et leurs fiertés. Elles ont raison.
Le lesbianisme radical, dit aussi lesbianisme politique, met les pieds dans le plat depuis longtemps et secoue la marmite. Le fond du discours n’a pourtant rien de choquant. Une refonte en profondeur du système patriarcal s’impose pour libérer les consciences. Les lesbiennes affirment leurs existences et leurs fiertés. Elles ont raison.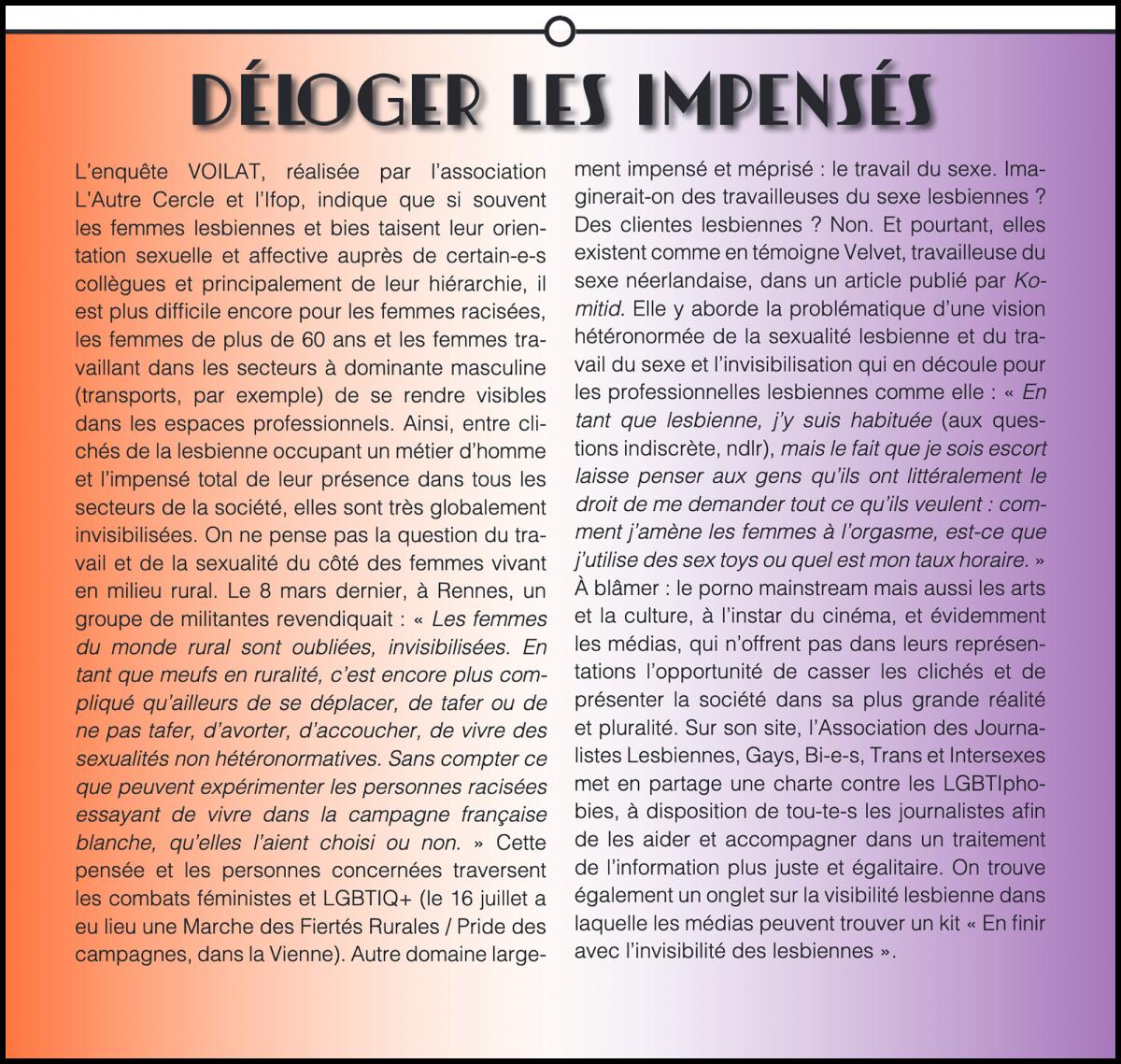
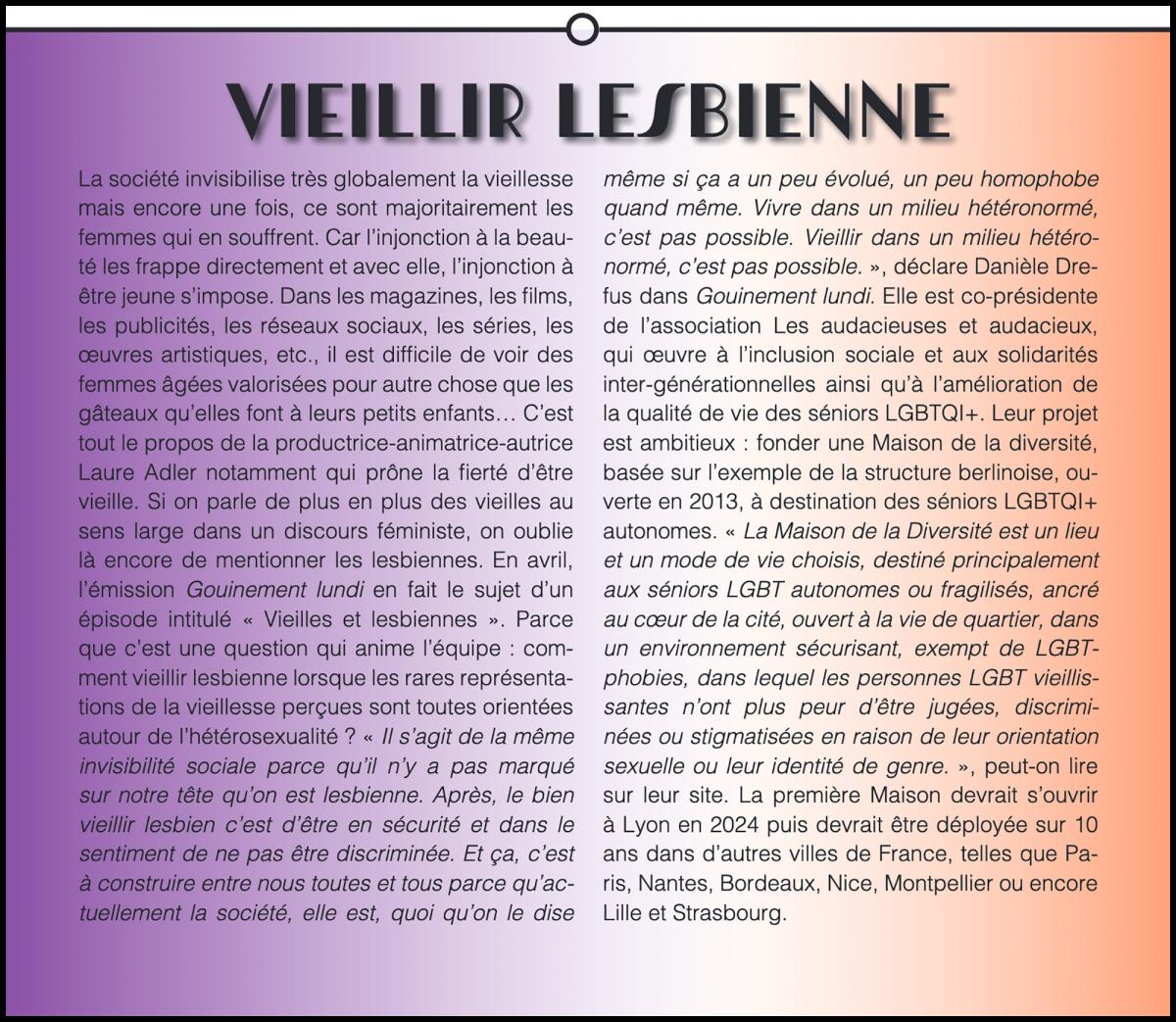

 La femme n’existe pas. Elle ne peut être pensée au singulier, à l’instar des luttes menées pour l’égalité des genres. Elles sont multiples et plurielles, ces luttes. Et concordent toutes à revendiquer pour toutes les personnes concernées le droit de choisir, la liberté d’exister et d’être soi, de s’exprimer en son propre nom et d’accéder au respect. Sans être discriminé-e-s en raison de son sexe, son genre, sa couleur de peau, son origine réelle ou supposée, sa classe sociale, son handicap, sa profession, son statut conjugal, son orientation sexuelle et/ou affective, etc. Alors, au-delà des dissensions existantes au sein du mouvement, comment penser et organiser une lutte féministe inclusive ?
La femme n’existe pas. Elle ne peut être pensée au singulier, à l’instar des luttes menées pour l’égalité des genres. Elles sont multiples et plurielles, ces luttes. Et concordent toutes à revendiquer pour toutes les personnes concernées le droit de choisir, la liberté d’exister et d’être soi, de s’exprimer en son propre nom et d’accéder au respect. Sans être discriminé-e-s en raison de son sexe, son genre, sa couleur de peau, son origine réelle ou supposée, sa classe sociale, son handicap, sa profession, son statut conjugal, son orientation sexuelle et/ou affective, etc. Alors, au-delà des dissensions existantes au sein du mouvement, comment penser et organiser une lutte féministe inclusive ?  À l’occasion des deux journées internationales de mobilisations et de luttes contre les violences sexistes et sexuelles et pour les droits des personnes sexisées – 8 mars et 25 novembre – les militant-e-s féministes sont de plus en plus nombreuses à battre le pavé et à faire entendre leurs voix dans l’espace public. Des voix plurielles qui portent des revendications communes, visant à combattre le sexisme d’une société encore largement imprégnée et dirigée par la culture patriarcale. Au-delà du sexe, des spécificités viennent s’accoler et amplifier les vécus de nombreuses femmes, en raison de leur couleur de peau, genre, classe sociale, orientation sexuelle et affective, handicap-s, âge, origine-s réelle-s ou supposée-s… Comment leurs parcours sont-ils pris en compte au sein du renouveau militant ? Comment s’organiser ensemble ? Et comment ne pas reproduire les schémas patriarcaux et capitalistes dénoncés par les mouvements féministes ?
À l’occasion des deux journées internationales de mobilisations et de luttes contre les violences sexistes et sexuelles et pour les droits des personnes sexisées – 8 mars et 25 novembre – les militant-e-s féministes sont de plus en plus nombreuses à battre le pavé et à faire entendre leurs voix dans l’espace public. Des voix plurielles qui portent des revendications communes, visant à combattre le sexisme d’une société encore largement imprégnée et dirigée par la culture patriarcale. Au-delà du sexe, des spécificités viennent s’accoler et amplifier les vécus de nombreuses femmes, en raison de leur couleur de peau, genre, classe sociale, orientation sexuelle et affective, handicap-s, âge, origine-s réelle-s ou supposée-s… Comment leurs parcours sont-ils pris en compte au sein du renouveau militant ? Comment s’organiser ensemble ? Et comment ne pas reproduire les schémas patriarcaux et capitalistes dénoncés par les mouvements féministes ? L’an dernier, à la même occasion, la manifestation du 8 mars partait également du campus Villejean, initiative impulsée par la collaboration entre Nous Toutes 35, association féministe organisatrice des marches et actions en lien avec les 8 mars et 25 novembre à Rennes, et Kune, collectif de femmes du quartier croisant féminisme et écologie populaire. L’idée : décentraliser le féminisme du centre ville et l’étendre à son entité plurielle. « La voix des femmes des quartiers populaires est rarement entendue. J’aime autant vous dire qu’on va en parler longtemps de notre passage et j’espère qu’il y en aura d’autres. », avait alors déclaré Régine Komokoli, co-fondatrice et porte-parole de l’association.
L’an dernier, à la même occasion, la manifestation du 8 mars partait également du campus Villejean, initiative impulsée par la collaboration entre Nous Toutes 35, association féministe organisatrice des marches et actions en lien avec les 8 mars et 25 novembre à Rennes, et Kune, collectif de femmes du quartier croisant féminisme et écologie populaire. L’idée : décentraliser le féminisme du centre ville et l’étendre à son entité plurielle. « La voix des femmes des quartiers populaires est rarement entendue. J’aime autant vous dire qu’on va en parler longtemps de notre passage et j’espère qu’il y en aura d’autres. », avait alors déclaré Régine Komokoli, co-fondatrice et porte-parole de l’association. Les prises de paroles se poursuivent, toujours traduites en langue des signes française. Parmi elles, l’Inter-organisation étudiante – composée de l’Union Pirate de Rennes 1 et 2, Solidaires Etudiant-e-s, la FSE et Nouvelles Rênes – dénonce l’absence de courage politique du gouvernement actuel dont les discours nous abreuvent de belles promesses mais manquent toujours d’actions concrètes : « Ainsi, Darmanin, ministre de l’Intérieur accusé de viol, se réjouit de son bilan du fait de la baisse des cambriolages. Et quel bilan ? 125 féminicides survenus en 2021. Mais n’en déplaise aux proches des 113 victimes de féminicides par leur conjoint ou ex conjoint, aux proches des 7 femmes trans et des 4 travailleuses du sexe victimes de féminicides, les bijoux et ordinateurs ont plus de valeur que nos vies. »
Les prises de paroles se poursuivent, toujours traduites en langue des signes française. Parmi elles, l’Inter-organisation étudiante – composée de l’Union Pirate de Rennes 1 et 2, Solidaires Etudiant-e-s, la FSE et Nouvelles Rênes – dénonce l’absence de courage politique du gouvernement actuel dont les discours nous abreuvent de belles promesses mais manquent toujours d’actions concrètes : « Ainsi, Darmanin, ministre de l’Intérieur accusé de viol, se réjouit de son bilan du fait de la baisse des cambriolages. Et quel bilan ? 125 féminicides survenus en 2021. Mais n’en déplaise aux proches des 113 victimes de féminicides par leur conjoint ou ex conjoint, aux proches des 7 femmes trans et des 4 travailleuses du sexe victimes de féminicides, les bijoux et ordinateurs ont plus de valeur que nos vies. » Accès à la santé pour les TDS, transidentité, migration, violences policières, violences institutionnelles, lutte contre le projet de loi de pénalisation des clients, les sujets portés à l’écran sont essentiels à intégrer à la révolution féministe. Et pourtant, ils sont souvent l’objet de divisions et de dissensions concernant le rapport au corps et sa marchandisation, entrainant – y compris dans certains milieux féministes - la stigmatisation régulière et des violences envers des travailleur-euse-s du sexe que l’on enferme dans un discours victimaire, plutôt que de s’intéresser à leurs conditions de travail et d’interroger directement les concerné-e-s. Doris, trésorière du STRASS, co-fondatrice des Pétrolettes à Rennes – association de développement communautaire pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux autres minorités avec et pour les travailleur-eu-s du sexe – et TDS depuis 5 ans en parle ce soir-là :
Accès à la santé pour les TDS, transidentité, migration, violences policières, violences institutionnelles, lutte contre le projet de loi de pénalisation des clients, les sujets portés à l’écran sont essentiels à intégrer à la révolution féministe. Et pourtant, ils sont souvent l’objet de divisions et de dissensions concernant le rapport au corps et sa marchandisation, entrainant – y compris dans certains milieux féministes - la stigmatisation régulière et des violences envers des travailleur-euse-s du sexe que l’on enferme dans un discours victimaire, plutôt que de s’intéresser à leurs conditions de travail et d’interroger directement les concerné-e-s. Doris, trésorière du STRASS, co-fondatrice des Pétrolettes à Rennes – association de développement communautaire pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux autres minorités avec et pour les travailleur-eu-s du sexe – et TDS depuis 5 ans en parle ce soir-là : « Aujourd’hui, notre question, c’est comment on arrive à mobiliser, à rendre notre démarche accessible et fédératrice et surtout hyper simple. Et quand je dis simple, ça veut dire ambitieuse dans les objectifs mais simple dans la façon de faire. Il y a du génie politique dans les quartiers populaires mais ce n’est pas toujours évident de rendre visible et de faire de l’aller vers. Donc c’est aussi à nous de faire différemment, de se mettre dans l’action et d’organiser des choses. », précise Priscilla Zamord. Elle poursuit : « Il y a des actions qu’on essaye de faire en alliance avec d’autres organisations. Ça crée du lien avec d’autres collectifs. » Elle se réfère notamment à la Marche pour la Vérité et la Justice pour Babacar Gueye, à laquelle Front de Mères a participé, à Rennes. Aurélie Macé, membre de l’organisation, était présente ce jour-là et témoigne :
« Aujourd’hui, notre question, c’est comment on arrive à mobiliser, à rendre notre démarche accessible et fédératrice et surtout hyper simple. Et quand je dis simple, ça veut dire ambitieuse dans les objectifs mais simple dans la façon de faire. Il y a du génie politique dans les quartiers populaires mais ce n’est pas toujours évident de rendre visible et de faire de l’aller vers. Donc c’est aussi à nous de faire différemment, de se mettre dans l’action et d’organiser des choses. », précise Priscilla Zamord. Elle poursuit : « Il y a des actions qu’on essaye de faire en alliance avec d’autres organisations. Ça crée du lien avec d’autres collectifs. » Elle se réfère notamment à la Marche pour la Vérité et la Justice pour Babacar Gueye, à laquelle Front de Mères a participé, à Rennes. Aurélie Macé, membre de l’organisation, était présente ce jour-là et témoigne : « En disant « Nous aussi », nous voulons faire entendre les voix de celles pour qui les violences sexistes et sexuelles sont une expérience inséparable du racisme, du validisme, de la précarité, qui définissent nos quotidiens : les violences sexuelles que nous subissons sont souvent pour nous l’aboutissement de notre domination matérielle, économique et sociale dans chacun des aspects de nos vies, que ce soit au travail, à la fac, dans la rue, à la maison ou face à des policiers. », expriment les associations et collectifs activistes tel-le-s que Acceptess T, le Collectif Afro-Fem, Gras Politique, Handi-Queer, Lallab ou encore le Strass dans l’appel publié sur le site de Mediapart.
« En disant « Nous aussi », nous voulons faire entendre les voix de celles pour qui les violences sexistes et sexuelles sont une expérience inséparable du racisme, du validisme, de la précarité, qui définissent nos quotidiens : les violences sexuelles que nous subissons sont souvent pour nous l’aboutissement de notre domination matérielle, économique et sociale dans chacun des aspects de nos vies, que ce soit au travail, à la fac, dans la rue, à la maison ou face à des policiers. », expriment les associations et collectifs activistes tel-le-s que Acceptess T, le Collectif Afro-Fem, Gras Politique, Handi-Queer, Lallab ou encore le Strass dans l’appel publié sur le site de Mediapart. Ce à quoi l’organisation visée répondra qu’elle échange avec des structures trans et des structures de protection à l’enfance (le 20 novembre étant également la Journée internationale des droits de l’enfant) « pour trouver un moyen que la manifestation NousToutes permette de donner de la visibilité à toutes les luttes, celle contre la transphobie et celle contre la pédocriminalité. » La date sera maintenue à Paris. Nous Toutes 38 et Nous Toutes 35, entre autres, prendront la décision de s’affranchir de l’appel national, comme le précisent les militant-e-s féministes grenobloises :
Ce à quoi l’organisation visée répondra qu’elle échange avec des structures trans et des structures de protection à l’enfance (le 20 novembre étant également la Journée internationale des droits de l’enfant) « pour trouver un moyen que la manifestation NousToutes permette de donner de la visibilité à toutes les luttes, celle contre la transphobie et celle contre la pédocriminalité. » La date sera maintenue à Paris. Nous Toutes 38 et Nous Toutes 35, entre autres, prendront la décision de s’affranchir de l’appel national, comme le précisent les militant-e-s féministes grenobloises : La crise sanitaire frappe et la pandémie révèle l’ampleur des inégalités de genre, et par conséquent la précarité des personnes sexisées. Le confinement est alors l’occasion de faire un recensement de toutes les structures militantes appelant à la mobilisation lors des 8 mars et 25 novembre. Un travail de titan-e-s, jamais réalisé auparavant. De ce travail minutieux, nait la Coordination féministe qui signe un premier texte visant à appeler à la mobilisation pour un déconfinement féministe. C’était le 8 juin 2020 et les rassemblements mettaient en lien les questions féministes, la précarité, le système de santé actuel, le capitalisme et les mécanismes de domination opérants dans les groupes oppressés. « Depuis, on a signé des appels, écrits ensemble, pour les manifestations, fait un webinaire féministe contre l’islamophobie et participé au cortège de Nice en juin 2021 contre la politique d’immigration de Macron, « Toutes aux frontières ». », précise Lisa.
La crise sanitaire frappe et la pandémie révèle l’ampleur des inégalités de genre, et par conséquent la précarité des personnes sexisées. Le confinement est alors l’occasion de faire un recensement de toutes les structures militantes appelant à la mobilisation lors des 8 mars et 25 novembre. Un travail de titan-e-s, jamais réalisé auparavant. De ce travail minutieux, nait la Coordination féministe qui signe un premier texte visant à appeler à la mobilisation pour un déconfinement féministe. C’était le 8 juin 2020 et les rassemblements mettaient en lien les questions féministes, la précarité, le système de santé actuel, le capitalisme et les mécanismes de domination opérants dans les groupes oppressés. « Depuis, on a signé des appels, écrits ensemble, pour les manifestations, fait un webinaire féministe contre l’islamophobie et participé au cortège de Nice en juin 2021 contre la politique d’immigration de Macron, « Toutes aux frontières ». », précise Lisa.  Cantines de rue, garderies collectives, caisses de grève… Il est essentiel de puiser les idées et outils dans les réussites du passé et les expériences des concernées, des militantes, des travailleuses, de toutes celles qui participent à la lutte, du quotidien, du terrain. Repenser l’organisation de la société. Là encore un travail minutieux s’impose. Pour une grève massive et inclusive, l’organisation en amont est primordiale si elle ne veut pas exclure une partie des personnes minorées et oppressées. Les militantes le disent : une journée de grève, c’est une année de préparation minimum. « Alors oui, ça rajoute des nouvelles choses à penser. Mais c’est aussi plus gratifiant de réfléchir et organiser un mouvement général. C’est plus valorisant ! On ne fait pas les choses dans le vent, on n’est pas seules, on va réussir à faire ensemble et ça, c’est motivant ! », s’enthousiasme Phil. Leur force émane du collectif, du fait de se retrouver, de s’encourager, se valoriser dans les expériences et compétentes des un-e-s et des autres.
Cantines de rue, garderies collectives, caisses de grève… Il est essentiel de puiser les idées et outils dans les réussites du passé et les expériences des concernées, des militantes, des travailleuses, de toutes celles qui participent à la lutte, du quotidien, du terrain. Repenser l’organisation de la société. Là encore un travail minutieux s’impose. Pour une grève massive et inclusive, l’organisation en amont est primordiale si elle ne veut pas exclure une partie des personnes minorées et oppressées. Les militantes le disent : une journée de grève, c’est une année de préparation minimum. « Alors oui, ça rajoute des nouvelles choses à penser. Mais c’est aussi plus gratifiant de réfléchir et organiser un mouvement général. C’est plus valorisant ! On ne fait pas les choses dans le vent, on n’est pas seules, on va réussir à faire ensemble et ça, c’est motivant ! », s’enthousiasme Phil. Leur force émane du collectif, du fait de se retrouver, de s’encourager, se valoriser dans les expériences et compétentes des un-e-s et des autres. « C’est important de créer un espace joyeux, de fête et d’inclusion, avec les collectifs des quartiers. », souligne Mélissa à propos de cet événement culturel et artistique, aux valeurs et revendications militants, féministes et antiracistes, composé de temps d’échanges, d’auto-formation, de transmissions des savoirs et des vécus, de parties de foot, de scènes ouvertes et de concerts vibrants. « L’idée, c’est d’ouvrir l’espace sous différents formats, différentes modalités de lutte. Le festival est une modalité de lutte ! Ça permet de multiplier les moyens de partager nos luttes et nos fêtes et de faire venir, rencontrer et participer des personnes qui ne trouvent peut-être leur place, ou leur légitimité, en manif ! », conclut Louise.
« C’est important de créer un espace joyeux, de fête et d’inclusion, avec les collectifs des quartiers. », souligne Mélissa à propos de cet événement culturel et artistique, aux valeurs et revendications militants, féministes et antiracistes, composé de temps d’échanges, d’auto-formation, de transmissions des savoirs et des vécus, de parties de foot, de scènes ouvertes et de concerts vibrants. « L’idée, c’est d’ouvrir l’espace sous différents formats, différentes modalités de lutte. Le festival est une modalité de lutte ! Ça permet de multiplier les moyens de partager nos luttes et nos fêtes et de faire venir, rencontrer et participer des personnes qui ne trouvent peut-être leur place, ou leur légitimité, en manif ! », conclut Louise. « Le langage et la grammaire sont des lieux pétris par l’idéologie. », commente Julie Abbou, post doctorante en sciences du langage à Paris 7, le 18 janvier dernier à l’occasion de sa conférence « Comment dire l’émancipation ? Les pratiques féministes du langage », organisée à Rennes 2 dans le cadre des Mardis de l’égalité. Pour les militant-e-s féministes, l’enjeu est grand. Puisqu’il permet de bousculer la grammaire et ainsi devenir sujet, être enfin représenté-e. Faire entendre une critique du monde. Pouvoir porter une parole féministe depuis une position de femmes. Puis plus largement de déconstruire la binarité du genre. Féminiser le langage, rappeler la présence des hommes et des femmes dans les différents groupes nommés, visibiliser la moitié de l’humanité considérée comme une minorité, trouver un genre commun, voire éviter le genre… Julie Abbou revient sur l’histoire du langage depuis les années 60, où elle apparaît comme un enjeu central dans les mouvements de lesbiennes et de libération des femmes.
« Le langage et la grammaire sont des lieux pétris par l’idéologie. », commente Julie Abbou, post doctorante en sciences du langage à Paris 7, le 18 janvier dernier à l’occasion de sa conférence « Comment dire l’émancipation ? Les pratiques féministes du langage », organisée à Rennes 2 dans le cadre des Mardis de l’égalité. Pour les militant-e-s féministes, l’enjeu est grand. Puisqu’il permet de bousculer la grammaire et ainsi devenir sujet, être enfin représenté-e. Faire entendre une critique du monde. Pouvoir porter une parole féministe depuis une position de femmes. Puis plus largement de déconstruire la binarité du genre. Féminiser le langage, rappeler la présence des hommes et des femmes dans les différents groupes nommés, visibiliser la moitié de l’humanité considérée comme une minorité, trouver un genre commun, voire éviter le genre… Julie Abbou revient sur l’histoire du langage depuis les années 60, où elle apparaît comme un enjeu central dans les mouvements de lesbiennes et de libération des femmes. En 2021, une proposition de loi va même jusqu’à demander l’interdiction de l’écriture inclusive pour les missions de service public. Julie Abbou explique : « Tous les procédés de féminisation du langage et d’écriture inclusive ne sont pas juste là pour désigner la présence des femmes et la présence des hommes mais aussi indexer un sens social. C’est-à-dire comment l’interlocuteur-ice se positionne : féministe, conservateur, etc. C’est une pratique politique de la grammaire. Et l’inclusion prend place dans un champ sémantique plus large : lutte contre les discriminations, diversité, égalité des chances, parité, intégration, etc. »
En 2021, une proposition de loi va même jusqu’à demander l’interdiction de l’écriture inclusive pour les missions de service public. Julie Abbou explique : « Tous les procédés de féminisation du langage et d’écriture inclusive ne sont pas juste là pour désigner la présence des femmes et la présence des hommes mais aussi indexer un sens social. C’est-à-dire comment l’interlocuteur-ice se positionne : féministe, conservateur, etc. C’est une pratique politique de la grammaire. Et l’inclusion prend place dans un champ sémantique plus large : lutte contre les discriminations, diversité, égalité des chances, parité, intégration, etc. » 


 « Y en a assez ! assez ! assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gouines et les pédés ! » Juin 2021, les Marches des Fiertés s’élancent dans plusieurs villes de France, dont Rennes, Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, Troyes ou encore Metz et Tours. Colorées et festives, les manifestations n’en restent pas moins engagées et militantes, prônant des revendications fortes concernant les droits, le respect et l’inclusion de toutes les orientations sexuelles et identités de genre dans une société qui rame (un peu, beaucoup) à accepter et reconnaître leurs existences.
« Y en a assez ! assez ! assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gouines et les pédés ! » Juin 2021, les Marches des Fiertés s’élancent dans plusieurs villes de France, dont Rennes, Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, Troyes ou encore Metz et Tours. Colorées et festives, les manifestations n’en restent pas moins engagées et militantes, prônant des revendications fortes concernant les droits, le respect et l’inclusion de toutes les orientations sexuelles et identités de genre dans une société qui rame (un peu, beaucoup) à accepter et reconnaître leurs existences. « Attention, sortie de placard ! » Sur le mail François Mitterand, HUMAN est écrit aux couleurs arc-en-ciel. Les pancartes « Queer féministes en colère », « Nos vies ≠ vos théories », « Jésus aussi avait deux papas », « Une maman peut en cacher une autre » ou encore « Une journée sans lesbienne est une journée sans soleil » côtoient les multiples drapeaux qui flottent dans la foule. La pansexualité s’exprime en rose, jaune et bleu, là où la bisexualité se colore de rose, violet et de bleu et là où la transidentité s’illustre de bleu, rose, blanc et de rose et bleu à nouveau. Sans oublier la non binarité, qui se pare de rose, blanc, violet, noir et bleu.
« Attention, sortie de placard ! » Sur le mail François Mitterand, HUMAN est écrit aux couleurs arc-en-ciel. Les pancartes « Queer féministes en colère », « Nos vies ≠ vos théories », « Jésus aussi avait deux papas », « Une maman peut en cacher une autre » ou encore « Une journée sans lesbienne est une journée sans soleil » côtoient les multiples drapeaux qui flottent dans la foule. La pansexualité s’exprime en rose, jaune et bleu, là où la bisexualité se colore de rose, violet et de bleu et là où la transidentité s’illustre de bleu, rose, blanc et de rose et bleu à nouveau. Sans oublier la non binarité, qui se pare de rose, blanc, violet, noir et bleu. À partir d’archives et d’interviews, Françoise Bagnaud, co-présidente d’Histoire du Féminisme à Rennes et lesbienne, Clémentine Comer, féministe, chercheuse et membre de Prendre le Droit, Alice Picard, féministe et chercheuse, et Camille Morin-Delaurière, féministe et doctorante en sciences politiques, travaillent sur le militantisme lesbien à Rennes et présentaient ce soir-là leurs recherches autour de l’engagement lesbien et ses coalitions et divergences avec les milieux respectivement gay et féministe dans les années 70 et 80. « À l’époque, on vivait cachées, c’était seulement ensemble, dans la communauté, qu’on était nous-mêmes. » Le témoignage de Sylvie n’est pas isolé et est révélateur de la lesbophobie de l’époque, qui perdure aujourd’hui encore.
À partir d’archives et d’interviews, Françoise Bagnaud, co-présidente d’Histoire du Féminisme à Rennes et lesbienne, Clémentine Comer, féministe, chercheuse et membre de Prendre le Droit, Alice Picard, féministe et chercheuse, et Camille Morin-Delaurière, féministe et doctorante en sciences politiques, travaillent sur le militantisme lesbien à Rennes et présentaient ce soir-là leurs recherches autour de l’engagement lesbien et ses coalitions et divergences avec les milieux respectivement gay et féministe dans les années 70 et 80. « À l’époque, on vivait cachées, c’était seulement ensemble, dans la communauté, qu’on était nous-mêmes. » Le témoignage de Sylvie n’est pas isolé et est révélateur de la lesbophobie de l’époque, qui perdure aujourd’hui encore. Permanences hebdomadaires, débats, jeux de société, rallyes auto… Les membres peuvent ici s’épanouir dans leur vie, l’acceptation et la compréhension de leur sexualité. La non mixité sert de source d’informations mais aussi de levier d’émancipation. « Le militantisme lesbien à Rennes se singularise dans l’importance qu’occupe le wendo, une pratique d’auto-défense féministe. », signale Clémentine Comer. Mélange d’arts martiaux et de self défense traditionnelle, le wendo s’adapte aux vécus spécifiques des femmes. Les stages sont mis en place par FEE, toujours à La Paillette. La chercheuse poursuit : « Ce sont des moments où les femmes prennent collectivement conscience des violences qu’elles ont vécues et où elles acquièrent confiance en elles. L’objectif de cette pratique est de comprendre ce qui se joue au moment d’une agression, quelles postures peuvent être mises en place pour faire face, aiguiser sa vigilance dans une situation où la peur apparaît, mais aussi reconnaître sa propre force et puissance. »
Permanences hebdomadaires, débats, jeux de société, rallyes auto… Les membres peuvent ici s’épanouir dans leur vie, l’acceptation et la compréhension de leur sexualité. La non mixité sert de source d’informations mais aussi de levier d’émancipation. « Le militantisme lesbien à Rennes se singularise dans l’importance qu’occupe le wendo, une pratique d’auto-défense féministe. », signale Clémentine Comer. Mélange d’arts martiaux et de self défense traditionnelle, le wendo s’adapte aux vécus spécifiques des femmes. Les stages sont mis en place par FEE, toujours à La Paillette. La chercheuse poursuit : « Ce sont des moments où les femmes prennent collectivement conscience des violences qu’elles ont vécues et où elles acquièrent confiance en elles. L’objectif de cette pratique est de comprendre ce qui se joue au moment d’une agression, quelles postures peuvent être mises en place pour faire face, aiguiser sa vigilance dans une situation où la peur apparaît, mais aussi reconnaître sa propre force et puissance. » Il le dit, les membres actifs de l’association sont épuisé-e-s. « On est passé-e-s sous les rouleaux. On a eu énormément de demandes durant les confinements. Un appel à l’aide de manière générale. Pour des raisons diverses. Parce que certaines personnes n’avaient pas d’imprimante pour leurs attestations, d’autres ne savaient pas écrire, d’autres encore n’avaient plus de sous. L’accueil individuel a repris dès la sortie du premier confinement. On a reçu des personnes exilées, des personnes trans qui venaient d’engager des réflexions autour de la transition, des parents s’informant pour leurs ados… C’était déconcertant par le nombre. L’activité d’écoute n’a pas désempli depuis 2020. », relate-t-il. Et pour cause, la crise sanitaire a contraint la population à l’isolement, dans des conditions inégales selon les situations. Lors de la Marche des Fiertés, il n’est pas sans rappeler que les personnes LGBTI+ en ont largement souffert :
Il le dit, les membres actifs de l’association sont épuisé-e-s. « On est passé-e-s sous les rouleaux. On a eu énormément de demandes durant les confinements. Un appel à l’aide de manière générale. Pour des raisons diverses. Parce que certaines personnes n’avaient pas d’imprimante pour leurs attestations, d’autres ne savaient pas écrire, d’autres encore n’avaient plus de sous. L’accueil individuel a repris dès la sortie du premier confinement. On a reçu des personnes exilées, des personnes trans qui venaient d’engager des réflexions autour de la transition, des parents s’informant pour leurs ados… C’était déconcertant par le nombre. L’activité d’écoute n’a pas désempli depuis 2020. », relate-t-il. Et pour cause, la crise sanitaire a contraint la population à l’isolement, dans des conditions inégales selon les situations. Lors de la Marche des Fiertés, il n’est pas sans rappeler que les personnes LGBTI+ en ont largement souffert :
 Les réactions sont mitigées. L’heureuse nouvelle est rapidement remplacée par la colère, comme le souligne Nikita, musicienne et alter ego de Vicky Veryno : « Oui, c’est cool et il faut s’en réjouir ! Mais ça m’énerve, c’est marqué « Pour Tou-te-s » ! Ça me fait le même effet qu’au moment du Mariage pour tous (loi adoptée en mai 2013 après de violentes manifestations contre le droit au mariage pour tous les couples, ndlr). Quand c’est arrivé, je n’avais pas encore connaissance de ma transidentité et bisexualité. Je me demandais juste pourquoi les couples non hétérosexuels n’avaient pas autant de droits que les couples hétérosexuels ? »
Les réactions sont mitigées. L’heureuse nouvelle est rapidement remplacée par la colère, comme le souligne Nikita, musicienne et alter ego de Vicky Veryno : « Oui, c’est cool et il faut s’en réjouir ! Mais ça m’énerve, c’est marqué « Pour Tou-te-s » ! Ça me fait le même effet qu’au moment du Mariage pour tous (loi adoptée en mai 2013 après de violentes manifestations contre le droit au mariage pour tous les couples, ndlr). Quand c’est arrivé, je n’avais pas encore connaissance de ma transidentité et bisexualité. Je me demandais juste pourquoi les couples non hétérosexuels n’avaient pas autant de droits que les couples hétérosexuels ? » Il n’y a pas qu’à la Marche des Fiertés que la population LGBTI+ milite pour l’obtention de droits égaux et pour le respect de toutes les identités. Mais ce jour-là représente l’occasion d’afficher et de scander haut et fort, dans l’espace public – lieu de fréquentes et régulières violences verbales, physiques et sexuelles envers les personnes LGBTIQ+ comme le rappelle les associations, dont SOS Homophobie qui publie chaque année un rapport chiffré à ce sujet – les revendications fortes et nombreuses. Parmi elles, l’ouverture de la PMA sans discriminations et dans les mêmes conditions pour tou-te-s, l’arrêt des opérations et médications d’assignation imposées aux personnes intersexes, la dépsychiatrisation de la transidentité en France et son retrait de la liste des maladies mentales, un engagement conséquent des pouvoirs publics pour prévenir le mal-être et le suicide des personnes LGBTI+, l’interdiction des thérapies de conversion (lors du conseil municipal du 28 juin 2021, la Ville de Rennes a déposé un vœu auprès du gouvernement pour que celui-ci y mette fin ; le centre et la droite ont refusé de voter), des politiques de santé garantissant l’accès aux soins dans le respect des besoins spécifiques des minorités sexuelles et de genre et des moyens pour les appliquer ainsi que l’accord systématique du droit d’asile aux personnes LGBTI+ exilées.
Il n’y a pas qu’à la Marche des Fiertés que la population LGBTI+ milite pour l’obtention de droits égaux et pour le respect de toutes les identités. Mais ce jour-là représente l’occasion d’afficher et de scander haut et fort, dans l’espace public – lieu de fréquentes et régulières violences verbales, physiques et sexuelles envers les personnes LGBTIQ+ comme le rappelle les associations, dont SOS Homophobie qui publie chaque année un rapport chiffré à ce sujet – les revendications fortes et nombreuses. Parmi elles, l’ouverture de la PMA sans discriminations et dans les mêmes conditions pour tou-te-s, l’arrêt des opérations et médications d’assignation imposées aux personnes intersexes, la dépsychiatrisation de la transidentité en France et son retrait de la liste des maladies mentales, un engagement conséquent des pouvoirs publics pour prévenir le mal-être et le suicide des personnes LGBTI+, l’interdiction des thérapies de conversion (lors du conseil municipal du 28 juin 2021, la Ville de Rennes a déposé un vœu auprès du gouvernement pour que celui-ci y mette fin ; le centre et la droite ont refusé de voter), des politiques de santé garantissant l’accès aux soins dans le respect des besoins spécifiques des minorités sexuelles et de genre et des moyens pour les appliquer ainsi que l’accord systématique du droit d’asile aux personnes LGBTI+ exilées. LES TERFS ET LA TRANSPHOBIE
LES TERFS ET LA TRANSPHOBIE Depuis, la militante est victime de nombreuses attaques, de cyber harcèlement en clair, sur les réseaux sociaux. Nikita soutient Sasha et réagit aux événements : « Les TERFs se trompent de cible à mon sens. La cible, c’est le patriarcat et le capitalisme. » L’injonction à la féminité ultra normée s’impose et pèse fortement sur les femmes trans. « Je ne crois pas du tout en la douceur féminine et tout ce qui constitue cette image d’Épinal. C’est un problème important de vivre en dichotomie. Je ne peux pas sortir sans me maquiller énormément. J’ai juste envie de vivre sereinement. Les personnes trans passent par la question de l’apparence. Pour moi, être femme n’est pas définissable. C’est mouvant. Ma femme à moi, elle est tout ce que je n’ai pas eu avant. Je me définis en tant que femme trans plutôt binaire, même si je pense que chaque personne a de la non binarité en elle. », explique-t-elle.
Depuis, la militante est victime de nombreuses attaques, de cyber harcèlement en clair, sur les réseaux sociaux. Nikita soutient Sasha et réagit aux événements : « Les TERFs se trompent de cible à mon sens. La cible, c’est le patriarcat et le capitalisme. » L’injonction à la féminité ultra normée s’impose et pèse fortement sur les femmes trans. « Je ne crois pas du tout en la douceur féminine et tout ce qui constitue cette image d’Épinal. C’est un problème important de vivre en dichotomie. Je ne peux pas sortir sans me maquiller énormément. J’ai juste envie de vivre sereinement. Les personnes trans passent par la question de l’apparence. Pour moi, être femme n’est pas définissable. C’est mouvant. Ma femme à moi, elle est tout ce que je n’ai pas eu avant. Je me définis en tant que femme trans plutôt binaire, même si je pense que chaque personne a de la non binarité en elle. », explique-t-elle.  ÇA BOUGE, MAIS…
ÇA BOUGE, MAIS… Ainsi, les stéréotypes, tant qu’ils ne sont pas conscientisés et déconstruits, biaisent nos regards et orientent la projection de ceux-ci dans nos quotidiens. Dans le système binaire, hommes et femmes peuvent être influencé-e-s par le male gaze et le cis gaze. Au cinéma, à la télévision, dans la littérature, la peinture, la bande dessinée, la musique, les médias, etc. nous reproduisons l’objectification des femmes, personnes LGBTI+, personnes handicapées, personnes racisées… Le problème étant que la majorité des œuvres grand public, mainstream, sont dictées par les personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, valides, ayant accès aux postes à responsabilité et aux espaces de décisions et de représentations.
Ainsi, les stéréotypes, tant qu’ils ne sont pas conscientisés et déconstruits, biaisent nos regards et orientent la projection de ceux-ci dans nos quotidiens. Dans le système binaire, hommes et femmes peuvent être influencé-e-s par le male gaze et le cis gaze. Au cinéma, à la télévision, dans la littérature, la peinture, la bande dessinée, la musique, les médias, etc. nous reproduisons l’objectification des femmes, personnes LGBTI+, personnes handicapées, personnes racisées… Le problème étant que la majorité des œuvres grand public, mainstream, sont dictées par les personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, valides, ayant accès aux postes à responsabilité et aux espaces de décisions et de représentations.  On le sait, l’Histoire est écrite par les hommes pour les hommes. Le patrimoine n’est que trop peu teinté de couleurs et les récits alternatifs échappent à ce qui devrait pourtant constituer l’héritage culturel commun. En introduction du premier tome de 40 LGBT+ qui ont changé le monde, Florent Manelli écrit : « Cet ouvrage aborde également la question de la mémoire LGBT+ et des archives éparpillées un peu partout en France, peu visibles et encore si peu accessibles. Cette mémoire est terriblement essentielle car elle prouve que les luttes LGBT+ ont un passé, qu’elles ont existé et que nous avons existé, écrit l’histoire, nous nous sommes battus et avons lutté pour nos droits. Les archives participent aussi à la construction d’une identité, à la façon dont chacun peut se définir au monde et aux autres. » Au total, l’illustrateur brosse le portrait de 80 activistes, personnalités, célèbres ou inconnues, qui, à leur échelle font ou ont fait avancer le mouvement LGBT+. Parmi ces personnes, figurent Marsha P. Johnson, Jean Chong, Hanne Gaby Odiele, Mykki Blanco, Harvey Milk, Hande Kader, Marielle Franco, Laverne Cox, Monique Wittig, Sylvia Rivera, Audre Lord ou encore Janet Mock.
On le sait, l’Histoire est écrite par les hommes pour les hommes. Le patrimoine n’est que trop peu teinté de couleurs et les récits alternatifs échappent à ce qui devrait pourtant constituer l’héritage culturel commun. En introduction du premier tome de 40 LGBT+ qui ont changé le monde, Florent Manelli écrit : « Cet ouvrage aborde également la question de la mémoire LGBT+ et des archives éparpillées un peu partout en France, peu visibles et encore si peu accessibles. Cette mémoire est terriblement essentielle car elle prouve que les luttes LGBT+ ont un passé, qu’elles ont existé et que nous avons existé, écrit l’histoire, nous nous sommes battus et avons lutté pour nos droits. Les archives participent aussi à la construction d’une identité, à la façon dont chacun peut se définir au monde et aux autres. » Au total, l’illustrateur brosse le portrait de 80 activistes, personnalités, célèbres ou inconnues, qui, à leur échelle font ou ont fait avancer le mouvement LGBT+. Parmi ces personnes, figurent Marsha P. Johnson, Jean Chong, Hanne Gaby Odiele, Mykki Blanco, Harvey Milk, Hande Kader, Marielle Franco, Laverne Cox, Monique Wittig, Sylvia Rivera, Audre Lord ou encore Janet Mock. Elle poursuit : « Je trouve que c’est cool de se réunir entre nous, on a des choses en commun, des vécus en commun. J’avoue que je déserte un peu les bars et boites hétéros. Si j’ai le choix entre un bar hétéro et un bar LGBT, c’est bien simple, j’irais au bar LGBT. Je nous vois comme une famille. Il y a un lien de sororité, d’adelphité. » Parce qu’en tant que femme lesbienne, quand Bilamé sort dans un espace non dédié, elle est régulièrement victime de remarques ou de comportements intolérables. « Je suis dans l’hypersexualisation H24 dans les lieux hétéros. En soirée, je me faisais beaucoup embêter par des hommes. Je tolérais pendant un temps et maintenant je ne supporte plus. Les mecs qui me touchent le cul parce que j’embrasse ma copine, me parlent de plan à 3, veulent me forcer à avoir un rapport en me disant que je suis lesbienne parce que j’ai pas connu le bon… Stop ! Et ça n’arrive pas qu’à moi. C’est relou et c’est tout le temps. Quelques semaines avant la crise sanitaire, un mec est venu me montrer son érection parce que je venais d’embrasser ma copine… Alors oui, en soirée, je préfère être avec des gens qui comprennent et qui partage un esprit adelphe. Je ne vis pas dans une utopie, je sais que toutes les personnes LGBTI ne sont pas bienveillantes. Mais je n’ai jamais eu d’embrouille dans le milieu queer. », conclut la militante.
Elle poursuit : « Je trouve que c’est cool de se réunir entre nous, on a des choses en commun, des vécus en commun. J’avoue que je déserte un peu les bars et boites hétéros. Si j’ai le choix entre un bar hétéro et un bar LGBT, c’est bien simple, j’irais au bar LGBT. Je nous vois comme une famille. Il y a un lien de sororité, d’adelphité. » Parce qu’en tant que femme lesbienne, quand Bilamé sort dans un espace non dédié, elle est régulièrement victime de remarques ou de comportements intolérables. « Je suis dans l’hypersexualisation H24 dans les lieux hétéros. En soirée, je me faisais beaucoup embêter par des hommes. Je tolérais pendant un temps et maintenant je ne supporte plus. Les mecs qui me touchent le cul parce que j’embrasse ma copine, me parlent de plan à 3, veulent me forcer à avoir un rapport en me disant que je suis lesbienne parce que j’ai pas connu le bon… Stop ! Et ça n’arrive pas qu’à moi. C’est relou et c’est tout le temps. Quelques semaines avant la crise sanitaire, un mec est venu me montrer son érection parce que je venais d’embrasser ma copine… Alors oui, en soirée, je préfère être avec des gens qui comprennent et qui partage un esprit adelphe. Je ne vis pas dans une utopie, je sais que toutes les personnes LGBTI ne sont pas bienveillantes. Mais je n’ai jamais eu d’embrouille dans le milieu queer. », conclut la militante. 



 Du chaos de l’expérimentation nait un moment de grâce. L’ouvrage méticuleux requiert concentration et rigueur. Les artistes dénouent la difficulté imposée par l’envie de perfection en rendant l’espace et la pratique accessibles et décontractées. L’important ici, c’est la participation au collectif. Delphine Guglielmini brode les points de départ, les participantes s’en emparent et apportent leur touche pour en faire un objet personnel et personnifié. « Je leur apprends les poings arrière, les points de tige, les points de chainette, et l’apothéose : le point de nœud. Ce qui est d’ailleurs antinomique car faire un nœud, c’est bafouiller. Mais non ! C’est joli un nœud. Ici, elles ont le droit au tâtonnement et à l’expérimentation. On leur confie un bout de tissu, je décortique les mouvements et elles en font ce qu’elles veulent. Elles font, refont, elles observent, elles refont encore. A force, elles trouvent leur propre écriture. », se réjouit-elle.
Du chaos de l’expérimentation nait un moment de grâce. L’ouvrage méticuleux requiert concentration et rigueur. Les artistes dénouent la difficulté imposée par l’envie de perfection en rendant l’espace et la pratique accessibles et décontractées. L’important ici, c’est la participation au collectif. Delphine Guglielmini brode les points de départ, les participantes s’en emparent et apportent leur touche pour en faire un objet personnel et personnifié. « Je leur apprends les poings arrière, les points de tige, les points de chainette, et l’apothéose : le point de nœud. Ce qui est d’ailleurs antinomique car faire un nœud, c’est bafouiller. Mais non ! C’est joli un nœud. Ici, elles ont le droit au tâtonnement et à l’expérimentation. On leur confie un bout de tissu, je décortique les mouvements et elles en font ce qu’elles veulent. Elles font, refont, elles observent, elles refont encore. A force, elles trouvent leur propre écriture. », se réjouit-elle. Et de cette révolte jaillit la créativité collective. Et de cette révolte jaillit la sororité. Et de cette révolte jaillit le partage et l’envie de réhabiliter et de partager le matrimoine. Un matrimoine dont fait pleinement partie Jeanne Malivel, d’abord graveuse et peintresse « qui designait du mobilier ! » Nous sommes au début du XXe siècle et l’artisane-artiste, originaire de Loudéac, se proclame féministe. Elle étudie aux Beaux-Arts de Paris, rencontre de nombreux-ses artistes et devient professeure aux Beaux-Arts de Rennes. Elle lutte contre l’exode des bretonnes vers Paris en permettant aux jeunes filles de travailler sur des métiers à tisser. Elle fonde le mouvement Des Seiz Breur (Les Sept Frères) afin de participer à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes.
Et de cette révolte jaillit la créativité collective. Et de cette révolte jaillit la sororité. Et de cette révolte jaillit le partage et l’envie de réhabiliter et de partager le matrimoine. Un matrimoine dont fait pleinement partie Jeanne Malivel, d’abord graveuse et peintresse « qui designait du mobilier ! » Nous sommes au début du XXe siècle et l’artisane-artiste, originaire de Loudéac, se proclame féministe. Elle étudie aux Beaux-Arts de Paris, rencontre de nombreux-ses artistes et devient professeure aux Beaux-Arts de Rennes. Elle lutte contre l’exode des bretonnes vers Paris en permettant aux jeunes filles de travailler sur des métiers à tisser. Elle fonde le mouvement Des Seiz Breur (Les Sept Frères) afin de participer à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes.

 Marlène Hagnéré, mécanicienne cycles, réagit : « Pour moi, le clivage est dans le fait de ne pas comprendre que certaines femmes ont besoin de se retrouver entre elles pour être à l’aise. L’égalité n’est qu’une illusion, même en 2022, elle n’existe vraiment pas partout (je dirais même quasiment nulle part), et l’idée de ces ateliers est justement de rééquilibrer la part des femmes dans certains domaines. (…) C’est quand même marrant, mais toutes les critiques que je reçois sur ces ateliers proviennent toujours du même profil de personne : homme blanc, hétéro, passé 50 ans (voire certains quadragénaires). Ça pose très peu de problèmes aux autres personnes… »
Marlène Hagnéré, mécanicienne cycles, réagit : « Pour moi, le clivage est dans le fait de ne pas comprendre que certaines femmes ont besoin de se retrouver entre elles pour être à l’aise. L’égalité n’est qu’une illusion, même en 2022, elle n’existe vraiment pas partout (je dirais même quasiment nulle part), et l’idée de ces ateliers est justement de rééquilibrer la part des femmes dans certains domaines. (…) C’est quand même marrant, mais toutes les critiques que je reçois sur ces ateliers proviennent toujours du même profil de personne : homme blanc, hétéro, passé 50 ans (voire certains quadragénaires). Ça pose très peu de problèmes aux autres personnes… » 
 Elles se réjouissent de la proposition temporaire d’un espace dédié aux femmes et minorités de genre. « Pour avoir un meilleur niveau et la confiance en soi ! », commente Cypriane qui fréquente également les soirées non mixtes mis en place par La Petite Rennes (atelier participatif et solidaire d’autoréparation de vélos). Il y a la question de l’empouvoirement qui leur apparaît comme essentielle. Pouvoir pratiquer, expérimenter, apprendre, chuter, faire des erreurs, persévérer, évoluer. La base. Mais ce qui les anime particulièrement, c’est de pouvoir respirer. Arrêter d’être angoissées à chaque fois qu’elles tournent le dos aux personnes masculines qui fréquentent elles aussi la salle. « J’ai peur ici d’être matée, parce qu’on est en legging, etc. Dans cette salle encore, je ne le ressens pas tellement. Mais par exemple, la piscine, c’est une catastrophe pour moi. Je prends sur moi à chaque fois que j’y vais. Être une femme en maillot de bain donne la sensation qu’on autorise les hommes à nous regarder et à nous juger. Mais non ! », scande Cyrielle. Elle aimerait que l’offre soit plus variée et régulière. Pas uniquement à The Roof mais plus globalement dans les lieux fréquentés par un public massivement masculin, principalement là où les corps sont dévoilés et en mouvement.
Elles se réjouissent de la proposition temporaire d’un espace dédié aux femmes et minorités de genre. « Pour avoir un meilleur niveau et la confiance en soi ! », commente Cypriane qui fréquente également les soirées non mixtes mis en place par La Petite Rennes (atelier participatif et solidaire d’autoréparation de vélos). Il y a la question de l’empouvoirement qui leur apparaît comme essentielle. Pouvoir pratiquer, expérimenter, apprendre, chuter, faire des erreurs, persévérer, évoluer. La base. Mais ce qui les anime particulièrement, c’est de pouvoir respirer. Arrêter d’être angoissées à chaque fois qu’elles tournent le dos aux personnes masculines qui fréquentent elles aussi la salle. « J’ai peur ici d’être matée, parce qu’on est en legging, etc. Dans cette salle encore, je ne le ressens pas tellement. Mais par exemple, la piscine, c’est une catastrophe pour moi. Je prends sur moi à chaque fois que j’y vais. Être une femme en maillot de bain donne la sensation qu’on autorise les hommes à nous regarder et à nous juger. Mais non ! », scande Cyrielle. Elle aimerait que l’offre soit plus variée et régulière. Pas uniquement à The Roof mais plus globalement dans les lieux fréquentés par un public massivement masculin, principalement là où les corps sont dévoilés et en mouvement.  « Dans ce contexte du sport, je trouve ça vraiment chouette de proposer un espace non mixte mais il ne faudrait pas que ce soit partout et tout le temps. », répond Nora lorsqu’on l’interroge sur le regard qu’elle porte sur la mixité choisie. Bien qu’il ne soit pas une nouveauté, le sujet reste controversé. Vivement critiquée dans les années 50/60/70, dans les périodes et les groupes engagé-e-s pour les droits civiques des personnes noires aux Etats-Unis ou encore les réunions du Mouvement de Libération des Femmes en France, la non mixité est pourtant essentielle dans les luttes pour l’égalité. Sans hommes cisgenres imprégnés de toute construction sociale privilégiée et dominante, sans personnes blanches « dépositaires d’un pouvoir hégémonique », comme le signale la sociologue Nacira Guénif-Souilamas dans Le Monde en défendant le collectif Mwasi lors du festival afroféministe. Elle précise : « Ces jeunes femmes veulent simplement créer un espace d’échanges sûr et rassurant. »
« Dans ce contexte du sport, je trouve ça vraiment chouette de proposer un espace non mixte mais il ne faudrait pas que ce soit partout et tout le temps. », répond Nora lorsqu’on l’interroge sur le regard qu’elle porte sur la mixité choisie. Bien qu’il ne soit pas une nouveauté, le sujet reste controversé. Vivement critiquée dans les années 50/60/70, dans les périodes et les groupes engagé-e-s pour les droits civiques des personnes noires aux Etats-Unis ou encore les réunions du Mouvement de Libération des Femmes en France, la non mixité est pourtant essentielle dans les luttes pour l’égalité. Sans hommes cisgenres imprégnés de toute construction sociale privilégiée et dominante, sans personnes blanches « dépositaires d’un pouvoir hégémonique », comme le signale la sociologue Nacira Guénif-Souilamas dans Le Monde en défendant le collectif Mwasi lors du festival afroféministe. Elle précise : « Ces jeunes femmes veulent simplement créer un espace d’échanges sûr et rassurant. »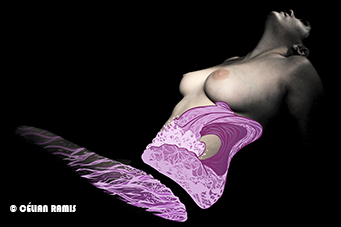
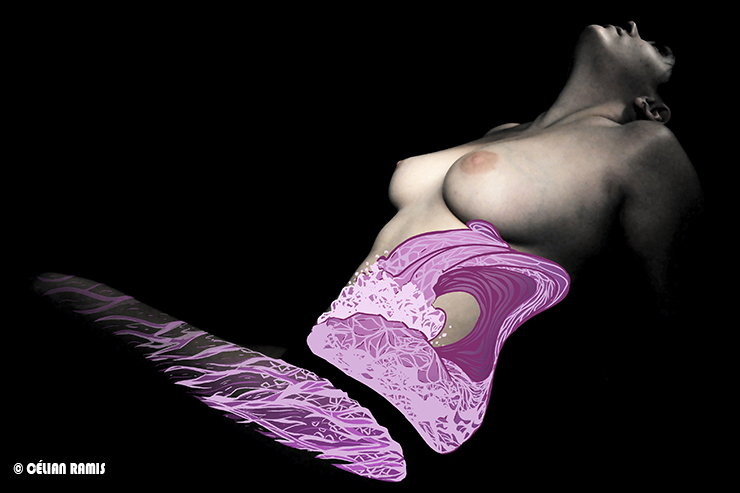
 Quelques jours plus tard, des mobilisations féministes occupent l’espace public pour dénoncer l’hypocrisie du président Macron et de sa (fausse) grande cause du quinquennat. Les militantes brandissent des pancartes, prônant « la riposte féministe », expression largement reprise lors des manifestations autour du 25 novembre, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles à l’encontre des personnes sexisées.
Quelques jours plus tard, des mobilisations féministes occupent l’espace public pour dénoncer l’hypocrisie du président Macron et de sa (fausse) grande cause du quinquennat. Les militantes brandissent des pancartes, prônant « la riposte féministe », expression largement reprise lors des manifestations autour du 25 novembre, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles à l’encontre des personnes sexisées.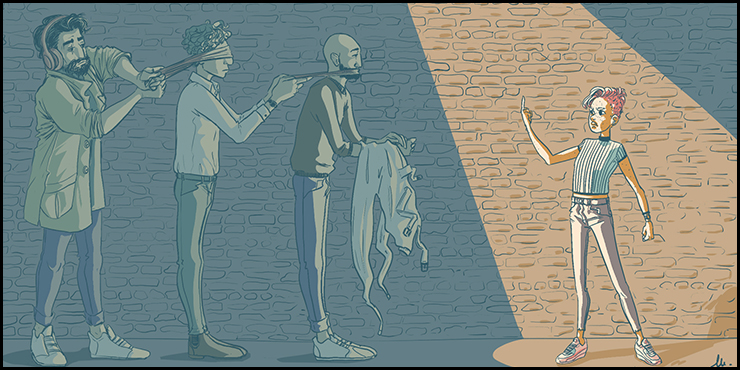

 Cependant, il y a toujours des militantes pour rompre l’ordre patriarcal. Pour dénoncer les travers capitalistes, sexistes et racistes. Pourtant, des années 70, on ne retient qu’un récit partiel. L’avortement est illégal et on se bat pour le rendre légal. En métropole. Parce qu’au même moment, à La Réunion, des milliers d’avortements et de stérilisations sont pratiqué-e-s par des médecins blancs sans le consentement des femmes, stigmatisées en raison de leur couleur de peau comme l’analyse Françoise Vergès dans Le ventre des femmes – Capitalisme, racialisation, féminisme.
Cependant, il y a toujours des militantes pour rompre l’ordre patriarcal. Pour dénoncer les travers capitalistes, sexistes et racistes. Pourtant, des années 70, on ne retient qu’un récit partiel. L’avortement est illégal et on se bat pour le rendre légal. En métropole. Parce qu’au même moment, à La Réunion, des milliers d’avortements et de stérilisations sont pratiqué-e-s par des médecins blancs sans le consentement des femmes, stigmatisées en raison de leur couleur de peau comme l’analyse Françoise Vergès dans Le ventre des femmes – Capitalisme, racialisation, féminisme. Si des mobilisations et événements militant-e-s ont lieu toute l’année, il y a tout de même deux dates qui s’inscrivent depuis longtemps dans le calendrier : le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La première provient des luttes ouvrières et suffragistes.
Si des mobilisations et événements militant-e-s ont lieu toute l’année, il y a tout de même deux dates qui s’inscrivent depuis longtemps dans le calendrier : le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La première provient des luttes ouvrières et suffragistes. On brandit la présomption d’innocence à chaque fois qu’un homme – de pouvoir – est visé ? Elles brandissent la présomption de sincérité des victimes. Elles hurlent leurs colères et combattent d’une main le mythe de la virilité et de l’autre le mythe du prédateur. La masculinité toxique et hégémonique doit être déconstruite en parallèle des réflexions sur la féminité unique, instituées par le patriarcat et le capitalisme.
On brandit la présomption d’innocence à chaque fois qu’un homme – de pouvoir – est visé ? Elles brandissent la présomption de sincérité des victimes. Elles hurlent leurs colères et combattent d’une main le mythe de la virilité et de l’autre le mythe du prédateur. La masculinité toxique et hégémonique doit être déconstruite en parallèle des réflexions sur la féminité unique, instituées par le patriarcat et le capitalisme. Elle témoigne de son vécu dans Médiapart et accuse le réalisateur Christophe Ruggia d’attouchements et de harcèlement sexuel. Elle était alors âgée de 12 à 15 ans. Elle fait état de la honte qu’elle a ressenti, puis de la colère qui s’est installée, jusqu’à ce qu’elle rompe le silence comme un acte viscéral.
Elle témoigne de son vécu dans Médiapart et accuse le réalisateur Christophe Ruggia d’attouchements et de harcèlement sexuel. Elle était alors âgée de 12 à 15 ans. Elle fait état de la honte qu’elle a ressenti, puis de la colère qui s’est installée, jusqu’à ce qu’elle rompe le silence comme un acte viscéral.
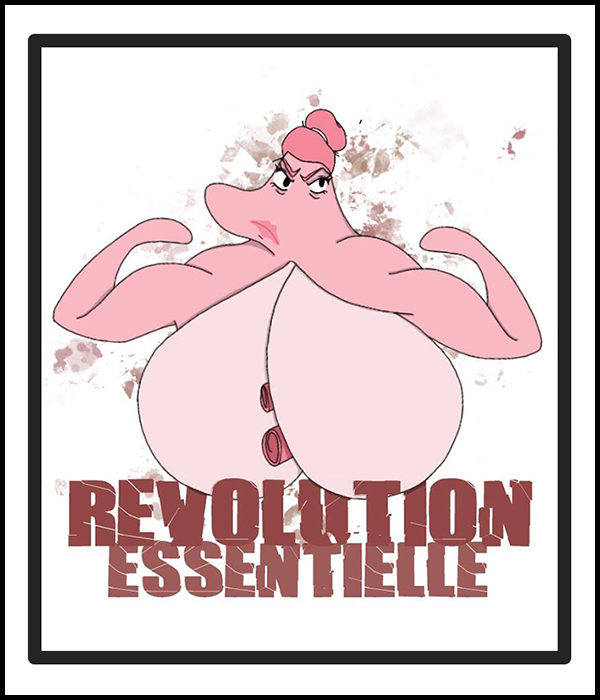 « C’est très intéressant je trouve ce qui se passe dans cette façon de se mobiliser collectivement. Ça va en parallèle avec le mouvement MeToo. On décrie les réseaux sociaux, avec ses dérives de haine en ligne et de déshumanisation de la société, mais en terme de visibilité donnée aux personnes qui n’arrivent pas à avoir des représentations médiatiques, c’est très important. Ils rendent la mobilisation plus grande, plus rapide et connectent des individus qui peuvent se regrouper et se rendre visibles.
« C’est très intéressant je trouve ce qui se passe dans cette façon de se mobiliser collectivement. Ça va en parallèle avec le mouvement MeToo. On décrie les réseaux sociaux, avec ses dérives de haine en ligne et de déshumanisation de la société, mais en terme de visibilité donnée aux personnes qui n’arrivent pas à avoir des représentations médiatiques, c’est très important. Ils rendent la mobilisation plus grande, plus rapide et connectent des individus qui peuvent se regrouper et se rendre visibles.  L’objectif : reconquérir la prise de parole. Elle prend la parole mais aussi, elle la donne. À celles et ceux qui trop souvent sont invisibilisé-e-s. Juriste de formation en droit des affaires, elle a par la suite repris ses études pour travailler dans des ONG en sciences politiques.
L’objectif : reconquérir la prise de parole. Elle prend la parole mais aussi, elle la donne. À celles et ceux qui trop souvent sont invisibilisé-e-s. Juriste de formation en droit des affaires, elle a par la suite repris ses études pour travailler dans des ONG en sciences politiques. Partir du vécu. En juin 2019, le site Reporterre publie un entretient avec Fatima Ouassak. Elle est politologue, co-fondatrice de Front de mères, premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, présidente du réseau Classe/Genre/Race et autrice du livre La puissance des mères.
Partir du vécu. En juin 2019, le site Reporterre publie un entretient avec Fatima Ouassak. Elle est politologue, co-fondatrice de Front de mères, premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, présidente du réseau Classe/Genre/Race et autrice du livre La puissance des mères.
 Elle se souvient : « Sans doute, dans l’ivresse heureuse des débuts de mon mandat, ai-je oublié un moment la puissance du machisme que nous affrontions. Une nouvelle loi, mon dernier grand chantier, allait pourtant me le rappeler. Et faire basculer notre ministère dans la partie la plus sombre de son histoire. (…)
Elle se souvient : « Sans doute, dans l’ivresse heureuse des débuts de mon mandat, ai-je oublié un moment la puissance du machisme que nous affrontions. Une nouvelle loi, mon dernier grand chantier, allait pourtant me le rappeler. Et faire basculer notre ministère dans la partie la plus sombre de son histoire. (…) 
 Les féminismes regorgent de force, de détermination, font place à des cheminements individuels et collectifs, amènent à repenser ce que nous voulons pour nous et celles et ceux qui nous entourent. Les féminismes mènent des révolutions multiples qui ne concernent pas uniquement les femmes mais globalement le monde dans lequel on vit.
Les féminismes regorgent de force, de détermination, font place à des cheminements individuels et collectifs, amènent à repenser ce que nous voulons pour nous et celles et ceux qui nous entourent. Les féminismes mènent des révolutions multiples qui ne concernent pas uniquement les femmes mais globalement le monde dans lequel on vit.
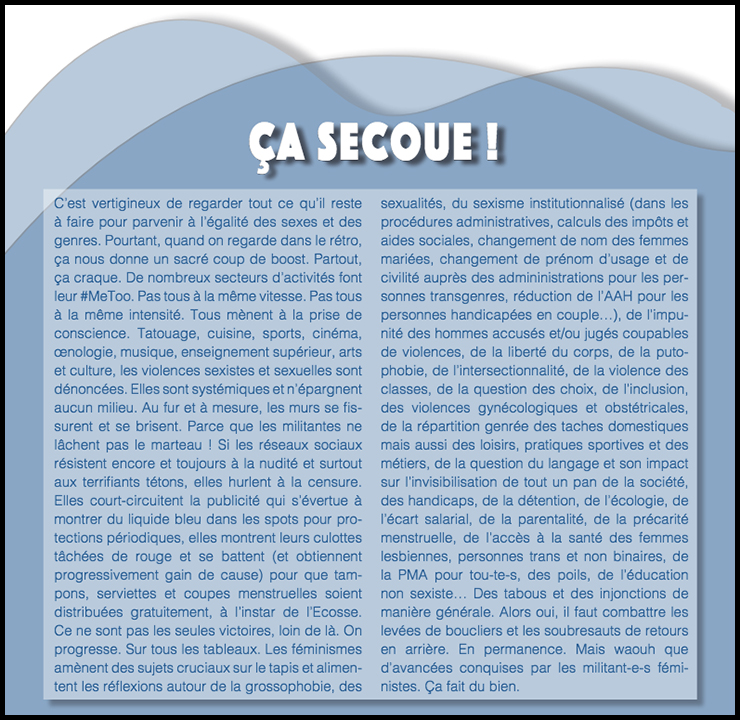



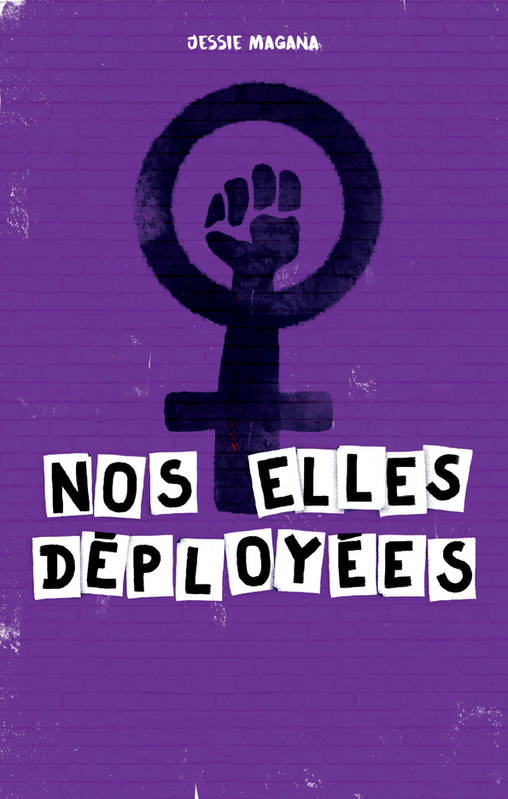 « Avec les réseaux sociaux, les #, des actrices, chanteuses, femmes comme vous et moi sans audience médiatique ont pu s’exprimer. Grâce à ces mouvements, la parole d’une femme devient mondiale. », s’enthousiasme-t-elle.
« Avec les réseaux sociaux, les #, des actrices, chanteuses, femmes comme vous et moi sans audience médiatique ont pu s’exprimer. Grâce à ces mouvements, la parole d’une femme devient mondiale. », s’enthousiasme-t-elle.