Il était attendu ce festival ! Début septembre déjà, plusieurs ateliers affichaient complets, les préventes réduisaient à vive allure, la soirée de soutien au Panama avait cartonné et beaucoup trépignaient d’impatience à l’idée de participer à un événement comme celui-ci, encore jamais organisé à Rennes. Les 28 et 29 septembre, aux Ateliers du Vent, la première édition du festival de littérature féministe, articulée autour de la figure de la sorcière, n’a eu aucun mal à trouver son public.
La sorcière n’est pas la même partout. Elle n’est pas la même pour tout le monde. Mais elle est toujours marginalisée par une communauté, une société, victime d’un rapport de domination. Que nous dit l’Histoire à ce sujet ? Qui sont-elles aujourd’hui ? La sorcellerie peut-elle être source d’empuissancement ? Quel est l’impact des mots sur nos esprits et nos actions ? Sommes-nous toutes des héritières des sorcières d’hier ?
De nombreuses questions ont été soulevées les 28 et 29 septembre aux Ateliers du Vent pour cette première édition de Dangereuses lectrices. Et les réponses se sont croisées, articulées, percutées, confrontées, ont résonné, rebondi, retenti, ont fait écho à des vécus, des ressentis, des expériences, ont apporté un éclairage sur un sujet caricaturé dans la pop culture mais aussi réapproprié par certaines féministes au fil des siècles. Ou encore ont soulevé d’autres questions.
Les mots sur les maux ont été lus, joués et mis en scène, chantés, performés, discutés, théorisés, photographiés, démontrés, animés. Le politique et l’intime se sont donnés rendez-vous dans les paroles des unes et des autres. Pourquoi et en quoi la figure de la sorcière cristallise-t-elle toujours siècle après siècle le rapport de domination exercé par les hommes sur les femmes ?
VILAINE SORCIÈRE...
Nez crochus, chapeaux pointus, turlututu. On pense que la vilaine sorcière n’est attribuée qu’au monde enfantin. On se trompe. Elle influence toutes les générations. Et vise « les femmes qui a priori sont sorties du rôle attendu d’elles. », souligne Fanny Bugnon, historienne à l’université Rennes 2, lors de sa conférence « Les sorcières dans l’histoire, des procès au symbole féministe ».
Ce samedi après-midi, elle décortique alors les images de la sorcière à travers le contexte historique. Les premières représentations, qui dateraient de 1451, sont en effet très symboliques : « Des sorcières qui chevauchent un objet emprunté à l’espace domestique, à savoir un balai ou un bâton. »
Entre le 13esiècle et le 15esiècle, la lutte s’accélère, la grande chasse s’intensifie. Au départ, ce sont les autorités ecclésiastiques qui dénoncent les agissements des sorciers et des sorcières, puis au fil du temps, les accusées sont majoritairement des femmes et des milliers de buchers s’enflamment pour anéantir les sorcières. Elles sont pensées comme des ennemies de la chrétienté et pour cela, elles subiront de nombreuses « mises en humiliation et souffrances de leur corps. »

Instruments de la répression, les femmes vont être les boucs émissaires d’une société européenne frappée par la crise économique et politique. À la fin du Moyen-Âge, « l’économie rurale est bouleversée, la famine guette la population appauvrie, les réformes sont les prémices de la société capitaliste. La révolte gronde. L’Etat déploie la répression et l’Eglise se met en chasse contre les comportements les plus déviants. Les naissances deviennent un enjeu majeur. L’avortement et la contraception sont sévèrement punis… Les savoir-faire et les connaissances des femmes deviennent alors les cibles de la répression ».
ACCUSÉES, CONDAMNÉES, BRÛLÉES…
Le décor est planté par le collectif L’Intruse, venu jouer ici Le procès de Péronne. On se situe dans le Nord de la France, à la fin du 17esiècle. Des rumeurs circulent sur la vieille Péronne, âgée d’environ 46 ans. Saoulée par un groupe de soldats, elle est un soir humiliée, harcelée physiquement et sexuellement. Sa faute ! déclarent les soldats, expliquant avoir été ensorcelés.
Sans doute aussi est-elle la cause « du brouillard épais, de la pluie froide, de la gelée qui ravage les récoltes, des orages, des mouches, des maladies, de la lèpre, la peste, des entrailles qui pourrissent » car « c’est évident, c’est un signe du malin. »
Les deux comédiennes, Camille Candelier et Anna Wessel, interprètent tour à tour les protagonistes du procès en sorcellerie de Péronne. Tantôt fonctionnaires qui complotent, tantôt voisines qui commèrent, elles nous emmènent avec humour et talent dans l’obscurité de l’esprit humain et patriarcal, démontrant l’aisance et la pression avec laquelle les « puissants » de l’époque tricotaient leur manipulatrice influence, allant jusqu’à faire avouer à des femmes leurs accouplements avec le démon.
« On les torture pour les faire avouer leur coït avec le diable. Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, la Justice est uniquement composée d’hommes. Et puis il y a ce rapport à la bestialité, à la sexualité. Le bourreau recherche la marque du diable. C’est le signe qu’elle a été possédée par le démon. Si elles connaissent le diable, cela veut dire qu’elles peuvent enfanter des êtres maléfiques. », précise Fanny Bugnon, dont les contenus résonnent avec la pièce de théâtre, le soir même. Elle poursuit :
« La mort ne suffit pas. Par le feu, on purifie le corps social. Parfois, la sorcière n’est pas tuée, elle est bannie. Mais le plus souvent, elle est exécutée, brûlée vive, étranglée… Leurs noms ne figurent pas dans les registres des décès et leurs biens sont confisqués. Elles sont considérées comme païennes, vicieuses, marginales, elles sont célibataires ou non, mais toujours pécheresses. Pour ça, on leur retire leur existence. »
QUE SONT-ELLES DEVENUES ?
Au 18esiècle, la chasse aux sorcières ne disparaît pas réellement. « La sorcellerie devient le monde de l’empoisonnement. Ce sont encore les femmes : les empoisonneuses, les infanticides (le sujet dans sa globalité fait l’œuvre d’un ouvrage collectif, auquel a participé Fanny Bugnon, intitulé Présumées coupables – les grands procès faits aux femmes, ndlr). On va oublier les sorcières et elles vont revenir à la postérité. », souligne l’historienne.
Dès la fin du 19e, elles réapparaissent. Dans l’essai La Sorcière, écrit par Jules Michelet en 1862 mais aussi le film musical Le magicien d’Oz, la série Ma sorcière bien aimée, le livre jeunesse La sorcière de la rue Mouffetard ou encore un peu plus tard, le film d’animation Kirikou et la sorcière. Entre autre.
« Dans Merlin l’enchanteur, sorti en 1963, Madame Mim est laide, vieille, elle fait peur. Elle est l’archétype de la vieille sorcière aux pouvoirs maléfiques. Mais les sorcières reviennent aussi dans le monde féministe avec, dans les années 70, la revue Sorcières par exemple. Elles sont des figures d’empowerment car elles sont des femmes qui échappent aux hommes. Les sorcières sont la métaphore de la condition des femmes. Elles sont des femmes qui peuvent, j’ai envie de le croire, réenchanter le monde. », conclut Fanny Bugnon.
QUI SONT LES SORCIÈRES ?
Plusieurs centaines d’années après la chasse aux sorcières, elles sont nombreuses les militantes à se revendiquer héritières des sorcières d’hier. Et si on attribue souvent ce retour sur le devant de la scène à Mona Chollet grâce à son brillant essai Sorcières – la puissance invaincue des femmes, on néglige et on méconnait alors tous les mouvements qui existent depuis longtemps, aux quatre coins du monde.
L’autrice Laura Nsafou, dans sa conférence « Soucougnan, sukunabe, deum– Transversalité de la figure de la « sorcière » dans la diaspora africaine », attire l’attention du public, dans un premier temps, sur la barrière de la langue. Car « sorcière » est terme européen. « Si on traduit ce mot français, on n’obtiendra pas la même signification aux Antilles ou en Afrique, ni même d’un pays à l’autre. », précise-t-elle.
Il est important de décoloniser le vocabulaire, fondé sur une méconnaissance absolue des religions et des croyances des pays colonisés.
« Le surnaturel est très présent dans la diaspora africaine. Mais il y a eu une diabolisation qui a commencé lors des périodes de la colonisation. Le vaudou, par exemple, on le retrouve énormément dans la fiction occidentale. On parle de magie noire. De magie qui tue. Le vaudou est une vraie religion qui signifie « mettre en paix ». »
explique Laura Nsafou.
Elle exprime sa fatigue face à ce processus de diabolisation permanente : « L’imaginaire blanc qui catégorise ces religions a des conséquences sur la manière dont les personnes concernées le vivent. »
Encore aujourd’hui marginalisées et stigmatisées, les conséquences sont immenses et souvent passés sous silence dans les médias. Elle mentionne par exemple les camps de sorcières dans lesquels vivent les femmes accusées, par leurs entourages, de sorcellerie. Les camps sont insalubres et des maltraitances y sont subies.
« Mais sur ce sujet, je n’ai pas trouvé beaucoup de sources pour le moment. Que des articles en anglais. », souligne-t-elle.
Autre exemple : les persécutions se poursuivent pour les adeptes du candomblé, une des religions afro-brésiliennes, qui voient leurs lieux de culte réduits à néant. Et d’un autre côté, sans vergogne, les Occidentaux-tales se réapproprient les rituels des peuples minorisés, sans se soucier de la pertinence et de ce que cela représente pour eux/elles.
L’autrice insiste, il est nécessaire de se situer et de se questionner : « C’est comme pour l’exotisation des corps des femmes noires. En littérature, la présence des corps noirs a commencé par la littérature de voyage à destination des hommes blancs. Pour les divertir et non pas pour les informer. Il fallait le rendre attrayant pour le regard blanc occidental. Quand la représentation est produite par des non concerné-e-s, elle devient une caricature, un divertissement aux dépens des concerné-e-s. Le discours devient alors marginalisant. »
TOUTES DES SORCIÈRES ?
Qui sont les sorcières et que signifie le fait de se revendiquer descendantes de sorcières ou sorcières tout court ? La table ronde réunissant Camille Ducellier, artiste multimédia, Taous Merakchi (alias Jack Parler), autrice et rédactrice, et Maureen Wingrove (alias Diglee), illustratrice et autrice, a permis de poursuivre le propos de Laura Nsafou, dans le fait de se situer.
Ainsi, les trois femmes ne se définissent pas toutes sorcières et composent ensemble, pendant cette rencontre, autour de leurs différents points de vue, qui parfois se complètent, parfois s’opposent et parfois se rejoignent.
Diglee, elle, n’est pas une sorcière. Elle nuance : elle est passionnée et curieuse de l’archétype de la sorcière. Elle ne pratique pas, ou très rarement, elle préfère écouter les récits de pratique. Taous Merakchi parle quant à elle de spiritualité alternative car elle ne sait pas encore précisément où se situe le politique et où se situe le spirituel dans sa pratique. Et Camille Ducellier explique qu’il lui arrive, parmi son « millefeuille identitaire », de se définir comme sorcière.
« Ça m’a réconciliée et aidée d’avoir un terme. Passionnée par les cultures ésotériques et baignée dans une culture féministe, ça m’a donné un trait d’union entre tout ça. Se dire lesbienne, queer, sorcière… C’est la puissance du verbe. Se dire quelque chose, c’est déjà un acte ! Je me sens sorcière queer, ça a une dimension politique. Ma vie de gouine et ma vie de queer font que j’ai des pratiques marginales qui se rajoutent encore… »
signale-t-elle.
A chacune, la sorcellerie apporte, de manière différente. Diglee, passionnée au départ par la connaissance des minéraux, veut comprendre ce qu’est la magie. « Mais dans le milieu ésotérique, le sexisme est roi, comme partout ailleurs. Il y a peu de femmes, peu de personnes racisées. Pour m’informer, je vais dans un tas de conférences sur le sujet, elles sont souvent animées par des hommes qui catégorisent la haute magie comme étant celle héritée de l’église donc pour les hommes et la sorcellerie, héritée des femmes donc intuitive et instinctive. Je veux comprendre ce qu’est la magie. Mais quand on est une femme, c’est difficile. Alors que je ne suis pas non plus du genre « féminin sacré ». Attention, c’est bien de revaloriser les qualités du féminin. Mais il faut qu’on puisse aussi conquérir les qualités du masculin ! Je veux me sentir humain avant d’être femme, ce qui est totalement illusoire. », déclame-t-elle.

Pour Taous Merakchi, la sorcellerie intervient sur un plan personnel et intime : « Revenir à moi-même, qui je suis, comment avancer avec les outils que j’ai déjà. Moi, je ne suis pas à plaindre du tout. C’est pour ça que ça ne m’appartient pas la définition de sorcière. Je ne suis pas prioritaire, il y a bien plus marginalisée que moi. »
Là où elles tombent toutes d’accord, c’est sur la source d’empuissancement que cela crée, peu importe si la personne se définit ou non sorcière. L’accès à l’information amène sur le chemin de la déconstruction. Que ce soit avec le livre de Mona Chollet, celui de Camille Ducellier intitulé Guide pratique du féminisme divinatoire, celui de Jack Parker et Diglee intitulé Grimoire de la sorcière moderneou encore à travers les réseaux sociaux.
« Ma déconstruction a commencé sur internet. Pour comprendre où était le problème et construire ma vision de la féminité. De ma féminité. Le féminin n’est pas sacré par essence. » précise Taous Merakchi, rejointe par Maureen Wingrove :
« Le collectif est porteur. Ça a été avéré qu’un groupe dégage une énergie. Quand il y a du nombre et de l’émotion, ça circule et ça fait du bien que ce soit psychologique, magique ou autre. On sent que quelque chose agit, quelque chose se passe. »
Camille Ducellier, elle, croit également que cette énergie, source d’empuissancement car source de transformation, ne doit pas rester au niveau individuel. Politiser le mouvement mais aussi le sortir des normes que l’on ne connaît que trop bien.
« Les américaines par exemple sont plus tournées vers l’action. En France, on est très accroché-e-s à la parole, l’analyse, la critique, etc. C’est très bien mais ce n’est pas la seule manière de comprendre le monde. La psychanalyse, l’ésotérisme et le féminisme sont trois systèmes symboliques que j’aime et que j’essaye de faire dialoguer. », souligne-t-elle.
À CHACUNE SES RITUELS
La table ronde, au large succès, n’apporte pas de réponse concernant la définition précise de ce qu’est une sorcière aujourd’hui. Elle nous incite plutôt à nous questionner sur nos propres attentes et pratiques, nous déculpabilisant grâce à une phrase de Camille Ducellier :
« Je pars du principe que si on se sent intimement en lien avec cet héritage, on peut se définir sorcière si on a envie. C’est un va et vient entre le passé, le présent et le futur. Les événements ont été effacés par le patriarcat, confisqués par le colonialisme. Aujourd’hui encore, il y a des femmes stigmatisées, des femmes considérées comme des « mauvaises femmes ». On peut se sentir connectées à cet héritage. »
Cet héritage, Liz Viloria le met en partage et en résonnance lors d’une performance qui se déroule à la nuit tombée sur le parvis des Ateliers du Vent. L’instant est solennel, une bougie est allumée, quatre personnes attisent la curiosité des festivalier-e-s qui, petit à petit, forment un cercle autour d’elles. On pense évidemment à l’exécution d’un rite magique.
Liz Viloria travaille sur une thèse, à l’université Rennes 2, en littérature comparée portant sur le statut des femmes dans les Caraïbes. « L’idée de la performance est née de mon parcours académique car je me suis rendu compte que mis à part le fait que le travail intellectuel est très solitaire, sa portée est limitée à un public restreint et plutôt spécialisé », explique-t-elle.
Sa performance, Calíbana,vient de son envie de partager les outils acquis auprès de tou-te-s les autrices et auteurs « écrivant au service de la déconstruction de la notion patriarcale du statut Femme. » Initialement réalisée en Colombie sur la thématique de la sexualité féminine, elle a eu lieu la première fois devant la cathédrale de Barranquilla :
« Sans que ceci ne soit voulu, aux yeux des spectateurs, la représentation parut comme un rite sorcier. Malgré les préjugés, les personnes (dont la police) sont venues regarder intriguées, curieuses et bienveillantes. »
Dans Calíbana, le sujet change selon l’occasion. Pour le festival Dangereuses lectrices, une nouvelle équipe s’est constituée et la thématique s’est portée sur la figure de la sorcière. Pendant un mois, ielles se sont retrouvées pour faire des cercles, travailler sur les rapports au corps mais aussi à leur lignée féminine, ainsi que les rapports aux arcanes majeurs du Tarot « qui dans la performance viennent représenter les différents archétypes présents dans l’inconscient collectif. »
Liz Viloria poursuit :
« Parmi ces archétypes, la sorcière est la femme savante, celle qui sait, qui lit, qui détient différents savoirs, la sorcière se perçoit elle même comme un organisme qui fait parti de la nature, qui connaît ses rythmes et qui écoute et connaît son corps. Cette connaissance ne vient pas du monde extérieur. »
Pour se préparer, elle a donc puisé dans son univers personnel, qu’elle a ensuite mis en partage et en résonnance avec les expériences des trois autres membres de l’équipe.
« Je viens d’une culture dont le rapport à ces rythmes est toujours présent : du citron avec de l’eau chaude le matin pour alcaliniser le corps, couper les légumes avec les mains et non avec des couteaux afin de garder leur texture pour la cuisson, nettoyer la maison avec de la sauge une fois par mois… Ce sont des petits rituels qui, au delà de leurs effets sur le monde extérieur, organisent la vie intérieure de la personne qui pratique : les rituels aident au bien vivre. Pendant le mois de préparation, on a partagé des rituels, certains nouveaux, d’autres déjà appris au cours de nos vies… On se déconstruit et se resignifie en prenant conscience de l’immersion du corps propre dans le monde quotidien. Dans cette édition, Laura Zylberyng (française), Jason-Jasmine Fortheringham (australien-ne), Touré Mayalan (guinéenne) et moi-même, portant le poids de la culture de quatre continents différents, avons décelé des points en commun dans l’assomption du corps propre et dans la construction de ce que Femme peut signifier. », analyse Liz Viloria.
SORTIR DE LA NORME HÉTÉRO-CIS-BLANCHE
Ainsi, le festival Dangereuses lectrices met en avant et en perspective des expériences sensibles, des récits de vie, des théories féministes, des héritages, des vécus et ressentis, qui s’expriment à travers chacun-e de manière et sous des formes différentes. Il y a les conférences et tables rondes, des ateliers, mais aussi du théâtre, une performance, la projection d’un film, une lecture, un concert…
Les arts sont porteurs de paroles et de points de vue. Et ici, ils prennent évidemment un sens militant et politique, même si on peut s’en détacher pour n’y voir que de l’informatif et du divertissement (intelligent).
Le mélange des genres et des styles est exaltant durant ce week-end aux Ateliers du Vent. Il suffit de tendre l’oreille pour entendre des propositions enthousiasmantes comme la lecture de Lizzie Crowdagger, spécialiste des histoires fantastiques et de fantasy avec des vampires motardes, des sorcières lesbiennes et des punks garous.
Elle lit des extraits de trois de ses ouvrages parmi lesquels figurent Enfant de Mars et de Vénus, une enquête fantastique avec une lesbienne motarde, une camionneuse trans, du surnaturel et des morts, Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires),un roman de fantasy avec des lesbiennes vampires à moto, et La sorcellerie est un sport de combat, dans lequel le balai est une Clio un peu particulière.
L’autrice prouve que d’autres personnages et récits sont possibles et que les sorcières sont tout aussi plurielles et multiples que les autres. Elle s’affranchit des assignations et casse les normes d’un genre littéraire codifié au masculin, et pré supposé hétérosexuel. Tout comme le cabinet d’intimité nous invite à observer des sexes, photographiés en noir et blanc, en oubliant totalement l’étiquette binaire assignée par l’organe, Homme ou Femme.
ÉCRITURE POIGNANTE
 Petit à petit, l’enchainement des expressions permet de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes d’oppression et au fil du temps, et des investissements, de nous déconstruire nous-mêmes. Dangereuses lectrices participe grandement à cette exploration et analyse, aussi personnelle que collective.
Petit à petit, l’enchainement des expressions permet de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes d’oppression et au fil du temps, et des investissements, de nous déconstruire nous-mêmes. Dangereuses lectrices participe grandement à cette exploration et analyse, aussi personnelle que collective.
Mais incontestablement, pour nous, c’est le concert de Petra Pied de Biche qui marque nos esprits. Sans détours, l’artiste clame sa Rage de raison, du nom de son dernier album. Un vrai coup de poing dans la gueule.
Son écriture brute, la violence de ses récits et vécus, son regard très franc souvent accompagné d’un large sourire, le rythme percutant de ses musiques nous hypnotisent complètement. Quand Petra Pied de Biche s’exprime, on la boucle et on l’écoute.
Témoignage du racisme latent vécu au quotidien, témoignage des jugements incessants quant à ses choix de vie, témoignage du sexisme ambiant mais aussi culture du viol, exploitation des travailleur-euse-s, minimisation des faits et des ressentis, l’artiste dénonce avec talent et engagement et secoue les mentalités. Parce qu’il y a urgence à écouter et à prendre en compte les discours des personnes concerné-e-s.
Par le biais de la littérature sous ses formes diverses, le festival Dangereuses lectrices a convoqué l’âme des révolté-e-s. Révolté-e-s parce que marginalisé-e-s en raison de leur sexe, de leur apparence, de leur orientation sexuelle, de leur couleur de peau, de leur identité de genre, de leurs choix de vie, etc.
Sorcières ou pas, une chose est sure : les femmes qui lisent sont dangereuses. Tout comme les femmes qui écrivent sont dangereuses. Alors, patriarcat, gare à ton cul. Les Dangereuses lectrices entendent bien être libres.


 En Matriarcate, on sait soigner l’endométriose, les femmes ne souffrent plus de douleurs menstruelles, les hommes développent des tas de complexes et un des plus gros tabous est l’érection hors mariage. « Mais vous avez quand même des privilèges les copains, on vous ouvre la porte quand vous passez ! », scande Typhaine D. cynique à souhait.
En Matriarcate, on sait soigner l’endométriose, les femmes ne souffrent plus de douleurs menstruelles, les hommes développent des tas de complexes et un des plus gros tabous est l’érection hors mariage. « Mais vous avez quand même des privilèges les copains, on vous ouvre la porte quand vous passez ! », scande Typhaine D. cynique à souhait. Tout ce qu’elle relate est affreux, dans les faits. Mais qu’est-ce qu’elle les met bien en perspective ! On est ébahi-e-s par sa prestation et par l’énergie que ça dégage et procure dans la salle. Elle contrecarre les discours haineux visant à réduire les féministes à des hystériques rabat-joie et pointent toutes les dissonances de nos sociétés actuelles en matière d’égalité femmes-hommes.
Tout ce qu’elle relate est affreux, dans les faits. Mais qu’est-ce qu’elle les met bien en perspective ! On est ébahi-e-s par sa prestation et par l’énergie que ça dégage et procure dans la salle. Elle contrecarre les discours haineux visant à réduire les féministes à des hystériques rabat-joie et pointent toutes les dissonances de nos sociétés actuelles en matière d’égalité femmes-hommes. 

 Mais avant cela, ce qui motive sa démarche, c’est sa participation au spectacle de danse contemporaine de Mickaël Phelippeau, Footballeuse,et son expérience personnelle avec le ballon rond, au sein du collectif Les dégommeuses, qu’elle ne nomme pas dans la conférence mais dans une interview à Libération :
Mais avant cela, ce qui motive sa démarche, c’est sa participation au spectacle de danse contemporaine de Mickaël Phelippeau, Footballeuse,et son expérience personnelle avec le ballon rond, au sein du collectif Les dégommeuses, qu’elle ne nomme pas dans la conférence mais dans une interview à Libération : 

 « C’était difficile pour eux de comprendre. Une révolutionnaire qui se fait guillotiner ! Difficile aussi d’entrer dans ce monde de la révolution et surtout d’accéder au style des écrits d’Olympe de Gouges. Mais ils se sont également rendus compte qu’elle traitait de sujets auxquels ils pouvaient être sensibles et qui restaient pour certains d’actualité. La pièce joue d’ailleurs sur l’ambivalence des jeunes à l’Histoire : un truc vieux, plein de poussière qui ne donne pas envie… mais quand on s’y plonge, elle peut résonner dans nos vies de tous les jours. », explique Claire Visier, qui a mis en scène le spectacle composé initialement par Isabelle Aboulker – qui a écrit le livret pour un collège de Montauban, d’où est originaire Olympe de Gouges – et repris par la cheffe de chœur et pianiste Estelle Vernay.
« C’était difficile pour eux de comprendre. Une révolutionnaire qui se fait guillotiner ! Difficile aussi d’entrer dans ce monde de la révolution et surtout d’accéder au style des écrits d’Olympe de Gouges. Mais ils se sont également rendus compte qu’elle traitait de sujets auxquels ils pouvaient être sensibles et qui restaient pour certains d’actualité. La pièce joue d’ailleurs sur l’ambivalence des jeunes à l’Histoire : un truc vieux, plein de poussière qui ne donne pas envie… mais quand on s’y plonge, elle peut résonner dans nos vies de tous les jours. », explique Claire Visier, qui a mis en scène le spectacle composé initialement par Isabelle Aboulker – qui a écrit le livret pour un collège de Montauban, d’où est originaire Olympe de Gouges – et repris par la cheffe de chœur et pianiste Estelle Vernay.


 Petit à petit, l’enchainement des expressions permet de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes d’oppression et au fil du temps, et des investissements, de nous déconstruire nous-mêmes. Dangereuses lectrices participe grandement à cette exploration et analyse, aussi personnelle que collective.
Petit à petit, l’enchainement des expressions permet de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes d’oppression et au fil du temps, et des investissements, de nous déconstruire nous-mêmes. Dangereuses lectrices participe grandement à cette exploration et analyse, aussi personnelle que collective. 

 Malgré le postulat de départ qui nous laisse imaginer un humour parodique, la réalisatrice – qui affirme être réellement fan de Céline Dion - accentue la portée dramatique de son propos. Plus épuré au niveau des personnages que dans Tout ce qui brille et Nous York, basés sur des bandes d’ami-e-s, le film se concentre sur un nombre plus restreint de personnalités que Géraldine Nakache peut davantage amplifier et complexifier, rendant centraux les silences et les non-dits.
Malgré le postulat de départ qui nous laisse imaginer un humour parodique, la réalisatrice – qui affirme être réellement fan de Céline Dion - accentue la portée dramatique de son propos. Plus épuré au niveau des personnages que dans Tout ce qui brille et Nous York, basés sur des bandes d’ami-e-s, le film se concentre sur un nombre plus restreint de personnalités que Géraldine Nakache peut davantage amplifier et complexifier, rendant centraux les silences et les non-dits.  Drôles et percutants, les dialogues apportent de la fraicheur et du rythme à cette histoire de famille qui pourrait être celle de milliers de gens. Géraldine Nakache nous surprend de par les subtilités du langage non verbal, qui dévoilent l’étendue de son talent d’actrice - même s’il n’est plus à démontrer, à l’instar d’une Leïla Bekhti à l’interprétation intense et toujours plus captivante de film en film.
Drôles et percutants, les dialogues apportent de la fraicheur et du rythme à cette histoire de famille qui pourrait être celle de milliers de gens. Géraldine Nakache nous surprend de par les subtilités du langage non verbal, qui dévoilent l’étendue de son talent d’actrice - même s’il n’est plus à démontrer, à l’instar d’une Leïla Bekhti à l’interprétation intense et toujours plus captivante de film en film.
 Ah non non non c’est vrai. A la SCAM, il y a un exemple sur les chiffres. Ils datent de 2014 – 2015 mais doivent probablement être assez actuels, même si ça pousse à la SCAM, avec un CA qui est en train de se féminiser. Mais, à la SCAM, il y a 35% de femmes sur presque 30 000 adhérents.
Ah non non non c’est vrai. A la SCAM, il y a un exemple sur les chiffres. Ils datent de 2014 – 2015 mais doivent probablement être assez actuels, même si ça pousse à la SCAM, avec un CA qui est en train de se féminiser. Mais, à la SCAM, il y a 35% de femmes sur presque 30 000 adhérents.

 Il y en a pour qui la sexualité est source d’épanouissement personnel mais aussi pour qui la thématique est complexe « parce que c’est une invitation à être soi et ce n’est pas si simple parce qu’on peut en avoir envie et peur à la fois. » Ou alors parce que leur orientation sexuelle n’est pas bien vue et leur homosexualité, elles n’en ont pas parlé à leurs familles. Ou encore parce que l’injonction à la virilité obstrue les rapports :
Il y en a pour qui la sexualité est source d’épanouissement personnel mais aussi pour qui la thématique est complexe « parce que c’est une invitation à être soi et ce n’est pas si simple parce qu’on peut en avoir envie et peur à la fois. » Ou alors parce que leur orientation sexuelle n’est pas bien vue et leur homosexualité, elles n’en ont pas parlé à leurs familles. Ou encore parce que l’injonction à la virilité obstrue les rapports : 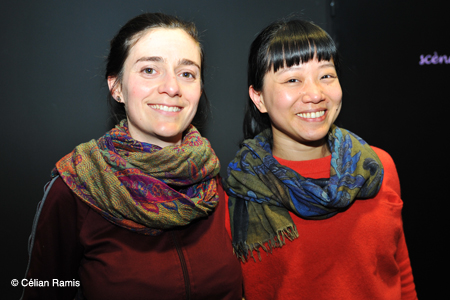 C’est douloureux et pourtant, on recommande L’origine du monde à quiconque souhaite satisfaire sa curiosité envers la condition féminine et l’égalité mais aussi en matière d’art social sublimé par la créativité et l’originalité de la compagnie Fiat Lux.
C’est douloureux et pourtant, on recommande L’origine du monde à quiconque souhaite satisfaire sa curiosité envers la condition féminine et l’égalité mais aussi en matière d’art social sublimé par la créativité et l’originalité de la compagnie Fiat Lux. 



 Elle dévoile cet épisode au cours duquel elle a menacé ses parents avec un couteau, épisode qui lui a valu un séjour à l’hôpital, au service pédopsychiatrie. L’enfermement provoque en elle une danse qui ne la quitte jamais et quand elle danse, elle sourit. Sa porte de sortie : le jour où sa mère a parlé. Où elle a dit toute la vérité aux médecins sur son mari qui bat sa fille depuis des années.
Elle dévoile cet épisode au cours duquel elle a menacé ses parents avec un couteau, épisode qui lui a valu un séjour à l’hôpital, au service pédopsychiatrie. L’enfermement provoque en elle une danse qui ne la quitte jamais et quand elle danse, elle sourit. Sa porte de sortie : le jour où sa mère a parlé. Où elle a dit toute la vérité aux médecins sur son mari qui bat sa fille depuis des années. Une révolte dans laquelle elles puisent afin de transformer la souffrance des épreuves et des injonctions en flammes de l’espoir et de l’accomplissement. Sans s’affranchir de tous les codes et s’émanciper de toutes les normes, elles questionnent, remettent en cause, dénoncent, échangent et partagent.
Une révolte dans laquelle elles puisent afin de transformer la souffrance des épreuves et des injonctions en flammes de l’espoir et de l’accomplissement. Sans s’affranchir de tous les codes et s’émanciper de toutes les normes, elles questionnent, remettent en cause, dénoncent, échangent et partagent.